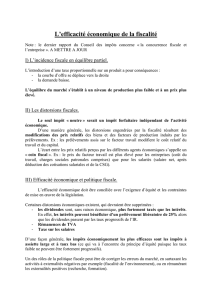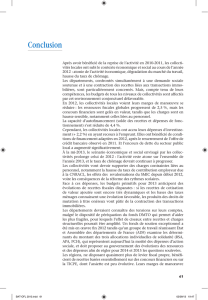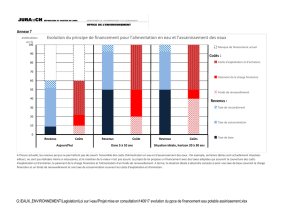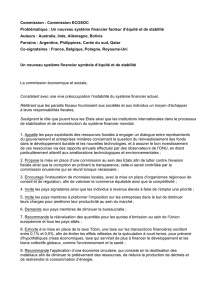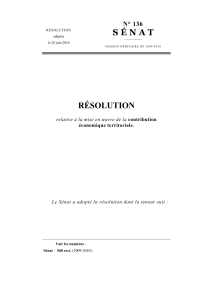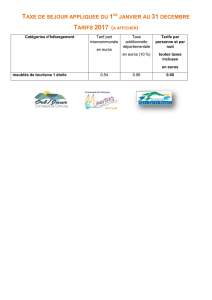Le système financier local et ses modèles : quelle production de

Le système financier local et ses modèles :
quelle production de connaissances
au cours des 30 années
passées ?
Constitution d’un état des lieux
avril 2015
volume 1
Camille Allé
Françoise Navarre
PUCA - BON DE COMMANDE N° 1402812537
Lab'Urba - Université Paris Est Créteil (UPEC) - Cité Descartes - bâtiment Bienvenüe - plot A
14-20, bld Newton - Champs sur Marne - 77454 Marne la Vallée cedex 2

SOMMAIRE
1
1 1
1 –
––
–
Introduction
IntroductionIntroduction
Introduction .........................................................................................................................................................3
3
3 3
3 –
––
–
Le partage des rôles et des ressource
Le partage des rôles et des ressourceLe partage des rôles et des ressource
Le partage des rôles et des ressources
ss
s .................................................................................................................8
3-1 - La fiscalité locale : généralité ; taxes spécifiques ..........................................................................................8
3-2– Les dotations et l’autonomie financière/fiscale ......................................................................................... 31
3-3– La péréquation ........................................................................................................................................... 36
4
4 4
4 -
--
-
Les dépenses
Les dépensesLes dépenses
Les dépenses ..................................................................................................................................................... 47
4–1– Les dépenses, au centre de l’action publique locale ................................................................................. 47
4–2– Les cadres théoriques ............................................................................................................................... 48
4–3– Les dépenses locales d’investissement dans les objectifs de régulation ................................................... 53
4–4– A la recherche des déterminants de la dépense publique locale .............................................................. 55
4–5– Les dépenses par fonction ........................................................................................................................ 58
5
5 5
5 –
––
–
Les (autres) modes de financement
Les (autres) modes de financementLes (autres) modes de financement
Les (autres) modes de financement .................................................................................................................. 63
5-1- Les recettes tarifaires ................................................................................................................................. 63
5–2- Les cofinancements entre collectivités / collectivités-Etat ........................................................................ 65
5-3- Les emprunts .............................................................................................................................................. 67
6
6 6
6 -
--
-
Les outils de gestion et de contrôle
Les outils de gestion et de contrôleLes outils de gestion et de contrôle
Les outils de gestion et de contrôle ................................................................................................................... 84
6-1– Le plan et la nomenclature comptable, des référentiels organisateurs..................................................... 86
6-2– Des contrôles, Les Cours et Chambres Régionales des Comptes ............................................................... 92
6-3– Les compétences, l’ingénierie .................................................................................................................. 100
6-4– Le contrôle de gestion en tant que dispositif analyseur .......................................................................... 102
6-5 – Les analyses financières .......................................................................................................................... 109
6-6– Des coûts, entre conceptions et évaluations ........................................................................................... 118
6-7 – La communication financière, au nom de la transparence ..................................................................... 125
6-8 - La performance locale (fait débat ?) ........................................................................................................ 129
7
7 7
7 –
––
–
Des mises en transversalité
Des mises en transversalitéDes mises en transversalité
Des mises en transversalité ............................................................................................................................. 135
7-1- La ville, ses coûts et leur financement ...................................................................................................... 135
7-2 - L’intercommunalité, objet au cœur des tensions fiscales et financières ................................................. 139
8
8 8
8 –
––
–
Des zones d’ombre
Des zones d’ombreDes zones d’ombre
Des zones d’ombre ......................................................................................................................................... 148

3
Le système financier local et ses modèles :
quelle production de connaissances au cours des 30 années passées ?
constitution d’un état des lieux
1
11
1
–
––
–
I
II
I
NTRODUCTION
NTRODUCTIONNTRODUCTION
NTRODUCTION
Un contexte
Depuis une trentaine d’années, le système financier local a donné lieu à différentes vagues d’observations et
d’analyses. Dès 1988, le GRALE (Groupement de recherches sur l’action locale en Europe) publiait un annuaire,
fourni, des centres de recherches s’intéressant, entre autres, aux questions de finances publiques locales
1
A. Guengant (2002) dresse le panorama des nombreux travaux effectués sur le thème au CREFAUR (Centre de
recherche en économie et finances appliquées de l'université de Rennes) depuis 1975, en soulignant l’évolution
tant des thématiques abordées que la façon de les aborder. Les économistes ont été fortement présents sur le
champ au point que l’on a pu, comme en témoigne Y. Fréville dès 1966, faire état de la véritable émergence
puis de la consolidation d’une économie des finances locales. Parallèlement, les transformations
institutionnelles (la décentralisation, « l’intercommunalisation », etc.) ont suscité de nombreux travaux,
engagés au prisme des sciences politiques (par exemple : Le Lidec, 2011). Les finances publiques locales
constituent bien des objets à gouverner comme des objets présidant aux formes de gouvernement, ou de
gouvernance.
Les sujets/thèmes abordés par le monde académique ont évolué avec les dynamiques sociétales Les rythmes
d’urbanisation des années 70 à 90 et plus globalement, les conditions de la production urbaine et de
l’aménagement, impliquant des actions publiques soutenues et une mobilisation intense des moyens des
collectivités, ont donné lieu à nombre d’études. Les tensions actuelles pesant sur les sources de financement
(qu’il s’agisse de la fiscalité, des transferts étatiques ou bien encore des emprunts), s’imposant tant à l’Etat
qu’aux collectivités territoriales, génèrent de nouvelles interrogations quant à la conduite de l’action publique,
1
Annuaire des collectivités locales, 1988, Adresses des principaux centres de recherche sur l'administration locale en Europe et en
Amérique du Nord, Grale, Tome 8, pp. 377-386.

4
pour la préservation des équilibres (financiers, politiques, sociaux et territoriaux), etc. Autant de changements
générant des besoins en termes de production de connaissances ; autant de questions problématiques à même
de susciter l’intérêt des chercheurs et même, le suscitant.
Parallèlement aux transformations des modes de gouvernement (suite aux mouvements successifs de
décentralisation), à celles des modes de planification et des visions les sous-tendant (Béhar, 2013
2
), et en lien
avec les dynamiques de développement territorial, les processus de différenciation, les différences fiscales et
financières entre territoires sont devenues des objets de préoccupations. La régulation des écarts, lorsqu’ils
sont tenus comme inéquitables, via des dispositifs nationaux et/ou locaux de solidarité, est placée, de façon
récurrente, à l’agenda politique. Les chercheurs ne manquent pas d’interroger le sens des mécanismes de
compensation mis en œuvre, ainsi que leur portée.
Dans un autre registre, les rapports parlementaires et/ou institutionnels ont été abondants. Les modes
d’imposition locale, fréquemment taxés de désuets (par exemple : Cour des comptes, 2008), appellent réforme
tout autant que les modes d’organisation territoriale. A cette fin, il faut des travaux préalables. Les rapports
d’évaluation de la gestion financière locale, dressés par la Cour des comptes, ne manquent pas non plus.
Certains, spécifiques, apportent même des éclairages sur des questions vives et appelant des mesures de
sauvegarde. Ce fut par exemple le cas pour les emprunts dits « toxiques », dont l’explosion mettait à mal les
équilibres, voire le devenir financier, de maintes collectivités (Cour des comptes, 2011).
La plupart des travaux et des rapports situent, à leur manière, les faits dans des perspectives diachroniques,
tout en ayant une profondeur variable.
Dans ce contexte, des éléments de connaissance quant au système financier local et à ses évolutions, effectives
ou souhaitées, existent. Un premier passage en revue laisse rapidement apparaître qu’ils sont fragmentés
entre des productions au statut distinct et surtout, entre des approches disciplinaires spécifiques et/ou des
visées thématiques particulières.
Les évolutions du système financier local, dans sa continuité comme dans ses ruptures, n’apparaissent pas
réellement. Une simple compilation des travaux existants ne suffit pas pour percevoir le « fil rouge » ou le sens
de la trajectoire et surtout, d’en percevoir les fondements. Elle ne renseigne pas non plus quant aux
changements éventuels de modèles qui ont pu se produire. S’agit-il de transformations effectives ou bien au
contraire, de simples adaptations conjoncturelles ? Une lecture rapide ne laisse pas non plus transparaître si les
préoccupations des chercheurs se renouvellent, en lien (ou non) avec les évolutions du contexte ou avec les
débats agitant les scènes politiques. Aussi, faire apparaître quelles sont finalement les traits marquants du
système financier local ainsi que les dimensions structurantes des travaux, qui permettent de les
éclairer, suppose alors un regard d’ensemble, dans une distance propice à s’abstraire des particularités de
chacun des travaux, à saisir ce qui fait plus globalement trait d’union ou point de rupture dans les
problématiques.
2
Pour exemple : Béhar D., 2013, « Les inégalités territoriales sont‑elles solubles dans le zonage ? », Vers l'égalité des territoires.
Dynamiques, mesures, politiques, éd.La Documentation Française, pp.406-420

5
Des objectifs
Dans cette optique, la constitution d’un état des lieux des productions de connaissance dans le domaine des
finances publiques locales au cours des 30 dernières années peut être conduite, avec un double objectif :
- Celui de percevoir les enseignements essentiels livrés par les études et recherches déjà conduites. Que
disent-ils concernant le système financier local, dans son intrication avec les contextes territoriaux,
avec les choix des élus, au regard encore des relations qui se nouent entre Etat et collectivités ?
- Celui de mettre en lumière quels sont les objets principalement mis à l’étude et selon quels modes
d’approche. Est-il des thématiques régulièrement abordées ? Est-ce le fait de courants spécifiques ou
d’écoles de pensée ? A contrario, quels sont les points laissés dans l’ombre, ceci freinant une vision
compréhensive ? Observe-t-on, au cours de la période prise en compte, des mutations significatives
tant dans « ce qui est produit » que parmi « ceux qui produisent » ?
L’entreprise semble centrale, au stade actuel. Dans les années récentes, les productions scientifiques
consacrées aux finances locales, les consultations de recherche sur le thème et les financements disponibles
pour effectuer les travaux, les colloques et manifestations dédiés… ont été rares ou se sont raréfiés.
Parallèlement, les interrogations quant aux moyens disponibles pour les collectivités locales et leurs usages
sont particulièrement vives au sein du débat public. Le grand écart interpelle ; tout semble se passer comme si
le lien entre recherche et action était distendu. Et ce précisément à un moment de contraintes et de tensions,
où la production de connaissances pourrait trouver une réelle utilité.
L’état des lieux projeté doit alors servir à confirmer ou non le constat formulé d’éloignement. Est-il plus
apparent que réel ? S’il est avéré, quelles hypothèses peut-on formuler quant à sa génération ? Provient-elle de
la défection de certains champs disciplinaires, au profit d’autres thématiques, ou bien d’un tarissement de la
demande d’expertise, conjugué à un fléchissement de son portage ?
Ceci étant, le survey en question, au-delà de sa portée informative et analytique, contribuera à jeter les bases
d’une « fonction de mémoire ». Dans la période récente, les transformations des dispositions normatives et des
modes de régulation ont été incessantes. Les nouveaux dispositifs empruntent à ceux qui les ont précédés, en
ménageant des mécanismes transitoires qui, fréquemment, perdurent. L’empilement gagne en complexité ; sa
lecture ne devient accessible que si elle s’inscrit dans des réflexions portant sur la durée et posant des repères.
Interpellés par l’atonie actuelle des travaux dans le domaine, des représentants de l’AdCF et du Lab’Urba sont
en train de susciter la constitution, puis l’animation, d’un réseau de chercheurs, d’experts, d’acteurs, intéressés
par la thématique des finances publiques locales
3
. Pour être pertinent, le lancement de nouvelles pistes de
travail, tel que le vise ce réseau, doit impérativement s’appuyer sur une connaissance structurée des voies de
recherches qui ont déjà été empruntées et de leurs issues. L’état des lieux visé constitue un des éléments de
base du dispositif.
3
Un Colloque « Le système financier local, entre ancien et nouveau modèle », s’est déroulé (à Paris) le 20 novembre 2014, constituant
le moment inaugural du réseau envisagé.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
1
/
164
100%