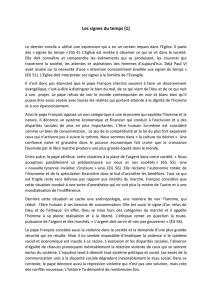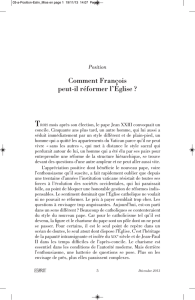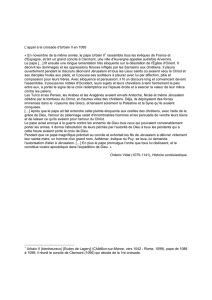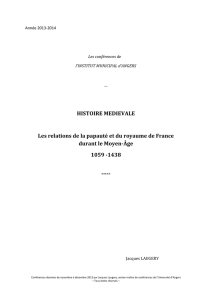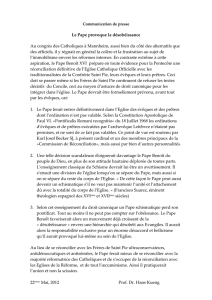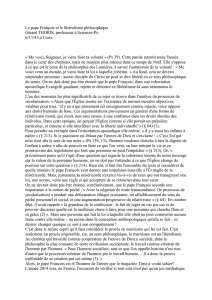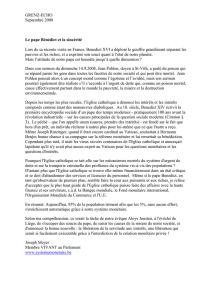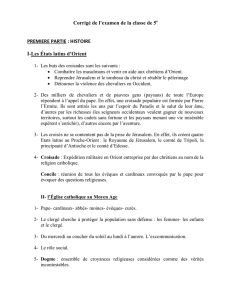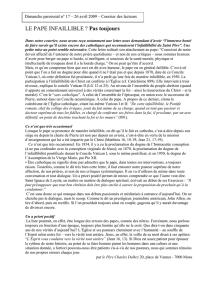HISTOIRE MEDIEVALE Les relations de la papauté et du royaume

Conférences données de novembre à décembre 2013 par Jacques Laugery, ancien maître de conférences de l’Université d’Angers
– Tous droits réservés –
Année 2013-2014
Les conférences de
l’INSTITUT MUNICIPAL d’ANGERS
__
HISTOIRE MEDIEVALE
Les relations de la papauté et du royaume de France
durant le Moyen-Âge
1059 -1438
*****
Jacques LAUGERY

Conférences données de novembre à décembre 2013 par Jacques Laugery, ancien maître de conférences de l’Université d’Angers
– Tous droits réservés –
Conférence n° 1
De la réforme grégorienne au concile de Latran IV (1059-1215)
Vers la théocratie pontificale
Au milieu du XIème siècle POPULUS SUBJECTUS et POPULUS CHRISTIANUS se
confondent totalement. Ils sont devenus « coextensifs ». L’occident chrétien est
désormais une réalité forte et homogène sous l’autorité d’un pouvoir impérial
restauré.
Mais assez paradoxalement le clergé est en crise, menacé de dissolution dans une
société féodale éclatée, avide et violente. Princes, châtelains et seigneurs entendent
projeter leur puissance nouvelle sur l’Eglise en s’arrogeant le droit de pourvoir aux
bénéfices ecclésiastiques et d’annexer à leur profit d’immenses biens d’église
accumulés depuis des siècles. Leur liberté d’action est d’autant plus grande que le
pouvoir royal, arbitre reconnu d’éventuels conflits, a été ramené à son plus bas
niveau. La simonie, ou mise à l’encan des bénéfices ecclésiastiques, règne partout
faisant de la naissance et de la fortune les critères premiers du choix des charges
épiscopales et abbatiales.
Un tel mode de désignation ne pouvait rester sans influence sur la vie quotidienne
du clergé et de l’Eglise toute entière, marquée par la violence, la pauvreté religieuse
et morale, l’indigence intellectuelle. Le seul remède à ce mal qui s’amplifiait était
sans doute de soustraire le clergé aux influences de l’autorité temporelle et de le
reconstruire sur la base de valeurs fondamentales réaffirmées, de mener une réforme
aussi profonde qu’urgente.
L’Eglise ne découvre pas soudain, à l’avènement du pape Grégoire VII en 1073, la
gravité de la situation. Depuis un certain temps déjà ses prédécesseurs (Léon IX
notamment) et les cardinaux s’efforçaient de lutter contre cette détérioration. Dès
1049 un concile tenu à Reims avait condamné et déposé plusieurs évêques
1 -

Conférences données de novembre à décembre 2013 par Jacques Laugery, ancien maître de conférences de l’Université d’Angers
– Tous droits réservés –
notoirement simoniaques. Mais la libération de l’Eglise de l’emprise des laïques,
condition première de la réforme, devait commencer par la tête, c’est-à-dire par la fin
de la tutelle impériale sur l’élection pontificale. Ce fut chose faite dès 1059, cinq ans
après que l’Eglise de Rome se fut officiellement séparée de celle d’Orient. Le Pape
devenait désormais un homme librement choisi par les seuls cardinaux et donc à
même de promouvoir de sa propre autorité cette séparation fondamentale et jugée
indispensable entre le monde des clercs et celui des laïques, entre le bon grain et
l’ivraie, la vertu et le péché.
Le projet pontifical s’était beaucoup nourri du monachisme et notamment de
l’exemple clunisien. L’abbaye bénédictine fondée au début du Xème siècle, aux
confins des royaumes et loin des sièges de l’autorité épiscopale, s’était placée sous
l’autorité directe et immédiate du souverain pontife, exempte donc de la tutelle
séculière. Son isolement politique et son rattachement direct au successeur de Saint-
Pierre lui avaient valu d’être protégée des pressions du siècle et d’avoir conservé une
pureté de vie monastique. Son exemplarité en avait fait un foyer de réforme
monastique (sous l’abbé Maieul notamment) dont l’influence avait atteint la vallée de
la Loire (Fleury, St-Florent de Saumur…) et souvent pris le nom de « pré-réforme ».
Sans être donc réellement un précurseur, Grégoire VII qui donnera son nom à la
réforme sera l’architecte d’une transformation profonde et durable de l’Eglise. Celle-
ci se poursuivra bien après sa mort en 1085, puisque son aboutissement sera l’œuvre
du IVème concile de Latran en 1215 et le triomphe de ce que l’on a appelé la
« Théocratie pontificale » sous la papauté d’Innocent III (1198-1216).
La première conséquence de la réforme grégorienne fut d’introduire dans l’occident
chrétien une notion toute nouvelle de « bicéphalie » de la chrétienté. Jusque là le
peuple, sujet et chrétien, n’avait eu qu’un seul chef : l’Empereur, garant de l’unité et
de l’intégrité territoriale ainsi que de l’orthodoxie chrétienne de l’Occident. Le Pape
était, en tant qu’évêque de Rome et successeur de Saint-Pierre, une autorité morale
inégalée pour le clergé, mais le chef de la chrétienté était unique : c’était l’Empereur.
La réforme créait deux pouvoirs en séparant ses prérogatives : le pouvoir sur les
hommes et le pouvoir sur les âmes, le temporel et le spirituel, la potestas et l’autoritas,
le domaine de l’Empereur et celui du Pape.
2 –

Conférences données de novembre à décembre 2013 par Jacques Laugery, ancien maître de conférences de l’Université d’Angers
– Tous droits réservés –
C’était une formidable source de complexité pour l’augustinisme politique qui
dominait ce temps. La cité terrestre et son organisation doivent préfigurer la cité
céleste et s’en rapprocher au plus près. La référence permanente à l’ancien Testament
donnait comme finalité à tout pouvoir le rachat des hommes condamnés par la faute
originelle et l’obligation de les orienter sur la voie du salut dans l’attente du
jugement dernier.
La séparation des pouvoirs entre le Pape et l’Empereur ne pouvait donc se faire sur
la base d’un simple équilibre, mais sur celle d’une domination du spirituel sur le
temporel, de l’autoritas sur la potestas. Toutes les forces devaient s’aligner derrière le
Pape « Guide suprême » et seul berger désigné par Dieu pour mener le troupeau sur
la bonne voie jusqu’à l’éternel bonheur du bercail !
Mais la liberté et la prépondérance de l’autorité pontificale sur le pouvoir impérial
impliquaient aussi celle du clergé, notamment des évêques, sur celle des princes et
des grands féodaux. Le desserrement de l’étau féodal était au prix de l’abandon des
avantages matériels consentis depuis des siècles au clergé par l’autorité temporelle.
C’était vrai dans les cités où les évêques s’investissaient dans des charges publiques
nombreuses, mais aussi dans les abbayes où ils assuraient par leurs prières l’éternité
heureuse des familles fondatrices, dans les cours des princes enfin où leurs conseils
et leur collaboration étaient déterminants. Pouvait-on, en application stricte de la
réforme, priver les princes nourriciers de l’aide déférente des évêques ou réduire ces
derniers avec leur église à la mendicité afin de les protéger d’un temporel
naturellement corrupteur ?
C’est naturellement dans l’Empire où les implications politiques du clergé étaient les
plus profondes que les conflits furent les plus précoces et les plus violents. De 1077 à
1122, de Canossa au concordat de Worms, la lutte fit rage entre le Pape et l’Empereur
attisée par la forte personnalité de Grégoire VII et l’intransigeance d’Henri IV. Dans
le royaume des Francs où la question se posait avec une acuité moindre, il fallut
malgré tout, l’inspiration conciliatrice d’Yves de Chartres et la diplomatie de Calixte
II pour éviter des heurts et définir des bases qui inspirèrent finalement le compromis
de Worms. On distinguait dans l’investiture du nouvel évêque, désigné par l’élection
libre du chapitre, une part purement religieuse et spirituelle (matérialisée par la
crosse et l’anneau remis par le Métropolitain) et une part temporelle (les bénéfices ou
regalia octroyés en contrepartie de l’implication politique de la fonction) remise
ensuite au nouveau prélat par le prince.
3 –

Conférences données de novembre à décembre 2013 par Jacques Laugery, ancien maître de conférences de l’Université d’Angers
– Tous droits réservés –
Si le concordat donnait à l’investiture un cadre théorique acceptable par les deux
parties, il était loin de régler définitivement les conflits de terrain qui allaient se
succéder pendant tout le Moyen-Âge. Le serment de fidélité dû au prince par un
évêque investi d’un fief et devenu à ce titre vassal de ce prince n’étant pas le
moindre !
Dans la réalité, les applications des procédures d’investiture connurent des périodes
d’apaisement et de conflits rallumés ; elles durent aussi dépendantes de la bonne
volonté des princes et de la « compréhension » pontificale à leur égard. En
Normandie comme en Angleterre où les successeurs de Guillaume le Conquérant
avaient tenu à faire de la réforme leur « affaire », la pression ducale et royale
demeura très forte mais s’exerça tout de même dans le sens souhaité (ou admis ?) par
le Pape. Dans les faits, les princes gardèrent toujours sur les élections épiscopales et
abbatiales une influence notable et d’autant plus efficace que les moyens matériels du
clergé en dépendaient. Très souvent, et comme le dira finalement Philippe Auguste,
on en venait au choix de candidats qui « plaisaient à Dieu et étaient utiles au
royaume ».
C’est au plus fort de la crise des Investitures que la chrétienté fut frappée par la
nouvelle de la conquête de Jérusalem par le pouvoir musulman (1087). Bien que
l’accès des chrétiens aux lieux saints n’en soit pas bouleversé, la papauté comprit très
vite, au-delà de l’émotion initiale, le parti qu’elle pourrait tirer, aux yeux de la
chrétienté occidentale, d’une opération de sauvegarde visant à rétablir un pouvoir
chrétien sur la Terre sainte. C’était une manière d’asseoir le pouvoir du Pape face à
l’autorité impériale ainsi que de rappeler à la chrétienté orientale la puissance de
celle de l’Occident.
En 1095 à Clermont, le pape Urbain II lança l’idée d’une croisade libératrice qui reçut
un accueil plus enthousiaste encore que prévu de la part de la noblesse. Cet
engagement n’était pas sans souligner les contradictions de l’Eglise. Elle, qui depuis
Charroux et Elne, avait toujours condamné la violence à travers le soutien apporté à
la Paix de Dieu et à la Trêve de Dieu, se trouvait à ce moment contrainte à
promouvoir et organiser une opération ouvertement militaire et violente visant à la
reconquête des Lieux saints. Mais contre « l’infidèle », l’opération devenait une
« guerre juste ».
4 -
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
1
/
37
100%