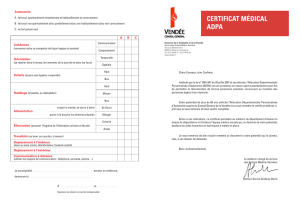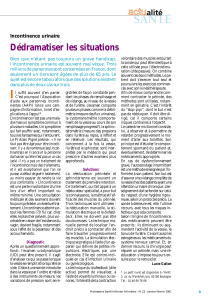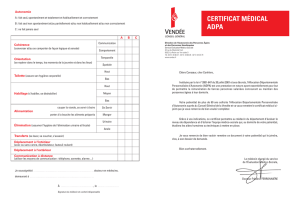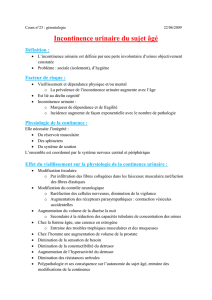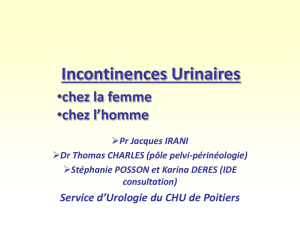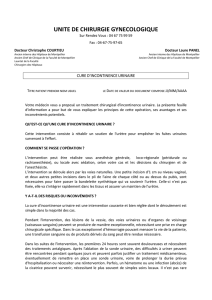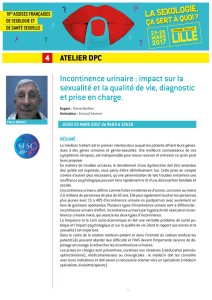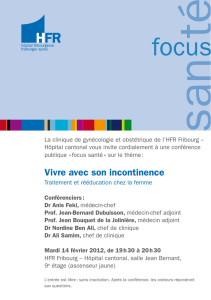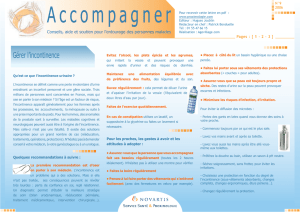et incontinence

DOSSIER
santé log – Soin à domicile n° 34 – Septembre-octobre 2013 15
A lire sur le web
Chaque article du dossier est désormais
précédé d’une URL réduite
(ex : santelog.com/id3401) pour vous permettre, une
fois « loggué » sur notre site d’accéder plus facilement
à nos contenus.
Incontinence
Sujet âgé et troubles
neurologiques
L’incontinence est une priorité de santé publique
dont la prévalence fut longtemps sous-estimée
et méconnue. Les données épidémiologiques
disponibles concernent essentiellement
l’incontinence urinaire, l’incontinence anale
restant encore trop taboue pour pouvoir avoir une
estimation fiable de sa prévalence. Actuellement il
est admis, de façon consensuelle en France, que
20% des femmes sont incontinentes urinaires, tous
âges confondus.
Concernant l’incontinence anale, on admet, que sa
prévalence est estimée à 10% dans la population
tous âges confondus. On ignore cependant le
pourcentage d’incontinence à la fois urinaire et anale
si bien qu’il n’est pas actuellement possible d’établir
avec précision la prévalence de l’incontinence
anale. Compte tenu du tabou régnant autour de
cette pathologie on est en droit de penser que sa
prévalence est encore sous-estimée.
Une prévalence qui ne va qu’augmenter avec le
vieillissement de la population et la prévalence des
troubles neurologiques chez le patient âgé.
R.M.
© ThinkStockPhotos
sommaire
PHYSIOPATHOLOGIE ET TYPOLOGIE
DE L’INCONTINENCE ............................................................. 16
DÉFINITIONS DE L’INCONTINENCE URINAIRE ....................18
LES INCONTINENCES NEUROLOGIQUES ...........................20
L’INCONTINENCE URINAIRE DU SUJET ÂGÉ ...................... 20
LES TRAITEMENTS PALLIATIFS ............................................ 23
TRAITEMENT HORMONAL SUBSTITUTIF
DE LA MÉNOPAUSE (ET INCONTINENCE) ........................... 24
INCONTINENCE FÉCALE DU SUJET ÂGÉ ............................25
L’INCONTINENCE URINAIRE D’ORIGINE
NEUROLOGIQUE, LES VESSIES NEUROLOGIQUES ..........26
INCONTINENCE ET MALADIE D’ALZHEIMER ......................29
INCONTINENCE ET HANDICAP ............................................30
INCONTINENCE ET RÉSEAU .................................................32
Rédaction : Dr Richard Matis, gynécologue-obstétricien péri-
néologie, Groupement Hospitalier de l’Institut Catholique de
Lille - Validation : Dr Martine Soudani, gériatre - Copyright ©
2013 AlliedhealtH www.santelog.com en partenariat avec
TENA.
Auteurs et remerciements :
7B6$'BB'RVVLHULQGG

DOSSIER
16 Septembre-octobre 2013 – Soin à domicile n° 34 – santé log
A lire sur le web
www.santelog.com/id3401
Physiopathologie et Typologie de l’Incontinence
Physiologie de la miction
La continence urinaire et la miction, régulées par
le système nerveux central et périphérique,
nécessitent une vessie, des sphincters lisse et
strié et un plancher périnéal en bon état.
La continence lors du remplissage vésical, est
assurée par l’inhibition parasympathique de la
contraction du détrusor et l’activation orthosym-
pathique de la contraction du sphincter lisse.
Lors de la miction la vidange vésicale est assurée
par la contraction du détrusor (récepteurs ` adré-
nergiques) concomitante du relâchement des
sphincters lisse (récepteurs _ adrénergiques) et
strié (volontaire). Le contrôle de la continence et
de la miction nécessite l’intégrité du système ner-
veux central et des nerfs périphériques.
La vessie recueille l’urine venant des uretères et
la retient entre deux mictions. Lors de la miction,
l’urine est évacuée par l’urètre. L’évacuation de
l’urine est contrôlée par des sphincters situés à la
base de la vessie et dans la paroi de l’urètre. Le
tonus de ces sphincters est habituellement suffi-
sant pour éviter toute perte involontaire d’urine.
Au moment d’uriner, ces sphincters se relâchent
et l’urine peut donc passer dans l’urètre, alors
que le muscle de la vessie se contracte en même
temps pour évacuer l’urine. Une fois vidée, la
vessie se relâche et le sphincter se contracte
pour retenir l’urine et commencer un nouveau
remplissage.
L’urine produite par les reins (A) s’écoule dans la
vessie (B) par les uretères. Quand la vessie se rem-
plit et atteint sa capacité maximale normale d’en-
viron 300 ml, les nerfs situés dans la paroi de la
vessie envoient un signal à la moelle épinière et au
La miction, est le résultat d’une contraction du
muscle vésical (le détrusor) associée à une relaxa-
tion du sphincter urétral qui s’ouvre laissant s’écou-
ler les urines par l’urètre. Cette commande est
automatique non contrôlée. Plus bas dans l’urètre,
juste au-dessous de la prostate, le sphincter externe
est contrôlé. C’est ce sphincter qui peut permettre
le blocage de la miction et «de se retenir».
La continence, en particulier chez la femme, est
un mécanisme complexe qui résulte du fonction-
nement coordonné par un ensemble d’éléments
qui sont les suivants:
Une vessie normale, de capacité
suffi sante, avec une pression
suffi sante pour fermer l’urètre, un
urètre en position normale avec une
résistance adéquate.
Cette force de résistance de l’urètre est due pour
moitié au sphincter lisse et pour moitié au sphinc-
ter strié de l’urètre moyen. La pression urétrale
cerveau. Le cerveau agit sur le fonctionnement de
la vessie par le système cholinergique. Jusqu’à un
certain volume, la vessie peut se remplir en adap-
tant sa capacité au volume d’urine, sans augmen-
tation de la pression intra vésicale. Au-delà d’un
certain volume, la vessie distendue envoie un
signal au système nerveux central qui va comman-
der les muscles de la vessie et des sphincters (C)
de l’urètre (D). Cette commande va générer la mic-
tion ou la retarder en fonction des circonstances.
Appareil vésico-sphinctérien et son innervation.
Fonctionnement du sytème urinaire @ www.tena.fr
7B6$'BB'RVVLHULQGG

santé log – Soin à domicile n° 34 – Septembre-octobre 2013 17
s’adapte normalement aux contraintes de pres-
sion abdominale (toux, effort...).
Physiologie de l’incontinence
urinaire
L’incontinence urinaire d’effort
Elle est souvent le fait d’une faiblesse du plancher
pelvien, avec une mobilité de l’urètre qui sort de
sa cavité secondairement à une augmentation de
la pression abdominale.
L’urètre perd alors sa capacité de rétention une
fois hors de l’enceinte manométrique abdomi-
nale, d’où la fuite urinaire lors des efforts. Le relâ-
chement du plancher pelvien favorisé par l’âge et
la multiparité, favorise la mobilité de l’urètre, qui
n’est plus maintenu. Souvent sont associés des
troubles de la statique pelvienne tels que les pro-
lapsus qui sont des chutes d’organes au travers
la fente urogénitale de la femme. La vessie, quand
elle n’est plus maintenue dans sa position anato-
mique au dessus du plancher pelvien, bombe
dans le vagin créant ce qu’on appelle une cysto-
cèle. Lorsque le prolapsus intéresse le rectum qui
bombe au travers de la paroi postérieure du
vagin, on parle de rectocèle. L’hystérocèle ou
hystéroptose signifie la descente de l’utérus. On
parle d’urétroptose, lorsqu’il s’agit de l’urètre qui
descend.
Ce «defect» périnéal a souvent pour
origine le traumatisme obstétrical.
Ainsi les déchirures du périnée, les accouche-
ments difficiles, les traumatismes du sphincter de
l’anus sont autant de causes de troubles de la
statique pelvienne et/ou d’incontinence. Parfois
cette incontinence peut être iatrogène à la suite
d’une hystérectomie, voire d’une cure de prolap-
sus qui peut démasquer une incontinence. Les
modifications hormonales de la ménopause favo-
risent par l’atrophie des tissus une diminution des
résistances de l’urètre et une incontinence.
Le mécanisme des fuites urinaires d’effort est
expliqué par la théorie dite de « l’enceinte de
pression». Lorsque l’urètre descend hors de son
enceinte de pression, il n’est plus soumis à la
pression abdominale. Ainsi lorsque la transmis-
sion de la pression venant de l’abdomen ne se
répercute plus aussi bien sur l’urètre que sur la
vessie, il y a une différence de pressions en faveur
de la vessie.
L’instabilité vésicale
Dans l’instabilité vésicale avec ou sans fuite uri-
naire, on observe des anomalies de la contraction
du muscle de la vessie. La diminution de la capa-
cité de remplissage se traduit par une pression
intra-vésicale qui augmente trop rapidement au
cours du remplissage.
La fuite survient quand la pression intra-vésicale
dépasse celle du sphincter. L’instabilité du détru-
sor entraine des contractions involontaires (dites
désinhibées) qui génèrent des mictions impé-
rieuses avec des fuites en jet. Cette instabilité
caractérisée pour les vessies de petite capacité,
peut à l’inverse survenir aussi en cas de vessie
distendue.
La distension vésicale
Elle est de plus en plus fréquente dans nos socié-
tés occidentales.
Les messages erronés sur les bienfaits de l’eau
pour la santé et la minceur, conduisent à une
consommation excessive de liquides qui, asso-
ciée à une insuffisance mictionnelle, aboutit à une
«vessie distendue».
Il s’agit le plus souvent de femmes
jeunes qui absorbent beaucoup
plus que les 1,5 litres de liquide
nécessaires et suffi sants par jour.
Les apports liquidiens tout compris (boissons,
thé, café, soupe, tisane etc..) dépassent large-
ment 2 litres par jour. Parallèlement ces femmes
n’urinent pas en conséquence, avec des écarts
entre deux mictions bien souvent supérieurs à 4
heures, alors qu’ils devraient être normalement
de 2 à 3 heures.
En remplissant de trop sans vider suffisamment
la vessie, celle-ci se distend et devient hypo-sen-
sible, pouvant aboutir à l’extrême à une «vessie
claquée». Celle-ci est source de fuites à l’effort
et/ou par impériosité et urgenturie. A l’effort car la
vessie claquée se laisse distendre par un remplis-
sage excessif jusqu’à plus de 500 ml, sans per-
ception de besoin d’uriner. La moindre pression
abdominale sur la vessie entraine alors un débor-
dement et une fuite. L’instabilité est une consé-
quence possible de la vessie distendue dont les
fibres musculaires ne réagissent plus correcte-
ment. Lorsque le besoin survient sur une vessie
hypo-sensible, il s’accompagne de contractions
vésicales désinhibées et d’impériosité comme
avec les vessies instables. • •
Ce qu’on appelle le «défaut de transmission» caractérise l’incontinence
urinaire d’effort.
Ce
’
qu’
on app
ll
ell
l
el
e
dé
dé
f
fau
td
td
t
et
ran
sm
ssi
i
on cara
té
cté
i
ris
l
el
’i
’in
con
ti
tin
ence
mi
s
7B6$'BB'RVVLHULQGG

DOSSIER
18 Septembre-octobre 2013 – Soin à domicile n° 34 – santé log
A lire sur le web
www.santelog.com/id3402
Défi nitions de l’incontinence urinaire
Les troubles mictionnels comprennent non seule-
ment l’incontinence urinaire, mais aussi l’hype-
ractivité vésicale et la rétention urinaire chronique
qui sont des deux phénomènes qui peuvent par-
fois être accompagnés de fuites urinaires.
L’incontinence urinaire est définie comme étant
« toute perte involontaire d’urine » quelles que
soient les personnes concernées, hommes,
femmes, enfants, personnes âgées, circons-
tances et quantité...
Certains patients considèrent que des pertes uri-
naires de quelques gouttes sont normales et
pensent ne pas avoir de fuite et encore moins être
« incontinent ». Les fuites sont définies par de
l’urine quelle que soit la quantité qui ne se
retrouvent pas dans la cuvette des toilettes! Si
l’urine est dans le slip, le linge, les draps, à coté
des toilettes (involontairement) on parle de fuite
et donc d’incontinence.
• l’incontinence urinaire d’effort;
• l’incontinence urinaire par hyperactivité ou instabilité vésicale;
• l’incontinence urinaire mixte associant l’incontinence d’effort
et l’instabilité vésicale;
• l’incontinence urinaire par regorgement, dans le cadre de rétention
chronique incomplète d’urine;
• l’incontinence sur vessie neurologique;
• l’incontinence totale et l’incontinence par traumatisme.
L’incontinence urinaire peut être classée
en six catégories:
Ce syndrome touche plus souvent les femmes au
moment de la maternité et de la ménopause. Mais toutes
les femmes, quel que soit leur âge, peuvent être concer-
nées: 1 femme sur 4 est confrontée à une incontinence
urinaire à l’effort à un moment de sa vie et environ 40%
des jeunes femmes rencontrent ce problème en faisant
du sport.
Source: © Mediabank SCA/TENA, D. Grünstein, DLKW
L’incontinence urinaire d’effort
Cette incontinence à l’effort est caractérisée par
une fuite involontaire d’urine:
- non précédée d’une sensation de besoin
d’uriner,
- et qui survient à l’occasion d’un effort.
C’est l’augmentation de la pression abdominale
qui agit la pression vésicale sans se transmettre
suffisamment à l’urètre. La différence entre les
pressions vésicale et urétrale se fait aux dépends
de l’urètre qui ne parvient plus à retenir l’urine.
Ces «efforts» sont le plus
souvent dus à la toux, au rire, aux
éternuements, lors du port d’une
charge, du passage à la position
debout ou à l’occasion de toute
activité physique plus ou moins
importante.
Les efforts peuvent être modérés et ne pas être
considérés par le patient comme un effort. Ainsi
le changement de position pendant le sommeil
peut être un effort suffisant pour générer une
fuite. Cette incontinence est dite «passive» car
elle résulte uniquement d’une baisse des résis-
tances urétrales sans contraction vésicale. La
fuite d’urine survient lorsque la pression abdomi-
nale s’élève au delà de la pression de clôture de
l’urètre. Ce type d’incontinence représente 50%
des incontinences urinaires féminines.
Le diagnostic est avant tout clinique, reposant
sur l’interrogatoire en premier lieu: les fuites sur-
viennent à l’effort. Il faut préciser quels sont les
efforts pouvant entrainer des fuites urinaires.
7B6$'BB'RVVLHULQGG
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%