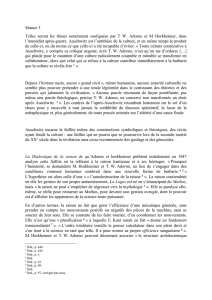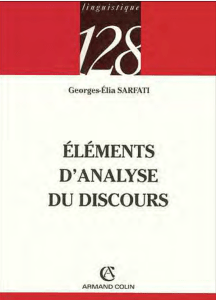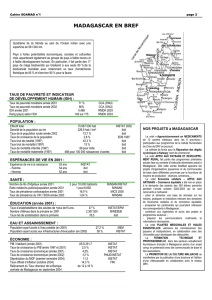LES VOYANTS UPANISHADIQUES
SWAMI ABHAYANANDA
Swami Abhayananda (né Stan Trout) naquit à Indianapolis en Indiana, le 14 août 1938.
Après avoir effectué son service militaire dans la marine, il s’installa dans le nord de la
Californie, où il suivit des études de philosophie et de littérature. En juin 1966, il découvrit
la philosophie du mysticisme et il éprouva le désir puissant de réaliser Dieu. Renonçant à
tout autre intérêt, il se retira dans une cabane isolée afin d’y mener une vie de solitude
dans les forêts montagneuses proches de Santa Cruz, en Californie, et au mois de novembre
de la même année, il trouva l’Illumination, par la grâce de Dieu.
Il passa encore quatre années de plus dans cette
cabane isolée avant de rencontrer par la suite
Swami Muktananda qui visita Santa Cruz, en 1970.
Par la suite, il rejoignit Muktananda en Inde, en tant
que disciple, et il vécut et travailla ultérieurement à
l’ashram de Muktananda situé à Oakland, en
Californie, où il traduisit le Chant de l’Avadhuta, en
1977.
1
En mai 1978, il retourna en Inde, où il fut
initié par son maître à l’ordre des moines Saraswati
et il reçut le nom monastique de Swami
Abhayananda, que l’on pourrait traduire par ‘’la Joie
de l’Intrépidité’’.
Pendant les années qui suivirent, il enseigna la
méditation dans plusieurs villes, mais en 1981, il
quitta l’organisation de Muktananda et il retourna
en retraite où il écrivit ‘’The Supreme Self’’ et
‘’History of mysticism’’.
2
Actuellement, Swami
Abhayananda réside sur la Treasure Coast, en Floride, où il continue d’enseigner, d’écrire
et de publier ses œuvres sur la connaissance du Soi. (Voir son site web –
https://www.themysticsvision.com/ - qui propose beaucoup de ses remarquables livres à
télécharger gratuitement en PDF).
En Inde, au cours du premier millénaire avant notre ère, les Védas furent finalement
rassemblés et consignés sous une forme écrite organisée ; et beaucoup plus tard, un
ensemble supplémentaire d'écrits philosophiques rédigés par les rishis, ou voyants,
qui avaient connu Dieu, fut ajouté à ces hymnes et préceptes religieux antérieurs, et
1
J’en ai réalisé une traduction, que voici :
https://studylibfr.com/doc/10068099/le-chant-de-l-avadhuta-de-dattatreya---swami-abhayananda
(Swami Abhayananda : Le chant de l’Avadhuta, NDT.
2
En voici deux autres extraits :
https://studylibfr.com/doc/10066547/les-hymnistes-v%C3%A9diques---swami-abhayananda Swami
Abhayananda : Les hymnistes védiques
https://studylibfr.com/doc/10179460/l-histoire-du-mysticisme-et-les-anciens-juifs---swami-abh... Swami
Abhayananda : L’histoire du mysticisme et les anciens juifs, NDT.

considéré dès lors comme faisant partie intégrante des Védas. Ces prolongements
philosophiques, destinés à un public plus érudit et intellectuellement plus raffiné,
furent appelés les Upanishads. Le terme sanskrit upanishad signifie « assis au-
dessous » et fait référence aux enseignements reçus aux pieds d'un Maître spirituel,
ou guru. Les Upanishads reposent également « en-dessous » des Védas, en tant que
dernière partie de l'ensemble, et sont donc connues comme étant le Védanta : la fin
(anta) des Védas.
Sur les cent huit Upanishads répertoriées, douze sont considérées comme étant d'une
importance et d'une valeur primordiales. En termes de pureté philosophique et de
pouvoir de persuasion, elles représentent pour la plupart d'entre nous ce que sont les
Upanishads. Elles ont pour noms Isha, Kena, Katha, Prasna, Mundaka, Mandukya,
Chandogya, Brihadaranyaka, Aitareya, Taitiriya, Svetasvatara et Maitri Upanishads.
Les auteurs et la date exacte de la rédaction de ces traités spirituels indépendants
sont inconnus ; nous savons seulement qu'ils furent écrits par des sages anonymes
qui avaient réalisé la Vérité dont ils parlent, entre environ 1200 et 400 avant notre ère.
Bien qu'ils varient en longueur et en style, leur thème commun est la réalisation
intérieure de l'identité de l'Atman (le Soi) et du Brahman (la Conscience universelle).
Nous pouvons nous efforcer de connaître Dieu, ou nous pouvons nous efforcer de
connaître notre Soi ; mais, selon les Upanishads, lorsque vous trouvez l'un, vous
trouvez également l'autre ; et c'est cette découverte qui constitue l'Illumination.
Il est depuis longtemps reconnu comme un fait de psychologie mystique que,
lorsqu'un homme parvient à connaître Dieu dans la vision unitive, il connaît alors
son propre Soi authentique. Cette réalité intrigante est exprimée très succinctement
dans un passage de l'ancienne épopée indienne, le Ramayana ; dans celle-ci, Rama,
qui représente la divinité incarnée, demande à son serviteur, Hanuman : « Comment
me considères-tu ? » Et Hanuman répond :
dehabhavena daso’smi
jivabhavena twadamshakah
atmabhave twamevaham
(Si je m'identifie au corps, je suis votre serviteur ;
Si je m'identifie à l'âme, je fais partie intégrante de Vous ;
Mais si je m'identifie au Soi, je suis réellement Vous).
i
Ces trois attitudes représentent des étapes progressivement plus subtiles
d'identification : de l'identification au corps à l'identification à l'âme, jusqu'à ce que
l'on arrive enfin à connaître le Divin, et ainsi son Soi éternel. Si chacune de ces trois
attitudes relationnelles trouve son expression en tant qu'attitude prévalente dans
diverses traditions religieuses, elles sont essentiellement représentatives du point de
vue de ces différentes étapes de la conscience de soi.
Nous avons vu, dans les Védas, comment la pensée religieuse a évolué d'une forme
primitive de culte de la nature vers le monothéisme, puis finalement vers une
conception moniste de la réalité. Cette progression dans la compréhension est le

reflet de celle qui se produit également dans l'esprit de chaque individu. Nous
commençons tous par être matérialistes, en considérant comme acquis que le monde
phénoménal qui s'offre à nous est la seule réalité. L'idée d'un Dieu transcendant, ou
d'un Principe unificateur inhérent au monde, ne semble être qu'une notion lointaine
et vague. Puis, au fur et à mesure que notre sentiment religieux s'éveille, peut-être à
la suite d'un rappel choquant de la mortalité, ou d'une clarté d'esprit subite en
contemplant le ciel étoilé ou une partie tranquille du littoral, nous commençons à
réfléchir. Et une certaine logique intérieure semble requérir un Créateur pour un
univers aussi vaste et aussi mystérieux. Nous commençons à sentir une Intelligence
qui nous dépasse, une Intelligence avec laquelle nous pouvons communiquer et dont
nous sommes de plus en plus conscients dans toutes nos pensées et nos actions.
La deuxième étape de notre développement religieux a lieu quand, après mûre
réflexion et introspection, nous arrivons à la conclusion qu'il y a en nous quelque
chose, un esprit moral, une lumière qui nous guide, qui est elle-même divine et qui
participe de Dieu Lui-même. Nous l'appelons notre « âme » et nous ressentons le
désir ardent de cette âme de retrouver la beauté et la bonté divines dont elle émane,
telle une étincelle d'un feu ardent.
Enfin, nous vivons la troisième étape de notre parcours, lorsque, dans un moment
d'aspiration et la contemplation de notre Source Divine, nous connaissons « la paix
qui dépasse toute compréhension ». Inopinément, dans un moment de clarté
intellectuelle sans précédent, nous connaissons cette Divinité unique face à face.
Nanti de cette connaissance éclairée, nous réalisons que le chercheur et le but, celui
qui connaît et ce qu'il cherchait à connaître, ne font qu'un. Comme le roi d'un grand
royaume qui se réveille d'un rêve dans lequel il est pauvre et perdu, nous nous
réveillons à la réalisation que nous n'avons jamais été séparés de l'Unique, mais que
nous avons seulement imaginé une séparation qui n'existait pas. Alors nous
connaissons Celui que nous avons toujours été : l'Être omniprésent qui, tout en
transcendant ce monde de lumière et d'ombre, est Lui-même le substrat et l'essence
de tout être.
C'est dans les Upanishads que nous entendons pour la première fois ces voyants
parfaitement éclairés qui ont atteint le stade ultime de la connaissance concernant
Dieu et le Soi, et nous déclarent que le Soi et Dieu ne font qu'un :
Même par l'esprit, cette vérité doit être apprise :
La multiplicité n'existe pas, il n'y a que l'Unité.
ii
Nous pouvons facilement comprendre intellectuellement l'idée d'une Unité sous-
jacente, mais cela reste une connaissance imparfaite et finalement insatisfaisante,
aussi longtemps que nous ne faisons pas directement l'expérience de cette Unité en
tant que Soi. Notre propre savoir même fait obstacle à l'expérience de la Vérité, en
maintenant la conscience limitée « je sais ». L'intellect même qui sait établit une
séparation entre ce qui connaît et ce qui est connu. Écoutez ce que les voyants des
Upanishads disent là-dessus :

Il est connu de ceux qui Le connaissent au-delà de la pensée, et non de ceux qui
imaginent qu'Il est accessible par la pensée. ... Si vous pensez « Je Le connais bien »,
vous ne connaissez pas la Vérité. Vous ne percevez que l'apparence du Brahman
produite par les sens intérieurs. Continuez à méditer.
iii
Ce qui ne peut être pensé par l'esprit, mais Ce par quoi l'esprit pense : sachez que
Cela seul est Brahman.
... Ce n'est pas ce qui est pensé que nous devrions vouloir connaître ; nous devrions
connaître Celui qui pense. « Il est mon Soi ! » C'est Cela qu'on devrait connaître. « Il
est mon Soi ! » C'est Cela qu'on devrait connaître.
iv
Et cette connaissance du Soi, ou de l'Atman, ne s'obtient que par l'expérience directe,
qui se produit quand le mental qui connaît est transcendé, et quand celui qui connaît
et ce qui est connu sont directement réalisés comme étant un. Aucune somme de
raisonnement, ni aucune somme de compréhension philosophique ne peuvent
approcher cette connaissance que l'on appréhende directement :
Il ne peut être vu par l'œil, et les mots ne peuvent Le révéler. Il ne peut pas être
réalisé par les sens, ni par l'austérité ou par l'accomplissement de rituels. Par la grâce
de la sagesse et la pureté de l'esprit, Il est perceptible dans le silence de la
contemplation.
v
Lorsqu’un sage perçoit cette grande Unité et réalise que son Soi est devenu tous les
êtres, quelle illusion et quelle tristesse pourraient jamais l'atteindre ?
vi
Lorsqu'il est éveillé à la vision de son propre Soi, lorsqu'un homme peut dire en
vérité : « Je suis Lui », quels désirs pourraient le conduire à se languir fiévreusement
du corps ?...
Lorsqu'un homme perçoit l'Atman, son propre Soi, le Dieu unique, le Seigneur de ce
qui était et de ce qui sera, alors il ne craint plus rien.
vii
Cette « vision » du Soi est décrite dans les Upanishads comme étant la Libération
(moksha). C'est une liberté, une délivrance du doute, de l'incertitude et des peurs qui
accompagnent l'ignorance, à tout jamais. Toutes les questions ont trouvé une
réponse ; tous les désirs et toutes les causes de chagrin se sont apaisés ; car
désormais, l'homme connaît le secret de toute l’existence. Toutes les notions
antérieures de limitation et de mortalité et toute l'obscurité de l'ignorance ont été
dissipées par la lumière éclatante de la Vérité :
Lorsque le sage sait que c'est grâce au grand Esprit omniprésent en nous que nous
sommes conscients pendant l'état de veille ou pendant les rêves, alors il dépasse
toute peine. Lorsqu’il connaît le Soi, la Vie intérieure qui se délecte comme une
abeille de la douceur des fleurs des sens, le Seigneur de ce qui était et de ce qui sera,
alors il dépasse toute peur.
viii

Lorsqu'un homme a vu la vérité de l'Esprit, il ne fait plus qu'un avec Lui ; le but de sa
vie est accompli, et il se situe à jamais au-delà de la souffrance.
... Lorsqu'un homme connaît Dieu, il est libre ; ses souffrances ont une fin, et il n'y a
plus ni naissance, ni mort. Par une union intérieure, lorsqu’il est au-delà du monde
du corps, il trouve le troisième monde, le monde de l'Esprit, où l'homme possède
tout, car il ne fait plus qu'un avec l'UN.
ix
Ce sont ces vérités, à savoir que « le Brahman est l'Atman »
x
, que « l'Atman est le
Brahman »
xi
, et que la réalisation de l'Atman/Brahman est la « Libération » ultime de
l'homme, qui constituent le grand message des Upanishads. Mais une autre question
demeure : « Comment parvenir à cette réalisation ? » En réponse à cette question, les
différents auteurs des Upanishads proposent plusieurs réponses qui, pour un
étudiant perplexe, peuvent paraître contradictoires et s'exclure mutuellement. Mais,
avec quelques explications, on comprend aisément que leurs directives ne sont pas
du tout contradictoires, mais complémentaires. Par exemple, dans la Katha
Upanishad, on nous donne trois explications différentes, quant au moyen de
connaître Dieu. Le premier est « par la grâce de Dieu » :
L'homme qui renonce à sa volonté humaine laisse derrière lui les souffrances et
contemple la gloire du Soi par la grâce de Dieu....
Ce n'est pas au moyen d'une grande érudition que l'on peut atteindre l'Atman, ni par
le biais de l'intellect et des enseignements sacrés. A ceux qu'Il choisit, Il est
accessible ; à Ses élus, le Soi révèle Sa gloire.
xii
Le deuxième est « par la pureté du cœur » :
Il est perçu par un cœur pur et par un esprit dont les pensées sont pures....
En renonçant à tous les désirs qui tenaillent son cœur, le mortel devient immortel, et
même dans ce monde, il ne fait plus qu'un avec le Brahman.
xiii
Le troisième est par une « contemplation ciblée et sans faille» :
Même des connaissances approfondies ne permettent pas d'atteindre le Soi, à moins
de renoncer aux mauvaises habitudes, de trouver le repos des sens, la concentration
de l'esprit et la paix du cœur....
Lorsque le sage repose son esprit dans la contemplation divine qui transcende le
temps, invisible dans le mystère des choses et dans le cœur de l'homme, alors il
s'élève au-dessus des plaisirs et des peines.
xiv
Ces trois méthodes ou moyens apparemment distincts pour parvenir à la réalisation
divine apparaissent sous une forme ou l'autre dans toutes les Upanishads. Et pour
comprendre le rapport intégral entre ces trois « voies » apparemment différentes,
nous devons les examiner à la lumière de l'expérience de ceux qui ont atteint le but
de la réalisation du Soi. Tout d'abord, comprenons ce que signifie « la grâce de
Dieu ».
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%
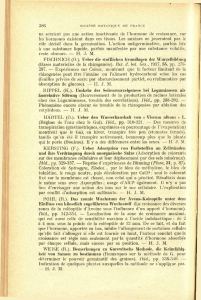
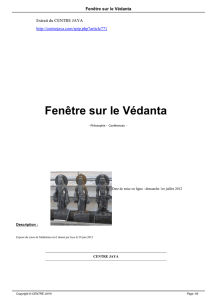

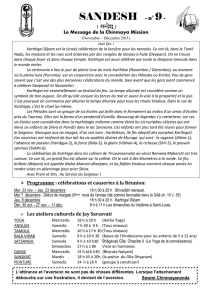
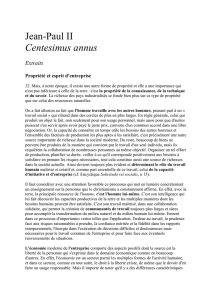
![[….] Mais une deuxième considération s`impose. Nous avions jusqu](http://s1.studylibfr.com/store/data/000852584_1-5369db7b64c38bfb08426a90323d86fc-300x300.png)