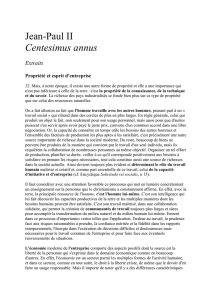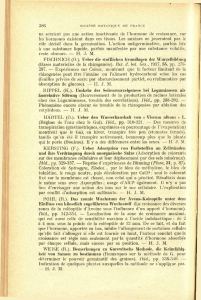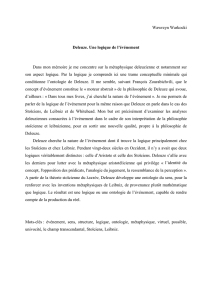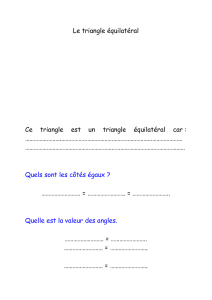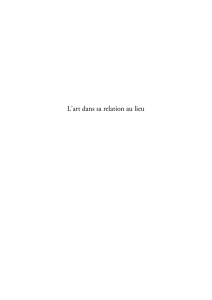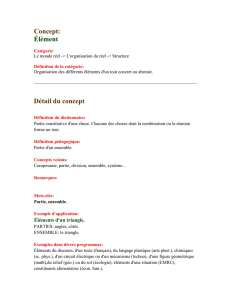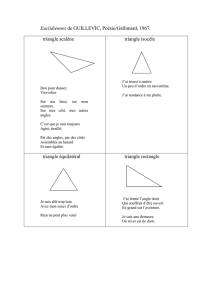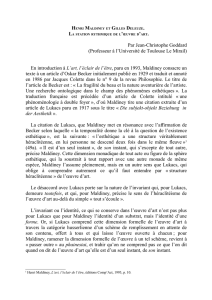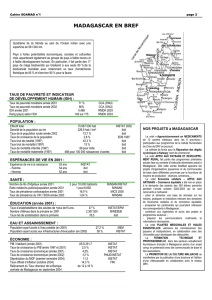Séance 3

Séance 3
Telles seront les thèses notamment soulignées par T W. Adorno et M Horkheimer, dans
l’immédiat après-guerre. Auschwitz est l’antithèse de la culture, et en même temps le produit
de celle-ci, ou du moins ce que celle-ci a été incapable d’éviter. « Toute culture consécutive à
Auschwitz, y compris sa critique urgente, écrit T. W. Adorno, n’est qu’un tas d’ordures […]
qui plaide pour le maintien d’une culture radicalement coupable et minable se transforme en
collaborateur, alors que celui qui se refuse à la culture contribue immédiatement à la barbarie
que la culture se révéla être
1
».
Depuis l’horreur nazie, aucun « grand récit », même humaniste, aucune autorité culturelle ne
semble plus pouvoir prétendre à une totale légitimité dans le continuum des théories et des
pensées qui jalonnent la civilisation. « Aucune parole résonnant de façon pontifiante, pas
même une parole théologique, précise T. W. Adorno, ne conserve non transformée un droit
après Auschwitz
2
». Les cendres de l’après-Auschwitz retombent lentement sur le sol d’un
chaos pour y ensevelir à tout jamais la crédibilité du discours spéculatif, la lueur de la
métaphysique et, plus généralement, de toute pensée orientée sur l’altérité d’une cause finale
Auschwitz incarne la faillite même des constructions symboliques et théoriques, des récits
ayant fondé la culture : une faillite qui ne pourra que se poursuivre lors de la seconde moitié
du XXe siècle dans la révélation sans cesse recommencée des goulags et des génocides.
La Dialectique de la raison de qu’Adorno et horkheimer publient initialement en 1947
analyse cette faillite en la référant à la raison kantienne et à ses héritages. « Pourquoi
l’humanité, se demandent M. Horkheimer et T. W. Adorno, au lieu de s’engager dans des
conditions vraiment humaines sombrait dans une nouvelle forme de barbarie ?
3
»
L’hypothèse est alors celle d’une « « l’autodestruction de la raison
4
». La raison contiendrait
en elle les germes de son propre anéantissement. Le Logos est né en s’émancipant du Muthos,
mais « la raison ne peut s’empêcher de régresser vers la mythologie
5
». Elle se paralyse elle-
même, se réifie pour retourner au Muthos, pour devenir une gestion aveugle, dont le pouvoir
est d’afficher les apparences de la science toute-puissante.
En d’autres termes, la raison ne fait que gérer l’efficience d’une mécanique générale, sans
prendre en compte les mouvements positifs ou négatifs des pièces de la machine, sans se
soucier de leur sens. Elle se contente de les faire tourner, d’en coordonner les mouvements.
Elle n’est qu’une « planification
6
» à laquelle E. Kant aurait en fait « donné un fondement
transcendantal
7
». « L’ordre totalitaire installe le penser calculateur dans son plein droit et
s’en tient à la science en tant que telle. Il a pour norme sa propre efficience sanguinaire
8
».
M. Horkheimer et T. W. Adorno peuvent désormais associer « la structure architectonique
1
Ibid., p. 444.
2
Ibid., p. 445.
3
Ibid., p. 5.
4
Ibid.
5
Ibid., p. 16.
6
Ibid., p. 98.
7
Ibid.
8
Ibid., p. 97, souligné par nous.

particulière au système kantien […] les pyramides gymniques des orgies bourgeoises et la
hiérarchie des premières loges
9
», en y reconnaissant un mode d’organisation « de la vie
entière privée de toute fin ayant un contenu
10
», bref de toute cause finale. De la sorte,
jugement moral kantien, sous l’effet de la raison, se coordonnerait avec l’immoralité sadienne.
Ainsi, les « équipes sportives modernes dont les activités collectives sont réglées avec une
telle précision qu’aucun membre n’a le moindre doute sur le rôle qu’il doit jouer et qu’un
remplaçant est prêt à se substituer à chacun sont un modèle précis dans les jeux sexuels
collectifs de Juliette, où aucun instant n’est inutilisé, aucun orifice corporel négligé, aucune
fonction ne reste inactive. Dans le sport, comme dans tous les secteurs de la culture de masse,
il règne une activité intense et fonctionnelle
11
». On comprend que cette écroulement de la
raicon transcendante annonce dans le même mouvement la chute des instances qui
l’annonçaient : les « grands récits », les métarécits », et 25 ans après la découverte
d’Auschwitz, lyotard pourra voir dans cette fin des Gr le signe de la postmodernité.
La deuxième grande raison, curieusement vient de la posture des philosophes des années
soixante et du contexte de l’époque. Le contexte était celui du triangle hiérarchisé et d’une
société dont la rigidité devenait insupportable. Ainsi pourra-t-on par exemple se souvenir de
la Chronique de l’école caserne de Jacques Pain et Fernand Oury. D’autre part, ce contexte
coïncide avec l’effritement annoncé des « grands récits » qui, jusque-là, fédéraient la vie
intellectuelle qu’on pourrait qualifier « d’opposition » (de gauche). Il serait ici possible de
situer la reprise de la psychanalyse sous l’arbitraire d’un signifiant lacanien se voulant en
phase avec la logique structuraliste. G. Deleuze et F. Guattari dénoncent ainsi l’aspiration « à
remplir une fonction majeure du langage, faire des offres de service comme langue d’Etat,
langue officielle (la psychanalyse aujourd’hui, qui se veut maîtresse du signifiant, de la
métaphore et du jeu de mots) » (Kplm, 50). Il en va de même pour le marxisme, alors en très
large part oblitéré par une dérive dogmatique basée sur le modèle soviétique, et dont les
principaux représentants politiques en France n’arrivaient pas à se défaire. Ni Lacan, ni Marx.
C’est ainsi que le philosophie émergente va chercher à quitter toute position de synthèse ou de
surplomb, « du haut », ce que Deleuze nommait le « molaire ». Lyotard, quant à lui, fustige
toute posture philosophique qui chercherait du haut de son trône, même pour libérer les
masses, à édicter une « vérité », toujours dogmatique.
On comprend d’ailleurs le retour à Nietzsche chez Deleuze, à la quête d’une philosophie qui
ne serait plus édictée depuis les nuages, depuis le sommet du triangle, mais qui se ferait à
« coups » de marteaux, en renouant avec le sol terrestre, avec les intensités qui circulent à la
surface, le micro-vibrations, ce que Deleuze nomme le « moléculaire ». C’est d’ailleurs le
retour à une philosophie « intensive », que ce soit chez Deleuze ou Lyotard, qui se profile. Il
s’agit de dresser ce que Deleuze nommait une « machine de guerre » contre le vieux triangle,
d’en déconstruire (le mot de derrida) systématiquement les organisations hiérarchisées.
La troisième raison s’oppose à la précédente, et marque toute l’ambiguïté des penseurs de la
postmodernité. Bien évidemment, en s’en prenant au triangle hiérarchisé, c’est l’ordre de
l’oppression qu’entendait critiquer tant Deleuze que Lyotard. T cette oppression a pour nom
au 20ème siècle le capitalisme. Mais le paradoxe est là, le capitalisme ne cherche pas à faire
penser, mais avant tout à capitaliser. Plus il peut capitaliser des flux financiers, mieux il se
porte. Plus ce qui peut le contraindre, comme les instances étatiques, est levé, mieux il se
porte. Parmi ce que peut le contraindre et le réguler, on reconnaît le grand triangle dominé par
9
Ibid., p. 99.
10
Ibid.
11
Ibid., pp. 98-99.

l’état. Aussi, lorsque le capitalisme n’est plus contraint, lorsqu’il n’a plus à s’exercer dans la
cadre d’un triangle avec une instance qui le surplombe, il atteint son bonheur total, se fait flux
financiers et réseaux, et se nomme le néo-libéralisme. Telle est l’ambiguïté : la déconstruction
du triangle tant souhaitée par les philosophes qui entendaient dans les années 70 s’en prendre
à la domination capitalisme n’a fait que le jeu de ce dernier qui, enfin, a pu devenir sauvage,
libéré de toute contrainte et de toute régulation. Telle est notre société actuelle.
Pour aborder ces mutations de la PM, je propose d’interroger, de façon sommaire, deux (trois)
philosophes qui sont emblématiques de la pm : j-f ; lyotard, qui introduit le thème, et G.
Deleuze à qui il faut associer F. Guattari.
1
/
3
100%