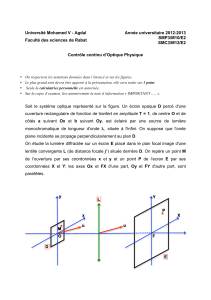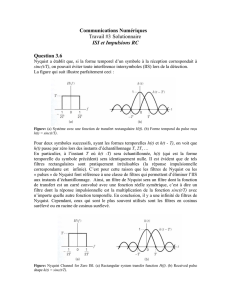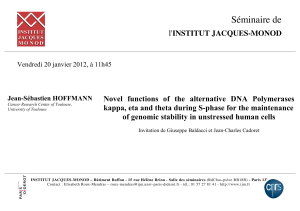Transformations isen|3 ∗13 nov 2020
IV – Séries de Fourier
Voici un signal carré, de période Tet de rapport cyclique θ∈[0,1] :
x(t) =sq(theta,T,t)
t
0
1
−T T 2T3T
−θT
2
θT
2
I) Calcul manuel
Assurerez-vous que vous savez établir que les coefficients de Fourier de ce signal ressemblent à
c0=θ, cn=sin nπθ
nπ (n6= 0).
On peut écrire ces coefficients de façon plus concise en introduisant la fonction sinus cardinal
sinc(t) :=
sin t
tt6= 0,
1t= 0,
de sorte que l’on a
cn=θsinc(nπθ)
et les sommes partielles de la série de Fourier SN(t) :=
N
X
n=−N
cne2jπ n
Ttpeuvent s’exprimer comme
SN(t) = θ"1+2
N
X
n=1
sinc(nπθ) cos(2πn
Tt)#.
Remarque : Il y a plusieurs normalisations possibles pour le sinus cardinal. . . celle que nous avons définie
ci-dessus, qui est la plus utilisée en France (et en tout cas à l’ISEN) a des zéros distants de π, on l’ap-
pelle également parfois sinus cardinal du mathématicien, qu’on pourrait noter sincπ. Malheureusement,
MATLAB a choisi une autre convention et de travailler plutôt avec le sinus cardinal de l’ingénieur
sinc1(t) := sincπ(πt).
Définissez votre propre fonction Sinc = sincπque vous pourrez utiliser à chaque fois que nous rencontre-
rons des "sinc" dans nos formules. Vous pouvez bien sûr utiliser pour cela le sinc = sinc1de MATLAB
en exploitant
Sinc(t) = sinct
π
pour éviter les divisions par zéro.
Vérifiez que vous vous rappelez comment visualiser des signaux (cf. TP1) en traçant le graphe de votre
sinus cardinal par exemple sur l’intervalle [−5π, 5π].

II) Représentation informatique
A – Signal exact
La fonction sq(theta,T,t), qui n’existe pas de base sous MATLAB, a été fabriquée pour vous : cf. fichier
sq.m fourni dans l’archive (à enregistrer dans votre dossier de travail).
Définissez les variables :
theta = 0.2;
T = 1;
N = 8; % les termes de la série de Fourier iront de -N à N
le tableau d’instants et le signal x:
tMin = -3*T; tMax = 5*T;
nSteps = 2^14+1; % nb d’échantillons
t = linspace(tMin,tMax,nSteps); % 16385 échantillons répartis linéairement
x = sq(theta,T,t);
(le nombre de 214 + 1 est choisi pour pouvoir aller jusqu’à N= 128. . . il faut attendre le cours de
traitement de signal et le théorème de Shannon pour comprendre pourquoi.)
Un petit tracé pour vérifier ?
figure(1)
hold on, grid on
axis([tMin tMax -1 2]) % fixe les limites du graphique
plot(t,x)
Convenons de mettre dans cette première figure(1) tous les tracés temporels ; les courbes fréquentielles
seront superposées dans une figure(2).
B – Spectre tronqué
Pour le tracé fréquentiel, nous ne pouvons pas représenter tous les cn(nous avons déjà la chance qu’ils
soient réels !), et comme nous allons considérer la somme partielle de rang N, tronquons le spectre à ce
rang : il y a donc une raie à chaque fréquence n
Tpour nallant de −NàN:
f = -N/T:1/T:N/T;
spectrum = theta * Sinc(f*T*pi*theta);
figure(2)
hold on, grid on
stem(f,spectrum,"r") % stem est comme plot, mais utilise des raies
Enfin, puisque les raies ont une amplitude donnée par le sinc, nous pouvons tracer cette enveloppe qui
éclaircit la figure (avec un échantillonnage plus rapide des fréquences pour éviter la « segmentation ») :
fFast = -N/T:1/(4*T):N/T;
envelope = theta * Sinc(fFast*T*pi*theta);
plot(fFast,envelope,"k")

C – Reconstruction temporelle
Considérons maintenant la somme partielle de rang Nde la série de Fourier :
SN(t) = θ"1+2
N
X
n=1
sinc(nπθ) cos(2πn
Tt)#.
On initialise le tableau xFourier puis on ajoute petit à petit tous les termes (fonctions de t) de la série :
xFourier = zeros(size(t)); % tableau de zéros ayant la même taille que t
for n = -N:N
cn = spectrum(N+1-n); % la liste spectrum contient les coef de Fourier
xFourier = xFourier + cn * exp(2*j*pi*n/T*t);
end
figure(1)
plot(t,xFourier,"r")
Remarquez que le signal obtenu est censé être réel. . . toutefois, il aurait été plus prudent d’écrire
plot(t,real(xFourier),"r") pour pallier l’existence d’éventuelles erreurs de calculs.
III) Interprétations
A – Dépendance à Tet θ
Soyez le plus exhaustif possible dans vos réponses.
1. Que se passe-t-il dans le domaine fréquentiel si l’on modifie la période T?
2. Que se passe-t-il dans le domaine fréquentiel si l’on modifie le rapport cyclique θ?
Remarquez en particulier que
pour θ=1
2, il n’y a plus d’harmoniques paires (c2n= 0 sauf c0),
pour θ=1
3, il n’y a plus d’harmoniques c3n(sauf c0),
etc.
B – Phénomène de Gibbs : quand N→ ∞
3. Modifiez progressivement N(sans dépasser 128) en réexécutant l’ensemble de vos commandes,
avantageusement placées dans un fichier .m (toute modification annexe à des fins pratiques est
fortement encouragée).
Observez le phénomène de Gibbs et les fameux 9 %.
1
/
3
100%