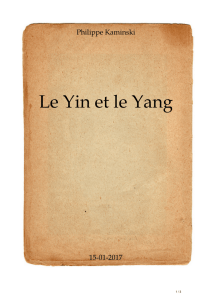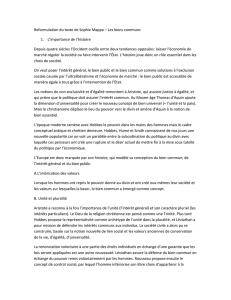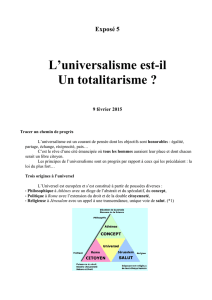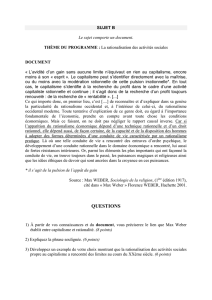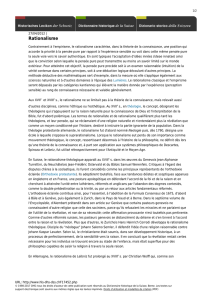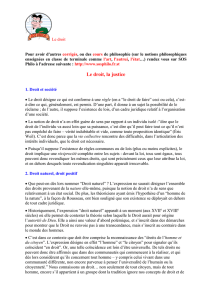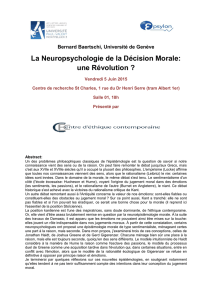Droit naturel : Objectivité et subjectivité - Mémoire de Master
Telechargé par
nestorkabore789

Sujet d’évaluation : le droit naturel
Unité de Formation et de Recherche : Sciences Juridiques et Politiques
Master 2 en Droit des Affaires, option Recherche
Travail réalisé par KABORE Kouliga Nestor
Année Universitaire 2024-2025
Chargé du cours : Pr. René ROBAYE et Pr. Mathieu ROLAIN
Module : La Théorie et philosophie du droit

Page 1 sur 5
Introduction
Imaginons un instant la paisiblité de la vie dans un monde où les droits de chaque
individu sont respectés, indépendamment des lois écrites ou des décrets gouvernementaux. Ce
monde idéal
1
en effet reposerait sur la notion de droit naturel, qui est une doctrine philosophique
qui prétend à l’universalité et à l’objectivité des droits inhérents à chaque être humain.
Cependant, il faut dire que cette idée noble
2
soulève autant de questions qu’elle apporte de
réponses. Dans le cadre de notre étude, l’une des questions sur laquelle l’on aimerait axer la
réflexion est celle de la nature du droit naturel.
Mais qu’est-ce que le droit naturel ? Le droit naturel désigne un ensemble de principes et
de règles considères comme inhérents à la nature humaine et universellement valable,
indépendamment des lois ou des institutions établies. Et en tant que notion voisine, le droit
positif renvoie à l’ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou une société à un
moment donné, telles qu’elles établies et reconnues par les autorités compétentes.
Le débat sur la nature du droit naturel remonte au xviie siècle. Le droit naturel était autrefois
aperçu par certains auteurs comme une création arbitraire de Dieu ou du moins comme un
système immuable et achevé, voire un droit universel visant à protéger les droits fondamentaux
des individus. Aujourd’hui, la question de la nature du droit naturel continue de se poser. Avec
l’évolution des sociétés, les mœurs et les valeurs morales évoluent aussi d’une société à une
autre.
L’étude de cette thématique revêt un double intérêt. Sur le plan théorique, l’intérêt du sujet
réside en ce qu’il nous permettra de comprendre non seulement les contours du débat doctrinal
autour de la nature du droit naturel mais aussi la pertinence du droit naturel dans la réflexion
juridique contemporaine. Et sur le plan pratique, l’intérêt de l’étude de cette thématique a trait
à la connaissance de l’influence du droit naturel sur la conception des droits fondamentaux des
individus.
L’enjeu principal de cette réflexion qui est de s’interroger sur la nature même du droit naturel,
l’on pourrait se poser la question de savoir : le droit naturel est-il une réalité objective ou
une construction sociale ? Est-ce une réalité objective ? Ou au contraire une réalité
subjective ?
1
La conception des jusnaturalistes du monde idéal
2
L’idée noble est celle de voir un monde où les droits des individus sont respectés sans restriction

Page 2 sur 5
L’objectif de cette étude étant d’analyser la nature du droit naturel, notre travail consistera tout
d’abord à présenter le droit naturel comme un droit fondamentalement objectif (I), avant de
montrer la véritable nature subjective de celui-ci (II).
I. Un droit théoriquement objectif
La qualification du droit naturel comme droit objectif tient non seulement des
considérations de l’école classiques (A) mais aussi de celles de l’école moderne (B).
A. La théorie classique du droit naturel
La nature du droit naturel a retenu l’attention de plusieurs penseurs au nombre desquels
on peut citer : Aristote, Saint Thomas d’Aquin, Stammler et Gény.
Les jusnaturalistes reconnaissent non seulement l’existence du droit positif mais ils considèrent
le droit naturel comme étant supérieur aux règles du droit positif.
Pour Aristote, le droit naturel est une forme de justice universelle qui découle de la nature
humaine et valable pour toutes les sociétés. Cette notion d’universalité de la justice était
reconnue a tout être humain peu importe son origine, sa race et sa culture.
Selon Saint Thomas d’Aquin, les règles inscrites dans la nature sont une volonté de Dieu. Pour
les chrétiens, c’est Dieu qui a créé la nature. Dieu a créé l’Homme, l’a doté de raison pour lui
permettre de découvrir ses principes. La conception du droit naturel de Saint Thomas est
mélangée à la théologie chrétienne. Il dit que le droit naturel est issu de la loi éternelle qui est
au sommet (lex aeterna).
Pour Stammler et Gény, leur philosophie rejoint celle d’Aristote même si Stammler émet des
doutes quant à l’immuabilité des principes fondamentaux.
Apres avoir examiné les fondements historiques du droit naturel, il est important de voir
comment ces concepts ont évolués au fil du temps.
B. La théorie moderne du droit naturel
L’école moderne du droit naturel a fondé principalement sa théorie sur l’œuvre de la
raison. Cette nouvelle théorie qui s’est intéressé à la nature du droit naturel avait pour penseurs :
Grotius, Samuel Von Pufendorf, Thomas Hobbes, John Locke et Rousseau.
Pour Grotius, le droit naturel est certes immuable mais cette immuabilité est fondée sur la
raison humaine. Selon la conception de l’auteur, le droit naturel est le produit de la loi naturelle
de l’individu, c’est-à-dire la raison.
Samuel Von Pufendorf, dans son œuvre de jure naturae et gentium, considère le droit naturel
comme une loi morale universelle, basée sur la raison et la nature humaine. Sur ce fondement,

Page 3 sur 5
il prône l’universalité et l’objectivité du droit naturel, car commune à tous les individus peu
importe leur origine, leur race, leur religion.
S’agissant de Hobbes et Rousseau, ils conçoivent le droit naturel comme le fruit d’un contrat
social. Dans les œuvres Léviathan de Hobbes et Du Contrat social de Rousseau, les auteurs
montrent la nécessité de vivre en société, car l’état de nature est, comme le dit Hobbes, une
« guerre de tous contre tous où l’homme est un loup pour l’homme ».
Quant à John Locke, il perçoit le droit naturel comme un droit universel et immuable qui
préexiste à toute société. Pour lui la vie en société doit viser à protéger le droit naturel et non a
le restreindre. Il prône en effet, le libéralisme politique.
Apres avoir exploré les fondements théoriques du droit naturel et sa prétendue
objectivité, il est crucial de confronter ces concepts à la réalité pratique. Cela nous amène donc
à analyser le caractère empiriquement subjectif du droit naturel.
II. Un droit empiriquement subjectif
En prétendant à l’universalité et à l’objectivité, le droit naturel se heurte aux réalités
socioculturelles qui révèlent ses limites. Son universalisme est souvent remis en cause (A) et le
rationalisme sur lequel il se fonde, est façonné par les dynamiques de chaque société (B).
A. Un universalisme remis en cause
Qu’est-ce que l’universalisme ? Selon le dictionnaire français, l’universalisme est une
doctrine qui considère la réalité comme un tout unique, dont dépendent les individus. Ainsi,
l’universalisme du droit naturel soutient que certaines valeurs, principes ou droits sont
universels, c’est-à-dire qu’ils s’appliquent à tous les êtres humains, indépendamment de leur
culture, religion, nationalité ou contexte historique. Cependant, il convient de nuancer cette
vision des choses, car la diversité culturelle, l’évolution historique et le contexte politique
peuvent remettre en cause cette vision unique des choses.
D’abord la diversité culturelle, il faut dire que les différentes cultures ont des normes et des
valeurs distinctes les unes des autres. Ce qui est considéré comme un droit naturel dans une
société peut ne pas l’être dans une autre. Par exemple le respect des ainés dans la société
africaine.
Ensuite l’évolution historique, il faut dire aussi que les notions du droit naturel ont évolué au
fil du temps en réponse aux changements sociaux, politiques et économiques. Ce qui était perçu
comme un droit naturel à une époque donnée peut ne plus l’être aujourd’hui. Ce qui montre que
ces droits ne sont pas immuables encore moins universels. C’est d’ailleurs ce que soutient la

Page 4 sur 5
thèse des historicistes. L’exemple parfait est le droit de propriété qui était initialement perçu
comme un droit absolu mais aujourd’hui limité par un certain nombre de règles.
Enfin le contexte politique, les différents régimes politiques ont des interprétations variées des
droits naturels. Un régime autoritaire pourrait restreindre les droits individuels sous prétexte de
sécurité nationale tandis qu’un démocrate pourrait les promouvoir. L’exemple parfait est la
liberté d’expression. Ainsi, la manière dont les droits naturels sont perçus et appliqués peut
varier considérablement en fonction du type de gouvernement en place.
Apres avoir discuté de la remise en cause de l’universalité du droit naturel, il est crucial
d’examiner comment le rationalisme, qui sous-tend ce droit, est façonné par les dynamiques
sociales et culturelles.
B. Un rationalisme produit par la société
Qu’est-ce que le rationalisme ? Selon le dictionnaire français, le mot rationalisme
vient du mot rationnel, c’est-à-dire « la raison ». Il est en effet une doctrine d'après laquelle
tout ce qui existe à sa raison d'être et peut donc être considéré comme intelligible ou d'après
laquelle la raison est effectivement en accord avec le monde et permet à l'homme de le connaître
et d'agir sur lui. La thèse visant a considéré la raison comme immuable et commune à tous les
êtres humains, est discutable. Elle est discutable, parce que les normes et les valeurs de la société
dans laquelle un individu vit influence notablement sa manière de penser et de raisonner. Ainsi,
au regard de la diversité culturelle des sociétés, on aura donc des raisonnements différents sur
une question donnée. Cette influence du cadre social a été traité par Lucien Malson son œuvre
Les enfants sauvages. Dans cette œuvre, l’auteur montre comment le cadre social influence la
raison de l’être humain. A cela, il faut ajouter aussi que les institutions religieuses participent
au façonnement de la raison de l’individu. Ainsi, on aura une diversité d’opinion sur question
de la dignité humaine soumise à une société chrétienne et une société laïque.
Conclusion
En résumé, nous avons étudié les fondements historiques du droit naturel, ainsi que ses
évolutions contemporaines. Nous avons également vu comment l’universalité du droit naturel
est remise en cause par la diversité culturelle et les contextes politiques et comment le
rationalisme, censé être universel, est en réalité produit et influencé par les dynamiques sociales.
Ainsi, bien que le droit naturel prétende à l’universalité et à la rationalité, il est essentiel de
reconnaitre les nuances et les variations qui le façonnent dans la pratique.
1
/
5
100%