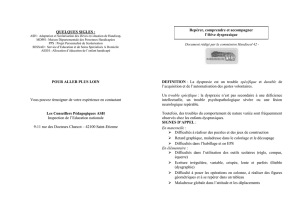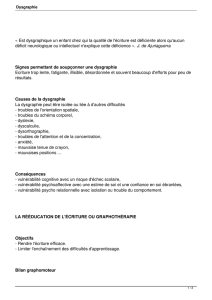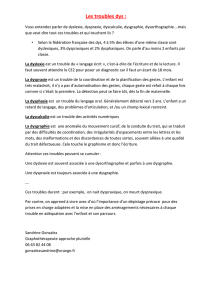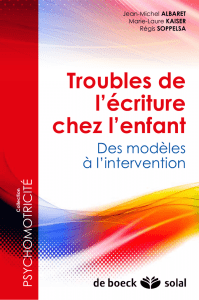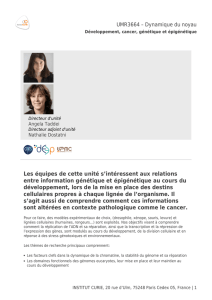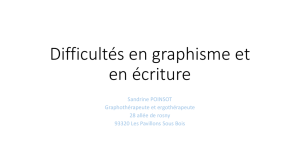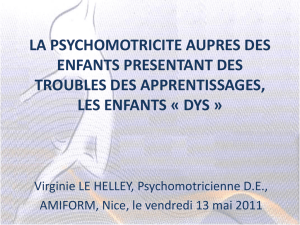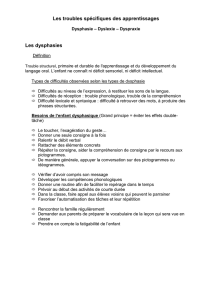Dysgraphie et rééducation psychomotrice : Données actuelles
Telechargé par
SOUAD HANI

Dysgraphies et rééducation psychomotrice :
Données actuelles
R.Soppelsa*, C.Matta Abizeid**, A.Chéron***, A.Laurent*, J.Danna****,
J.-M.Albaret*–*****
* Institut de Formation en Psychomotricité, Université de Toulouse III, Paul Sabatier, Toulouse
** Institut de Psychomotricité, Université Saint-Joseph, Beyrouth, Liban
*** Institut de Formation en Psychomotricité, Centre Hospitalier Intercommunal de Meulan-Les Mureaux
**** Laboratoire de Neurosciences Cognitives, UMR 7291, FR 3C 3512, Aix-Marseille Université – CNRS
***** Toulouse NeuroImaging Center, Université de Toulouse, Inserm, UPS
RÉSUMÉ
La dysgraphie développementale ou Trouble de l’Apprentis-
sage de la Graphomotricité (TAG) recouvre des réalités et
donne lieu à des dénitions très variables selon les auteurs.
Sa prévalence oscille entre 5 et 27 %. Le diagnostic est posé
en tenant compte de la qualité de l’écriture et de la fré-
quence d’inscription évaluées par des tests papier-crayon. La
généralisation des tablettes graphiques devrait permettre de
compléter l’analyse de la trace par une analyse des proces-
sus sous-jacents. Le trouble est rarement isolé et fréquem-
ment associé aux autres troubles psychomoteurs que sont le
Trouble de l’Acquisition de la Coordination et le Trouble
Décit de l’Attention Hyperactivité, ainsi qu’au Trouble des
Apprentissages. Les études sur les corrélats cérébraux sont
encore peu nombreuses. La rééducation des troubles de
l’écriture nécessite une pratique de l’écriture et l’association
étroite de la production graphomotrice et du langage.
L’intérêt des nouvelles technologies auprès des sujets avec
TAG est discutée au niveau du diagnostic et de la réédu-
cation.
MOTS-CLÉS
écriture, troubles neurodéveloppementaux, épidémiologie,
évaluation, thérapie
Les difcultés qu’éprouvent certains enfants à apprendre à
écrire ont des répercussions sur l’ensemble de leur scolarité.
Elles rendent pénible la réalisation du travail scolaire, s’accom-
pagnent d’une baisse de motivation, de frustrations et parfois
de fatigue et de douleurs au niveau de la main (ébauches de
crampes), inuencent négativement l’auto-évaluation de leur
niveau d’expression écrite, entrainant une baisse de l’estime
de soi [1,2]. Par ailleurs, leurs productions écrites sont bien sou-
vent sous-estimées par les enseignants.
La dysgraphie développementale recouvre des réalités et
donne lieu à des dénitions très variables selon les auteurs,
qui tiennent en grande partie au fait que « l’écriture n’est pas
seulement une habileté motrice ou seulement une habileté
linguistique » [3, p. 419]. À côté de la composante graphomotrice
que nous privilégierons ici, certains insistent sur l’aspect ortho-
graphique ou encore sur les processus cognitifs notamment
mnésiques ou exécutifs. Berninger et al.
[4]
proposent ainsi de
distinguer, dans les troubles spéciques des apprentissages,
trois troubles organisés autour d’une atteinte de différents
niveaux du langage écrit ainsi que de la mémoire de travail :
ladysgraphie avec une atteinte au niveau de la production de
la lettre (impaired subword handwriting) ; la dyslexie avec une
atteinte de l’orthographe et de la lecture des mots ; l’incapa-
cité d’apprentissage du langage oral et écrit (oral and written
language learning disability) portant sur l’expression écrite et
le niveau syntaxique.
Des auteurs comme Karlsdottir et Stefansson [5] identient
deux types de dysfonctionnement de l’écriture qui appa-
raissent à des périodes différentes de l’apprentissage de l’écri-
ture. Le premier concerne le début de la scolarité en primaire
et porte sur la formation des lettres et des liaisons entre elles,
difcultés qui nécessiteraient alors une pratique plus intensive
de l’écriture. Le second se manifeste par une variabilité dans la
forme des lettres et surviendrait plus tardivement, en n de
primaire, au moment où l’écriture devient un moyen de com-
munication (cf. critères du BHK-Ado plus bas [6]).
Selon Ajuriaguerra [7, p. 286], « est dysgraphique tout enfant
dont la qualité de l’écriture est déciente alors qu’aucun dé-
cit neurologique important ou intellectuel n’explique cette
décience ». Pour autant, ce « trouble des apprentissages
oublié » selon l’expression de Katusic et al. [8] est absent des
classications internationales qui insistent soit sur l’aspect
expression écrite au sein des troubles spéciques des appren-
tissages, soit en font un symptôme du Trouble de l’Acquisition
de la Coordination.
Sa prévalence étant au moins aussi importante que la dyslexie,
nous proposons d’isoler un Trouble de l’Apprentissage de la
Graphomotricité dont les critères seraient les suivantes [9] :
1.
Les réalisations en écriture, évaluées par des tests standar-
disés passés de façon individuelle mesurant la qualité et la
fréquence d’inscription de l’écriture, sont nettement au-
dessous du niveau escompté compte tenu de l’âge chro-
nologique du sujet, de son niveau intellectuel, de son
© Les entretiens de Bichat 2016 -
1
Psychomotricité W
Les Entretiens
de
Psychomotricité
2016
PSY_01_soppelsa.indd 1 27/06/2016 12:29

niveau de développement psychomoteur général et d’un
enseignement approprié à l’âge. Cela peut se traduire par
une écriture lente, illisible, comportant des ratures et des
formes de lettres variables, un geste manquant de uidité
et de régularité.
2.
La perturbation décrite dans le critère 1 interfère de façon
signicative avec la réussite scolaire ou les activités de la
vie courante faisant appel à l’écriture.
3.
La perturbation n’est pas due à une affection médicale
générale (par ex., paralysie cérébrale, hémiplégie ou dys-
trophie musculaire), ni à un trouble de l’acquisition de la
coordination.
La prévalence de la dysgraphie oscille entre 5 et 27 % selon
l’âge considéré, les critères retenus et les outils d’évaluation
utilisés
[5,8,10,11]
. Dans les dysgraphies développementales, diffé-
rents sous-types ont été décrits mais ces distinctions restent
insatisfaisantes, ne parvenant pas à rendre compte des diffé-
rentes composantes de l’écriture, du caractère isolé ou comor-
bide du trouble de l’écriture, ni de son évolution [9].
Plusieurs facteurs endogènes et exogènes exercent une
inuence sur la qualité de l’écriture
[12]
. Pour les facteurs endo-
gènes, nous retiendrons la dextérité digitale, l’intégration
visuomotrice à savoir le lien étroit qui existe entre perception
visuelle et action motrice, et l’attention visuelle en début de
scolarité, puis la seule dextérité digitale ultérieurement. Le
principal facteur exogène est la quantité de pratique de l’écri-
ture qui diminue sensiblement ces dernières années et ne per-
met pas d’atteindre un niveau d’expertise sufsant dans ce
domaine.
Diagnostic de la dysgraphie
L’évaluation de l’écriture se fait à partir de tests papier-
crayon. L’outil le plus couramment utilisé est le BHK [13],
adaptation française d’un test mis au point aux Pays-Bas par
Hamstra-Bletz et al.
[14]
. Ces auteurs se sont inspirés des tra-
vaux d’Ajuriaguerra et al.
[15]
et ont sélectionné les items per-
tinents pour déceler les écritures dysgraphiques en tenant
compte de l’évolution des connaissances et des outils utilisés
pour écrire. Le test consiste à faire copier aux enfants un
texte standardisé pendant une durée de 5 minutes sur une
feuille de papier dépourvue de lignes. Les cinq premières
lignes sont composées de mots monosyllabiques rencontrés
au Cours Préparatoire, puis le texte se complexie en même
temps que la taille des lettres diminue. L’analyse de l’écriture
porte sur :
•
l’aspect qualitatif à partir de 13 items rendant compte de la
lisibilité : 1) écriture grande ; 2) inclinaison de la marge vers
la droite ; 3) lignes non planes ; 4) mots serrés ; 5) écriture
chaotique ; 6) liens interrompus entre les lettres ; 7) télesco-
pages ; 8) variation de hauteur des lettres troncs (sans
hampe ni jambage) ; 9) hauteur relative incorrecte ; 10) dis-
torsion des lettres ; 11) formes de lettres ambigües ;
12) lettres retouchées ; 13) hésitations et tremblements.
•
l’aspect quantitatif avec la fréquence d’inscription soit le
nombre de caractères produits durant les 5 minutes.
Il est étalonné pour la population française sur 837 enfants
scolarisés du CP au CM2. Un étalonnage sur la population
libanaise, en cours de publication, existe également.
Une version pour les adolescents, le BHK-Ado
[6]
, a été réalisée
plus récemment avec des items adaptés aux caractéristiques
de la dysgraphie au collège, à savoir défauts de lisibilité et de
stabilité. L’étalonnage a été réalisé sur 471 enfants et adoles-
cents scolarisés de la 6e à 3e.
Par ailleurs, il est intéressant de confronter différentes situa-
tions de production d’écriture an d’apprécier l’inuence des
contraintes de la tâche : spontanée, copie de textes en scripte
et en cursive, dictée.
À côté de ces évaluations du produit, soit la trace écrite, des
mesures des processus impliqués dans l’écriture peuvent être
réalisées à l’aide des tablettes digitales, pour l’heure cantonné
aux recherches expérimentales. Elles fournissent des informa
-
tions sur les aspects spatiaux, temporels et cinématiques ainsi
que sur la pression exercée sur la tablette [16]. Les trois variables
les plus pertinentes pour rendre compte de la qualité de l’écri-
ture sont la vitesse du mouvement, sa uence, et la pression
comme le rapporte une récente revue de la littérature [17].
La dysgraphie au sein des troubles
neurodéveloppementaux
Si la dysgraphie peut être isolée [8,18], elle est fréquemment
associée au TAC comme le montre l’étude récente de Vaivre-
Douret et al. [19], dans laquelle 38 des 43 enfants TAC ont des
difcultés d’écriture et 19 une dysgraphie. Elle est aussi ren-
contrée dans le TDA/H, et ce d’autant plus que la composante
inattention est présente dans le tableau clinique [20].
Concernant les troubles des apprentissages, Capellini et al. [21]
rapportent que 100 % des enfants avec trouble des apprentis-
sages présentent une dysgraphie, et 85 % des enfants avec
dyslexie. Si l’on s’intéresse aux sujets avec dysgraphie, 30 à
67 % d’entre eux présentent des troubles des apprentissages
selon les études [9].
Pour Nicolson et Fawcett [22], l’association entre ces troubles
neuro-développementaux résulterait, au niveau cognitif, d’un
défaut d’automatisation consécutif, au niveau cérébral, à un
dysfonctionnement des circuits cortico-cérebelleux et cortico-
striataux impliqués dans l’apprentissage procédural.
Corrélats cérébraux
Le réseau cérébral impliqué spéciquement dans l’écriture est
localisé dans l’hémisphère gauche, et composé de la zone du
sillon frontal supérieur et du gyrus frontal moyen, la zone du
sillon intrapariétal et du lobule pariétal supérieur, ainsi que le
cervelet droit ; d’autres structures non spéciques en lien avec
les aspects moteurs et linguistiques interviennent égale-
ment [23,24]. Les études en imagerie portant sur les troubles de
l’écriture sont peu nombreuses et ont principalement été réa-
lisées sur des sujets cérébrolésés. Pour ce qui concerne la dys-
graphie développementale, elles sont encore moins nom-
breuses. Parmi celles-ci, Richards et al. [25]. montrent des
différences d’activation en IRM fonctionnelle (IRMf) entre des
2
- © Les entretiens de Bichat 2016
W Psychomotricité
PSY_01_soppelsa.indd 2 27/06/2016 12:29

enfants bons et faibles scripteurs scolarisés en CM2 sur deux
tâches de mouvement d’opposition des doigts : répétitif
(pouce-index) et séquentiel (pouce-doigts).
En comparant différentes tâches de production écrites (écrire
la lettre qui suit celle qui est présentée selon l’ordre alphabé-
tique ; écrire la lettre manquante d’un mot correct sur le plan
orthographique ; écrire une rédaction sur un thème), Richards
et al. [3] montrent, à l’aide de l’imagerie en tenseur de diffu-
sion1 (DTI) et de l’IRMf que les sujets avec dysgraphie se diffé-
rencient à la fois des sujets avec dyslexie et des sujets
contrôles. L’intégrité structurale des bres de la substance
blanche est meilleure chez les sujets contrôles, avec un
nombre de connexions fonctionnelles moindres, éléments que
l’on peut relier à leur maîtrise du langage écrit contrairement
aux deux groupes pathologiques. Les sujets avec dysgraphie
diffèrent aussi des sujets avec dyslexie en terme d’intégrité de
la substance blanche dans le faisceau fronto-occipital inférieur
gauche, qui sous-tend la voie sémantique du langage, et de
connectivité fonctionnelle entre la zone d’intérêt occipito-tem-
porale et le lobule pariétal inférieur.
Rééducation de l’écriture
Sur le plan scientique, la rééducation de l’écriture rentre dans
la période de maturité. La dysgraphie est prise en compte
comme les autres troubles des apprentissages avec un réseau
de professionnels spécialisés qui s’associent dans le but de
permettre à l’enfant de ne pas être limité dans sa progression
scolaire par cette difculté. Les premières conduites à tenir
sont proposées
[27]
. Des méthodes rééducatives sont validées et
permettent une amélioration des patients
[28-33]
. Les premières
méta-analyses sont publiées [34].
Des croyances et des questions récurrentes tombent.
• L’importance de la posture et celle de la prise du crayon sur
la production d’écriture sont désormais relativisées car plu-
sieurs postures et plusieurs prises permettent une produc-
tion graphique aisée et économique et ont peu d’effet sur
la qualité et sur la vitesse de production de l’écriture.
•
L’utilisation de la relaxation dans le traitement de l’écriture
échoue toujours à montrer son efcacité sur la qualité de
l’écriture. Les tentatives associant relaxation et biofeedback
présentent les mêmes limitations en terme d’efcacité à
moins d’y associer un entrainement à l’écriture. Une piste
possible proposée par Walker [35] est une utilisation du
neuro-feedback qui semble avoir des effets sur la qualité
littéraire des dysgraphiques.
• La question motivationnelle, qui a été centrale dans la prise
en charge depuis les années 70, montre ses limites.
L’ensemble des travaux portant sur le fait de lutter contre la
phobie de l’écriture, contre l’évitement à laisser une trace se
heurte à la contrainte de l’exposition au stimulus
1 « L’imagerie en tenseur de diffusion est une technique d’IRM qui permet la
cartographie in vivo de la microstructure et de l’organisation des tissus. Elle offre
la possibilité de détecter et de quantier des anomalies de la substance blanche
non visibles en imagerie conventionnelle. » [26].
phobogène. Il y a plus de résultat quand l’enfant, confronté
à sa difculté, met en place un comportement proactif, por-
tant sur l’auto-évaluation et l’autocorrection de sa produc-
tion. Les auteurs montrent de plus que l’évaluation de l’ef-
cacité que l’enfant peut faire de sa production est
indépendante de celle-ci [36].
Il se dégage de la méta-analyse de Hoy et al. [34] un consensus :
pour que les méthodes rééducatives présentent un minimum
d’efcacité il faut que l’enfant pratique l’écriture et que la
production motrice soit associée au langage. La communica-
tion demande à ce que le message émis possède une stabilité
importante an d’éviter une perte de l’information. Cette
contrainte s’impose quelle que soit la partie du corps impli-
quée ; la stabilité d’émission touche la production du langage
oral, du langage des signes, de l’écriture, de la dactylo-
graphe [37]. L’écriture se conçoit comme une expertise asso-
ciant de multiples composantes cognitives et motrices mais ne
se résumant pas à elles. Comme toute activité experte, elle
demande un entrainement portant sur elle-même. Ceci
explique pourquoi tous les dispositifs thérapeutiques qui
portent sur les processus sous-jacent n’ont que peu d’efca-
cité [38].
Les rééducations portant sur la tâche constituent actuellement
la majeure partie des techniques efcaces. Elles se répar-
tissent entre :
•
Les thérapeutiques neuro-motrices (Neuromotor Task
Training [39]) qui s’inspirent des théories sur le contrôle
moteur et se sont développées pour le traitement des
enfants porteurs de TAC. Elles comportent un volet psycho-
logique centré sur une approche contextuelle qui prend en
compte la peur de l’échec, le trouble de l’attention, le
manque de motivation et les difcultés de compréhension
de la tâche. Un second volet porte sur le contrôle de la
motricité avec des exercices de planication par anticipation
du mouvement, un travail spécique sur l’organisation des
séquences motrices avec comme entrainement des exercices
sur la variation des paramètres du mouvement (variation de
la vitesse des forces impliquées). Les principes thérapeu-
tiques sont ceux de l’apprentissage moteur soit l’utilisation
de modèle associé à des instructions verbales, une organisa-
tion de la pratique, et un apport raisonné des feedbacks
portant sur les caractéristiques du mouvement et pas sur
l’écriture elle-même.
•
Les rééducations cognitives et méta-cognitives s’appuient
sur le modèle d’intervention cognitivo-comportementale où
on propose à l’enfant d’être acteur de son propre change
-
ment en associant les techniques de débat socratique, le
guidage du comportement par le langage interne et la réso-
lution de problème. Cette philosophie de traitement a été
mise en acte sur les jeunes enfants en voie d’apprentissage
avec des exercices portant sur la connaissance de l’alphabet
et la pratique de l’écriture orientée vers la qualité [29]. La
méthode de Jongmans et al. [30] utilise le fait que l’enfant
peut rééchir sur sa propre production et être son propre
juge, son correcteur et celui qui produit la trace graphique.
Les expérimentations où l’on propose à l’enfant d’enseigner
© Les entretiens de Bichat 2016 -
3
Psychomotricité W
PSY_01_soppelsa.indd 3 27/06/2016 12:29

l’écriture à un robot montrent aussi que le fait d’endosser le
rôle d’éducateur a un effet sur sa propre qualité d’écri-
ture [40,41].
• Enn, le fait que l’on ait mis en lumière à partir des années
2000, la forte corrélation entre la capacité à produire du
texte de bonne qualité et l’écriture manuscrite a incité un
certain nombre d’auteurs à utiliser la composition comme
moyen de rééducation. Graham et al. [42,43] ont mis au point
le dispositif de développement d’une stratégie d’autorégu-
lation (Self-Regulated Strategy Development – SRSD). La
méthode consiste à permettre à l’enfant, dans un groupe
ou en individuel, de prendre plaisir à produire un texte et
d’améliorer ces productions écrites. Le SRSD repose sur un
enseignement explicite des stratégies nécessaires, de leur
utilisation et de leur gestion, réparti en six étapes dont
l’agencement est adapté aux besoins spéciques des per-
sonnes concernées. Les groupes sont autogérés, l’adulte
maintient le cadre et l’organisation temporelle des activités
proposées au sein de la séance. Les enfants développent
leurs connaissances sur la production de textes en partant
de ce qu’ils savent déjà, en recherchant des exemples dans
la littérature enfantine et en les analysant. Ils construisent
des scenarios en se servant, par exemple, d’une représenta-
tion graphique des textes qu’ils vont produire.
L’entrainement peut s’accompagner d’aides sous forme de
ches d’auto-instructions où sont notés les éléments sur les-
quels porter son attention lorsque l’on produit un texte.
Les dernières années ont vu apparaître des techniques qui,
tout en restant orientées sur la tâche, tentent de remettre du
perceptivo-moteur dans la rééducation. Au regard de ces nou-
velles orientations de la pratique psychomotrice qui mettent
l’accent sur la nécessité d’organiser, par un guidage verbal
orienté, des informations sensorielles pertinentes pour favori-
ser l’apprentissage de l’écriture du jeune enfant, deux tech-
niques complémentaires vont être décrites : l’apprentissage
multi-sensoriel des lettres (AMSL)
[44]
et la technique graphique
d’extension (TGE) [45].
L’apprentissage multi-sensoriel de la lettre aborde une
exploration multimodale des lettres. Elle vise à associer, de
façon systématique, le mode haptique avec les modalités
visuelles et auditives dans l’exploration de lettres mal connues
ou déformées de l’enfant et ayant une certaine fréquence
d’apparition dans le langage. Deux kits de lettres cursives sont
nécessaires, un kit de petites lettres permettant à l’enfant de
bien empaumer la lettre, un kit de lettres plus grandes per-
mettant une exploration plus systématisée de la lettre. Dans
un premier temps, l’exploration haptique est utilisée sans gui-
dage précis : l’enfant tient la lettre de petite taille dans la
main, lors d’une activité de discrimination auditive à partir de
petites phrases contenant plusieurs fois la lettre étudiée. Dans
un second temps, l’exploration haptique est guidée : l’enfant
suit les contours de la lettre de plus grande taille, selon le
tracé de l’écriture avec, puis sans contrôle visuel. Une dernière
phase consiste à retrouver la lettre étudiée placée sous un fou-
lard avec une autre lettre, servant de « distracteur », et dont
les caractéristiques sont plus ou moins proches de la lettre
étudiée. On introduit donc une modalité d’exploration (hap-
tique) que l’on sait adaptée pour discriminer nement les
formes et les orientations des objets et constituant même une
modalité d’exploration préférentielle chez les plus jeunes. Elle
permettrait donc de mieux stabiliser les caractéristiques inhé-
rentes à chaque lettre en améliorant sa représentation et ainsi
sa mémorisation.
La technique graphique d’extension aborde des éléments
toniques et posturaux, lors de tracés de grande amplitude réa-
lisés à la craie sur des supports muraux. Elle sollicite des traces
de base sur des mouvements d’extension : cercles, droites et
courbes abordables avec les plus jeunes. Le psychomotricien
introduit des conditions particulières de traçage neutralisant
certains paramètres d’exécution motrice pour en mettre
d’autres en exergue selon les objectifs thérapeutiques visés. La
nature de ces paramètres sera essentiellement sensorielle :
postural, tonique, visuel et kinesthésique. Ils sont portés à la
connaissance de l’enfant et servent de feedbacks. Ces feed-
backs inuenceront, par exemple, la distance au support,
l’orientation du corps pendant l’exécution de la trace, l’utilisa-
tion ou non du contrôle visuel, la tonicité du bras. An d’assu-
rer une meilleure intégration de ces feedbacks aux réalisations
suivantes, le principe d’apprentissage implicite par analogie
peut aider certains enfants à mieux s’en saisir ; il s’agit d’utili-
ser des images qui faciliteront cette intégration. Par exemple,
suggérer de « caresser un chat qui fait le dos rond » permet
de guider l’orientation de la trace et la gestion des appuis plus
aisément qu’une consigne directe sur les caractéristiques à
modier dans la posture et le mouvement. L’enfant sera invité
à observer sa trace et y faire correspondre une réponse
motrice plus ajustée pour en parfaire la uidité et la qualité.
Ces ajustements naitront des guidages verbaux explicites et/
ou implicites opérés sur les composantes perceptives du
mouvement.
Ces deux techniques visent à aider l’enfant dans sa phase
d’apprentissage de l’écriture. Leur complémentarité se situe
dans les types de mouvements qu’elles abordent ; l’AMSL sou-
tient les composantes morphocinétiques de l’écriture, à savoir
la formation de lettres de quelques centimètres, assurées par
le poignet et les doigts. La TGE participe, quant à elle, à la
gestion des composantes topocinétiques de l’écriture, qui
régissent les déplacements dans un espace graphique donné
(agencement, orientation, maintien de la ligne), assurés par
l’ensemble du bras.
De la trace écrite au mouvement d’écriture
Si, du point de vue du lecteur, une écriture dysgraphique se
résume à l’écriture de mots illisibles, elle peut également être
envisagée comme la conséquence d’un mouvement mal
maitrisé.
Depuis les années 1980, avec le développement des tablettes
graphiques, le regard originellement porté sur la qualité de la
trace statique sur le papier s’est tourné vers l’analyse du pro-
cessus d’écriture, c’est-à-dire vers les aspects moteur impli-
qués dans la formation de la trace écrite. D’un point de vue
technique, l’enregistrement du déplacement et de la pression
4
- © Les entretiens de Bichat 2016
W Psychomotricité
PSY_01_soppelsa.indd 4 27/06/2016 12:29

de la pointe du stylo au cours du temps permet d’étudier les
variations cinématiques et dynamiques sous-jacentes au mou-
vement d’écriture. D’un point de vue clinique, l’objectif visé
est double : il s’agit d’une part de déterminer les caractéris-
tiques d’un mouvement d’écriture dysgraphique pour en af-
ner les symptômes et le diagnostic et, d’autre part, de propo-
ser des méthodes de rééducation directement centrées sur la
remédiation des troubles du mouvement d’écriture.
Intérêt des nouvelles technologies pour le diagnostic
de la dysgraphie
La qualité du mouvement d’écriture repose principalement sur
des variables dites « cachées », c’est-à-dire non visibles dans
la trace écrite, comme par exemple la pression exercée sur la
feuille, les accélérations inappropriées du stylo ou ses arrêts,
etc. Si l’outil (la tablette) permet d’accéder à un large panel de
variables, la question est de savoir lesquelles sont pertinentes
pour afner le diagnostic de la dysgraphie. À partir d’une
méta-analyse sur les troubles de l’écriture [17], nous pouvons
identier trois variables comme pertinentes pour informer sur
la qualité du mouvement d’écriture : la vitesse du mouvement,
sa uence, et la pression exercée par le stylo sur la feuille.
Concernant cette dernière variable, il est très probable que la
pression exercée par les doigts sur le stylo soit plus informative
encore que celle exercée par le stylo sur la feuille mais la tech-
nologie2 ne permet pas actuellement d’inclure cette variable.
Quelles sont alors les perspectives pour le diagnostic de la dys-
graphie ? Nous avons vu que le test de référence en France est
le BHK [13]. Imaginons à présent que ce test s’effectue de la
même manière sur tablette graphique, avec une feuille
blanche xée dessus et un stylo compatible qui laisse une
trace pour garder les conditions naturelles d’écriture.
L’inclusion (non exhaustive) des variables cinématiques et
dynamiques sur le décours de l’écriture pourrait permettre
d’afner le contour de l’expression de la dysgraphie, notam-
ment en isolant les moments où l’enfant écrit des moments
où il lit le texte qu’il doit recopier3.
Intérêt des nouvelles technologies pour la rééducation
de la dysgraphie
Au-delà d’une aide pour le diagnostic de la dysgraphie, les
nouvelles technologies peuvent également aider le scripteur à
mieux écrire. Comment ? Une première idée, qui paraît la plus
intuitive, est de faire ressentir le mouvement correct. C’est ce
que font souvent les thérapeutes lorsqu’ils prennent la main
du scripteur et la guide pour faire ressentir les sensations sous-
jacentes au mouvement correct. Cependant, la principale
limite de cette méthode est que le scripteur n’est plus maître
du mouvement qu’il effectue : les informations provenant des
2 La pression exercée par les doigts sur le stylo requiert la présence de capteurs
de force sur le stylo. Certains prototypes sont développés dans le domaine de la
recherche mais, à notre connaissance, aucune industrie ne propose encore des
tablettes graphiques avec des stylets équipés de capteurs de force.
3 À l’heure actuelle, le critère de vitesse du BHK, basé sur le nombre de lettres
écrites en 5 minutes, est biaisé par le temps de lecture du texte à recopier.
muscles du membre effecteur (c’est-à-dire de la main qui tient
le stylo) ne sont donc pas correctes et cela perturbe le contrôle
naturel de l’écriture. L’autre piste de recherche, que nous
allons plus précisément détailler à titre illustratif, est de
retranscrire ces variables cachées en informations sonores
pour permettre au scripteur d’entendre ce qui est correct, et
ce qu’il ne l’est pas, dans son mouvement d’écriture an de
mieux l’exécuter.
Un exemple : sonier l’écriture
L’écriture est une activité silencieuse, exception faite du léger
son de frottement du stylo sur la feuille qui n’est pas réelle-
ment pris en compte par le scripteur. L’audition est donc une
modalité sensorielle disponible pour véhiculer des informa-
tions supplémentaires pendant l’écriture. La sonication de
l’écriture consiste, dans le cas présent, à convertir en informa-
tion sonore certaines variables du mouvement pour rendre
perceptible ces variables cachées de l’écriture. Les sons
peuvent facilement transmettre des informations temporelles
ou dynamiques pour lesquelles la vision est moins sensible. Ils
s’avèrent donc particulièrement pertinents pour renseigner sur
les variables du mouvement d’écriture. Enn, notons que
l’ajout d’informations sonores peut moduler l’attention et la
motivation. La composante esthétique ou ludique que
peuvent revêtir les sons est un facteur motivationnel d’autant
plus crucial qu’un dysgraphique se trouve la plupart du temps
dans un rapport conictuel avec l’acte d’écrire.
Avec l’aide précieuse d’acousticiens experts dans la synthèse
et le contrôle sonore, une méthode de sonication de l’écri-
ture en temps-réel sur tablette graphique a été conçue. Elle
est actuellement en n de validation expérimentale car il reste
encore à vérier l’importance de ne pas créer une « prothèse
sonore » dont le scripteur deviendrait dépendant et sans
laquelle l’écriture se dégraderait de nouveau.
Conclusion : importance de l’écriture manuscrite
De manière générale, l’avènement rapide des tablettes4 dans
le monde de l’éducation amène à repenser les méthodes d’ap-
prentissage et à se questionner sur l’intérêt d’apprendre
encore l’écriture le stylo à la main, surtout chez l’enfant atteint
d’une dysgraphie. Cet avènement conduit à une émulation
dans la communauté scientique qui cherche à déterminer
l’impact de la disparition de l’écriture manuscrite.
Pour illustrer l’importance d’écrire à la main, retournons au
cas où l’écriture fait du bruit, lorsque par exemple la feuille
laisse place au tableau noir et le stylo à la craie. Il devient alors
possible de reconnaître les yeux fermés la lettre écrite entre
par exemple un « X » ou « Z », uniquement grâce au son qui
informe sur le nombre de traits qui composent la lettre. Cet
exemple illustre parfaitement comment des informations
(sonores dans notre exemple) sur le mouvement d’écriture
participent à l’encodage de la lettre. Des travaux ont ainsi
4 Autour de 130 000 tablettes sont recensés dans les écoles en 2015 en France
(voir http://eduscol.education.fr/cid71927/tablettes-tactiles-retours-d-experi-
mentations-et-potentialites-pedagogiques.html pour plus de détails).
© Les entretiens de Bichat 2016 -
5
Psychomotricité W
PSY_01_soppelsa.indd 5 27/06/2016 12:29
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%