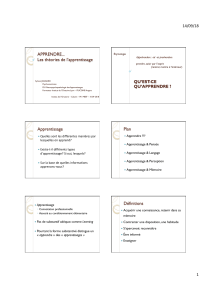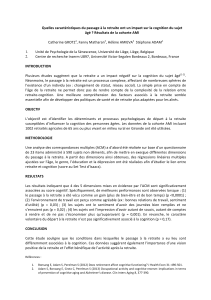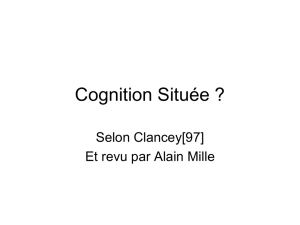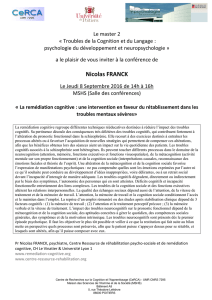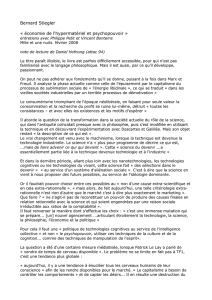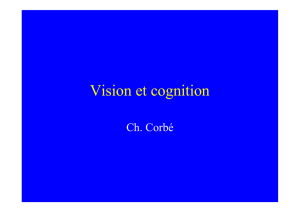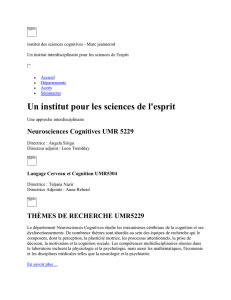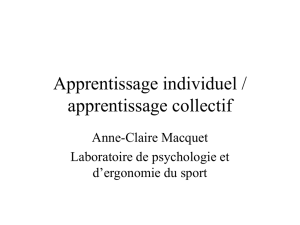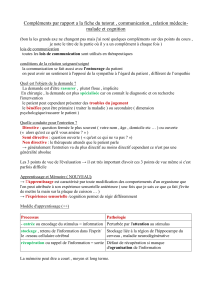See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/303306564
Cognition sociale
ArticleinEMC - Neurologie · May 2016
DOI: 10.1016/S0246-0378(16)65655-5
CITATIONS
3
READS
8,222
1 author:
Some of the authors of this publication are also working on these related projects:
MRI correlates of episodic memory deficits in amyotrophic lateral sclerosis View project
Cognition sociale & neuropsychologie française View project
Maxime Bertoux
French Institute of Health and Medical Research
104 PUBLICATIONS1,741 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Maxime Bertoux on 20 November 2017.
The user has requested enhancement of the downloaded file.

17-022-E-30
Cognition
sociale
M.
Bertoux
Les
processus
neurocognitifs
qui
nous
permettent
d’interagir
avec
autrui
de
manière
adaptée
composent
la
«
cognition
sociale
»
qui
se
réfère
spécifiquement
à
la
manière
dont
nous
percevons,
traitons
et
interpré-
tons
les
informations
sociales.
Composante
non
négligeable
de
l’intelligence
humaine
pourtant
longtemps
négligée,
elle
jouit
depuis
une
quinzaine
d’années
d’un
intérêt
croissant,
proportionnel
au
développe-
ment
des
neurosciences
sociales.
Le
bon
fonctionnement
de
la
théorie
de
l’esprit,
de
l’empathie
et
de
la
reconnaissance
des
émotions
(permettant
d’inférer
ce
qu’autrui
pense
et
ressent),
de
même
qu’une
connaissance
des
normes
sociales
et
une
fine
analyse
des
contextes
nous
permettent
de
vivre
ensemble
en
«
harmonie
»
et
de
coopérer
efficacement,
deux
éléments
assurant
la
survie
de
l’espèce.
Soutenues
par
certains
processus
cognitifs
transversaux,
ces
fonctions
modulent
drastiquement
nos
comportements
sociaux
quotidiens
et
ont
une
influence
déterminante
sur
notre
bien-être
et
notre
réussite
sociale.
Cet
article
propose
un
aperc¸u
des
connaissances
actuelles
sur
la
cognition
sociale
et
les
fonctions
qui
y
sont
associées.
Il
en
présente
les
corrélats
neuroanatomiques
et
évoque
ensuite
les
maladies
neurologiques
et
psychiatriques
fréquemment
associées
à
–
ou
caractérisées
par
–
une
perturbation
de
la
cognition
sociale,
avant
de
terminer
par
un
court
inventaire
des
outils
neuropsychologiques
les
plus
fréquemment
utilisés
pour
son
évaluation
clinique.
L’article
souligne
l’importance
des
fonctions
de
la
cognition
sociale
dans
les
comportements
humains
et
l’adaptation
à
la
société.
Faisant
écho
à
la
reconnaissance
de
la
cogni-
tion
sociale
comme
étant
l’un
des
six
domaines
cognitifs
principaux
au
sein
du
manuel
diagnostique
et
statistique
des
troubles
mentaux
(cinquième
édition),
l’article
plaide
pour
une
évaluation
quasi
systéma-
tique
de
la
cognition
sociale
en
neurologie
et
en
psychiatrie
et
pour
le
développement
de
nouveaux
tests
cliniques
permettant
une
évaluation
rapide
mais
multidimensionnelle
de
ce
domaine
cognitif.
©
2016
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
Mots-clés
:
Cognition
sociale
;
Théorie
de
l’esprit
;
Empathie
;
Émotions
;
Autisme
;
Démence
frontotemporale
Plan
■Introduction
1
■Fonctions
de
la
cognition
sociale
2
Théorie
de
l’esprit
2
Empathie
2
Reconnaissance
des
émotions
2
Régulation
émotionnelle
2
Sémantique
sociale
:
normes
conventionnelles
et
morales
2
Analyse
contextuelle
3
Mécanismes
aspécifiques
de
soutien
de
la
cognition
sociale
:
fonctions
exécutives
et
circuit
de
la
récompense
3
■Bases
neurales
3
■Maladies
de
la
cognition
sociale
4
■Évaluation
clinique
4
Théorie
de
l’esprit
5
Empathie
5
Reconnaissance
émotionnelle
5
■Conclusion
5
Introduction
Vouloir
définir
ce
qu’est
la
«
cognition
sociale
»
reviendrait
presque
à
définir
ce
qu’est
la
cognition
tant
l’humain
est
un
ani-
mal
social.
La
plupart
de
nos
activités
quotidiennes
sont
motivées
et/ou
modulées
par
des
buts
et
contextes
sociaux.
Il
en
est
ainsi
depuis
notre
enfance [1] et
il
en
sera
de
même
tout
au
long
de
notre
vie [2].
L’essentiel
de
nos
vies
étant
social,
il
est
difficile
de
dire
que
telle
ou
telle
fonction
cognitive
n’appartient
pas
à
la
cognition
sociale
;
notre
cerveau,
disproportionné
pour
notre
taille,
pour-
rait
d’ailleurs
être
le
pur
produit
d’une
évolution
nous
permettant
de
gérer
des
systèmes
sociaux
complexes [3].
La
cognition
sociale
se
réfère
spécifiquement
à
la
manière
dont
nous
percevons,
traitons
et
interprétons
les
informations
sociales.
La
cognition
sociale
per-
met
donc
de
reconnaître
les
émotions
des
autres,
de
deviner
ou
d’interpréter
leurs
sentiments,
croyances
ou
idées
et
d’y
répondre
de
manière
appropriée.
Elle
est
l’ensemble
des
processus
qui
nous
permet
de
comprendre
et
de
se
représenter
les
autres
personnes
et
groupes
sociaux,
de
réguler
nos
émotions,
d’établir
des
normes
sociales
et
morales
et
de
coopérer
ensemble.
En
bref,
la
cognition
sociale
est
la
somme
des
processus
neurocognitifs
nous
permet-
tant
de
nous
adapter
à
un
groupe
et
à
la
société.
EMC
-
Neurologie 1
Volume
0
>
n◦0
>
xxx
2016
http://dx.doi.org/10.1016/S0246-0378(16)65655-5

17-022-E-30 Cognition
sociale
Représentation cognitive
Théorie de l'esprit
Théorie de l'esprit cognitive Théorie de l'esprit affective / Empathie
cognitive
Se représenter les pensées,
croyances des autres
Se représenter les
sentiments des autres
Ressentir les sentiments des
autres
Représentation affective
Empathie
Empathie affective
Figure
1.
Représentation
sché-
matique
du
chevauchement
entre
théorie
de
l’esprit
et
empathie.
Du
fait
de
son
importance
cruciale
dans
les
relations
inter-
personnelles
et
la
psyché
humaine,
il
est
surprenant
de
voir
que
l’essentiel
des
découvertes
dans
ce
domaine
s’est
fait
après
2000.
Pionnière
à
vouloir
décrire
l’architecture
cognitive
de
la
pensée,
la
psychologie
de
l’intelligence
a
toujours
négligé
les
apti-
tudes
relatives
aux
relations
avec
autrui
et
celles-ci
n’ont
jamais
été
intégrées
au
modèle
Cattell-Horn-Carroll,
principal
modèle
de
l’intelligence [4].
Si
l’engouement
des
neurosciences
pour
la
cognition
sociale
conduit
progressivement
à
effacer
l’arbitraire
distinction
entre
cognitif,
émotionnel,
social
et
comportemen-
tal,
beaucoup
reste
à
faire
dans
ce
vaste
champ
si
longtemps
négligé.
Une
fois
n’est
pas
coutume,
c’est
de
l’étude
de
ses
troubles
que
nous
vient
de
nombreuses
connaissances
sur
la
cognition
sociale.
La
description
des
mécanismes
autistiques,
l’exploration
des
séquelles
des
lésions
cérébrales
ou
encore
l’étude
des
maladies
neurodégénératives
ont
permis
d’approfondir
nos
connaissances
sur
les
fonctions
et
régions
cérébrales
qui
sous-tendent
la
cogni-
tion
sociale [5,
6].
Certaines
études
dissèquent
ses
mécanismes
et
essaient
de
comprendre
leur
architecture,
leur
spécificité
ou
la
nature
de
leurs
interactions
avec
d’autres
fonctions
cognitives.
D’autres
montrent
à
quel
point
l’évaluation
de
la
cognition
sociale
représente
un
intérêt
clinique
capital.
Il
est
en
effet
bien
établi
que
les
troubles
de
la
cognition
sociale
sont
à
l’origine
d’un
handi-
cap
fonctionnel
important
:
ils
entraînent
une
baisse
de
la
qualité
de
vie
et
favorisent
le
chômage,
l’isolement,
la
survenue
de
pro-
blèmes
mentaux,
et
parfois,
de
comportements
criminels [7–10].
Ils
sont
également
source
de
tensions
et
de
ressentiment
importants
pour
les
proches
des
patient(e)s,
entraînant
des
conséquences
dra-
matiques
sur
leur
propre
santé
et
qualité
de
vie.
Au
cours
d’une
évaluation
clinique,
il
apparaît
ainsi
crucial
d’allouer
un
moment
pour
évaluer
les
fonctions
de
la
cognition
sociale,
que
je
décris
ici
succinctement.
Fonctions
de
la
cognition
sociale
Théorie
de
l’esprit
La
théorie
de
l’esprit
est
une
fonction
centrale
de
la
cognition
sociale
et
donc
un
facteur
déterminant
dans
les
rapports
sociaux
et
l’adaptation
à
un
environnement
social.
La
théorie
de
l’esprit
est
la
fonction
cognitive
qui
nous
permet
d’inférer
les
états
mentaux
d’autrui.
Elle
est
le
plus
souvent
divisée
en
théorie
de
l’esprit
cogni-
tive
et
affective.
La
première
permet
la
représentation
mentale
des
croyances,
intentions
ou
pensées
d’autrui
et
la
deuxième
la
repré-
sentation
mentale
des
émotions
ou
sentiments
d’autrui.
La
théorie
de
l’esprit
affective
est
également
appelée
«
empathie
cognitive
».
La
Figure
1
permet
d’illustrer
comment
théorie
de
l’esprit
et
empa-
thie
s’articulent
pour
la
majeure
partie
des
théoricien(ne)s
de
la
cognition
sociale [11].
L’une
(théorie
de
l’esprit)
traite
les
informa-
tions
davantage
cognitives
tandis
que
l’autre
(l’empathie)
traite
les
informations
plus
affectives.
Empathie
L’empathie
est
la
capacité
de
partager
et
de
comprendre
les
sentiments
des
autres.
C’est
une
fonction
fondamentale
de
l’expérience
émotionnelle
et
son
rôle
est
majeur
dans
les
inter-
actions
sociales
puisqu’elle
permet
la
communication
affective
et
motive
les
individus
à
agir
de
manière
prosociale,
notamment
en
favorisant
l’attachement [12].
L’empathie
peut
être
divisée
en
deux
composantes,
une
«
empathie
cognitive
»
superposable
à
la
théorie
de
l’esprit
affective,
qui
permet
la
représentation
mentale
des
émotions
ou
sentiments
d’autrui
et
une
«empathie
affec-
tive
»,
qui
permet
une
réponse
émotionnelle
aux
émotions
ou
sentiments
d’autrui.
L’empathie
affective
est
donc
la
capacité
à
ressentir
ce
qu’autrui
ressent
(e.g.
ressentir
de
la
tristesse
lors
du
chagrin
d’un(e)
proche),
aussi
appelée
«
contagion
émotion-
nelle
»,
ou
encore
de
ressentir
un
sentiment
différent
en
réaction
à
ce
qu’une
autre
personne
ressent
(e.g.
de
l’embarras
devant
une
personne
trop
joviale) [11,
13].
Notons
que
cette
distinction
entre
«
cognitif
»
et
«
affectif
»
est
ici
une
pure
distinction
de
lan-
gage
puisqu’il
s’agit
bien,
dans
un
cas
comme
dans
l’autre,
de
représentations
cognitives
véhiculant,
dans
le
deuxième
cas,
une
information
émotionnelle.
Reconnaissance
des
émotions
L’émotion
peut
être
définie
comme
une
expérience
psychophy-
siologique
résultant
d’une
confrontation
entre
stimuli
internes
(pensée,
représentation,
interprétation)
et
environnementaux.
Elle
se
traduit
par
une
réaction
interne
psychologique
et
génère
une
réaction
externe
motrice
(e.g.
tonus
musculaire,
tremble-
ments,
fuite,
etc.)
et
physiologique
(e.g.
pâleur,
rougissement,
augmentation
du
rythme
cardiaque,
etc.).
Pour
Darwin
déjà [14],
l’émotion
avait
fonction
d’adaptation,
de
communication
et
de
rétrorégulation.
Les
travaux
d’Ekman [15] ont
permis
d’identifier
sept
émotions
dites
«
canoniques
»
ou
universelles,
indépendantes
des
origines
culturelles
:
la
colère,
le
dégoût,
la
joie,
la
neutralité,
la
peur,
la
surprise
et
la
tristesse.
Malgré
les
débats
qui
accompagnent
cette
théorie [16],
la
majorité
des
auteur(e)s
s’inspirent
aujourd’hui
de
ces
travaux.
D’autres
travaux
nous
ont
permis
de
concevoir
l’émotion
comme
une
réponse
cérébrale
à
des
stimuli
récompen-
sant
ou
punissant [17].
Dans
cette
optique,
les
émotions
sont
donc
des
renforc¸ateurs
qui
ont
par
ailleurs
une
fonction
de
communi-
cation
spécifique [18].
La
reconnaissance
des
émotions
serait
donc
la
traduction,
par
un
autre
individu,
de
cette
communication [19].
Régulation
émotionnelle
Notre
capacité
à
réguler
nos
émotions
en
fonction
des
situations
auxquelles
nous
faisons
face
a
une
valeur
adaptative
évidente,
en
nous
permettant
par
exemple
de
rester
calme
face
au
danger
ou
encore
de
positiver
pour
finir
une
tâche
laborieuse [20].
S’il
ne
s’agit
pas
là
d’une
fonction
sociale
per
se,
cette
capacité
à
suppri-
mer
la
réponse
physiologique
externe
d’une
émotion
(suppression
émotionnelle)
ou
à
modifier
la
manière
dont
nous
évaluons
une
situation
pour
en
changer
notre
ressenti
(réévaluation
cognitive)
a
une
valeur
évidente
d’adaptation
sociale [21] (ou
in [22]).
Sémantique
sociale
:
normes
conventionnelles
et
morales
Savoir
interagir
normalement
avec
les
autres
dépend
également
d’un
ensemble
de
règles,
établies
pour
permettre
aux
humains
de
vivre
en
harmonie [23].
Ces
normes
sociales
sont
un
ensemble
de
croyances
partagées
de
tous
sur
ce
qui
constitue
un
comportement
2EMC
-
Neurologie

Cognition
sociale 17-022-E-30
approprié
ou
non
dans
une
situation
particulière [24].
Elles
sont
à
l’origine
des
lois
et
de
la
moralité [25,
26] et
peuvent
être
partagées
au
sein
d’une
culture
particulière
(e.g.
dire
bonjour
en
entrant
dans
une
boulangerie),
ou
sont
plus
universelles
et
à
forte
valeur
morale
(e.g.
ne
pas
jouer
avec
la
nourriture),
et
parfois
codifiées
et
établies
en
loi
(e.g.
ne
pas
tuer).
Bienséance,
étiquette,
conven-
tions
sont
d’autres
appellations
de
ce
stock
de
normes
sociales
que
nous
possédons
et
appliquons
tous
au
quotidien
sans
même
nous
en
rendre
compte.
“
Point
fort
Exemple
quotidien
du
respect
des
normes
sociales
et
de
la
manière
dont
elles
fac¸onnent
notre
comportement
Déjeunant
au
restaurant,
ce
sont
les
normes
sociales
qui
me
font
:
attendre
que
chacun
soit
servi
à
ma
table
avant
d’entamer
mon
plat,
mettre
mes
mains
et
non
mes
coudes
sur
la
table,
étendre
ma
serviette
sur
mes
cuisses
et
non
l’attacher
à
mon
col,
me
tenir
droit
sur
ma
chaise,
garder
une
conversation
«
de
bon
ton
»,
servir
les
autres
ou
leur
proposer
de
les
servir
quand
je
me
sers
de
l’eau,
dire
par-
don
quand
mon
bras
passe
devant
un
convive,
attendre
que
chacun
ait
terminé
pour
demander
l’addition,
payer
l’addition
équitablement
et
me
lever
sans
fracas.
D’autres
normes
peuvent
encore
m’encourager
à
laisser
ou
non
un
pourboire
sur
la
table
ou
directement
lors
du
paie-
ment.
Je
peux
également
me
conformer
à
d’autres
normes
sociales
me
faisant
entrer
dans
le
restaurant
avant
ma
par-
tenaire,
tirer
sa
chaise
pour
qu’elle
s’asseye
et
lui
tenir
la
porte
en
sortant.
D’autres
encore
peuvent
me
pousser
ou
m’empêcher
de
renvoyer
un
plat
s’il
n’est
pas
chaud,
à
accepter
ou
refuser
le
vin
qu’on
me
sert
si
son
goût
n’est
pas
à
ma
convenance,
à
exiger
que
l’on
change
mon
cou-
vert
si
celui-ci
est
d’une
propreté
discutable,
à
exiger
le
changement
ou
le
remboursement
d’un
plat
ou
d’une
boisson
si
elle
n’est
pas
à
la
hauteur
de
mes
attentes.
Politesse,
bienséance,
galanterie,
l’ensemble
de
ces
comportements
est
modulé
par
ma
propre
culture,
mon
genre,
mon
âge,
mon
éducation,
mon
environnement
socioculturel
et
économique
et
l’endroit
dans
lequel
je
déjeune.
Un
cadre
supérieur,
habitué
à
déjeuner
au
res-
taurant
et
à
un
certain
niveau
d’exigence
sera
plus
à
l’aise
avec
l’idée
de
renvoyer
une
bouteille
plutôt
qu’une
étu-
diante
issue
d’un
milieu
défavorisé
;
de
même,
il
n’aura
pas
la
même
exigence
dans
un
restaurant
étoilé
que
dans
une
pizzeria
de
quartier.
Le
respect
des
normes
et
leur
réciprocité
sont
renforcés
par
la
punition
sociale
(le
rejet)
ou
la
menace
de
cette
punition
et
per-
mettent
in
fine
la
coopération
humaine [27].
D’un
point
de
vue
cognitif,
l’application
de
ces
normes
implique
leur
apprentissage,
la
capacité
à
prédire
les
conséquences
d’une
action
impliquant
le
respect
ou
non
de
ces
normes,
la
prise
en
compte
de
ces
prédictions
pour
prendre
des
décisions
correctes
et
guider
son
comportement,
l’évaluation
des
états
mentaux
des
autres
dans
le
contexte
de
ces
normes
et,
éventuellement,
d’agir
en
conséquence
suite
à
une
transgression
de
ces
normes [26].
Analyse
contextuelle
Le
contexte
joue
un
rôle
important
dans
nos
propres
attitudes
et
représentations
cognitives
ou
affectives
mais
module
également
les
inférences
et
interprétations
que
nous
avons
des
états
men-
taux
ou
émotionnels
de
nos
congénères.
L’attitude
d’autrui
ne
peut
être
interprétée
efficacement
que
si
elle
est
contextualisée.
De
même
qu’un
visage
surpris
pourra
être
perc¸u
comme
effrayé
dans
un
contexte
effrayant,
ce
que
nous
savons
de
l’histoire
de
cer-
taines
personnes
est
un
contexte
qui
modulera
nos
actions
envers
eux.
La
régulation
émotionnelle
ou
l’adaptation
sociale
pour-
raient
aussi
être
considérées
comme
des
mises
à
jour
constantes
et
volontaires
du
contexte [28].
L’intégration
des
informations
contextuelles
sert
donc
la
cognition
sociale
et
modulerait
ses
fonctions [29,
30].
Elle
pourrait
être
imaginée
comme
une
boucle
interprétant
et
réinterprétant
sans
cesse
un
stimulus.
À
chaque
boucle,
l’analyse
viendrait
s’enrichir
d’informations
contextuelles
d’abord
évidentes
puis
plus
élaborées [31,
32].
À
terme,
l’analyse
contextuelle
permettrait
d’effectuer
des
prédictions,
basées
sur
des
informations
plus
abstraites
telles
que
la
nature
de
nos
relations
avec
les
autres
et
les
expériences
passées [29].
Mécanismes
aspécifiques
de
soutien
de
la
cognition
sociale
:
fonctions
exécutives
et
circuit
de
la
récompense
Comme
toute
fonction
de
haut
niveau,
la
cognition
sociale
repose
sur
des
systèmes
de
plus
bas
niveau
et
implique
des
fonc-
tions
cognitives
transversales
comme
le
langage,
la
mémoire
et
les
fonctions
exécutives [33,
34].
Le
lien
entre
fonctions
exécu-
tives
et
théorie
de
l’esprit
est
particulièrement
discuté
dans
la
littérature
(pour
une
revue [35]).
Certain(e)s
plaident
pour
une
dépendance
stricte,
considérant
la
théorie
de
l’esprit
comme
une
fonction
exécutive [36],
quand
d’autres
plaident
pour
une
relative
indépendance [37].
Il
semblerait
que
cognition
sociale
et
fonc-
tions
exécutives
soient
des
dimensions
bien
distinctes
de
l’esprit
humain,
mais
en
interaction [38].
Certaines
fonctions
exécutives
soutiendraient
en
effet
certains
aspects
de
la
cognition
sociale,
en
permettant
par
exemple
d’inhiber
notre
propre
état
men-
tal
ou
émotionnel
(inhibition
cognitive)
avant
de
changer
de
perspective
(flexibilité
mentale)
pour
inférer
celui
d’autrui [39,
40].
Les
capacités
d’abstraction
et
la
mémoire
de
travail
pourraient
également
être
impliquées
dans
la
création
et
le
maintien
de
cette
nouvelle
représentation [37].
Enfin,
l’inhibition
et
la
flexibilité
seraient
également
à
l’œuvre
dans
la
régulation
émotionnelle [31].
Le
système
de
la
récompense
est
un
autre
système
transversal
impliqué
dans
la
cognition
sociale.
Nos
échanges
et
interactions
sociales
sont
fac¸onnés
par
la
poursuite
de
récompenses
sociales
:
attractivité,
approbation,
acceptation,
reconnaissance,
récipro-
cité,
qui
vont
elles-mêmes
influencer
notre
statut
social
et
notre
réputation.
Ces
récompenses
sont
d’une
importance
critique
dans
notre
connaissance
d’autrui
et
le
développement
de
relations
non
superficielles,
deux
nécessités
à
l’adaptation
et
à
la
survie
de
l’espèce.
Au
sein
d’un
réseau
social
réel
(mais
aussi
«
en
ligne
»,
sur
internet),
elles
permettent
de
solidifier
les
liens
sociaux
et
de
réaffirmer
ou
de
caractériser
des
relations
(e.g.
relation
amicale,
romantique,
etc.) [41].
Elles
modulent
et
sont
modulées
par
des
fac-
teurs
tels
que
la
proximité,
la
confiance
et
le
soutien
et
sont
traitées
par
le
cerveau
de
la
même
manière
que
les
récompenses
primaires
(i.e.
nourriture
ou
sexe)
via
le
circuit
de
la
récompense,
impli-
quant
notamment
le
cortex
préfrontal
médian/ventromédian
et
le
striatum
ventral [42].
Bases
neurales
Du
fait
de
son
implication
centrale
dans
des
processus
tels
que
les
jugements
d’intentionnalité,
le
jugement
moral,
l’attribution
d’actions,
de
traits
de
caractère,
de
personnalité
et
l’anticipation
des
actions
d’autrui,
le
cortex
préfrontal
médian
constituerait
le
noyau
de
la
cognition
sociale
et
servirait
de
module
d’intégration
des
informations
sociales
plurimodales [43,
44].
De
nombreuses
études
lésionnelles
et
d’imagerie
fonctionnelle
montrent
le
rôle
crucial
du
cortex
préfrontal
médian
dans
la
théorie
de
l’esprit
(cf.
les
méta-analyses [45–47])
et
l’empathie [48,
49].
Le
cortex
cingulaire
antérieur,
du
fait
de
son
implication
dans
les
aspects
exécutifs
de
la
cognition
(e.g.
supervision,
contrôle,
inhibition),
serait
aussi
impliqué
dans
les
processus
de
régulation
émotionnelle [20] et
d’apprentissage
probabiliste,
à
l’œuvre
dans
l’intégration
de
nou-
velles
normes
et
récompenses
sociales.
EMC
-
Neurologie 3

17-022-E-30 Cognition
sociale
1
3
5
7
2
4
6
Figure
2.
Localisation
des
corrélats
neuroanato-
miques
de
la
théorie
de
l’esprit.
1.
Jonction
tem-
poropariétale
;
2.
pôle
temporal
;
3.
cortex
orbito-
frontal
;
4.
insula
;
5.
amygdale
;
6.
cortex
préfron-
tal
médian
;
7.
cortex
préfrontal
ventromédian.
Le
cortex
orbitofrontal
semble
également
capital
pour
évaluer
la
valence
émotionnelle
d’un
stimulus
en
contexte
et
pour
déter-
miner
la
justesse
d’une
possible
réponse
envers
lui [21,
50].
Cette
région,
centrale
dans
le
codage
des
valeurs
et
dans
l’évaluation
des
contingences,
permettrait
d’éviter
la
transgression
des
normes
lors
de
la
réalisation
d’une
action [51,
52].
Cette
région
est
en
outre
importante
pour
la
reconnaissance
de
la
colère,
une
expression
généralement
associée
à
la
transgression
d’une
règle [18].
La
jonction
temporopariétale
est
impliquée
dans
de
nombreux
processus
à
l’œuvre
dans
la
théorie
de
l’esprit,
notamment
pour
inférer
ou
prédire
les
états
mentaux
d’une
personne
à
partir
des
diverses
informations
disponibles
sur
celle-ci [30,
47].
L’insula
assurerait
la
coordination
entre
les
informations
des
milieux
internes
et
externes [29],
une
étape
essentielle
de
l’analyse
contextuelle
et
de
l’apprentissage
par
renforcement,
deux
fonc-
tions
capitales
de
l’intégration
des
normes
sociales [53,
54].
Cette
région
est
aussi
capitale
pour
la
reconnaissance
du
dégoût [55].
Le
pôle
temporal
effectuerait
l’association
entre
les
stimuli
(situation,
inférence,
etc.)
et
le
contexte [29].
Il
serait
égale-
ment
impliqué
dans
les
tâches
de
théorie
de
l’esprit [56].
Plus
globalement,
le
lobe
temporal
pourrait
permettre
le
stockage
et
l’indexation
des
normes
ou
caractéristiques
sociales
inva-
riantes [57].
L’amygdale,
impliquée
dans
la
reconnaissance
de
la
peur [58],
permet
plus
généralement
la
détection
des
stimuli
à
valeur
émo-
tionnelle
et
jouerait
ainsi
un
rôle
important
dans
la
régulation
émotionnelle.
Ces
régions,
représentées
sur
la
Figure
2,
sont
les
principales
régions
impliquées
dans
les
divers
processus
de
la
cognition
sociale [43,
45–47].
D’autres
régions
sont
également
impliquées
dans
la
cognition
sociale,
à
des
degrés
divers
de
spécificité
et
d’importance.
Le
stria-
tum,
central
dans
l’apprentissage
associatif
(entre
un
stimulus
et
sa
valeur)
et
prédictif
(quand
l’association
précédente
n’est
pas
constante
mais
probable) [17] aurait
un
rôle
important
dans
l’apprentissage
et
l’adaptation
aux
normes
sociales [53,
54,
59] et
dans
la
poursuite
des
récompenses
sociales [41].
Citons
aussi
le
précu-
néus,
impliqué
dans
l’imagerie
mentale [60],
le
cervelet [61] dont
le
rôle
dans
les
aspects
les
plus
abstraits
de
la
cognition
sociale
a
été
démontré
et
encore
les
régions
prémotrices,
ou
plus
généralement
le
système
des
neurones
miroir [62],
impliqué
plus
spécifiquement
dans
la
perception
de
la
douleur.
Maladies
de
la
cognition
sociale
Toute
atteinte
cérébrale
peut
potentiellement
avoir
un
impact
sur
la
cognition
sociale
à
des
degrés
divers.
Ces
troubles
peuvent
s’observer
après
une
lésion
cérébrale
causée
lors
d’un
accident
vasculaire
ou
d’un
traumatisme
crânien
et
peuvent
être
les
symp-
tômes
précoces
de
certaines
maladies
neurodégénératives [63,
64].
Elle
est
particulièrement
affectée
dans
les
maladies
suivantes
:
•
l’autisme
est
un
des
troubles
neurodéveloppementaux
les
plus
fréquents,
caractérisé
par
un
trouble
de
la
communication
et
de
l’interaction
sociale
et
des
comportements
restreints
et
répé-
titifs [65].
En
plus
d’un
déficit
intellectuel
fréquent,
on
peut
observer
dans
l’autisme
un
déficit
de
reconnaissance
émotion-
nelle
(in [66]),
une
baisse
de
l’empathie
affective
et
une
atteinte
variable
de
la
théorie
de
l’esprit [67] ;
•
la
schizophrénie
est
un
trouble
neuropsychiatrique
survenant
habituellement
entre
15
et
30
ans
avec
une
prévalence
de
1
%.
Les
patient(e)s
atteint(e)s
de
schizophrénie
présentent
des
diffi-
cultés
à
identifier
les
émotions
faciales [68] et
un
déficit
variable
de
théorie
de
l’esprit [69] ;
•
la
démence
frontotemporale
est
la
deuxième
maladie
neuro-
dégénérative
du
sujet
jeune
après
la
maladie
d’Alzheimer
;
elle
est
caractérisée
par
de
nombreux
troubles
du
comportement
associés
à
l’atrophie
corticale
préfrontale,
insulaire
et
tempo-
rale.
Les
patient(e)s
présentent
un
trouble
de
la
reconnaissance
émotionnelle [6,
64,
70],
un
trouble
général
et
sévère
de
la
théo-
rie
de
l’esprit [37,
64,
71],
de
la
régulation
émotionnelle [72] ainsi
qu’une
baisse
de
l’empathie [73] et
une
perturbation
du
circuit
de
la
récompense [74,
75] ;
•
la
maladie
d’Alzheimer,
maladie
neurodégénérative
la
plus
fré-
quente,
entraîne
un
trouble
de
régulation
émotionnelle [76],
des
difficultés
de
théorie
de
l’esprit [77] et
un
trouble
de
la
reconnais-
sance
des
émotions [70].
Ces
troubles
seraient
toutefois
liés
à
la
sévérité
de
l’atteinte
cognitive
globale [70,
78] ;
•la
maladie
de
Parkinson
:
un
trouble
de
la
reconnaissance
émo-
tionnelle
peut
s’observer
dans
la
maladie
de
Parkinson [79] de
même
qu’une
dysfonction
de
certains
aspects
de
la
théorie
de
l’esprit
et
de
l’empathie,
corrélés
à
la
dégradation
cognitive
glo-
bale [80] ;
•
autres
maladies
:
on
observe
également
une
atteinte
variable
de
la
cognition
sociale
dans
la
dépression
(liée
à
la
sévérité
des
symptômes
dépressifs
et
à
l’altération
exécutive [81]),
dans
le
trouble
bipolaire
(plus
sévère
en
phase
aiguë
mais
également
présente
chez
les
patient(e)s
euthymiques [82]),
la
maladie
de
Huntington
(atteinte
sévère) [83],
le
trouble
de
l’attention
avec
ou
sans
hyperactivité
(atteinte
légère) [84],
la
sclérose
latérale
amyotrophique
(où
les
troubles
seraient
liés
à
l’atteinte
exé-
cutive) [85],
la
démence
sémantique [86] mais
aussi
la
sclérose
en
plaques,
les
syndromes
de
Williams,
de
Prader-Willi,
de
Turner,
de
Rett
et
d’Angelman
et
l’alcoolodépendance [87].
Évaluation
clinique
Considérant
l’importance
de
la
cognition
sociale
dans
les
comportements
humains,
l’étendue
et
la
complexité
des
méca-
nismes
impliqués
dans
son
bon
fonctionnement
et
le
nombre
de
maladies
qui
peuvent
les
affecter,
l’évaluation
de
la
cognition
sociale
est
capitale
en
neurologie
et
en
psychiatrie.
Son
impor-
tance
a
d’ailleurs
été
reconnue
dans
la
cinquième
édition
du
manuel
diagnostique
et
statistique
des
troubles
mentaux
(DSM-
5)
qui
considère
désormais
la
cognition
sociale
comme
l’un
des
six
principaux
domaines
cognitifs [65].
Les
raisons
de
conduire
une
évaluation
de
la
cognition
sociale
sont
évidentes
pour
quantifier
et
caractériser
les
troubles
d’un(e)
patient(e),
orienter
son
diag-
nostic
et
apprécier
l’efficacité
d’une
intervention
thérapeutique.
Lors
de
cette
évaluation,
il
est
également
important
d’identifier
si
les
troubles
observés
sont
à
imputer
à
un
trouble
spécifique
de
4EMC
-
Neurologie
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%