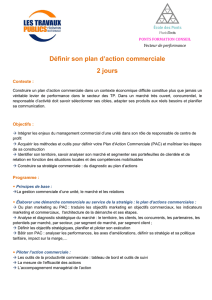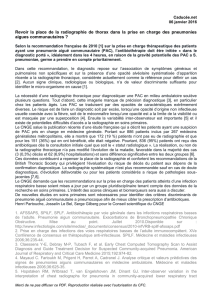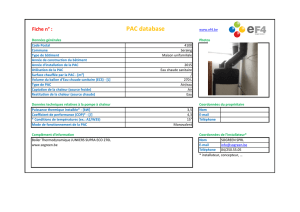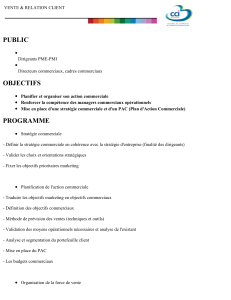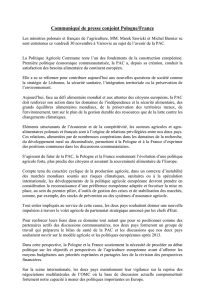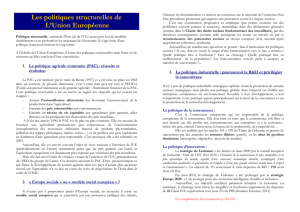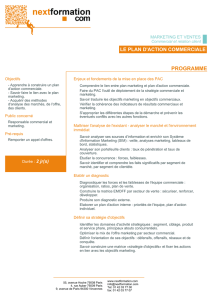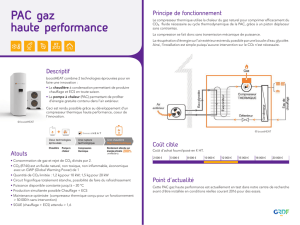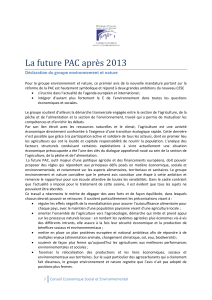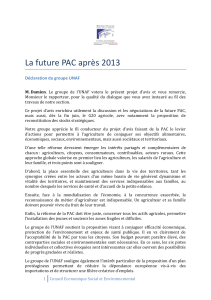85
PNEUMONIES AIGUËS
COMMUNAUTAIRES SÉVÈRES
DE L’ADULTE
J.-P. Sollet, F. Lellouche, C. Le Gall
Le but essentiel de la prise en charge d’un patient ayant une
pneumonie aiguë communautaire (PAC) sévère est d’assurer sa
guérison, c’est-à-dire permettre un retour à l’état antérieur dans les
délais les plus brefs, sans séquelle liée à la pneumonie elle-même ou
aux thérapeutiques administrées (intubation et ventilation méca-
nique, effets indésirables des médicaments, complications
nosocomiales ou iatrogènes…), et sans sélection de micro-orga-
nismes résistants. Cet objectif doit être également obtenu aux
meilleurs coûts. Les PAC sont des causes fréquentes d’hospitalisation
et de mortalité. Si la plus grande partie des PAC est prise en charge
par les médecins traitants, un phénomène sociologique sans précé-
dent fait que de nombreux patients se présentent directement aux
urgences des hôpitaux. Les cliniciens doivent reconnaître rapide-
ment la gravité initiale ou potentielle, certaines PAC pouvant
s’aggraver secondairement aux urgences ou dans un service
d’accueil.
Les formes sévères des PAC impliquent une prise en charge sans
délai. De manière concomitante, il s’agit d’une urgence :
• dans le diagnostic avec une radiographie thoracique de bonne
qualité, éventuellement une tomodensitométrie thoracique;
• dans l’évaluation de la gravité présente ou potentielle, sur des
critères simples. La compétence et l’expérience du clinicien sont
essentielles dans cette évaluation;
• dans la réalisation des prélèvements à visée microbiologique :
hémocultures, prélèvements de l’arbre bronchique, ponction pleu-
rale en cas d’épanchement et antigènes urinaires (pneumocoque et
Legionella pneumophila du sérogroupe 1);
• dans l’administration de l’antibiothérapie probabiliste intégrant
les micro-organismes extra- et intracellulaires;
• dans la prise en charge des défaillances d’organes, essentiellement
respiratoire et hémodynamique.
En raison de cette gravité, une admission rapide en réanimation
est requise.
Le pneumocoque reste la bactérie prédominante au cours des
PAC. Mais au moment du diagnostic de PAC, le pathogène respon-
sable est méconnu et le restera pour près de 50 % des PAC du fait des
limites des techniques microbiologiques d’identification. L’antibio-
thérapie est donc initialement probabiliste. Elle doit intégrer dans
son spectre l’ensemble des pathogènes potentiellement responsa-
bles, tout en restant active sur le pneumocoque. Les sociétés savantes
ont publié des recommandations précises.
L’apparition parmi les pneumocoques, de souches résistantes à
la pénicilline G, tend à modifier les schémas thérapeutiques probabi-
listes. Parmi les bêtalactamines, l’amoxicilline, les céphalosporines
de troisième génération, ceftazidime exclue, et les pénèmes restent
actifs sur les souches de sensibilité diminuée à la pénicilline G. Les
nouvelles fluoroquinolones actives sur le pneumocoque (FQAP),
tout en gardant un spectre large, présentent et présenteront un
intérêt réel si des échecs liés directement à la résistance aux bêtalac-
tamines apparaissent; leur utilisation doit tenir compte du rapport
bénéfice/risque en raison d’effets indésirables plus importants.
Malgré une antibiothérapie active et une prise en charge en
réanimation, la mortalité reste élevée, de 21 % à 48 % [1-6].
Le pneumocoque a la particularité de tuer rapidement, l’anti-
biothérapie ne semblant pas modifier cette mortalité précoce [7].
L’importance de la réaction inflammatoire explique cette gravité
initiale [8]. Des facteurs génétiques jouent probablement un rôle
important dans cette gravité [9, 10].
Des innovations thérapeutiques adjuvantes pourraient
permettre une réduction de la mortalité à condition que la prise en
charge soit optimale et que l’antibiothérapie soit adaptée [11, 12].
ÉVALUATION DIAGNOSTIQUE
DÉFINITION
Une PAC est une pneumonie acquise en ville, dans la
« communauté ». L’un des problèmes majeurs est, pour une partie
des PAC, le délai admis entre une hospitalisation pour PAC et une
hospitalisation antérieure; dans les séries publiées, quand il est
précisé, ce délai est de plus de sept jours [13, 14]. Ce délai est proba-
blement trop court pour différencier nettement une infection
associée aux soins de celle acquise dans la communauté; un délai
d’un mois serait le plus adapté à la définition d’une PAC. Cette défi-
nition reste néanmoins imprécise et des « extensions » sont
nécessaires.
En effet certaines populations de patients présentent des particu-
larités dont l’impact se retrouve dans la répartition habituelle des
micro-organismes. Par ailleurs dans certains cas la distinction entre
infection acquise dans la communauté et infection nosocomiale est
difficile. C’est le cas en particulier des patients vivant en maison de
retraite, qui représentent un groupe particulier par la classe d’âge, la
fréquence des pathologies sous-jacentes, la pression de sélection
exercée par les traitements antibiotiques, une épidémiologie diffé-
rente, des risques d’épidémie (affections virales, tuberculose…). La
variété des structures accueillant les personnes âgées rend parfois diffi-
cile la distinction entre « communauté» et hôpital, d’autant que la
circulation de ces patients entre ces structures et les hôpitaux est
importante; des patients, ayant acquis lors d’une hospitalisation anté-
rieure une colonisation par une bactérie multirésistante comme
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), ou par la pres-
sion des antibiotiques des bactéries exceptionnelles au cours des PAC
(Pseudomonas æruginosa), peuvent avoir une infection d’acquisition
communautaire mais due à une bactérie d’acquisition nosocomiale du
fait d’une colonisation prolongée (plusieurs mois pour SARM); d’une
pathologie sous-jacente broncho-pulmonaire (bronchite chronique,
dilatation des bronches, mucoviscidose) qui expose le patient à une
colonisation par P. æruginosa favorisée par des traitements antibioti-
ques itératifs; d’un traitement immunosuppresseur (corticoïdes) qui
peut exposer les patients à des infections particulières : Legionella pneu-
mophila, Pneumocystis jiroveci, levures…
Sont exclus des PAC, toutes les infections pulmonaires asxso-
ciées aux soins dont les infections nosocomiales : pneumonies
survenant en hospitalisation à domicile, pneumonie diagnostiquée
dans les jours suivant le retour au domicile (L. pneumophila). Par
ailleurs la tuberculose dans sa localisation pulmonaire sans co-infec-
tion à germe banal, la pneumocystose (P. jiroveci), les infections à
levures, les pneumonies d’inhalation ne sont pas considérées
comme des PAC.
Quoi qu’il en soit, il est important pour le clinicien de recher-
cher ces facteurs et de modifier éventuellement les antibiothérapies
probabilistes habituellement recommandées au cours des PAC.
Certaines recommandations tiennent compte de ces modifications
dans l’épidémiologie bactérienne, en particulier des risques de
P. æruginosa.
SIGNES CLINIQUES ET RADIOLOGIQUES
Les signes cliniques sont bien connus. Les signes généraux sont
regroupés sous le terme de syndrome inflammatoire de réponse
systémique : fièvre supérieure ou égale à 38 °C ou hypothermie infé-
rieure ou égale à 36 °C, tachycardie supérieure ou égale à 90 bpm,
fréquence respiratoire supérieure ou égale à 20/min, hyperleucocy-
tose supérieure ou égale à 12 000/mm
3
ou leucopénie inférieure à
4 000/mm
3
.
Les signes d’expression de la PAC sont la toux, l’expectoration,
la dyspnée, associées ou non à des douleurs pleurales. À l’examen
clinique, matité et râles crépitants avec ou sans frottement pleural.
Ils sont associés parfois à des signes extrapulmonaires (céphalées,
myalgies, troubles digestifs…). L’expectoration peut être absente
initialement ou de manière permanente, limitant l’exploration
microbiologique à partir des sécrétions bronchiques.
La différenciation clinique entre pneumonie dite « atypique » et
pneumonie pneumococcique n’est pas spécifique.
Les personnes âgées ont souvent un tableau clinique trompeur
marqué par une symptomatologie fruste et même l’absence de fièvre.
La radiographie thoracique est fondamentale pour affirmer une
pneumonie. L’image typique est une opacité parenchymateuse
alvéolaire avec bronchogramme aérien prenant un aspect systéma-
44200_Volume4_1 Page 908 Jeudi, 12. février 2009 2:16 14

Pneumopathies aiguës communautaires sévères de l’adulte
909
tisé lobaire ou d’opacités alvéolaires multiples. D’autres aspects sont
décrits : pseudo-tumoral, images interstitielles… Des complications
peuvent être associées : épanchement pleural, cavité, images alvéo-
laires bilatérales compatibles avec un œdème lésionnel (syndrome
de détresse respiratoire aigu, SDRA)… Une maladie sous-jacente
méconnue peut être découverte (cancer).
Dans les formes sévères de PAC, les modifications radiologiques
sont rarement spécifiques d’un agent pathogène. Des images exten-
sives et très destructrices peuvent être liées à S. aureus producteur de
leucocidine de Panton et Valentine [15].
Une discordance entre une symptomatologie clinique bruyante
et l’absence d’image radiologique évidente peut exister. Une
nouvelle radiographie faite dans des conditions rigoureuses : en
inspiration, face et profil, permet de préciser une image non visible
sur un cliché de mauvaise qualité. En l’absence d’image évidente,
malgré une radiographie de bonne qualité, une tomodensitométrie
peut être nécessaire pour visualiser des opacités alvéolaires compati-
bles avec une pneumonie.
FACTEURS DE RISQUE DE MORTALITÉ
Les services de réanimation utilisent déjà des scores de gravité
prédictifs de mortalité. Des scores ou des facteurs de risque plus spéci-
fiques ont été étudiés au cours des PAC. Les scores sont devenus une
nécessité pour décrire une population, évaluer la performance d’unité
de soins, stratifier les patients pour l’évaluation de nouvelles thérapeu-
tiques… Leur utilisation aux niveaux collectif et individuel, impose à
l’utilisateur de connaître la méthodologie de construction et de valida-
tion de ce score afin d’en maîtriser les limites [16]. Au niveau
individuel, leur utilité dans l’aide à la décision est très limitée.
Ils sont élaborés à partir de données issues d’une population
test définie, les inclusions et les exclusions étant clairement préci-
sées. La construction du score fait appel à la méthode de régression
logistique qui permet le choix des items constitutifs et leur « poids »
relatif dans ce score. Une fois construit, le score est validé dans une
population identique mais indépendante de la population initiale.
Cette étape de validation comprend trois étapes : calibration, discri-
mination, robustesse.
L’ensemble de ce processus ayant été accompli, un score peut
alors être appliqué dans la population pour laquelle il a été construit
et avec l’objectif qui lui était assigné. S’il s’agit d’un score de morta-
lité, son utilisation pour une décision individuelle conduit à des
erreurs du fait d’une sensibilité et d’une spécificité trop faibles.
Deux scores ont fait l’objet de nombreuses publications et de
validation en tant que scores de mortalité : ce sont le pneumonia seve-
rity index et le CURB-65 de la British Thoracic Society (BTS). Enfin un
troisième score dit de Leroy a été déterminé spécifiquement en
réanimation.
PNEUMONIA SEVERITY INDEX, PSI
Ce PSI, dit score de Fine, est un score prédictif de mortalité à
trente jours des PAC chez les patients hospitalisés [17]. Publié en
1997, il est en fait l’aboutissement de plusieurs études publiées
entre 1993 et 1997. Il a eu pour but d’établir des variables prédictives
de mortalité. Il a été établi sur une population de 14 199 patients vus
dans des hôpitaux nord-américains (États-Unis et Canada) pour une
PAC (MedisGroups derivation cohort), puis validé dans une cohorte de
38 039 patients dans une population identique. La dernière étape de
validation a été faite dans une cohorte « Pneumonia PORT » (patient
outcome research team). Étaient exclus les patients infectés par le VIH
et immunodéprimés, hospitalisés dans les sept jours précédant le
diagnostic, transférés d’un autre hôpital. Les patients venant de
maisons de retraite constituaient 8,5 % de l’effectif.
Le score est établi en calculant la somme des points attribués à
dix-neuf variables auxquelles sont attribués des points (données
démographiques, maladie sous-jacente, données cliniques, données
radiologiques, données de laboratoire dont une gazométrie arté-
rielle) (tableau 85.1). Selon le nombre de points, cinq classes de
risque de mortalité au 30
e
jour, ont été différenciées et à chacune
d’elle est attribuée une mortalité. Les classes de risque vont de I à V,
mais seules les classes de II à V se voient attribuées des points, la
classe de risque I étant par définition celle pour laquelle aucun
facteur de risque n’est retrouvé.
La mortalité était de 0,1 % pour la classe de risque I, de 0,6 %
pour la classe de risque II (égal ou inférieur à 70 points), de 2,8 %
pour la classe de risque III (de 71 à 90 points), de 8,2 % la classe IV
(de 91 à 130 points) et de 29,2 % pour la classe de risque V (plus de
130 points); la mortalité globale de la cohorte était de 5,2 %. Une
étude prospective [18] a permis de valider la « solidité » de ce score : la
mortalité des patients de la classe de risque IV était de 9 % dont 7 %
liés à la PAC et celle de la classe de risque V de 27,1 % dont 20,4 %
liés à la PAC. Les informations sur cette cohorte ont été secondaire-
ment publiées : dans seulement 5,7 % des cas une cause bactérienne a
été identifiée, une hospitalisation secondaire a été nécessaire pour 71
des 944 patients traités en ambulatoire soit 7,5 % [19].
Plusieurs limites et réserves sont apparues au PSI : le poids
attribué à l’âge ainsi qu’aux comorbidités est très important;
l’hypoxémie dont le « poids » est seulement de 10, reste en clinique
un facteur important de gravité; ce score n’est pas prédictif de
mortalité individuelle mais de mortalité de cohorte; son utilisation
dans d’autres populations ou dans un pays et/ou un système de
santé différent ou par les médecins généralistes nécessite une valida-
tion spécifique.
S’agissant d’un score prédictif de mortalité, tenter d’en faire un
outil de décision d’admission en réanimation, peut conduire à des
erreurs de prise en charge : par exemple un jeune adulte ayant une
hypotension et une tachycardie pourrait être « classé » en risque III
bien que la PAC soit sévère. Cet objectif n’a pas été validé.
SCORE CURB-65
Ce score proposé par la British Thoracic Society est un score
prédictif de mortalité construit et validé dans une population de
1 000 PAC à partir d’une base de données disponibles au Royaume
Uni, en Nouvelle Zélande et aux Pays-Bas [20]. Il a été réactualisé en
associant le facteur « âge » [21]. Six éléments, recueillis lors de l’admis-
sion à l’hôpital le composent : confusion, urée sanguine > 7 mmol.l
–1
,
fréquence respiratoire ≥ 30/min, pression artérielle systolique <
90 mmHg ou diastolique ≤ 60 mmHg, âge ≥ 65 ans (tableau 85.2).
Chaque élément forme l’acronyme du score. La valeur de 1 point est
attribuée pour chaque variable présente. Ce score permet la stratifica-
tion des patients en six classes de 0 à 5 de risque croissant de
mortalité : 0,7 % pour un score à 0; 3, 2 % pour un score à 1; 13 %
pour un score à 2; 17 % pour un score à 3; 41,5 % pour un score à 4
Tableau 85.1. Classes de risque de mortalité au cours des pneumonies
communautaires [17]
Classe de
risque Cohortes de validation
N points N patients Mortalité
(%) Prise en charge
I Absence de
facteur 3 034 0,1 % Ambulatoire
II ≤ 70 5 778 0,6 % Ambulatoire
III 71-90 6 790 2,8 % Hospitalisation
IV 91-130 13 104 8,2 % Hospitalisation
V > 130 9 333 29,2 % Hospitalisation
Le nombre total de points est égal à la somme des points attribués à chacune des 19 variables
suivantes : âge (nombre d’années pour les hommes, années –10 pour les femmes), provenance d’une
maison de retraite (+10), maladie sous-jacente (+30 cancer, +20 maladie hépatique, +10 insuffisance
cardiaque, +10 maladie cardio-vasculaire, +10 insuffisance rénale), signes cliniques de gravité
(+20 troubles de conscience, + 20 fréquence respiratoire ≥ 30/min, +20 pression artérielle systolique
< 90 mmHg, +15 température < 35 °C ou ≥ 40 °C, +10 fréquence cardiaque > 125/min), altérations
biologiques ou radiologiques (+30 pH < 7,35, +20 urée sanguine > 11 mmol/l, +20 natrémie
< 130 mmol.l
–1
, +10 glycémie > 14 mmol.l
–1
, +10 hématocrite < 30 %, + 10 PaO
2
< 60 mmHg,
+10 épanchement pleural).
Tableau 85.2. CURB* 65, score de la British Thoracic Society [20]
Confusion mentale
Urée > 7 mmol.l
–1
Fréquence respiratoire ≥ 30/min
Pression artérielle : systolique < 90 mmHg ou diastolique ≤ 60 mmHg
Âge ≥ 65
Un patient présentant au moins deux de ces quatre facteurs a un risque de
mortalité multiplié par 36
* C pour confusion, U pour urea, R pour respiratory rate, B pour blood pressure
44200_Volume4_1 Page 909 Jeudi, 12. février 2009 2:16 14

910
Affections et leurs traitements
et 57 % pour un score à 5. Les règles pronostiques de ce score ont une
forte valeur prédictive négative concernant le décès (93 à 95 %), mais
elles sont peu sensibles (47 à 65 %). La pression artérielle diastolique
≤ 60 mmHg et la fréquence cardiaque > 90/min sont de mauvais para-
mètres pronostiques. L’association de trois critères BTS (rythme
respiratoire ≥ 30/mn, pression artérielle diastolique ≤ 60 mmHg et
l’état confusionnel aigu) donne la meilleure approximation du risque
de décès dans la pneumonie du sujet âgé [22].
SCORE ÉTABLI EN RÉANIMATION
Une étude menée en réanimation, stratifie les patients en trois
classes avec une mortalité de 4, 25 et 60 % [23]. Cet index pronos-
tique à l’admission est établi à partir de six facteurs indépendants de
mortalité (âge supérieur à 40 ans, pronostic à cinq ans de la maladie
sous-jacente, pneumonie dont le mécanisme n’est pas une inhala-
tion, atteinte de plus d’un lobe, nécessité d’une ventilation
mécanique, choc septique). Pour la classe de risque intermédiaire, la
mortalité ne peut pas être prédite uniquement à l’admission, un
ajustement est nécessaire tenant compte des complications surve-
nues en cours d’hospitalisation.
IMPACT DE LA RÉSISTANCE BACTÉRIENNE
SUR LA MORTALITÉ
L’impact de la résistance bactérienne sur la mortalité a été
essentiellement étudié au cours des pneumonies à pneumocoque. La
résistance à la pénicilline G ne semble pas entraîner de surmortalité
[7]. Dans une étude menée en France, la mortalité globale était de
16,3 % parmi les 465 patients adultes hospitalisés pour une PAC due
au pneumocoque; elle était de 18,3 % pour celles dues à des souches
sensibles et 13,9 % pour celles dues à des souches de sensibilité dimi-
nuée [24]. En réanimation, toujours dans cette étude, la mortalité
était de 34,8 % chez les patients ayant une souche sensible à la péni-
cilline et 27,8 % chez ceux ayant une souche de sensibilité
diminuée. Parmi les 221 patients ayant une PAC à pneumocoque
bactériémique, la mortalité était de 20,1 % pour les souches sensibles
à la pénicilline G et 15,2 % pour les souches de sensibilité diminuée.
IMPACT DU DÉLAI DE L’ADMINISTRATION
D’ANTIBIOTIQUES SUR LA MORTALITÉ
Plusieurs études ont montré une relation entre la mortalité et le
délai d’administration des antibiotiques par rapport à l’admission
[25-28]. À partir de la base de données Medicare aux États-Unis, sur
une population de plus de 65 ans, une réduction de la mortalité de
15 % au 30
e
jour est observée quand l’antibiothérapie est administrée
dans les 8 h [25] ou dans les 4 h [26], mais uniquement chez les
patients n’ayant pas eu d’antibiothérapie avant l’admission. Ce délai
est confirmé dans une étude prospective de cohorte, qui a par ailleurs
identifié les facteurs exposant à un retard de l’antibiothérapie : âge
avancé, troubles des fonctions supérieures, absence de fièvre et
d’hypoxémie [27].
Ce délai de 4 h pouvant devenir un critère de performance de la
qualité des soins, une étude a montré que dans 22 % des cas l’anti-
biothérapie est administrée au-delà de 4 h du fait du retard
diagnostique lorsque la présentation clinique est atypique et la
radiographie thoracique initiale non contributive [28].
CRITÈRES D’ADMISSION EN RÉANIMATION
C’est essentiellement au niveau des services d’accueil et des
urgences que ces critères d’admission en réanimation doivent être
maîtrisés, le réanimateur étant appelé en fonction de cette évalua-
tion. Cette démarche s’inclut dans la campagne de la prise en charge
précoce du sepsis sévère lancée en 2006 par plusieurs sociétés
(www.srlf.com). Ces critères cliniques, radiologiques et biologiques
doivent être simples. Le jugement clinique et l’expérience du clini-
cien restent importants dans cette décision.
Plusieurs facteurs de risque de mortalité des PAC ont été
identifiés : extension des images radiologiques et existence d’un
choc septique [2]; maladie sous-jacente ultérieurement ou rapide-
ment fatale, état de choc, bactériémie, antibiothérapie inadaptée,
complications non liées à la pneumonie [5]; ventilation mécanique
et choc septique.
Les différentes sociétés savantes proposent une hiérarchie des
différents critères de gravité pour soutenir cette décision d’admettre
ou non un patient ayant une PAC. Les facteurs de risque de mortalité
sont utilisés pour évaluer cette gravité.
En 2007, l’Infectious Diseases Society of America (IDSA) et
l’American Thoracic Society (ATS) ont élaboré conjointement des
critères d’évaluation de la gravité [29]. Ces critères sont issus du
score de l’ATS révisé en 2001 et de celui du CURB 65 de la BTS. L’âge
et l’existence de comorbidités ne font pas partie de cette évaluation.
Ces critères présentés dans le tableau 85.3, sont hiérarchisés en
critères mineurs et majeurs : l’existence d’au moins un critère majeur
impose la prise en charge en réanimation; sans ces critères majeurs
la présence d’au moins trois critères mineurs suscite une admission
en réanimation.
La Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF)
en 2006 propose l’utilisation du score de l’ATS (tableau 85.4) révisé
en 2001 pour supporter la décision de prise en charge en réanima-
tion [30]. La présence de deux critères mineurs ou d’un critère
majeur prédit la nécessité d’une admission en soins intensifs avec
une sensibilité de 78 %, une spécificité de 94 %, VPP 75 % et VPN
95 %. Le PSI est un autre élément de cette décision.
L’utilisation des scores de mortalité dans la décision d’hospitali-
sation est dominée par les analyses issues des travaux de Fine [17, 18,
31]; ils ont été en partie validés pour cette décision. En revanche ces
scores n’ont pas été validés pour l’admission en réanimation. L’utili-
sation de la gravité par ces scores, en particulier le PSI, conduit à
méconnaître une gravité évidente chez un patient jeune, ayant une
hypoxémie sévère et même un état de choc. Une étude nord-améri-
caine a conclu que les scores PSI et CUR65 n’étaient pas adaptés en
tant que critères d’admission en réanimation [32]. Sur cette cohorte
de 1 339 patients hospitalisés, 170 étaient admis en réanimation
(12,7 %). Sur ces 170 patients, 27 % étaient classés en faible risque
de mortalité (classes I, II et III). Inversement, en tenant compte des
critères de sévérité, une grande partie des patients n’ont pas été
admis en réanimation : 74 % des 440 patients avaient les critères
modifiés de l’ATS, 80 % des 321 patients avaient les critères de la
BTS. La mortalité des patients admis en réanimation était de 21,1 %,
significativement plus élevée que celle des patients non admis en
réanimation (5,1 %), mais uniquement pour ceux classés en risque
IV et V. S’intéressant aux patients ayant un PSI à V, seuls 20 % sont
admis en réanimation dont 69 % ont au moins un critère majeur;
l’âge avancé et une maladie chronique grave (neurologique, cancer)
sont les deux facteurs limitant l’admission en réanimation [33].
Tableau 85.3. Évaluation de la gravité d’une PAC selon l’IDSA et l’ATS.
Critères d’admission en réanimation en critères mineurs (trois critères)
et critères majeurs (un critère) [29]
Critères « mineurs »
a
Critères « majeurs »
• Fréquence respiratoire
b
≥ 30/min
• PaO
2
/FiO
2
≤ 250
– Atteinte multilobaire radiologique
– Confusion désorientation
• Urée sanguine ≥ 7 mmol.l
–1
• Leucopénie
c
< 4 000/mm
3
• Thrombopénie > 100 000/mm
3
• Hypothermie < 36 °C
• Hypotension nécessitant un
remplissage
– Nécessité d’une ventilation
mécanique
– Choc septique : nécessité de
drogues vasoactives
a Tenir compte d’autres critères : hypoglycémie chez les patients non diabétiques, alcoolisme aigu et/ou
sevrage alcoolique, hyponatrémie, acidose métabolique inexpliquée ou élévation du lactate artériel,
cirrhose, asplénie.
b La ventilation non invasive peut se substituer à la fréquence respiratoire et au rapport PaO
2
/FiO
2
.
c liée à l’infection uniquement.
Tableau 85.4. Définition d’une pneumonie communautaire sévère à partir
de la classification des critères de l’American Thoracic Society en critères mineurs
(deux critères) et critères majeurs (un critère)
Critères « mineurs » à l’admission Critères « majeurs » à l’admission
et en cours d’évolution
• PaO
2
/FiO
2
< 250
• Atteinte multilobaire radiologique
• Pression artérielle systolique
≤ 90 mmHg
• Nécessité d’une ventilation
mécanique
• Choc septique
44200_Volume4_1 Page 910 Jeudi, 12. février 2009 2:16 14

Pneumopathies aiguës communautaires sévères de l’adulte
911
En pratique, le processus d’admission en réanimation doit
s’appuyer sur les critères proposés par l’IDSA/ATS en 2007, avec trois
critères mineurs ou un critère majeur. Même s’ils restent à valider par
des études prospectives, cette approche permet de mieux définir
cliniquement la gravité de la PAC et de formaliser l’admission en
réanimation. Mais dans tous les cas le jugement clinique et l’expé-
rience du médecin restent importants. Compte tenu de la
dynamique de cette infection si, lors de l’évaluation initiale, une
admission en réanimation n’a pas été décidée et après avoir vérifié
que le traitement antibiotique a bien été administré dans les 4 h de
l’admission, une surveillance à partir des critères de l’évaluation
initiale doit être établie; cette surveillance aura l’avantage d’alerter le
clinicien sur une éventuelle aggravation secondaire.
DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE
FAUT-IL ISOLER L’AGENT PATHOGÈNE?
Au cours des PAC, comme pour toute situation infectieuse, il est
important d’isoler l’agent pathogène. Plusieurs raisons justifient
cette démarche : affirmer la nature infectieuse de la PAC, permettre
une adéquation de l’antibiothérapie à la bactérie isolée, limiter
l’utilisation prolongée de molécules à spectre large afin de maîtriser
l’apparition de résistances, les surcoûts et les effets indésirables.
Malgré les recherches mise en œuvre, l’agent responsable n’est
isolé que dans 50 % des cas [2, 3, 4]; dans l’étude menée en réanima-
tion, l’agent pathogène a pu être identifié dans 72 % des cas [1].
Ce faible rendement peut s’expliquer par l’utilisation de techni-
ques de microbiologie inadéquates ou la fréquence d’une
antibiothérapie préalable. Des progrès considérables ont été effectués
avec la mise au point de techniques diagnostiques spécifiques et
rapides comme les antigènes urinaires.
QUELLE STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE POUR EXPLORER
UN FOYER PULMONAIRE?
Les prélèvements peuvent être effectués directement au sein du
foyer infectieux (biopsie pulmonaire, ponction transthoracique) ou
indirectement par des procédures invasives (fibroscopie) ou par des
cultures d’expectorations.
L’étude de Moine menée en réanimation, reflète bien la grande
diversité des prélèvements effectués en France : expectoration dans
45 % des cas, prélèvements bronchiques distaux protégés dans 89 %
des cas [1]. Ces prélèvements contribuaient au diagnostic bactériolo-
gique dans respectivement 30 % et 32 % des cas.
Plusieurs modalités de prélèvements sont proposées : « non
invasifs » et « invasifs » permettant lors d’une fibroscopie des prélève-
ments bronchiques distaux. L’expectoration permet d’affirmer un
diagnostic lorsque des micro-organismes pathogènes tels que Legio-
nella pneumophila, Mycobacterium tuberculosis ou virus sont isolés.
Pour les autres micro-organismes, l’interprétation de la culture est
possible à condition de respecter les conditions de prélèvement.
Ces explorations restent à évaluer au cours des PAC, en terme de
sensibilité et de spécificité en tenant compte d’une antibiothérapie
préalable qui peut modifier considérablement l’interprétation des
résultats. Le diagnostic est possible dans 80 % des cas chez les
patients n’ayant pas d’antibiotique [34], mais seulement dans
32,7 % des cas lorsque les patients en reçoivent [35].
PRÉLÈVEMENTS BRONCHO-PULMONAIRES INVASIFS
PONCTION TRANSTHORACIQUE
Faite à l’aiguille fine (22 ou 25 G) elle permet un diagnostic
dans 14,5 à 27 % des cas [2, 36]. Mais des problèmes de tolérance
(pneumothorax, hémoptysies de faible abondance dans 13 % à 20 %
des cas) en limitent l’usage. Cette technique est contre-indiquée
chez les patients ayant une hypoxémie sévère, des troubles de coagu-
lation, un emphysème sévère ou qui sont ventilés.
PONCTION TRANSTRACHÉALE
Cette technique a été une méthode de référence [33], mais a été
abandonnée en raison des complications (hémorragie, décompensa-
tion d’une insuffisance respiratoire aiguë, emphysème sous-cutané),
des contre-indications (troubles de la coagulation, détresse respira-
toire, agitation du patient…), des difficultés d’interprétation en cas
de troubles de déglutition, et de la perte d’expérience des équipes.
Des faux négatifs sont observés : chez six patients ayant une bacté-
riémie à Streptococcus pneumoniæ, dans trois cas seulement la bactérie
était isolée dans la ponction transtrachéale [34-36].
PRÉLÈVEMENTS BRONCHIQUES EFFECTUÉS LORS D’UNE FIBROSCOPIE
Ces prélèvements (lavage broncho-alvéolaire, cathéter distal
protégé, brosse…) ont été peu évalués dans le cadre spécifique des
PAC [37]. L’interprétation de ces cultures quantitatives est en général
issue d’études effectuées au cours des pneumonies acquises au cours
de la ventilation mécanique. Parmi les rares études publiées, celle de
Örtqvist [38] et celle de Jimenez [39] soulignent une bonne sensibi-
lité et concordance de la brosse au LBA chez des patients ayant une
PAC peu sévère et n’ayant pas reçu d’antibiotique.
Chez les patients intubés et ventilés d’emblée, la fibroscopie ne
pose pas de problème, mais il existe des risques inhérents : aggrava-
tion de l’hypoxémie au cours de la fibroscopie ou au décours d’un
LBA, pneumothorax ou hémoptysie au décours d’une brosse…).
Chez les patients non intubés hypoxémiques, une fibroscopie effec-
tuée même à travers un masque à haute concentration d’oxygène
peut décompenser une détresse respiratoire. Si elle est indiquée,
l’opérateur doit être entraîné et être capable de gérer une complica-
tion. En ventilation non invasive, avec un opérateur entraîné, une
exploration fibroscopique peut être réalisée avec sécurité [40]. Néan-
moins, en raison du risque de décompensation respiratoire et d’arrêt
cardiaque hypoxémique, son utilité doit être démontrée dans la
démarche diagnostique initiale d’une PAC.
PRÉLÈVEMENTS BRONCHIQUES NON INVASIFS
L’étude de l’expectoration a été longtemps décriée en France :
manque de spécificité, temps de laboratoire. Son premier intérêt est
de permettre d’affirmer un diagnostic microbiologique lorsque
L. pneumophila, P. jiroveci, M. tuberculosis et un virus sont isolés, à
condition qu’une demande spécifique soit faite au laboratoire.
Pour les autres micro-organismes l’interprétation de la culture
est possible à condition de respecter les conditions suivantes : réelle
expectoration obtenue en aidant le patient, transport immédiat au
laboratoire, critères cellulaires (moins de dix cellules épithéliales et
plus de vingt-cinq polynucléaires par champ), prédominance d’un
ou éventuellement de deux types de bactéries, culture semi-quantita-
tive. L’IDSA recommande cet examen [29, 41].
PRÉLÈVEMENTS EXTRAPULMONAIRES
Ces prélèvements peuvent contribuer à l’identification de
l’agent responsable :
• hémocultures (positives dans 7 à 27 % des cas, surtout pour le
pneumocoque dans plus d’un tiers des cas);
• ponction pleurale;
• antigènes urinaires de L. pneumophila du sérogroupe 1, antigènes
urinaires de S. pneumoniæ;
• détection de virus (influenza, virus respiratoire syncytial, adéno-
virus, para-influenza 1,2 et 3) et plus récemment du coronavirus
responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), par des
techniques de culture, de sérologie, de test rapide de détection
d’antigène, de PCR et d’immunofluorescence.
En fonction du contexte, une sérologie VIH oriente les
explorations; une pneumonie à pneumocoque peut être un événe-
ment révélateur d’une infection par le VIH.
Les sérologies de L. pneumophila, Mycoplasma pneumoniæ et
Chlamydia pneumoniæ ont un intérêt rétrospectif et l’élévation
retardée des anticorps n’aide pas au diagnostic initial. La séroconver-
sion est définie par une élévation d’un facteur 4 du titre d’anticorps
entre deux prélèvements; pour C. pneumoniæ, une élévation d’un
facteur 4 du taux des IgG ou un taux d’IgM dépassant 1 :16 sur un
seul prélèvement.
Les agglutinines froides supérieures à 1 : 64 sont en faveur de
M. pneumoniæ.
Des techniques d’amplification génomique (PCR) sont en cours
d’évaluation pour ces micro-organismes, en particulier
C. pneumoniæ, L. pneumophila et M. pneumoniæ.
La procalcitonine peut avoir un intérêt pour différencier une
infection bactérienne d’une infection virale. La cinétique pourrait
avoir un intérêt pronostique.
Parmi ces examens complémentaires, de récentes publications
sur les hémocultures et les antigènes urinaires pneumococciques ont
abordé leur utilité dans la stratégie diagnostique :
44200_Volume4_1 Page 911 Jeudi, 12. février 2009 2:16 14

912
Affections et leurs traitements
Les hémocultures sont recommandées pour les pneumonies
sévères; deux hémocultures à 1 ou 2 h d’intervalle correspondent
aux pratiques habituelles. Des réserves ont été faites sur leur utilité
[42, 43] : le résultat n’est pas immédiat, le rendement est faible (de 4
à 18 % de l’ensemble des hémocultures). À partir de facteurs indé-
pendants prédictifs de bactériémie (maladie hépatique sous-jacente,
tension artérielle systolique < 90 mmHg, température < 35 °C ou
> 40 °C, pouls > 125/min, urée sanguine > 11 mmol.l
–1
, natrémie
< 130 mmol.l
–1
, leucocytes < 5 000/mm
3
ou > 20 000/mm
3
) il est
proposé de prélever deux hémocultures quand le risque de bacté-
riémie est élevé (un facteur sans antibiothérapie antérieure ou deux
facteurs) et une seule hémoculture pour un faible risque (pas de
facteur ou un facteur avec une antibiothérapie préalable). Lorsque le
risque est élevé, 14 % des hémocultures sont positives; lorsqu’il est
faible, seules 6 % le sont. Une autre manière de procéder est
d’utiliser le score PSI pour les classes IV et V [44, 45].
Les antigènes urinaires pneumococciques et de L. pneumophila 1
ont amélioré notablement la documentation des PAC. Pour le pneu-
mocoque, les lipopolysaccharides de la membrane externe
bactérienne persistent à l’état soluble dans les liquides biologiques
(urines, liquide céphalo-rachidien [LCR]) et peuvent être détectés par
une méthode immunochromatographique, même lorsque la bactérie
n’est plus viable. L’intérêt de ce test est sa rapidité (15 min). Ce test
reste positif même après l’instauration d’une antibiothérapie,
permettant dans ce contexte un diagnostic a posteriori. La sensibilité
est de 75 à 80 % lors des bactériémies [46-49]. En l’absence de bacté-
riémie la sensibilité est moins bonne, de 29 à 52 %. L’une des plus
grandes études publiés à ce jour évaluant la performance de ce test
sur 452 patients ayant une PAC [50] montre que les antigènes sur des
urines concentrées étaient positifs dans 70 % des vingt-sept patients
ayant une PAC à pneumocoque et chez 26 % des patients ayant une
PAC sans documentation bactériologique; 10 % des patients ayant
une PAC non à pneumocoque avaient un test positif, sa spécificité
est de l’ordre de 97 %). Il a été montré d’exceptionnels faux positifs
chez les enfants ayant une pathologie chronique respiratoire avec
une colonisation à S. pneumoniæ [51], chez les patients qui ont eu un
épisode de pneumonie dans les trois mois [52]. En revanche les faux
positifs sont rares chez les patients à broncho-pneumopathie chro-
nique obstructive (BPCO) alors même qu’ils sont colonisés [53].
Plusieurs tests sont commercialisés pour la détection des antigènes
solubles urinaires de L. pneumophila mais uniquement du
sérogroupe 1. La sensibilité est de 70 à 90 % avec une spécificité de
99 % [54, 55]. Comme pour le pneumocoque, ce test est très rapide.
Il est positif dès le premier jour de la maladie et le reste pendant
l’évolution. Il permet une prise en charge adaptée et précoce des
légionelloses, et a en partie contribué à une augmentation des
diagnostics étiologiques. En pratique, si les antigènes améliorent la
documentation, et permettent dans les formes non graves de
restreindre l’antibiothérapie probabiliste à un seul agent, ils ne
peuvent à eux seuls, au cours de PAC sévères, justifier des modifica-
tions de l’antibiothérapie des premiers jours qui doit être large.
QUAND ET À QUI FAIRE LES PRÉLÈVEMENTS?
Il est important, au cours des PAC sévères, d’établir un
diagnostic microbiologique (tableau 85.5), à plus forte raison s’il
existe une immunodépression, un échec d’une antibiothérapie préa-
lable, une hospitalisation récente, ou une maladie sous-jacente
pulmonaire. L’évolution des résistances bactériennes et la maîtrise
de la consommation d’antibiotiques incitent aussi à isoler l’agent
responsable.
Ces prélèvements doivent être effectués à l’admission avant
tout traitement antibiotique ou toute modification et en cours de
traitement lorsqu’un échec est constaté.
Quelles que soient les explorations utilisées, elles ne contri-
buent pas au choix de l’antibiothérapie initiale qui est toujours
probabiliste jusqu’au retour des résultats des prélèvements. Elles
doivent par ailleurs, ni retarder l’administration des antibiotiques
qui doivent être administrés dans les 4 h après l’admission à
l’hôpital, ni décompenser une insuffisance respiratoire chez un
patient non ventilé. Inversement, l’urgence du traitement ne justifie
pas l’absence de prélèvements.
Enfin les résultats de ces prélèvements sont indispensables pour
la réévaluation du troisième jour de traitement.
Le résultat des prélèvements permet de retenir une PAC certaine
lorsque le pathogène compatible avec une PAC est isolé dans un
prélèvement non contaminé (hémoculture, sécrétion bronchique de
bonne qualité) ou identifié par les antigènes urinaires, la PCR, une
séroconversion. La PAC est probable lorsqu’à l’examen direct d’un
prélèvement de qualité des sécrétions, une bactérie est compatible
avec un pathogène d’une PAC, la concentration est significative à la
culture d’expectoration sans examen direct, la concentration dans
un prélèvement protégé est inférieure au seuil, la sérologie est posi-
tive sans pouvoir vérifier la séroconversion.
ÉPIDÉMIOLOGIE BACTÉRIENNE
La répartition générale des micro-organismes est dominée dans
toutes les études épidémiologiques, par S. pneumoniæ suivi de
H. influenza, des micro-organismes intracellulaires (C. pneumoniæ,
L. pneumophila, M. pneumoniæ), de S. aureus, des entérobactéries, des
virus… Il y a des variations importantes selon les études, les pays, et
les définitions utilisées [13, 38, 39, 56]. Les traitements probabilistes
des PAC sévères tiennent compte de la diversité des micro-orga-
nismes et de l’évolution des résistances bactériennes.
RÉPARTITION EN RÉANIMATION
Plusieurs études épidémiologiques en réanimation [1-4]
montrent que la répartition est sensiblement identique à celle cons-
tatée lors des PAC moins sévères (tableau 85.6), globalement les
bactéries dites « atypiques » sont responsables de 20 % des PAC. Les
Tableau 85.5. Explorations proposées en fonction de la tolérance de l’hypoxémie
au cours d’une pneumonie communautaire sévère
Patient intubé
d’emblée
Patient non intubé
Hypoxémie bien tolérée Hypoxémie mal tolérée
(VNI, MHC)
Prélèvements protégés
avec ou sans fibroscopie
(brosse, LBA ou PDP…)
Et aspiration trachéale
Expectoration
Et éventuellement
fibroscopie
1
(prélèvements protégés)
Expectoration
Dans tous les cas : hémocultures, ponction pleurale si épanchement,
expectorations (avec recherche spécifique L. pneumophila), antigènes urinaires
(L. pneumophila sérogroupe 1, pneumocoque), sérologie (Chlamydophila,
Mycoplasma, L. pneumophila).
Autres prélèvements si orientation diagnostique : expectoration
(M. tuberculosis), LBA (P. jiroveci, si expectoration non contributive),
prélèvement nasopharyngé (culture de virus), PCR (Chlamydophila,
Mycoplasma, L. pneumophila), autre sérologie (Coxiella burnetii), agglutinines
froides (M. pneumoniæ),
Sérologie VIH.
LBA : lavage broncho-alvéolaire, PDP : prélèvement distal protégé.
1. Opérateur expérimenté et disponibilité du laboratoire de microbiologie.
Tableau 85.6. Répartition des micro-organismes isolés
au cours des pneumonies communautaires admises en réanimation
Örtqvist [3]
1985
Suède
BTS [4]
1992
Royaume-Uni
Torres [2]
1990
Espagne
Moine [1]
1991
France
Nb patients 53 62 92 132
Étude rétrospective rétrospective prospective prospective
Âge moyen 52 54 53 58
Mortalité 25 % 48 % 22 % 24 %
Ventilation 58 % 88 % 61 % 61 %
Micro-organismes %
Inconnu
S. pneumoniæ
H. influenzæ
L. pneumophila
M. pneumoniæ
Virus influenza
S. aureus
Streptococcus sp
C. psittaci
Entérobactéries
P. æruginosa
47 %
28
–
–
5
4
4
–
4
–
–
42 %
18
12
12
7
5
3
–
–
3
–
48 %
14
–
13
6
–
–
3
–
4
5
28 %
32
11
3
1
5
4
7
–
10
–
44200_Volume4_1 Page 912 Jeudi, 12. février 2009 2:16 14
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%