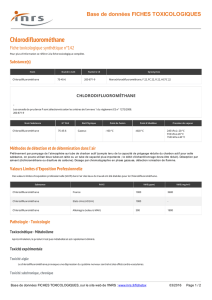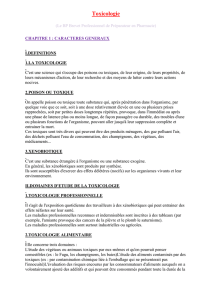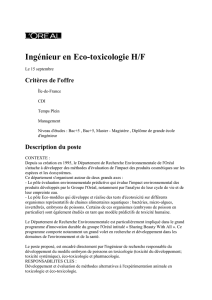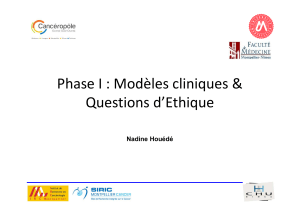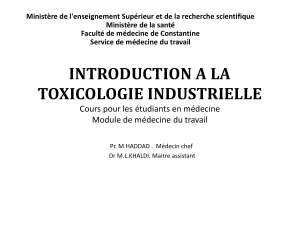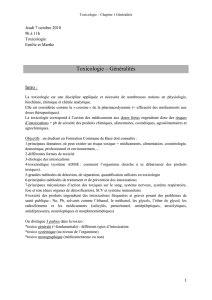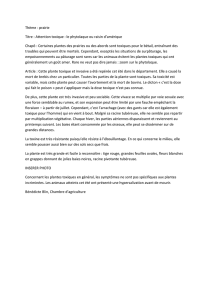Toxicologie : Notions fondamentales et évaluation des risques
Telechargé par
benoit toni

“Dosis sola facit venenum, c’est la dose qui fait le
poison“ est un des éléments clefs de l’approche
toxicologique souligné dès le XVIème siècle par
Paracelse ; le sens donné au mot poison à cette
époque rejoint celui de toxique utilisé actuellement. A
la simplicité de la question de base de la toxicologie
“quelle est la dose toxique ?” ; il est rétorqué “autant
de réponses qu’il y a de combinaisons cible/agent
toxique”.
La toxicologie est depuis longtemps reconnue
comme étant la science des poisons, c'est-à-dire
qu'elle étudie les effets néfastes d’un xénobiotique1
sur les organismes vivants. Elle englobe une
multitude de connaissances scientifiques et
s'intéresse à plusieurs secteurs de l'activité humaine
(chimie, agriculture, alimentation, médicaments) et à
différents environnements (professionnel,
domestique).
Les produits chimiques font partie intégrante de
notre vie quotidienne. Le développement scientifique
et technologique s'accompagne d’une augmentation
du nombre et de la diversité de ces substances à
l’origine d’une exposition croissante.
Cette fiche va fournir une brève description des
principes de bases de la toxicologie ; elle s’attachera
ensuite à décrire plus en détail la place de cette
discipline en santé environnementale à travers la
méthodologie d’évaluation du risque sanitaire.
Q u e l l e s s o n t l e s n o t i o n s
f o n d a m e n t a l e s e n
t o x i c o l o g i e ?
Etre exposé à une substance ne signifie pas pour
autant que celle-ci va pénétrer dans l’organisme et y
exercer un effet.
L’absorption d’un xénobiotique peut conduire à divers
effets biologiques qui peuvent s'avérer soit
bénéfiques pour la santé (par exemple, traitement
d’une maladie après l'administration d'un
médicament), soit néfastes (par exemple, une
atteinte pulmonaire après l'inhalation d'un gaz
corrosif). La notion d'effet toxique implique des
conséquences dommageables pour l'organisme.
1 Toute substance (chimique, biologique ou physique) étrangère à
l’organisme
Un xénobiotique qui a pénétré dans l'organisme peut
agir sur celui-ci ; les résultats de cette action sont
appelés les effets (l’étude du mécanisme d’action de
ces effets est la toxicodynamie). Inversement,
l'organisme peut agir sur ce produit ; c'est ce qu'on
appelle les biotransformations (leur étude fait partie
de la toxicocinétique).
On dit qu’une substance est toxique lorsque, après
pénétration dans l’organisme, quelle que soit la voie,
à une certaine dose unique ou répétée, elle
provoque, immédiatement ou à terme, de façon
passagère ou durable, des troubles d’une ou
plusieurs fonctions de l’organisme pouvant aller
jusqu’à l’arrêt complet de ces fonctions et amener la
mort.
LA D O S E
On peut différencier la dose externe lorsqu’on parle
de la quantité de substance qui entre en contact avec
l’homme par diverses voies d’exposition (inhalation,
ingestion, contact cutané), et la dose interne ou
absorbée lorsque l’on parle de la quantité de
substance qui a pénètré dans l’organisme (c’est la
dose externe, réduite des taux d’absorption)
L’accroissement de la dose interne au sein d’une
population s'accompagne généralement d'une
augmentation de l'intensité ou de la diversité des
effets toxiques (c’est ce qu’on appelle la relation
dose-effet), ou d’une augmentation de la fréquence
de survenue d’un effet (c’est ce qu’on appelle la
relation dose-réponse).
Cependant, les toxiques n'ont pas tous le même
degré de toxicité. Certains exercent une faible
toxicité même si on les absorbe en grande quantité
(par exemple, le sel), tandis que d'autres exercent
une forte toxicité même lorsqu'on les absorbe en
faible quantité (par exemple, le curare).
On peut en partie expliquer de telles variations par
les différences qui existent entre la structure
chimique des substances (c’est ce qu’on appelle la
relation structure-activité) et leur affinité pour
certaines cibles de l’organisme, et par conséquent,
leur capacité à provoquer un changement dans
l'organisme vivant. Des modifications, même
minimes, dans cette structure peuvent être à l'origine
d'effets différents, comme indiqué dans l’exemple qui
suit.
L A T O X I C O L O G I E

Schéma1 : Structure chimique et effet toxique
• Les effets toxiques à seuil de dose
Ils concernent les substances qui provoquent, au
delà d’une certaine dose, des dommages dont la
gravité est proportionnelle à la dose absorbée. Selon
cette approche classique de la toxicité, les effets
néfastes ne surviennent que si cette dose est atteinte
et dépasse les capacités de détoxification, de
réparation ou de compensation de l'organisme. Il
existe donc une dose (externe) limite en dessous de
laquelle l’effet n'a théoriquement pas lieu de survenir.
Dans ce cas, les études toxicologiques permettent
généralement d’identifier un indice que l’on appelle
dose maximale sans effet néfaste observable
(DMSENO, ou NOAEL en anglais pour no-observed
adverse effect level).
• Les effets toxiques sans seuil de dose
Pour des xénobiotiques exerçant des effets sans
seuil de dose, il existe une probabilité, même infime,
qu'une seule molécule de toxique pénétrant dans le
corps humain provoque des changements dans une
cellule qui sera par la suite à l'origine de l’effet
néfaste.
Ces xénobiotiques sont, pour l'essentiel, des
substances génotoxiques2, pouvant avoir des effets
cancérogènes3 ou reprotoxiques4.
Pour ces substances génotoxiques, on considère en
principe que l’initiation de la cancérogenèse ou d’un
effet sur la descendance est déclenchée par des
mutations dans le matériel génétique (ADN),
respectivement des cellules somatiques5 ou des
cellules germinales.
2 Qui provoque l'apparition de lésions dans l'ADN pouvant
éventuellement conduire à des mutations
3 Qui est susceptible de provoquer un cancer
4 Qui est susceptible de provoquer un effet sur les organes
reproducteurs, le système hormonal correspondant, la
conception ou le développement de l’enfant
5 Ce sont les cellules qui ne sont pas transmises aux enfants et
constituent la grande majorité des cellules de l'organisme. On
les oppose aux cellules germinales, qui constituent les
cellules reproductrices de l'espèce.
LE S V O I E S D ’A B S O R P T I O N
Ce sont les voies par lesquelles une substance
pénètre dans l'organisme. Les voies d'absorption
habituelles sont les voies respiratoires (par
inhalation) ; la peau (par pénétration cutanée) et la
voie digestive (par ingestion) (Cf. Schéma 2).
L’absorption de substances toxiques peut provoquer
une cascade de signaux biologiques
•
Schéma2 : Les sources et les voies d’exposition des toxiques ainsi que
leur distribution chez l’être humain
http://www.emcom.ca/science/exposurefr.shtml
LE S T Y P E S D E T O X I C I T E
• On distingue classiquement 3 formes de
toxicité : la toxicité aiguë, la toxicité à court terme
(subaiguë et subchronique) et la toxicité à long
terme (chronique).
La plupart des xénobiotiques peuvent causer à la fois
une toxicité aiguë et une toxicité à court terme ou à
long terme selon les conditions d'exposition. Les
effets néfastes qui en résultent peuvent être
différents. Ils peuvent être locaux (effets au point de
contact avec l’organisme) ou systémiques (effets
sur un ou plusieurs organes/systèmes après
distribution dans l’organisme par voie sanguine).
• La toxicité d’une substance peut être
modifiée par l’exposition préalable, simultanée, ou
consécutive à une autre substance. Les effets
peuvent alors soit s’additionner (synergie additive)
ou s’amplifier (potentialisation), soit au contraire se
combattre (antagonisme ; notion à la base de
l’utilisation d’antidotes).
• Les effets sur la santé peuvent être
réversibles ou temporaires lorsqu’ils disparaissent
après cessation de l’exposition à la substance (par
exemple irritation de la peau, nausées), ou
irréversibles ou permanents lorsqu’ils persistent ou
s’intensifient après arrêt de l’exposition (par exemple
cancer, cirrhose hépatique).
6 Procédé au cours duquel un xénobiotique est modifié
(transformé) par une réaction chimique, à l'intérieur de
l'organisme
Benzène : neurotoxique
et cancérogène (cancer
du sang)
Toluène : neurotoxique sans
cancérogénicité connue

Certains effets apparaissent rapidement après une
exposition unique à un toxique ; ce sont les effets
immédiats (par exemple, une intoxication au
cyanure). D’autres effets n’apparaissent qu’après un
temps de latence plus ou moins long ; ce sont les
effets retardés. Ce peut être le cas des effets
cancérogènes qui ne se manifestent qu’au bout de
plusieurs années, mais également les effets
observés avec des toxiques cumulatifs pouvant se
manifester à la suite d’expositions répétées. Par
exemple, le fluorure de sodium, en très faibles
concentrations (comme dans le dentifrice ou l'eau
potable), ne cause pas d'effet néfaste visible, même
à long terme ; cependant, lorsque l'organisme est
exposé à des concentrations beaucoup plus élevées,
ce produit se dépose et s'accumule dans les os. Au
début, la quantité de fluorure n’entraîne pas de
symptôme visible, mais après quelques années
d'exposition, il apparait une fluorose, ce qui rend les
os extrêmement fragiles et cassants.
E S S A I S D E T O X I C I T E
Dans la plupart des cas, la toxicité aiguë d'une
substance est mieux connue. Elle est observée chez
l’homme après la survenue d’expositions
accidentelles. Elle est étudiée in vivo, chez l’animal
après exposition à des doses relativement élevées,
ou in vitro avec des tests sur cultures cellulaires.
Les connaissances sur la toxicité à court ou long
terme viennent d’une part, d'essais sur les animaux
après des expositions de 1, 3 ou 6 mois, voire de 2
ans pour les études de cancérogenèse, et d’autres
part, d’études sur des travailleurs exposés à des
produits chimiques pendant un certain nombre
d’années.
LA V A R IA B I LI T E I N D IV I D U E L L E
Les individus peuvent être affectés différemment par
une dose toxique, et une même personne peut y
réagir différemment selon les moments de sa vie.
Deux principaux types de facteurs contribuent à
expliquer la nature et l'étendue des effets toxiques :
• Les facteurs héréditaires, des différences
dans le patrimoine génétique peuvent intervenir dans
la capacité des individus à transformer les toxiques.
• Les facteurs physiologiques qui sont
nombreux et incluent :
o l'âge : la sensibilité aux effets toxiques est
différente chez les nouveaux-nés, les jeunes
enfants et les personnes âgées ;
o le sexe ;
o l'état nutritionnel : la toxicité peut être
influencée par la masse de tissus adipeux, la
déshydratation, les carences en vitamines … ;
o la grossesse : il se produit des modifications
de l'activité métabolique de l’organisme et donc
des xénobiotiques au cours de la grossesse ;
o l'état de santé : les individus en bonne santé
sont plus résistants, car ils métabolisent et
éliminent les toxiques plus facilement que ceux
qui présentent des atteintes du foie ou des reins
où ont respectivement lieu ces 2 phénomènes.
La connaissance de l'interaction de tous ces facteurs
et de nombreux autres aspects demeure incomplète.
En effet, il est souvent difficile d'évaluer la sensibilité
d'un individu ou d'une population et de prévoir quelle
sera la réponse biologique de l'organisme après
l'exposition à un toxique.
L a t o x i c o l o g i e d a n s
l ’ é v a l u a t i o n d u r i s q u e
La toxicologie est un des piliers du processus de
l’évaluation du risque pour la santé de l’homme via
son environnement.
Le recours à des données toxicologiques s’applique
à toutes les étapes de l’évaluation de risque.
Schéma3 : L’évaluation du risque, d’après Les quatre
étapes de l’évaluation des risques pour la santé
humaine du National Research Council (1983)

LO R S D E L ’I D E N T I F I C A T I O N D E S D A N G E R S
Un danger est une capacité intrinsèque d’un
xénobiotique à causer des effets néfastes sur la
santé.
Il peut être exprimé de multiples façons : mortalité,
morbidité7, apparition d’une maladie, incapacité,
pouvoirs cancérogène, mutagène, ou tératogène8,
modification d’un facteur physiologique ou même
atteinte à la qualité de la vie.
Les essais expérimentaux sur l’animal permettent
de connaître les effets sur la santé des différents
xénobiotiques. Elles sont souvent longues (1, 3, ou 6
mois, voire 2 ans) et coûteuses, mais surtout
nécessitent un grand nombre d’animaux, sans pour
autant que les résultats observés soient
transposables à l’homme.
Dans le but de réduire le nombre d’animaux testés,
la fiabilité et le temps nécessaire pour une
évaluation, des méthodes dites « alternatives à
l’expérimentation animale » ont été développées.
Elles comprennent aussi bien les modèles in vitro
(expérimentation sur culture cellulaire), que les
modèles in silico9 (modélisation toxicocinétique,
étude de la relation structure-activité). Par ailleurs,
les récentes avancées technologiques (par exemple,
les puces) dans le domaine de la génomique10 et la
protéomique11 devraient accélérer nos
connaissances en toxicologie. A l’heure actuelle, les
méthodes dites « alternatives » sont essentiellement
utilisées pour l’étude des mécanismes toxiques ;
l’entrée en vigueur du règlement REACH prévoit de
les rendre obligatoires celles qui sont validées par
l’ECVAM12. Enfin, quel que soit le modèle utilisé, la
transposition des résultats à l’homme reste un facteur
limitant important.
LO R S D E L ’E S T I MA T I O N D E L A R EL A T IO N D O S E -
REPONSE
Dans le cas d’un effet à seuil de dose, la relation
dose-réponse est synthétisée par un niveau de dose
(dose de référence) dont on pense raisonnablement
qu’il ne produira pas d’effet chez l’homme. Ce niveau
de dose est obtenu en appliquant un facteur
d’incertitude à la DMSENO définie précédemment.
Ce niveau de dose est appelé valeur
toxicologiques de référence (VTR) dans le
domaine de la santé environnementale.
7 Nombre de personnes souffrant d'une maladie donnée pendant
un temps donné, dans une population
8 Pouvant provoquer un développement anormal de l’embryon et
conduisant par là même à des malformations
9 Modèle utilisant l’outil informatique
10 Science qui étudie la structure et le fonctionnement des gènes
11 Science qui étudie la structure et le fonctionnement des
protéines
12 Centre européen de validation des méthodes alternatives
Dans le cas d’un effet sans seuil de dose, on parle
d’un excès de risque attribuable au facteur étudié
ou de seuil toxicologique critique (TTC en anglais,
pour Threshold of Toxicological Concern), qui est
considéré acceptable socialement. Par exemple dans
le domaine alimentaire, on considère selon cette
approche, que la consommation quotidienne pendant
70 ans d’un additif alimentaire en dessous de
1.5 µg/jour n’entraînera pas d’excès de risque de
cancer au-delà d’un cas supplémentaire dans une
population de 100 000 personnes.
LO R S D E L ’E S T I MA T I O N D E S E X P O S I TIO N S
Cette étape consiste à décrire et à quantifier aussi
précisément que possible les expositions des
populations, d’une part, par groupes pertinents d’âge
et de sexe, compte-tenu des variations de
sensibilité, et d’autre part, selon les différentes
sources d’exposition et les différentes voies d’entrée
du toxique.
La toxicologie a ici sa place dans l’utilisation de
méthodes recherchant la présence d'un
biomarqueur13 d'exposition dans le sang, les
urines, la peau, les cheveux, etc. Le biomarqueur
d’exposition peut être l’agent toxique en lui-même,
l'un de ses métabolites14 ou son association avec
une molécule cible (ADN, albumine, hémoglobine).
Malheureusement, les données sont souvent
manquantes et on est amené à faire des hypothèses
sur la manière dont les individus sont exposés,
notamment à partir de données d’émission à la
source.
LO R S D E L A C A R A C T E R I S A TI O N D U R I S Q U E
Le risque est la probabilité de survenue du
danger (c’est-à-dire de l’effet toxique) ; il est
caractérisé en confrontant les résultats de
l’estimation de la relation dose-réponse avec ceux de
l’estimation des expositions. Cette étape comporte
donc des incertitudes plus ou moins importantes
selon la nature et quantité des données recueillies.
En effet, cette approche suppose notamment qu’il
existe un lien causal entre l’agent et le, ou les effets
étudiés aux doses estimées ; or elle est souvent
basée sur des données chez l’animal qui sont par la
suite transposées chez l’homme (variations inter-
espèces). Il existe également des incertitudes quant
à la détermination des DMSENO (fonction du
protocole d’étude) et à l’application des autres
facteurs de sécurité (variations inter-individuelles
…) pour l’élaboration des doses de référence.
13 Paramètre toxicologique pouvant servir à montrer ou prédire un
évènement toxique chez un individu.
14 Produit de transformation d’un xénobiotique par l’organisme.

De même, les extrapolations des fortes doses aux
faibles doses pour les effets sans seuil sont aussi
sources d’incertitudes. Enfin, pour des expositions
chroniques, une dose cumulative est calculée en
additionnant chaque exposition unitaire (par
exemple, chaque dose quotidienne), sans tenir
compte de la demi-vie de la substance dans
l’organisme, de son métabolisme, ou du mécanisme
d’action impliqué.
L’analyse des incertitudes permet d'apprécier la
confiance qui peut être accordée aux estimations.
Elle permet également d'établir des
recommandations de recherche qui concernent dans
bien des cas la toxicologie et qui ont permis l’essor
de cette discipline au cours de ces dernières années.
En conclusion, la démarche d’évaluation du risque
doit se faire de manière pluridisciplinaire, avec la
participation d’experts dans les divers domaines, tels
que des environnementalistes, des épidémiologistes
et des toxicologues.
Rédacteurs :
Mounia EL YAMANI et Caroline SERET
Relecteurs :
Christophe ROUSSELLE et Nathalie BONVALLOT
Références
Bonvallot N. et Dor F. Valeurs toxicologiques de
référence : méthodes d’élaboration. InVS 2002
Carpenter DO et coll.. Human Health and chemical
mixtures: an overview.Environ Health Perspect 1998,
106: 1263-1270
Clayson et coll. Toxicological rik assessment Volume 1
et 2 CRC Press, Florida, 1985
Empereur-Bissonet P.Aspect méthodologiques de
l’évaluation quantitative des risques pour la santé
humaine liés aux pollutions chimiques de
l’environnement. Energies santé. Vol 10, n°4 pp. 562-
582. 1999
Gérin M., et coll. Environnement et Santé publique,
Fondements et pratiques, 2003.
Ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec. Principes directeurs d’évaluation du risque
toxicologique pour la santé humaine de nature
environnementale, Collection orientations et
interventions, décembre 1999
Schieber C. et Schneider T. Analyse des modalités de
fixation des valeurs limites d’exposition et d’émission
pour les substances chimiques et radioactives. Centre
d’études sur l’évaluation de la protection dans le
domaine nucléaire. Rapport N° 272, Août 2002
Viala A. et Botta A. Toxicologie. 2ème édition, Lavoisier.
Sur Internet
1. L’OMS édite des données disponibles dans la
série Environmental Health Criteria de l'International
Programme on Chemical Safety.
http://www.who.int/bookorders/francais/subscription2.js
p?sesslan=2
2. IRIS La banque de données est accessible
gratuitement:
http://www.epa.gov/iriswebp/iris/index.html
3. ATSDR. Les profils toxicologiques et les MRL sont
disponibles http://www.atsdr.cdc.gov/toxpro2.html et
http://www.atsdr.cdc.gov/mrls.html
4. L'Agence de Protection de l'Environnement de
Californie (Cal-EPA) et plus particulièrement le Bureau
d'évaluation des risques sanitaires environnementaux
(Office of Environmental Health Hazard Assessment -
OEHHA). http://www.oehha.ca.gov/
5. L’INRS dispose d’un catalogue de Fiches
toxicologiques, ce sont des synthèses techniques et
règlementaires des informations concernant les
risques liés à un produit ou à un groupe de
produits.www.inrs.fr
6. l'Ineris met en ligne un répertoire de fiches
techniques concernant diverses substances
dangereuses http://www.ineris.fr/
1
/
5
100%