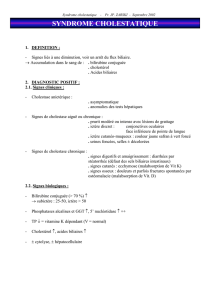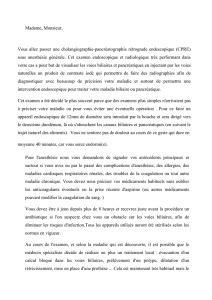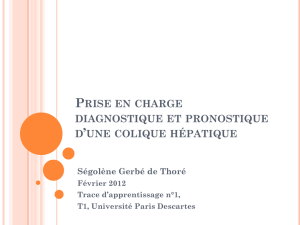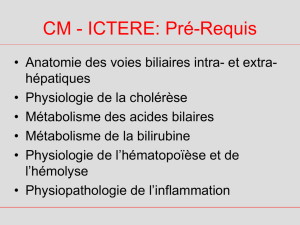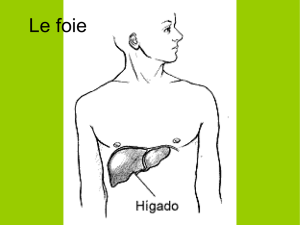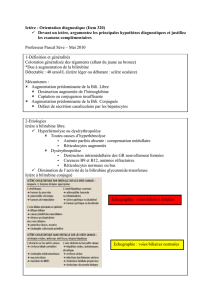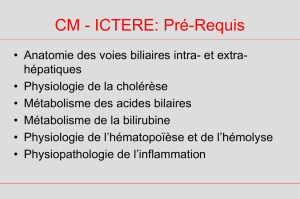Cholestase : Conduite à tenir, Diagnostic et Traitement
Telechargé par
Mohamed Amine Ait Lhadj

Conduite à tenir devant une cholestase
J.-A. Bronstein, J.-L. Caumes, M. Richecoeur, A.-S. Lipovac
La cholestase est une situation clinique fréquente en pratique quotidienne. Elle peut être évoquée devant
des signes cliniques (ictère, prurit), ou biologiques (augmentation des phosphatases alcalines [PAL], des
cGT). La cholestase peut être isolée ou associée à d’autres anomalies clinicobiologiques qui peuvent
accompagner ou révéler une maladie hépatobiliaire. La démarche diagnostique est grandement facilitée
par l’échographie abdominale. De nouvelles techniques d’imagerie médicale, notamment la
cholangiographie par résonance magnétique et l’échoendoscopie, sont plus sensibles que la
tomodensitométrie. Le cathétérisme rétrograde par voie endoscopique ne garde que des indications à
visée thérapeutique. On distingue habituellement les cholestases intrahépatiques, des cholestases
extrahépatiques.
© 2005 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Cholestase ; Cholestase intrahépatique ; Cholestase extrahépatique ; Ictère ; Prurit ;
Échographie abdominale ; Cholangiographie par résonance magnétique
Plan
¶Physiopathologie 1
Mécanismes 1
Conséquences 1
¶Circonstances de découverte 2
¶Diagnostic positif : le syndrome cholestatique 2
Cholestase clinique 2
Cholestase biologique 2
¶Diagnostic étiologique 3
Arguments du diagnostic 3
Explorations morphologiques 3
Étiologies 4
¶Traitement 5
En cas de cholestase extrahépatique 5
En cas de cholestase intrahépatique 5
■Physiopathologie
Mécanismes
La cholestase est définie par la diminution du débit de bile
dans le duodénum. Cela peut refléter une anomalie du métabo-
lisme de la bile, du pôle basal de l’hépatocyte à l’ampoule de
Vater. On distingue habituellement les cholestases extrahépati-
ques et les cholestases intrahépatiques.
Cholestases extrahépatiques
Une obstruction des canaux biliaires détermine successive-
ment une dilatation des voies biliaires extrahépatiques, des
voies biliaires intrahépatiques, une augmentation de la perméa-
bilité canaliculaire, une inversion de la polarité de l’hépatocyte
qui font que les substances normalement sécrétées dans la bile
vont refluer dans le sang. Quand la cholestase se prolonge, elle
détermine, par des mécanismes inconnus, une néocanaliculoge-
nèse, une fibrose puis une cirrhose appelée cirrhose biliaire
secondaire.
Cholestases intrahépatiques
Elles peuvent être dues :
• soit à une obstruction des voies biliaires intrahépatiques, par
altération des canaux biliaires comme dans la cirrhose biliaire
primitive, ou par une tumeur comprimant les voies biliaires ;
• soit à une altération des systèmes de transport hépatocytaires
responsables de la sécrétion biliaire. Au niveau de la mem-
brane basale de l’hépatocyte, il s’agit principalement de
l’adénosine triphosphate (ATP) Na+ , K+ dépendante (Na+ ,
K+ - ATPase). Cette pompe électrogénique permet de mainte-
nir le gradient transmembranaire de sodium comme source
d’énergie pour la captation de nombreux substrats. Au niveau
intracellulaire, les substrats peuvent rejoindre le pôle canali-
culaire soit par diffusion (généralement sous forme liée à des
protéines), soit éventuellement par une voie vésiculaire
impliquant le réticulum endoplasmique et l’appareil de Golgi.
Au niveau de la membrane canaliculaire, les acides biliaires
sont transportés par deux systèmes. L’un est un transporteur
dépendant de l’ATP, l’autre est un système électrogénique
dépendant du potentiel de membrane. L’atteinte de ces
transporteurs, en particulier par les médicaments, peut
entraîner une cholestase.
Conséquences
Les manifestations cliniques et biologiques de la cholestase
résultent (Tableau 1):
• de l’accumulation dans le sang et d’autres tissus de substances
normalement excrétées dans la bile, incluant les acides
biliaires, la bilirubine, les lipides biliaires et plusieurs enzymes
de la membrane cytoplasmique des hépatocytes ;
• de la malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles
A, D, E, K provenant d’une concentration postprandiale
insuffisante d’acides biliaires dans la partie haute de l’intestin
grêle.
¶7-007-B-15
1Hépatologie

■Circonstances de découverte
Différents tableaux peuvent se présenter :
• soit un contexte bruyant (fièvre, encéphalopathie). Il est alors
urgent d’en rechercher la cause et de la traiter ;
• soit l’absence de signe de gravité. On a alors le temps de faire
le point. Il peut s’agir de signes cliniques ou biologiques
révélant ou compliquant une maladie hépatobiliaire, il peut
s’agir d’une anomalie purement biologique de découverte
fortuite.
■Diagnostic positif : le syndrome
cholestatique (Tableau 1)
Cholestase clinique
L’ictère et le prurit sont les manifestations essentielles.
L’ictère se caractérise par une coloration jaune des conjonctives
et des téguments. Les urines sont foncées, les selles sont
décolorées. L’intensité de l’ictère est variable. En cas d’ictère
intense, la peau peut avoir des reflets verdâtres. L’ictère n’est pas
constant au cours de la cholestase. Il peut apparaître très
tardivement des semaines, voire des années après comme au
cours de la cirrhose biliaire primitive.
Le prurit est très probablement en rapport avec la présence de
sels biliaires dans la peau, mais aussi à la fixation de ligands des
opiacés endogènes sur les récepteurs centraux et d’une activa-
tion des mastocytes avec libération de médiateurs dont l’hista-
mine.
[5, 11]
C’est un signe majeur mais inconstant de la
cholestase survenant chez 20 à 50 % des malades ictériques et
chez la plupart des malades ayant une cirrhose biliaire
primitive.
Ce syndrome clinique classique ne préjuge pas forcément du
mécanisme de la cholestase.
Cholestase biologique
Elle se définit par l’élévation de la bilirubine conjuguée (BC),
de la phosphatase alcaline (PAL), une augmentation de la
gammaglutamyl transpeptidase (cGT) à des taux supérieurs à
deux fois la normale, une augmentation du cholestérol sérique
et de la concentration des sels biliaires, ainsi que la présence de
la bilirubine dans les urines.
[9]
Un autre marqueur peut être
rajouté ; augmentation de la 5’ nucléotidase (5NU), spécifique
d’une maladie hépatobiliaire.
Phosphatases alcalines
L’origine de la PAL est hépatique, intestinale, rénale et
placentaire. Une élévation supérieure à quatre fois la valeur
normale est retrouvée chez 75 % des patients présentant une
cholestase prolongée. Une augmentation de cette importance se
rencontre dans les obstructions. Malgré tout, cette augmenta-
tion ne préfigure pas de la nature intra- ou extrahépatique de
l’obstruction. Une élévation modérée jusqu’à trois fois la valeur
normale n’est pas spécifique de telle ou telle maladie hépatobi-
liaire. Les principales causes d’élévation de la PAL sont l’obs-
truction partielle des voies biliaires, la cirrhose biliaire primitive,
la cholangite sclérosante, les ductopénies biliaires, les médica-
ments comme les androgènes, la phénytoïne, certaines granu-
lomatoses (sarcoïdose).
Gammaglutamyl transpetidase
L’élévation de la cGT reflète le même spectre d’anomalies que
l’augmentation des PAL. L’augmentation de la cGT est souvent
corrélée avec celle des PAL. Quelques auteurs ont suggéré que la
cGT avait une meilleure sensibilité que la PAL, mais elle
manque de spécificité. L’augmentation de la cGT est notée dans
un nombre de situations cliniques (maladies du pancréas,
infarctus du myocarde, diabète, bronchopathie chronique
obstructive). L’augmentation de la cGT est un test sensible dans
l’alcoolisme variant entre 52 et 94 %. Compte tenu de son
manque de spécificité, une élévation de la cGT sans augmenta-
tion de la PAL ou de la 5NU ne doit pas orienter vers une
maladie hépatique.
5’ nucléotidase
L’élévation de cette enzyme est rencontrée dans les mêmes
circonstances que la PAL. Elle détecte aussi bien les obstacles, les
infiltrations, et les processus occupants. Si les valeurs des deux
enzymes (PAL et 5NU) sont souvent corrélées, leurs variations
ne sont pas forcément proportionnelles. Ainsi, chez certains
patients, une enzyme peut être élevée et l’autre normale. Ainsi,
l’intérêt majeur du dosage de la 5NU est sa grande spécificité.
Une élévation de cette enzyme associée à une augmentation des
PAL suggère une origine hépatique chez une personne non
enceinte. Cependant, compte tenu de l’existence d’exception-
nelle dissociation entre ces deux enzymes, une augmentation de
la PAL sans élévation des 5NU peut être aussi d’origine
hépatique.
On distingue habituellement les cholestases récentes ou de
courte durée qui apparaissent souvent dans un contexte suggé-
rant leur étiologie. Dans les cholestases prolongées ou chroni-
ques, la cholestase peut être initialement anictérique,
asymptomatique ou entraîner un prurit et/ou une asthénie. Il
existe une augmentation de la concentration circulante des
acides biliaires, des PAL et de la cGT. L’activité des aminotrans-
férases est modérément élevée. La cholestase devient ensuite
ictérique. Le prurit est fréquent, mais non constant. Il existe
une stéatorrhée, entraînant une malabsorption des graisses et
des vitamines liposolubles. Un amaigrissement apparaît. Une
pigmentation de mélanine peut s’ajouter à l’ictère. Des xantho-
mes sous-cutanés secondaires à l’hypercholestérolémie peuvent
se développer, en particulier sur les paupières. La malabsorption
de la vitamine A et de la vitamine E entraîne exceptionnelle-
ment des symptômes chez l’adulte. L’ostéopénie est, en revan-
che, fréquente, mais la malabsorption de la vitamine D ne joue
pas un rôle important. Il s’agit essentiellement d’une ostéopo-
rose. Cette ostéopénie peut être asymptomatique ou entraîner
des douleurs osseuses, des tassements vertébraux et des fractu-
res. La bilirubine conjuguée dépasse rarement 500 µmol/l.
Lorsque la bilirubine dépasse 500 µmol/l, il faut rechercher soit
une insuffisance rénale, soit une hémolyse associée. Le taux de
prothrombine (TP) peut être abaissé du fait d’une malabsorption
de la vitamine K. Le facteur V est normal ou augmenté et ne
baisse qu’au stade terminal de la maladie lorsque survient une
insuffisance hépatocellulaire.
Tableau 1.
Signes cliniques et biologiques du syndrome cholestatique.
Conséquences cliniques
A. Primaires : accumulation des constituants biliaires
Bilirubine Ictère
Acides biliaires Prurit
Substances pruritogènes
Lipides Xanthomes, xanthélasma
Anomalies morphologiques des hématies
Cuivre Anneau de Kayser-Fleischer
Enzymes hépatiques Phosphatases alcalines
5’ nucléotidase
Gammaglutamyl transpeptidase
B. Secondaires : diminution de la concentration intestinale d’acides
biliaires entraînant la malabsorption de
Graisses alimentaires Stéatorrhée
Amaigrissement
Vitamine A Héméralopie
Vitamine D Ostéomalacie
Vitamine E Neuromyélopathie
Vitamine K Syndrome hémorragique
7-007-B-15
¶
Conduite à tenir devant une cholestase
2Hépatologie

■Diagnostic étiologique
Arguments du diagnostic
L’interrogatoire doit rechercher : la prise de médicaments, de
drogues, d’alcool, rechercher des facteurs de risque d’infections
par les virus hépatotropes, les antécédents chirurgicaux, en
particulier une cholécystectomie, des antécédents familiaux et
personnels de maladies du foie, le statut au virus de l’immuno-
déficience humaine (VIH), un séjour outre-mer.
Il est utile de rechercher ensuite les signes cliniques accom-
pagnant l’installation de la cholestase : douleur de type biliaire,
ou pancréatique, altération de l’état général, fièvre.
L’examen clinique peut révéler un signe de Courvoisier, des
signes d’insuffisance hépatocellulaire ou d’hypertension portale,
comme une ascite, une splénomégalie, des angiomes stellaires,
ou une gynécomastie. Certains éléments suggèrent l’étiologie
néoplasique comme un gros foie nodulaire et douloureux, une
vésicule palpable, des adénopathies sus-claviculaires.
Les examens biologiques simples permettent une orientation
étiologique. Une polynucléose oriente plutôt vers une angiocho-
lite, une hépatite alcoolique, une leucopénie vers une hépatite
virale, l’hyperéosinophilie vers une hépatite médicamenteuse. Une
anémie évoque un saignement ou un cancer, une polyglobulie un
syndrome paranéoplasique. Les aminotransférases (AT) très élevées
orientent vers une hépatite (virale, toxique, médicamenteuse). Les
AT élevées peuvent se rencontrer au cours des obstructions
biliaires aiguës. Les AT élevées de façon modérée se rencontrent
dans la cholestase pure et dans toutes les maladies aiguës ou
chroniques du foie. Une hypergammaglobulinémie oriente vers
une hépatopathie chronique, un bloc bc vers une cirrhose.
D’autres marqueurs peuvent être recherchés : tests sérologiques
pour les virus hépatotropes, surcharge ferrique (coefficient de
saturation de la sidérophiline, ferritine), recherche d’autoanticorps
(anticorps antimitochondries, antimuscles lisses, anti-liver/kidney
microsomes
[anti-LKM]), recherche d’un déficit de la céruléoplas-
mine, d’un déficit en $1-antitrypsine.
Explorations morphologiques
Échographie
L’échographie est l’examen morphologique de choix à réaliser
dans le diagnostic étiologique des cholestases. La facilité d’accès,
le caractère non invasif, peu onéreux, non ionisant, l’absence de
contre-indication sont autant de facteurs qui font que cet
examen est le prolongement naturel de l’examen clinique. Il
peut être réalisé au lit du malade. Il permet de savoir s’il s’agit
d’une cholestase extrahépatique par la mise en évidence d’une
dilatation des voies biliaires. La sensibilité de cet examen dans
la détection d’une dilatation des voies biliaires et d’une obstruc-
tion des voies biliaires varie entre 55 et 91 %.
[13, 14]
La
sensibilité augmente lorsque la concentration sérique en
bilirubine s’aggrave et avec la durée prolongée de l’ictère.
[6]
Le
canal hépatique commun, dont le diamètre transversal est
inférieur à 7 mm, doit être considéré comme normal. Un
obstacle est possible lorsqu’il est plus large.
Dans un petit nombre de cas, cet examen peut se solder par
un résultat faussement négatif, soit en raison d’une erreur de
l’échographiste, soit lorsqu’il n’existe pas de véritable dilatation
comme c’est parfois le cas au cours d’une lithiase de la voie
biliaire principale, ou bien en cas d’obstacle récent. D’autres
situations peuvent ne pas entraîner une dilatation des voies
biliaires : une infiltration pariétale diffuse, une cholangite
sclérosante.
Les voies biliaires intrahépatiques normales peuvent être
détectées. Lorsqu’elles sont dilatées, elles deviennent évidentes
et sont parfois plus larges que les branches portales adjacentes
(signes du canon de fusil). Le doppler est un moyen utile pour
différencier les vaisseaux des voies biliaires, car ces dernières ne
génèrent aucun signal enregistrable. Les dilatations intrahépati-
ques sont plus évidentes dans le lobe gauche, même en cas
d’obstruction symétrique car ce secteur est plus facilement
étudié. Quand les voies biliaires intrahépatiques sont dilatées,
l’obstruction biliaire est presque certaine.
Cholangiographie par résonance magnétique
ou bili-IRM
Comme pour toutes les techniques d’IRM, il y a plusieurs
stratégies pour effectuer une bili-IRM. Toutes utilisent, à la base,
une séquence fortement pondérée en T2 dans laquelle les
fluides stationnaires, tels que la bile et les sécrétions pancréati-
ques, ont un hypersignal intense par rapport aux tissus hépati-
que ou pancréatique environnants. Les voies biliaires intra- et
extrahépatiques normales sont visualisées dans plus de 90 % des
cas.
[15]
Les variantes anatomiques sont dépistées avec préci-
sion.
[19]
L’existence et le site d’un obstacle biliaire sont
respectivement déterminés dans 90 à 100 % et 85 à 100 % des
cas.
[20]
Les lésions bénignes ou malignes sont distinguées dans
au moins 80 % des cas.
[4]
Les calculs de la voie biliaire principale sont détectés à partir
de 4 mm de diamètre, mais ne peuvent être différenciés d’un
caillot sanguin, d’une tumeur, d’un sludge, ou de parasites.
[3]
En
cas de dilatation de la voie biliaire principale, la sensibilité pour
dépister une lithiase de la voie biliaire principale de plus de
4 mm est de 90 à 95 % par rapport à la cholangiographie
rétrograde perendoscopique.
[2]
Le rôle de la bili-IRM dans le
diagnostic des cancers des voies biliaires n’est pas encore bien
défini. La valeur prédictive positive de détection d’un cholan-
giocarcinome est de 86 %, la valeur prédictive négative de
98 %.
[7]
Ces résultats sont peut-être surestimés.
[16]
La bili-IRM
permet de détecter et d’évaluer l’extension des obstructions
hilaires et périhilaires.
[23]
En cas de pancréatite aiguë, la bili-
IRM est utile pour évaluer les voies biliaires, la présence d’une
lithiase, l’aspect des canaux pancréatiques, la présence de kystes
pancréatiques.
[18]
Elle permet aussi de distinguer un cancer du
pancréas d’une pancréatite chronique.
[1]
Actuellement, son
principal inconvénient est sa disponibilité réduite.
[21]
Échoendoscopie
Cet examen permet d’évaluer le canal hépatique commun en
positionnant l’extrémité de l’endoscope dans la portion verticale
du duodénum. La portion basse du canal hépatique et
l’ampoule sont alors bien dégagées. Cette méthode apparaît être
la seule capable de permettre une image de l’ampoule. Elle
semble avoir une très bonne sensibilité et spécificité pour le
diagnostic de carcinome de l’ampoule et pour celui de calcul
enclavé dans le canal cholédoque.
[10]
Tomodensitométrie (TDM)
Sa sensibilité et sa valeur prédictive sont comparables à celle
de l’échographie dans le diagnostic d’obstruction. Sa place est
limitée dans l’exploration de première intention des voies
biliaires. En revanche, son intérêt principal réside dans le bilan
d’extension à distance des tumeurs biliopancréatiques.
[8]
La
TDM est plus sensible que l’échographie pour identifier de petits
abcès, des collections extrahépatiques, de l’air et des
calcifications.
Cholangiographie rétrograde perendoscopique
(CPRE)
Une opacification rétrograde des voies biliaires peut être
effectuée lorsqu’un cathétérisme endoscopique de la papille est
possible. Le taux de succès est habituellement supérieur à 90 %.
Cette méthode montre le pôle inférieur de l’obstruction et
permet une sphinctérotomie lorsqu’elle est nécessaire, aussi bien
que la visualisation et des biopsies de l’ampoule de Vater. Si une
lésion obstructive peut être cathétérisée, une endoprothèse peut
être déployée à partir du bas.
Biopsie hépatique (PBH)
Cet examen a une place privilégiée dans l’approche diagnos-
tique et la recherche d’une cholestase chronique. Cet examen
s’attache à rechercher :
• des signes d’obstacle pour éliminer une pathologie sur l’arbre
biliaire extrahépatique ;
• une maladie de l’arbre biliaire intrahépatique en recherchant
des signes caractéristiques d’une cirrhose biliaire primitive à
un stade floride ou une cholangite sclérosante primitive ;
Conduite à tenir devant une cholestase
¶
7-007-B-15
3Hépatologie

• une infiltration granulomateuse comme dans la sarcoïdose ;
• enfin l’examen anatomopathologique permet parfois de
rattacher une cholestase purement biologique et sans traduc-
tion histologique à une stéatose, une hyperplasie nodulaire
régénérative, une maladie vasculaire, etc.
Étiologies (Fig. 1)
Il est important dans un premier temps de dépister les
urgences qui incitent à un diagnostic et un traitement précoces.
En l’absence d’urgence, deux situations cliniques sont alors
possibles : il existe un contexte clinique ou non. L’échographie
guide le diagnostic. Le bilan clinique et échographique permet
un diagnostic dans 75 % des cas.
[17]
Si l’échographie est
normale, la bili-IRM, l’échoendoscopie, la PBH sont alors
envisagées au cas par cas.
Situation d’urgence clinique
Angiocholite
Il s’agit d’un tableau d’ictère douloureux et fébrile, d’intensité
variable. La triade de Charcot n’est présente que dans un peu
plus d’un tiers des cas. La douleur est absente dans 25 % des
cas. La polynucléose franche est un élément d’orientation. La
possibilité est l’évolution vers un syndrome septicémique. Dans
5 % des cas l’échographie ne montre ni lithiase, ni dilatation
des voies biliaires. Ceci renforce l’intérêt de la bili-IRM.
Hépatites aiguës
Le risque majeur est l’apparition d’une insuffisance hépato-
cellulaire (IHC) (chute du taux de prothrombine et du facteur
V).
En faveur d’une origine virale aiguë (A, B, C, D, E), on
retient : la notion de contact, la phase préictérique, l’élévation
importante des alanines aminotransférases (ALAT), la positivité
des marqueurs sériques. Les hépatites du groupe Herpesviridae
(cytomégalovirus, virus d’Epstein-Barr [CMV, EBV]) causent
plutôt des hépatites cholestatiques. Une forme clinique choles-
tatique d’hépatite virale A doit être connue.
En faveur d’une cause médicamenteuse, on retient : la prise
de médicaments hépatotoxiques, la mise en évidence d’une
hyperéosinophilie, l’amélioration des anomalies du bilan
hépatique après arrêt du traitement.
Situation non urgente
Contexte clinique évocateur
Devant un antécédent de cholécystectomie pour lithiase ou
s’il existe une lithiase vésiculaire en échographie, il faut
éliminer en priorité une lithiase de la voie biliaire principale
(VBP). Selon les moyens, une bili-IRM ou une échoendoscopie
sont les premières explorations.
Devant un ictère progressif avec une altération de l’état
général on évoque un cancer de la tête du pancréas, ou des
voies biliaires. L’examen met en évidence une grosse vésicule,
souvent associée à un prurit. Le diagnostic repose sur la bili-
IRM, qui met en évidence une dilatation des voies biliaires selon
le siège de l’obstruction, une infiltration de la voie biliaire, la
TDM permet de faire un diagnostic topographique de syndrome
tumoral de la tête du pancréas. L’augmentation du CA19.9 doit
être interprétée avec prudence.
En cas d’alcoolisme, il faut penser à une hépatite alcoolique.
Le tableau clinique est celui d’un ictère fébrile pseudoangiocho-
litique. L’examen biologique met en évidence une polynucléose,
une hypertransaminasémie prédominant sur les aspartates
aminotransférases (ASAT). Il existe une IHC. Le diagnostic est
porté par PBH.
S’il existe une hépatopathie chronique connue : il faut
rechercher une cause aggravante
En cas de grossesse trois diagnostics sont possibles. La stéatose
aiguë gravidique d’abord, évoquée au troisième trimestre de la
grossesse devant des douleurs abdominales, un ictère, une
hypertension artérielle, une hypertransaminasémie. Une chute
du facteur V est habituelle. Le pronostic maternofœtal de cette
affection a radicalement été transformé par l’accouchement
précoce. La cholestase intrahépatique gravidique ensuite qui se
manifeste par un prurit qui rend la grossesse à risque pour le
fœtus. Au cours de la pré-éclampsie, enfin, des lésions hépati-
ques très sévères peuvent apparaître.
Dans un contexte infectieux, il faut éliminer la cholestase des
maladies infectieuses. Elle se rencontre principalement au cours
des infections bactériennes à Gram négatif. D’autres agents
infectieux peuvent être impliqués : leptospirose, mycobactéries,
rickettsies, tréponèmes. Le VIH favorise d’autres agents infec-
tieux : CMV et cryptosporidiose.
En cas de cardiopathie connue, la présence d’un gros foie
douloureux évoque un foie cardiaque avec un reflux hépatoju-
gulaire. L’état des veines sus-hépatiques doit être précisé, si cela
n’a pas été fait sur l’échographie « standard ».
L’alimentation parentérale (NPT) est à l’origine d’une choles-
tase : 20 % à 100 % des malades qui reçoivent une NPT présen-
tent des perturbations des enzymes hépatiques. Ces écarts
reflètent probablement la présence variable d’autres facteurs de
risque d’atteinte hépatique, tels que la maladie sous-jacente à
l’origine de l’indication d’une NPT (maladie inflammatoire
chronique idiopathique de l’intestin [MICI], néoplasie ou
sepsis).
D’autres circonstances peuvent être retrouvées : la découverte
d’une cholestase chez une femme ayant un CREST syndrome
oriente d’emblée vers une cirrhose biliaire primitive. S’il existe
une MICI connue, une cholangite sclérosante est envisagée.
Chez un malade ayant une sarcoïdose ou une collagénose, une
granulomatose est envisagée.
Contexte clinique sans orientation
Anomalies hépatiques focalisées à l’échographie. Il peut
s’agir d’un cancer primitif ou secondaire du foie. L’échographie
et le scanner mettent en évidence un syndrome tumoral. Les
marqueurs tumoraux orientent le diagnostic. La biopsie du foie
échoguidée permet d’obtenir une preuve histologique. Dans un
contexte d’hépatopathie chronique, on évoque un carcinome
hépatocellulaire. Dans le cas contraire, on pense à une métas-
tase d’un cancer digestif, pulmonaire ou génital.
Cholestase
Interrogatoire
Anamnèse
Examen clinique
Présence d'un contexte clinique
Éliminer les urgences
Anomalies hépatiques
diffuses
Anomalies hépatiques
focalisées
Cholangiopathie
Granulomatose
Fibrose
Amylose
Anomalies
des voies biliaires
Échographie
Bili-IRM
Échoendoscopie
Biopsie du foie
Non
Oui
Anormale
Anormale
Normale
Normale
Figure 1. Conduite à tenir devant une cholestase.
7-007-B-15
¶
Conduite à tenir devant une cholestase
4Hépatologie

Il peut s’agir aussi d’abcès infectieux, bactériens, parasitaires
(kyste hydatique, échinococcose alvéolaire, amibiase hépatique).
La confirmation est obtenue par la mise en évidence directe du
germe ou du parasite, ou par sérologie.
Anomalies hépatiques diffuses à l’échographie. Il peut
s’agir d’une stéatose hépatique.
Les hémopathies ensuite peuvent s’accompagner d’anomalies
diffuses. Environ 10 % des malades avec une maladie de
Hodgkin développent un ictère. L’apparition d’une cholestase
est parfois un signe clinique précoce.
[22]
Les malades avec un
lymphome non hodgkinien peuvent aussi présenter un ictère dû
à une infiltration hépatique, une cholestase hépatique non
obstructive, une compression tumorale des voies biliaires.
Échographie normale. Il est important d’éliminer une
anomalie biliaire non détectée par l’échographie par la réalisa-
tion d’une bili-IRM et/ou d’une échoendoscopie au niveau de la
région ampullaire.
Lithiase de la voie biliaire principale. Dans sa forme asymp-
tomatique, l’existence d’une cholestase peut être le seul signe
révélateur. L’échographie est peu performante pour ce diagnos-
tic. L’échoendoscopie est l’examen le plus performant pour ce
diagnostic.
L’ampullome vatérien réalise une cholestase fluctuante. Le
diagnostic repose sur l’échoendoscopie et la CPRE avec biopsies.
La cholangite sclérosante primitive atteint l’homme jeune avec
un début insidieux associant des douleurs de l’hypocondre
droit, un prurit. L’échographie retrouve un aspect épaissi de la
paroi des voies biliaires. La bili-IRM tend à devenir l’examen de
première intention, le cathétérisme rétrograde n’étant pratiqué
qu’en cas de difficulté diagnostique ou à visée thérapeutique.
Les anomalies observées sont des sténoses souvent longues,
parfois multiples, typiquement sans dilatation d’amont nette,
un aspect en « chapelet » est très évocateur. Les lésions histolo-
giques élémentaires sont au nombre de quatre : la fibrose
péricanalaire avec cholangite ou atrophie des cellules biliaires,
la prolifération néoductulaire, la diminution du nombre de
canaux biliaires et la nécrose hépatocytaire parcellaire en
bordure de l’espace porte. L’atteinte est le plus souvent intra- et
extrahépatique, rarement uniquement intrahépatique (< 20 %)
ou uniquement extrahépatique (< 7 %).
[12]
Parmi les autres causes on peut citer la compression d’origine
extrinsèque, complications de la chirurgie biliaire.
Finalement, l’absence d’anomalie incite à rechercher une
cause intrahépatique : en l’absence d’éléments d’orientation, il
paraît logique de débuter l’enquête par la recherche d’anticorps
antitissus dont la présence serait en faveur d’une cirrhose
biliaire primitive ou d’une cholangite auto-immune. Ensuite,
l’examen qui permet le diagnostic des causes les moins rares est
la PBH. Les différentes causes sont résumées dans le Tableau 2.
■Traitement
En cas de cholestase extrahépatique
Le but est la levée d’obstacle ; le choix du traitement instru-
mental ou chirurgical dépend de l’âge, du terrain, de la nature
de l’obstacle.
En cas de cholestase intrahépatique
Il est avant tout étiologique.
Le traitement du prurit repose classiquement sur la colestyra-
mine (Questran
®
) administrée en dehors des autres prises
Tableau 2.
Causes des cholestases intrahépatiques.
Cirrhose biliaire primitive Atteint la femme aux alentours de la ménopause Anticorps antimitochondries supérieurs à
1/100
PBH : signes histologiques de cholangite non
suppurative avec destruction des canaux
biliaires de petite et moyenne taille.
Granulomatose : sarcoïdose, tuberculose Contexte clinique avec manifestations extrahépatiques de la
maladie générale
PBH : granulomes
Hyperplasie nodulaire régénérative (HNR) Révélée habituellement par les conséquences de
l’hypertension portale. Une cholestase peut être le seul signe.
PBH avec coloration de la trame réticulinique
Amylose hépatique Une cholestase anictérique est présente dans 60 à 80 % des
amyloses hépatiques AL et AA respectivement. L’atteinte
hépatique n’est révélatrice que dans moins de 20 % des cas.
L’hépatomégalie est habituelle.
Les dépôts amyloïdes sont recherchés dans un
autre tissu que le foie en raison du risque
hémorragique accru de la PBH.
Dilatation sinusoïdale ou péliose Contexte favorisant : prise d’estrogènes à forte dose ou
d’androgènes, ou prise d’azathioprine
PBH
Maladie de Rendu-Osler L’atteinte hépatique est retrouvée chez plus de 30 % des
malades. Les formes asymptomatiques sont fréquentes. Une
cholestase anictérique est présente dans 50% des cas
PBH : aspect histologique variable ; lésions
d’HNR, péliose ; foie cardiaque.
Ductopénie idiopathique Plusieurs formes anatomocliniques : formes sévères rentrant
ou non dans le cadre d’une maladie d’Alagille, ou formes
apparemment bénignes de découverte fortuite chez des
patients asymptomatiques
PBH
Cholestase paranéoplasique Cancer du rein
Sarcome rénal
Maladies génétiques rares Mucoviscidose : il est exceptionnel que la maladie
hépatobiliaire se manifeste avant les signes pulmonaires ou
pancréatiques.
Cholestases intrahépatiques familiales progressives :
Déficit en $1 antitrypsine
Porphyrie érythropoïétique
Cholestase récurrente bénigne Épisodes récidivant de cholestase clinique et biologique
débutant chez l’adulte jeune et entrecoupés de phases de
rémission. L’activité de la cGT reste souvent normale
PBH : cholestase centrolobulaire
pratiquement pure, sans fibrose et avec un
infiltrat inflammatoire minime.
La maladie a été rattachée à une mutation du
gène FIC1.
Conduite à tenir devant une cholestase
¶
7-007-B-15
5Hépatologie
 6
6
1
/
6
100%