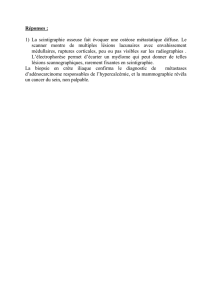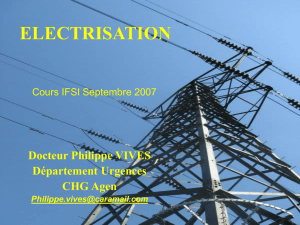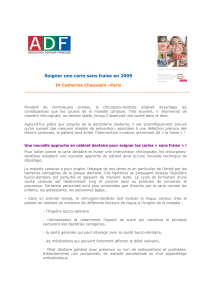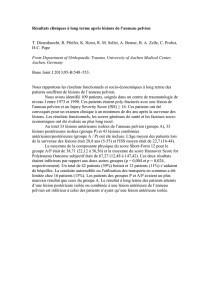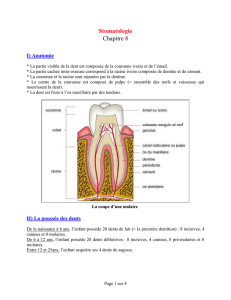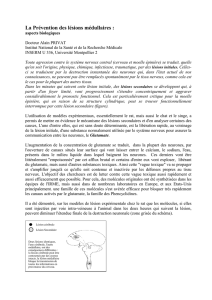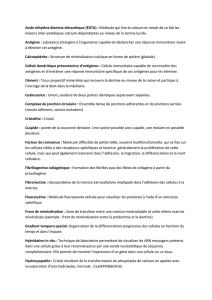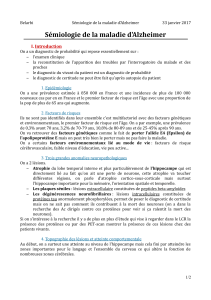Classification des lésions carieuses : De Black au concept SI/STA
Telechargé par
fadwa lachker

Classifications des lésions carieuses.
De Black au concept actuel par sites
et stades
J.-J. Lasfargues, J.-J. Louis, R. Kaleka
La connaissance et la gestion de la maladie carieuse ont considérablement évolué depuis l’ère de GV
Black. Il est aujourd’hui possible de guérir les lésions carieuses par des procédés non invasifs de
reminéralisation en évitant ainsi les restaurations et lorsque cela n’est plus possible de réaliser des
interventions opératoires minimales limitant la taille des restaurations. Plusieurs publications font état de
l’inadéquation de la classification de Black avec les concepts cariologiques actuels, et proposent de
nouveaux systèmes de classification. Les auteurs analysent ces différents systèmes en fonction de leur
intérêt clinique et proposent, après en avoir fait la synthèse, un nouveau système de classification des
lésions carieuses par site de cariosusceptibilité et stade de progression, le concept « SI/STA » (acronyme
pour sites et stades). Dans ce sytème, trois sites carieux occlusal, proximal, et cervical permettent de
classer topographiquement les lésions en fonction des zones d’accumulation préférentielle de la plaque
dentaire. Pour chacun de ces trois sites, cinq stades de progression des lésions sont définis, en fonction de
critères de diagnostic clinique, radiographique et histologique : le stade 0 est un stade réversible, la lésion
étant alors reminéralisable ; le stade 1 correspond à une lésion confinée dans le tiers dentinaire externe ;
le stade 2 à une lésion étendue au tiers dentinaire médian mais ne fragilisant pas la structure dentaire. Le
traitement restaurateur de ces lésions implique des interventions opératoires a minima. Les stades 3 et
4 correspondent à des lésions extensives ayant atteint le tiers dentinaire interne et nécessitant un
traitement restaurateur visant à protéger et renforcer les structures dentaires résiduelles, fragilisées ou
perdues. Plus qu’une simple classification, le concept SI/STA est un guide thérapeutique de dentisterie
préventive, adhésive et restauratrice pour le traitement des lésions carieuses quels que soient leur site et
leur stade d’évolution. La mise au point d’une classification internationale consensuelle validée par
l’ensemble de la communauté scientifique odontologique est fortement souhaitée.
© 2006 Elsevier SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Carie dentaire ; Lésions carieuses ; Classification ; Critères de diagnostic ; Sites carieux ;
Stade de progression carieuse ; Décision thérapeutique
Plan
¶Introduction 1
¶Différentes classifications des lésions carieuses 2
Classification de Black 2
Classification par degré de Lubetzki 2
Classification de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 2
Classifications à visée diagnostique 3
Classification spécifique aux lésions occlusales d’Axelsson (2000) 5
Classifications spécifiques aux lésions proximales 5
Classifications spécifiques aux caries radiculaires 6
Évolutions actuelles vers une classification générale à but
thérapeutique 6
¶Concept SI/STA 7
Classification SI/STA 7
Trois principes de base du concept Si/Sta 9
Applications cliniques du concept SI/STA 11
¶Conclusion 15
■Introduction
Il est clairement établi que les lésions carieuses sont les
conséquences d’un déséquilibre infectieux de l’écosystème
buccal, provoquant la déminéralisation des tissus durs dentai-
res.
[1, 2]
Les lésions carieuses sont en fait les signes physiques
d’un processus actif et évolutif, et doivent donc être différen-
ciées de la maladie carieuse proprement dite. Ainsi le traitement
de la carie ne peut se réduire au seul traitement de la lésion
carieuse ; il suppose également le contrôle des facteurs de risque
engagés dans la maladie. Cette prise de conscience majeure, qui
a été le fait marquant du développement de la cariologie lors de
ces vingt dernières années, a eu des conséquences notables dans
l’approche diagnostique et thérapeutique de la carie.
[3]
Une de
ces conséquences a été de reconsidérer la classification des caries
à la lumière des connaissances acquises sur la balance
déminéralisation/reminéralisation et des nouvelles possibilités
de traitement tant non chirurgical que chirurgical des lésions
carieuses.
¶23-069-A-10
1Odontologie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Classifier les lésions carieuses revient à répertorier les diffé-
rentes lésions présentes à un instant donné dans la bouche d’un
patient atteint par la carie selon un ensemble de critères
prédéfinis. Une classification pertinente devrait avoir deux
objectifs : celui d’identifier la lésion située au niveau des
couronnes cliniques dentaires par son site topographique, mais
aussi de la caractériser par ses attributs pathologiques, et ce dès
le stade le plus précoce de développement des lésions. Le
premier objectif a essentiellement un intérêt épidémiologique
ou de codification des actes ; toutefois, à lui seul, il est de peu
d’intérêt pour la pratique clinique, car il ne constitue pas une
aide à la prise de décision. La prise en considération des
caractéristiques pathologiques des lésions permet d’envisager les
différentes options de traitement requis de façon à aboutir à la
guérison des lésions ainsi répertoriées, soit par des procédures de
prévention, soit par des interventions chirurgicales d’intercep-
tion suivies d’une restauration. C’est la raison pour laquelle,
après avoir constaté l’inadéquation de la classification des caries
de Black avec les nouveaux concepts cariologiques en vigueur,
nous avions proposé, dès 1999, une nouvelle classification des
lésions carieuses à visée thérapeutique qui soit en quelque sorte
un guide clinique permettant d’assister le praticien dans sa prise
de décision.
[4, 5]
D’autres propositions de classifications des
caries ont également été formulées avant et pendant cette
période, en particulier le système de classification proposé par
Mount et Hume basé sur le site et la taille des lésions.
[6, 7]
La
révision de la classification de Black est un des éléments
constitutifs du concept actuel de dentisterie moins invasive ou
«minimally invasive dentistry », basé sur des soins préventifs non
invasifs et, lorsqu’une restauration est indiquée, des prépara-
tions cavitaires peu invasives dites a minima.
[8]
Malheureuse-
ment à ce jour, les efforts entrepris pour obtenir un consensus
sur une classification universelle n’ont toujours pas abouti, et de
ce fait la classification de Black,
[9]
bien que jugée de nos jours
obsolète, demeure encore la référence internationale à laquelle
les praticiens du monde entier se réfèrent dans leur pratique
quotidienne.
L’objectif de ce travail est de décrire et discuter les différentes
classifications des lésions carieuses actuellement disponibles,
dont le concept « SI/STA », qui associe une classification des
lésions carieuses par site de cariosusceptibilité et stade d’évolu-
tion aux principes modernes de traitement de la carie.
■Différentes classifications
des lésions carieuses
Classification de Black
Au tout début du XX
e
siècle, Black a publié une classification
des lésions carieuses en relation avec la situation de la carie sur
la dent :
• classe I : carie au niveau des défauts de structure dans les
puits et sillons ;
• classe II : carie proximale des prémolaires et des molaires ;
• classe III : carie proximale des incisives et canines sans
atteinte des bords incisifs ;
• classe IV : carie proximale des incisives et canines avec
atteinte des bords incisifs ;
• classe V : carie des collets dentaires ;
• classe VI : carie des bords incisifs et pointes cuspidiennes
(classe rajoutée ultérieurement).
Cette classification strictement topographique a été logique-
ment utilisée par extension pour désigner le lieu où la prépara-
tion cavitaire devait être débutée puis réalisée en fonction de la
classe de carie considérée. À tel point que dans l’esprit des
praticiens, cette classification initialement lésionnelle devint un
système codifiant les cavités d’obturation en relation avec les
matériaux disponibles à l’époque, l’or et l’amalgame. Dans la
classification de Black, le degré d’altération tissulaire, c’est-à-
dire la taille ou le stade atteint par la lésion, n’est pas pris en
compte car à l’époque on ignorait la relation étroite existant
entre les bactéries cariogènes et le processus de déminéralisation
ainsi que les possibilités de reminéralisation des structures
dentaires. L’élimination chirurgicale des tissus lésés était
considérée comme nécessaire et suffisante pour traiter la
maladie. Le système de Black, simple à mémoriser et extrême-
ment logique car fondé sur l’approche chirurgicale du traite-
ment, fut universellement adopté par les dentistes.
D’autre part, le système de Black suppose l’utilisation de
l’amalgame, un matériau d’obturation coronaire non adhésif,
régi par des principes de réalisation de cavités stéréotypées,
imposant une forme de contour préconçue, centrée sur la
résistance de l’obturation plutôt que sur celle de la dent et
conduisant de ce fait à des sacrifices tissulaires inutiles. Un de
ces principes en particulier, l’extension préventive postulait que
les limites extrêmes des cavités devaient être placées de telle
sorte que les bords de l’obturation soient soumis à l’autonet-
toyage lors de la mastication de façon à prévenir les lésions
récurrentes. On sait aujourd’hui que l’allongement excessif du
périmètre cavosuperficiel ne diminue pas la probabilité de carie
secondaire ; au contraire la longévité de la restauration aug-
mente lorsque les cavités sont de faible volume. Les principes
d’extension préventive et de préparation standardisée ne sont
plus que de vieux adages légués par les pionniers de la dentis-
terie. L’approche contemporaine plus conservatrice est basée sur
la préservation tissulaire : elle consiste à n’éliminer que la
quantité nécessaire et suffisante de tissus déminéralisés, et à
privilégier le recours aux matériaux de restauration adhésifs.
L’objectif de la restauration exclusivement mécanique se double
aujourd’hui d’un objectif biologique : un scellement étanche de
la cavité de façon à protéger le complexe dentinopulpaire.
Cependant si les principes de Black sont aujourd’hui abandon-
nés, sa classification semble devoir défier le temps et reste une
référence commode, alors qu’elle n’est plus conforme ni aux
données cariologiques scientifiquement établies ni aux concepts
d’intervention minimale et de restauration adhésive qui préva-
lent aujourd’hui.
[10]
Le besoin d’une nouvelle classification prenant en considéra-
tion les concepts modernes d’économie tissulaire est bien réel.
Classification par degré de Lubetzki
Cette classification
[11]
a été très longuement utilisée en
France, constituant le fondement des pratiques traditionnelles
de la dentisterie opératoire préconisé par Marmasse à partir de
1946. Elle comprend quatre degrés :
• premier degré : carie de l’émail ;
• second degré : carie de l’émail et de la dentine ;
• troisième degré : carie avec complications pulpaires (pulpites
irréversibles) ;
• quatrième degré : carie avec complications pulpaires et
parodontales (nécrose pulpaire et ses complications).
On notera que sur les quatre catégories mentionnées, les deux
premières concernent des lésions amélodentinaires pour les-
quelles le traitement est compatible avec le maintien de la
pulpe, les deux suivantes concernent les complications pulpaire
et parodontale des lésions carieuses impliquant des traitements
endodontiques. Cette approche relativement tranchée s’explique
par le contexte de forte prévalence carieuse de l’époque, les
lésions étant à évolution rapide et diagnostiquées tardivement
à un stade cavitaire.
Classification de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS)
[12]
La classification internationale des maladies différencie, au
chapitre des maladies de la cavité buccale, les caries dentaires
(chapitre XI, K02) en fonction du tissu atteint :
• carie limitée à l’émail (carie initiale, taches blanches) ;
• carie de la dentine ;
• carie du cément.
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
23-069-A-10
¶
Classifications des lésions carieuses. De Black au concept actuel par sites et stades
2Odontologie

S’y ajoutent d’autres libellés dont :
• carie dentaire stabilisée ;
• autres caries dentaires (sans précision).
À cette classification de nature histologique, le système de
l’OMS ajoute une notation par degré « D », codifiant la gravité
de la lésion, la série pouvant être utilisée à titre épidémiologi-
que :
• D1 : lésion de l’émail cliniquement détectable avec une
surface intacte non cavitaire ;
• D2 : lésion de l’émail cliniquement détectable avec une cavité
limitée à l’émail ;
• D3 : lésion de la dentine cliniquement détectable avec ou
sans cavitation dans la dentine ;
• D4 : lésion ayant atteint la pulpe.
On observe dans ce système deux degrés d’atteinte pour
l’émail, le critère de différenciation étant l’apparition d’une
cavité altérant la surface de l’émail, et deux degrés d’atteinte
pour la dentine, le critère de différenciation correspondant à
l’atteinte de la pulpe. La distinction concernant l’absence ou la
présence de cavité est importante, car il est désormais admis que
toutes les lésions non cavitaires doivent être détectées et arrêtées
par des moyens préventifs non invasifs.
[13]
Classifications à visée diagnostique
À partir des années 1990, il devient évident que les interven-
tions invasives (chirurgicale et restauratrice) doivent être évitées
aussi longtemps que possible. Une raison essentielle à cela est
que des traitements préventifs non opératoires peuvent arrêter
non seulement les lésions de l’émail mais aussi les lésions
dentinaires cavitaires ou non cavitaires.
[14-16]
Par ailleurs en
évitant les interventions opératoires, on diffère l’enclenchement
du cycle des restaurations tel qu’il a été décrit par Elderton en
1990,
[17]
et adapté par différents auteurs.
[10, 18]
Toute restaura-
tion nécessitant d’être remplacée après un certain temps du fait
du vieillissement des matériaux, des récidives carieuses liées à
l’absence de gestion préventive de la maladie, et de l’insuffi-
sance de la qualité des restaurations réalisées en pratique
généraliste,
[19]
ont abouti, par suite des mutilations successives
et cumulées de la dent, à son extraction.
[20]
Simultanément à
cette prise de conscience préventive, l’émergence de nouveaux
concepts de préparation orientés vers la préservation tissulaire
trouvait son application grâce au développement des outils de
microdentisterie (aides visuelles, instrumentation rotative
miniaturisée, air abrasion, sonoabrasion etc.) faisant évoluer la
dentisterie opératoire du modèle chirurgical invasif dans lequel
elle était emprisonnée vers un modèle médical préventif
[10]
(Fig. 1, 2).
C’est dans cette effervescence que de nombreux auteurs ont
tenté de reclassifier les lésions carieuses en fonction du degré
d’atteinte des tissus amélodentinaires, en tentant de distinguer
les stades de déminéralisation et de destruction de ces tissus,
avec l’objectif de favoriser les approches non invasives et
d’intervention opératoire a minima pour les stades réversibles
ou débutants, au détriment des approches plus conventionnelles
pour les stades cavitaires avancés.
Classification de Pitts (1997)
En 1997, Pitts, souhaitant attirer l’attention des praticiens sur
la nécessité de détecter précocement les lésions initiales,
proposa la métaphore de l’iceberg (Fig. 3) avec sa partie visible
concernant les lésions évoluées aisément diagnostiquables et
relevant des soins restaurateurs, et sa partie immergée, la plus
grande, concernant toutes les lésions initiales malheureusement
le plus souvent ignorées et donc non traitées mais pouvant
pourtant être guéries par des mesures prophylactiques
spécifiques.
[22]
L’auteur distingue du plus sain vers le plus malade, les seuils
de diagnostic suivants :
• lésions initiales subcliniques en état dynamique de
progression/régression détectables par les moyens de diagnos-
tic modernes ou du futur ;
Éruption Enfance
Adolescence
Âge adulte
Vieillesse
Absence
de
prévention
Le modèle
chirurgical
invasif
J.J.L.
Figure 1. Cycle des restaurations dans le cadre du modèle chirurgical
invasif : une pratique axée sur les traitements chirurgicaux conduit à la
perte prématurée des dents.
Éruption Enfance
Adolescence
Âge adulte
Vieillesse
Hygiène,
fluor,
sealant
Le modèle
médical préventif
non/peu invasif
J.J.L.
Figure 2. Cycle des restaurations dans le cadre du modèle mé-
dical préventif : une pratique basée sur la prévention et les soins
précoces moins invasifs conduit à la conservation des dents pour toute
la vie.
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Classifications des lésions carieuses. De Black au concept actuel par sites et stades
¶
23-069-A-10
3Odontologie

• lésions détectables uniquement avec les outils conventionnels
de diagnostic ;
• D1 : lésions de l’émail cliniquement détectables mais avec
une surface « intacte » ;
• D2 : lésions cliniquement détectables mais avec une cavité
limitée à l’émail ;
• D3 : lésions dentinaires (ouvertes et fermées) détectables
cliniquement : stable et non cavitaire ou en progression et
cavitaire (D3+ ) ;
• D4 : lésions ayant atteint la pulpe.
Cette classification reflète la volonté de l’auteur de réorienter
les pratiques vers des interventions préventives qui sont
indiquées jusqu’au stade D3. Ce n’est qu’à partir du stade
D3+ que les soins préventifs doivent être associés à des soins
opératoires. La plus grande part d’activité du dentiste en
cariologie devrait donc concerner l’approche préventive non
invasive, seules les lésions dentinaires cavitaires en progression
et profondes relevant d’une approche chirurgicale complémen-
taire de l’approche préventive.
[21]
Autres classifications par scores visuels
de diagnostic
Plusieurs auteurs ont tenté d’établir une échelle quantitative
par score sous forme de continuum depuis la dent saine jusqu’à
la destruction totale de la dent, en utilisant comme gold
standard l’apparence visuelle de la lésion, seule ou corrélée aux
données radiographiques et histologiques. Ces systèmes de
scores peuvent être en particulier utilisés pour les essais
cliniques.
Critères de diagnostic clinique et radiographique selon
Machiulskiene et al. (1998)
En 1998, Machiulskiene et al., cités dans l’ouvrage de Fejers-
kov et Kidd,
[23]
proposent une échelle de 0 (dent saine) à 10
(dent extraite suite à la carie) fondée sur l’apparence clinique et
l’examen radiographique de façon à identifier les lésions actives
et inactives, tant primaires que secondaires (dents obturées).
0 : sain ;
1 : active, surface intacte ;
2 : active, surface discontinue ;
3 : active, avec cavité ;
4 : inactive, surface intacte ;
5 : inactive, surface discontinue ;
6 : inactive, avec cavité ;
7 : obturée ;
8 : obturée, avec lésion active ;
9 : obturée, avec lésion inactive ;
10 : extraction due à la carie.
Critères de diagnostic visuel selon Ekstrand et al. (1998)
À partir de 1998, Ekstrand et al.
[24, 25]
proposent un système
de scores cliniques basé sur l’apparence visuelle des lésions en
relation avec la profondeur de pénétration histologique.
Bien que conçus pour la recherche clinique, ces critères
visuels sont relativement simples à utiliser et nous semblent de
nature à permettre une prise de décision thérapeutique perti-
nente par le praticien. Cependant, pour Ekstrand, la détection
et le diagnostic des lésions sont une chose, l’activité et la
sévérité des lésions en sont une autre. Ce n’est qu’en mettant
en relation ces différents paramètres que l’on peut envisager les
options de monitorage et de traitement logiques de ces lésions.
Ekstrand et al.
[26, 27]
proposent d’évaluer l’activité de la lésion
par les quatre paramètres cliniques suivants :
• l’aspect visuel de la lésion, qui indique sa sévérité (ou stade
d’évolution) allant d’une atteinte superficielle et réversible
vers une atteinte cavitaire profonde et non réversible ;
• la localisation de la lésion, selon qu’elle se situe dans une
zone favorisant une accumulation préférentielle de plaque
(aire de contact interdentaire, sillons et défauts de surface,
proximité gingivale, défauts cavitaires, ou encore le pourtour
des verrous orthodontiques) ou en dehors ;
• la perception tactile, c’est-à-dire la sensation au sondage qui
permet d’apprécier la présence de dépôts de surface, la
rugosité de l’émail et la consistance (dure ou molle) des
cavités dentinaires ;
• le statut de la gencive marginale en regard des surfaces
concernées (tiers gingival) évalué par l’absence ou la présence
de saignement provoqué par un sondage prudent.
Ces différents critères de diagnostic ont été combinés permet-
tant de relier la sévérité et l’activité des lésions prises indivi-
duellement et de quantifier par des scores allant de l’état sain à
l’état le plus avancé (Tableau 1).
D1
D2
D3
D4
cavitation/progression
Considéré avant D3,
comme «sans carie»
stable/sans cavitation
Seuil entre
«maladie et santé»
Traitements recommandés
J.J.L.
Lésions atteignant la pulpe
Lésions dentinaires cliniquement
détectables (ouvertes ou fermées)
Lésions cliniquement détectables
avec cavités limitées à l'émail
Lésions cliniquement détectables
avec surface d'émail «intacte»
Lésions uniquement décelables avec des
aides au diagnostic (bitewing, FOTI)
Lésions initiales subcliniques en état dynamique
de progression/régression, décelables par les
outils diagnostiques modernes (Diagnodent) ou du futur
TO + TP
TP
Pas de
traitement
opératoire
PTA
Figure 3. L’iceberg de la carie dentaire selon
Pitts.
[21]
D : seuil de diagnostic ; TO : traite-
ments avec interventions de dentisterie opéra-
toire ; TP : traitements prophylactiques actifs ;
PTA : pas de traitement actif autre que les
mesures habituelles de contrôle de la carie.
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
23-069-A-10
¶
Classifications des lésions carieuses. De Black au concept actuel par sites et stades
4Odontologie

Classification spécifique aux lésions
occlusales d’Axelsson (2000)
Axelsson, s’appuyant sur plus de vingt années de pratique de
la prévention, publie en 2000 une synthèse remarquée sur le
diagnostic et le risque carieux.
[28]
Dans cet ouvrage, il propose
une classification des lésions carieuses occlusales avec une
échelle gradée en cinq points.
• Grade 1 : tache blanche ou lésion colorée atteignant seule-
ment l’émail, sans image radiographique ;
• Grade 2 : cavité superficielle dans l’émail à l’entrée des sillons
avec perte minérale dans l’émail adjacent détectable par la
radiographie ;
• Grade 3 : perte minérale amélaire avec lésion du tiers externe
de la dentine détectable par la radiographie ;
• Grade 4 : perte minérale conséquente avec cavitation étendue
de l’émail au tiers médian de la dentine ;
• Grade 5 : cavitation avancée impliquant le dernier tiers de la
dentine.
Dans cette classification, on voit apparaître l’utilisation du
cliché rétrocoronaire comme aide au diagnostic ; cependant,
les clichés rétrocoronaires (bitewing
) ont une moindre validité
pour la détection précoce des caries occlusales par rapport aux
caries proximales.
[23]
Cette classification propose également la
délimitation de la dentine en tiers pour caractériser le degré de
pénétration carieuse en direction pulpaire. Axelsson considère
qu’aussi longtemps qu’une cavité demeure confinée dans
l’émail, il n’y a pas d’invasion bactérienne de la dentine et que
donc la lésion peut être arrêtée. Tant qu’il n’y a pas d’effrac-
tion dentinaire, il n’est pas nécessaire de recourir à un
traitement invasif. La pénétration bactérienne intervient
secondairement à la déminéralisation de la dentine, des
réactions adverses de la pulpe n’étant observées que lorsque la
déminéralisation atteint le dernier millimètre protégeant la
pulpe. Axelsson suggère de n’éliminer alors que la dentine
ramollie infectée et d’isoler et sceller les bactéries résiduelles
par une restauration étanche. Cette proposition se fonde à
juste titre sur les travaux de Mertz-Fairhurst et al. qui ont
montré qu’il était possible d’arrêter une lésion carieuse
dentinaire et de maintenir l’état de santé pulpaire à long
terme en scellant la dentine cariée, à condition de réaliser des
préparations ultraconservatrices avec étanchéification du
périmètre cavitaire par une obturation adhésive.
[29]
Classifications spécifiques aux lésions
proximales
Les caries proximales des dents postérieures correspondent à
la classe II de Black. L’identification des lésions proximales est
classiquement effectuée à l’aide de clichés rétrocoronaires
corrélés à l’examen clinique des embrasures éventuellement
après séparation temporaire et empreinte pour détecter la
présence ou l’absence de cavité.
[30]
Les clichés bitewing ont une
valeur indiscutable pour détecter et évaluer la profondeur d’une
lésion proximale et ses rapports avec la pulpe (Fig. 4). Cepen-
dant, ils présentent le désavantage de sous-estimer la profon-
deur des lésions et nécessitent, pour une bonne interprétation
des lésions et de leur progression, d’être renouvelés à différentes
dates et dans les mêmes conditions de prise des clichés.
Plusieurs systèmes (anglais, suédois ou norvégien) utilisent les
Tableau 1.
Quantification du degré d’activité et de sévérité des lésions carieuses.
[27]
Paramètres de l’activité Degré de sévérité Score
Aspect visuel État sain 0
Opacité (après séchage) 1A
Tache brune (après séchage) 1B
Opacité (sans séchage) 2A
Tache brune (sans séchage) 2B
Ombre grise soulignée 3
Perte de l’intégrité de surface 4
Cavité punctiforme 5
Cavité extensive 6
Accumulation de plaque Zones non favorables 0
Zones favorables 6
Sensation au sondage Émail lisse, dentine dure 0
Émail rugueux, dentine molle 5
Saignement gingival au
sondage
Pas de saignement 0
Saignement 3
“Point important
Critères de diagnostic visuel selon Ekstrand et al.
(1998)
0 : absence ou début de déminéralisation de l’émail : pas
ou peu de changement de translucidité de l’émail après
séchage prolongé à l’air (> 5 s) ;
1 : émail déminéralisé jusqu’à mi-hauteur sans réaction
dentinaire : opacité ou coloration difficilement visible sur
surface humide mais très distinctement visible après
séchage à l’air ;
2 : atteinte de toute l’épaisseur de l’émail (stade 2a : stade
2 + début d’atteinte dentinaire avec formation de dentine
réactionnelle sclérotique) : opacité ou coloration
distinctement visible sans séchage à l’air ;
3 : cavitation débutante associée à de la dentine
déminéralisée, avec atteinte du tiers médian dentinaire,
réaction de sclérose canaliculaire et apposition de dentine
réactionnelle péripulpaire (stade 3a : stade 3 + dentine
ramollie en cas de contact avec la plaque dentaire) :
rupture localisée de l’émail dans une zone opaque ou
dyschromique et/ou coloration grise provenant de la
dentine sous-jacente ;
4 : cavitation franche avec présence de dentine ramollie,
atteinte du tiers profond dentinaire et extension latérale
de la carie. Synthèse de dentine réactionnelle sclérotique,
dentine réactionnelle péripulpaire et de dentine
réparatrice : cavitation au sein d’un émail opaque ou
dyschromique exposant la dentine.
Figure 4. Cliché rétrocoronaire sur son support de film : détection des
lésions proximales (site 2). Face distale de 34 (stade 0), face distale de 36
(stade 1), face distale de 24 (stade 2) et face distale de 26 (stade 3).
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
Classifications des lésions carieuses. De Black au concept actuel par sites et stades
¶
23-069-A-10
5Odontologie
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%