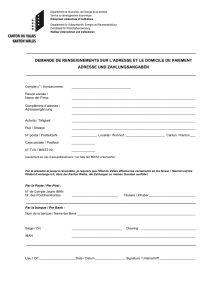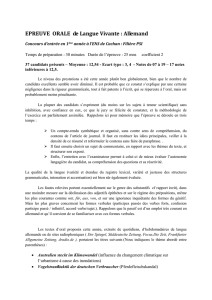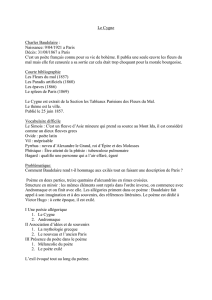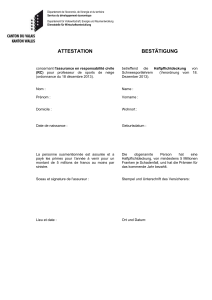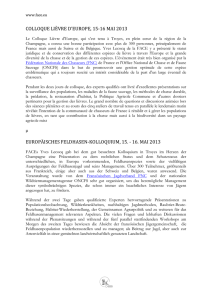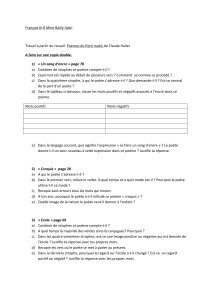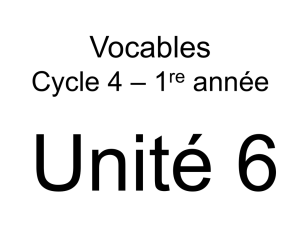L'Herne
Les Cahiers de l'Herne
paraissent sous la direction de
CONSTANTIN TACOU
L’Édition de tête de ce Cahier tirée à cent vingt exemplaires
est accompagnée d’une lithographie originale de Zoran Music
dont : cent exemplaires numérotés de 1 à 100, dix Hors Commerce
numérotés de 1 à X et 10 Épreuves d’Artiste numérotées de
A à J . Toutes ces lithographies ont été numérotées e t signées
par l’Artiste.
Édité avec le concours du Centre National des Lettres
Tous droits de traduction, de reproduction
et d’adaptation réservés pour tous pays.
O Éditions de l’Herne, 1989
41, rue de Verneuil, 75007 Paris
Holderlin
Ce cahier a été dirigé par
Jean-François Courtine
Sommaire
11 Jean-François Courtine, avant-propos
Traductions
15
18
22
26
27
27
29
31
33
38
41
43
47
51
58
63
79
81
83
86
98
108
121
Offrande matinale au rédempteur, traduction J .-L. Vieillard-Baron
Pain e t vin, traduction Fr. Fédier
Pain e t vin, traduction J.-P. Faye
En souvenir de, traduction J.-P. Lefebvre
La moitié de la vie, traduction J.-P, Lefebvre
Si de là-bas, si loin..., traduction J.-P. Lefebvre
A la source du Danube, traduction Fr. Fédier
L’lster, traduction Fr. Fédier
Le Rhin, traduction Fr. Fédier
Germanie, traduction J . Hervier
Tout comme au jour de fête, traduction Fr. Fédier
Fête de la paix, traduction J. Bollack
Fête de la paix, traduction J.-P. Lefebvre
L’Unique (première, deuxième et troisième version), traduction A. du Bouchet
Patmos, traduction J.-E. Jackson
Colomb, traduction B. Badiou et J.-C. Rambach
Grèce (troisième version), traduction Fr. Fédier
En bleu adorable, traduction A. du Bouchet
En bleu adorable, traduction J. Hervier
Mnémosyne, traduction B. Badiou et J .-C. Rambach
Le plus proche, le meilleur, traduction B. Badiou et J.-C. Rambach
Apriorité de l’individuel, traduction B. Badiou et J .-C. Rambach
L’Archipel, traduction J. Tardieu
7
Témoignages
131
143
Témoignage
Car, pour peu de choses désaccordée
Michel Deguy
André du Bouchet
Holderlin et la philosophie
167
Les débuts philosophiques de Schelling et
de Holderli n
Image vivante du néant
Y a-t-il une beauté pour la philosophie?
La joie d’Hypérion
Xavier Tilliette
177 Marc Kauffmann
184 Marc Crépon
200 Jean-Luc Nancy
Les Lumières, la France
Le meurtre de l’histoire
2 19 Jacques D’Hondt
239 Le communisme des esprits, traduction Jacques D’Hondt
Holderlin en France
242 Andrejz Warminski
La Grèce, la tragédie
263
277
Wolfgang Binder
Arnaud Villani
297
Beda Allemann
322
328
Bernard Boschenstein
Renate Boschenstein
Holderlin e t Sophocle
Figures de la dualité: Holderlin e t la
tragédie grecque
Holderlin entre les Anciens e t les
Modernes
Holderlin, disciple de Dionysos
Souvenir d’edipe
Le Divin, les dieux
345
Jean-Louis Vieillard-Baron
352
370
Jean-François Marquet
Jean-Miguel Garrigues
399
Jacques Colette
L’image de la Gèce chez Holderlin e t
chez Heinse
Structure de la mythologie holderlinienne
Du U Dieu présent .v au U Dieu plus
médiat &un Apôtre Y.
L’Église esthétique
Poétique holderlinienne
416
444
457
473
489
8
Jean-Pierre Lefebvre
Christopher Fynsk
François Fédier
Rainer Nagele
Eliane Escoubas
Les yeux de Holderlin
Finitude de la Dichtung
N.d.T.
De l’abîme, en effet ...
Holderlin e t Walter Benjamin : L’Abstraction lyrique
Holderlin et Heidegger
503
5 12
528
535
Michel Haar
Marc Froment-Meurice
Pascal David
J.-Fr. Courtine
Heidegger e t le Dieu de Holderlin
Le doable état de la parole
Un chant nouveau
Bibliographie succincte
Avant-propos
HoZderZzn et la Frdnce
Holderlin et la France : il s’agit là certainement d’une conjonction singulière et
privilégiée. Non pas seulement en raison du bref séjour à Bordeaux, d’un premier
voyage assez énigmatique à travers la France et du dramatique retour, marqué par
les signes de l’égarement. Sans doute la France représente-t-elle, dans la constellation
holderlinienne, réelle et imaginaire, historique et géographique, une instance décisive,
puisqu’elle constitue comme la lointaine possibilité d’une expérience de la Grèce.
A l’automne 1802, Holderlin confie à Bohlendorff le choc de cette rencontre :
(( L’élément violent, le feu du Ciel et l’apaisement des gens dans la nature [...I, cela
m’a constamment saisi [,..] et je peux bien dire qu’Apollon m’a frappé [...] L’athlétique
des gens du Sud, dans les ruines de l’esprit antique, me rendit plus familière la
manière d’être propre des Grecs )) (Lettre no 240).
Mais c’est aussi en France, après les premières traductions des années trente (au
premier rang desquelles celle des Poèmes de la folie, due à Pierre Jean-Jouve), et les
études de la germanistique universitaire (Claverie, Tonnelat, Bertaux), que la réception
du poète prend dans l’après-guerre une tournure remarquable. Les commentaires de
Heidegger et l’horizon générale de sa (( lecture )) ont certainement joué un rôle tout
à fait décisif. Henri Corbin a traduit, dès 1937, dans la belle revue Mesures, l’essai
sur Holderiin e t l’essence de la poésie, qui sera repris l’année suivante chez Gallimard,
dans le recueil Qu’est-ce que la métaphysique ? Les déterminations heideggériennes de
Holderlin comme (( poète du poète », poète de 1’« essence de la poésie », annonciateur
du sacré en un temps de détresse - mais aussi poète des Allemands, ou mieux de
l’Allemagne devant laquelle son œuvre se tient comme un destin possible -, si elles
rencontrèrent assez tôt ici même de vigilantes critiques (Paul de Man, Blanchot),
marqueront incontestablement des décennies d’interprétations et de traductions.
On ne saurait naturellement réduire à ce commun dénominateur les tentatives
de plusieurs générations de traducteurs, de Gustave Roud à André du Bouchet, en
11
passant par Tardieu, Ph. Jaccottet, Jean-Pierre Faye ou Jean Bollack. Mais le volume
de la Pléiade, publié sous la direction de Jaccottet, et qui constitue par lui-même
un signe patent de la situation éminente du poète en ce pays, porte clairement
l’empreinte des travaux de la Revue de Poésie (Michel Deguy, Fr. Fédier). Ainsi la
traduction et surtout le travail poétique sur la traduction d’un poète étranger ont
contribué de manière très remarquable, comme l’a étudié notamment Bernhard
Boschenstein I , à façonner la diction même de quelques-uns de nos grands poètes.
Qu’on songe par exemple à René Char!
Les textes ici rassemblés entendent bien prendre acte de cette situation nationale,
sans nullement prétendre faire le bilan d’un demi-siècle d’études ou plus généralement
de réception holderliniennes. Si nous avons voulu présenter un large éventail de
traductions différentes, certaines anciennes et d’autres toutes récentes, c’est naturellement pour souligner la diversité - légitime et nécessaire - des lectures et des approches.
Mais sans viser à égaler l’érudition de la Forschzlng allemande, s’agissant d’un
auteur qui demeure un de ses objets de prédilection, nous avons tenu à ouvrir
largement ce Cahier à des contributions internationales, pour marquer à la fois la
multiplicité des approches et leur convergence relative, quand elles veulent bien
s’armer des méthodes historiques et philologiques.
Si de telles contributions risquent de mettre à mal le (( mythe )) du poète fou,
médiateur inspiré entre les dieux et les hommes, nous pensons qu’elles peuvent aussi
contribuer à renouveler l’écoute de la parole holderlinienne, en soulignant en elle la
FqXavq à laquelle la poésie des modernes doit aussi pouvoir accéder, sans pour autant
porter atteinte à sa dimension (( prophétique ».
Nombreux sont ceux dont le secours amical m’a été précieux dans la préparation
de ce Cahier. Faute de pouvoir les mentionner tous, je tiens à remercier tout
spécialement le Professeur O. Poggeler, le Dr. Ch. Jamme du Hegel-Archiv de Bochum
pour leurs suggestions et leurs encouragements. M. Alain Pernet, ingénieur au CNRS,
m’a aidé dans la correction des épreuves. Qu’il trouve ici l’expression de ma reconnaissance.
Jean-François Courtine
NOTE
1 . (( Holderlin en France. Sa présence dans les traductions et dans la poésie », in Hoideriin uu de
France, études réunies par B. Boschenstein et J . Le Rider, Tübingen, 1987, p. 8-23.
Traductions
OFFRANDE MATINALE AU RÉDEMPTEUR
Plus glorieux encore que ce soleil matinal
Qui fit sauter le roc fermant ta tombe,
Tu perças, Ô Divin, en une neuve extase,
A toi et aux tiens donnant en ce jour la victoire.
Ils se délièrent de la chair sacrée, les bandeaux;
Les gardiens sont figés par ta marche victorieuse :
Mais, pour fonder divinement ton triomphe,
L’amour te précède, fortifié dans le tombeau tranquille.
Ainsi les doux liens d u sommeil sont effacés
De mes yeux par la fraîche main du matin,
En direction du ciel, vers ma patrie lointaine,
Et vers qui, ravi, trouva avant moi le SauveurVers tous, élève mes yeux enivrés de joie
Par ce cristal rayonnant.
Devant toi, ô soleil, je plie le genou, prosterné,
A toi, soleil suprême, j’adresse avec joie ma prière.
Donne la foi, l’amour qui sourd de ton cœur,
Donne suavité, douceur, dévouement pour toi.
Et comme le soleil renouvelle sans cesse sa flamme,
Ravive en moi la flamme de ton amour.
Vois comme il transfigure les monts, les vals et les champs
De son rayonnement auroral et doré.
Qu’ainsi la pieuse image de ton amour fasse se répandre
Ce que cette terre nourrit de plus noble.
L’amour qui a pour moi souffert sur la croix,
Et étendu ses bras vers moi,
L’amour sacré qui a obtenu grâce pour moi,
L’amour sage qui m’a découvert le conseil de Dieu,
L’amour puissant dans l’action, la patience, l’effort,
L’amour qui purifie dans le combat, qui sans relâche
S’occupe à diriger vers le ciel mon cœur qui le désire,
Ah! cet amour, allume-le en moi! Merci à toi pour la foi qui enlace à moi
Maint cœur fidèle et pieux, proche ou lointain!
Merci à toi pour la bonne étoile qui par les crépuscules de la vie
Me console et me guide vers le haut.
C’est, toi que nous cherchons là où les soleils resplendissent,
Les Eternels, frange de ton vêtement de lumière,
Pour t’étreindre éternellement là dans la plénitude,
Pour la dernière fois éveillés après notre court songe.
Pour la dernière fois : - dans le nouveau matin céleste,
Que se dévoile - ô mes amis, ne vous affligez pas! Ce qui, maintenant, lutte pour la liberté, profondément caché,
15
Et qui pousse vers la lumière les floraisons secrètes.
Vous, nuages, fuyez! le soleil surgit des monts,
Fuyez pour toujours là-bas vers votre pays ténébreux!
Déjà retentit un fort bruit des cercueils éclatés,
A vous, amis, ma main fraternelle! Poème uttribué à Holderlin
Traduit pur J.-L. Vieillard-Buron
MORGENOPFER AN DEN ERLOSER
Noch herrlicher uls jene Morgensonne,
Die sprengte deines Grubes Felsenthor,
Drangst du, o Gottlicher, zu neuer Wonne
Dir und den Deinen siegend einst hervor.
Es losten sich vom heil’gen Leib die Binden,
Die Hüter jësselt deine Siegesbahn :
Dir aber, gottlich den Triumph zu gründen,
Geht Lieb’ in stiller Grub gestürkt uoran.
So streift uuch mir des Schlummers sunfte Bande
Vom Auge ab des Morgens kühle Hand,
Und himmelun zum fernen Heimutlande,
Und wer entzückt uor mir den Heiland fund, Zu ullen dringt mein Auge, wonnetrunken
Von jenem struhlenden Chrystall, hinan.
Vor dir, O Sonne, knie’ ich hingesunken,
Dich hoh’re Sonne bet’ ich freudig an. [ S . 4261
Gib Glauben, Lieb’ uus deinem Herzen stammend,
Gib Sanftmuth, Mildigkeit, Ergebung dir.
Und wie die Sonne immer neu entflammend,
So flamme deine Liebe frisch in mir.
Sieh, wie sie Berge, Thaler und Gefilde
Mit ihrem Gold’nen Morgenglanz uerklürt;
So strom’ uus deiner Liebe frommem Bilde
Dus Edelste, was diese Erde nührt.
Die Liebe, die f u r mich um Kreuz gelitten,
Und ibre Arme nach mir ausgestreckt,
Die Heilige, die Gnade mir erstritten,
Die Weise, die mir Gottes Ruth entdeckt,
Die Lieb’ im Wirken, Dulden, Streben krüfiig,
Im Kampfi lüuternd, himmelwartz nuch ihr
Mein sehnend Herz zu richten stets gescbüfiig, Arb diese Lieb’ entzünde du in mir!Dank dir, daJ glaubig sich urn micb geschlungen
Munch treues frommes Hem, JO nab’ als fern!
Dunk dir, duJ durch des Lebens Dümmerungen
Micb trostend uufwürts führt der bolde Stern.
16
Dich suchen wir, dort, W O die Sonnen prangen,
Die ew’ gen, deines Lichtgewandes Saum,
Vollendet dort dich ewig zu umfangen,
Zum letztenmal erwekt nach kurzem Traum.
Zum letztenmal : - am neuen Himmelsmorgen
Enthülie sich - O Freunde trauert nicht! - [S. 4271
Was izt nach Freiheit ringet tief uerborgen,
Und die geheime Blüthe dringt ans Licht.
Ihr Nebel flieh !die Sonn’ entsteigt den Bergen,
Flieht ewig bin zu eurem düstern Land!
Schon tont es laut aus den gesprengten Sürgen,
Euch, Freunde !meine brüderiiche Hand! -
NOTE
Ce poème a été retrouvé et attribué à Holderlin, après une minutieuse étude thématique par
~
M. Reinhard Breymayer, chercheur qui se consacre au piétisme en Württemberg aux X V I I I ~et X I Xsiècles.
II a consacré à ce poème une importante publication, intitulée (( ... Und die geheime Blüthe dringt ans
Licht », parue dans Bldtter für württembergische Kirchengeschichte, 82, 1982, p. 254-328.
On pourra se reporter également au recueil collectif intitulé In Wahrheit und Freiheit. 4SOIahre
EuangelischesS t i j in Tübingen, publié par Friedrich Hertel, Stuttgart, Calwer Verlag, 1986. En particulier,
p. 128 à 204, les articles de Volker Schafer sur les relations de Holderlin et de Hegel, avec des inédits,
et de Reinhard Breymayer sur la famille de Holderlin, avec inédits également.
Le poème (( Morgenopfer an den Erloser est paru anonymement dans Cdcilia ein wochentfiches
Fatniiienbfatr für Christensinn und Christenfreuden, publié par Jonathan Friedrich Bahnmaier, professeur
ordinaire de théologie et de pédagogie à Tübingen; le poème fait partie du volume annuel de 1818.
Reihnard Breymayer pense que ce poème a pu être écrit par le jeune Holderlin comme Epicedium, en
guise de déploration et de consolation, à l’occasion de la mort d’un camarade du Stvt de Tübingen,
Johann Ludwig Friedrich Spittler, qui mourut du typhus le 2 1 mars 1793 à l’âge de dix-huit ans. Quoi
qu’il en soit, ce poème témoigne d’une qualité exceptionnelle qui tranche sur la médiocrité littéraire de
la pieuse revue où il parut. Par ailleurs, le très fort sentiment religieux dont il fait preuve est d’une
nature bien particulière, entre la renaissance naturelle et la résurrection, très conforme à ce que ;’ai moimême analysé dans Platon et l’Idéalisme allemand ( I 770-1830), Paris, Beauchesne, 1979, p. 95-128, à
propos de l’aurore d’Iéna.
))
Je remercie Gérard Maillat de son amicale collaboration à cette difficile traduction
PAIN ET VIN
1
Tout autour la ville est en repos; la ruelle éclairée devient calme,
Et ornés de torches les chars s’en vont avec le bruit.
Saouls rentrent des joies du jour se reposer les hommes,
Et gain et perte pèse une tête sensée
Bien contente chez soi; vide de raisins et de fleurs,
Et d’œuvres de la main, le marché affairé est en repos.
Mais la lyre résonne loin, de jardins; peut-être que
Là-bas, bien-aimés, s’en joue ou bien un homme solitaire
D’amis lointains garde souvenir et du temps de jeunesse; et les fontaines,
Toujours sources et fraîches font leur bruit au bord d’herbes odorantes.
Calme, dans l’air, à la brune, résonne le carillon des cloches,
Et gardant les heures, un veilleur appelle le nombre.
A présent aussi vient un souffle, il anime les sommets du bois,
Vois! et le double de notre Terre, l’astre d’argent
Vient en secret aussi. La fantasque, la nuit vient,
Pleine d’étoiles et bien peu soucieuse de nous,
Scintille l’étonnante là-bas, l’étrangère entre les hommes
Au-dessus de crêtes, tristement et splendidement elle monte.
2
Prodigieuse la faveur de la Très-Haute et personne
N e sait de quand et quoi lui advient d’elle.
Ainsi meut-elle le monde et l’âme espérante des hommes,
Même aucun sage ne comprend ce qu’elle prépare, car ainsi
Le veut le Dieu suprême, qui beaucoup t’aime, et pour cela
Est encore plus aimé qu’elle, de toi, le jour sensé.
Mais parfois un œil clair aime aussi l’ombre
Et tente pour le plaisir, avant que ce soit urgence, le sommeil,
O u bien il jette aussi volontiers, un homme fidèle, son regard dans la nuit,
Oui, il sied de lui consacrer couronnes et chant,
Parce que aux errants elle est sacro-sainte, et aux morts,
Mais demeure soi-même, éternellement, dans le plus libre des esprits.
Mais il lui faut aussi, à nous, afin que dans le temps qui hésite,
Que dans la ténèbre pour nous quelque chose soit tenable,
Nous accorder l’oubli et l’enivrement sacré,
Accorder la parole fleuve qui, comme les amants, soit
Sans assoupissement et plus pleine coupe et de vie plus audacieuse,
Sainte mémoire aussi. de rester éveillé la nuit.
3
Et aussi abritons en vain le cœur dans la poitrine, en vain seulement
Retenons-nous encore le courage, maîtres et apprentis, car qui
Serait capable de l’empêcher, et qui nous interdirait la joie?
Un splendide signe aussi chantent, de jour et de nuit,
18
Les tempêtes. Alors viens! que nous voyons l’ouvert,
Que nous cherchions quelque chose de vivant, si loin soit-il.
Ferme reste une seule chose : que ce soit vers midi, ou que ça aille
Jusqu’à la minuit, toujours demeure une mesure,
A tous commune; pourtant à chacun aussi est imparti son propre,
Jusque-là va et parvient chacun, là où il le peut.
Pour cela! et railler la raillerie aime une démence exultante
Quand dans la nuit sainte soudain elle saisit les poètes.
Pour cela viens à l’Isthme! là-bas où la mer ouverte bruit
Au Parnasse et la neige entoure d’éclat le roc delphique,
Là-bas au pays de l’Olympe, là-bas sur les hauteurs du Cithéron,
Sous les pins, là-bas, sous les grappes, d’où
Thèbes en bas et Isménos bruit, dans le pays de Cadmos,
De là vient et là il rit, transplanté, le Dieu.
4
Bienheureuse Grèce, toi, maison des célestes, tous,
Ainsi est vrai ce qu’un jour dans l’enfance nous avons entendu?
Salle fériale! Le sol est mer! et tables les montagnes
Vraiment pour unique usage avant le temps bâties!
Mais les trônes, où donc? Lois de la Terre, et les pas,
Où, emplis de nectar, allant en des recoins, plain-chant?
Où sont-elles poids, les sentences rustiques et pénétrantes?
Sec est Delphes, que le comprenne, mieux : s’accomplisse
Que cela devienne vrai, car où cela éclate-t-il, plein d’un bonheur tout présent,
En tonnerre depuis un air serein, sur les yeux, en entrant?
Le Père, 1’Ether consume et tend, comme des flammes, vers la Terre,
En mille façons vient le Dieu. En bas, comme des roses, le sol
A des célestes inadressé, périssable, mais comme des flammes
Opère d’en haut et met à l’épreuve la vie, consumant, nous aussi.
Mais ceux qui devinent, là et ici, et lèvent les têtes
Mais les hommes, assemblés, partagent le bien en fleur.
Le consumant. Ainsi arrive le céleste, profond ébranlement parvient ainsi
Depuis les ombres, en descendant, parmi les hommes, son jour.
5
Non ressenti cela vient d’abord, ils tendent à la rencontre
De lui les enfants. Presque atteint de dos le bonheur,
Car d’eux il a pudeur, l’homme. C’est pourquoi aussi voit de ses yeux
A peine, un demi-dieu; et il y a feu autour d’eux, et sommeil.
Mais à eux, grand est le courage, à plein ils lui emplissent le cœur
Ceux-là, mais il voit à peine, dans la fournaise, le bien;
Crée, prodigue et presque lui devenait frontière, la Terre,
Mais pour se reposer arrache en avant éternellement dans la nuit le Partage.
Eux-mêmes affermissent cela, les célestes, si par ailleurs
Rien ne les égare, et s’accoutument les hommes au bonheur
Et au jour, et à regarder ceux qui sont manifestes, la face
De ceux qui, depuis longtemps déjà Un et Tout nommés,
A fond ont empli la poitrine taciturne du libre contentement,
Et d’abord et seulement ont comblé tout désir;
Longue et lourde, la parole de cette arrivée, mais
Blanc est l’instant. Serviteurs des célestes sont
19
Pourtant, connaissant la Terre, leur pas est contre l’abîme
Jeune, plus humain, cependant cela dans les profondeurs est ancien.
6
A présent ils gardent les bienheureux et les esprits,
Tout véritablement doit faire connaître leur louange.
La lumière n’a rien droit de regarder qui ne plairait aux Suprêmes,
Devant 1’Ether ce qui tente oisivement ne sied pas du tout.
Pour cela, se tenir un temps en sa présence,
Les peuples s’érigent en ordonnances tusques
Les uns parmi les autres, et bâtissent les beaux temples et villes
Chacune selon les contrées montent au-dessus des côtes Mais où sont-elles? Où fleurissent les célèbres, les couronnes de la Fête?
Thèbes fane, et Athènes; ne bruissent-elles plus les armes
A Olympie, plus les chars en or des Jeux,
Et ne s’ornent-ils plus jamais de tresses, les navires de Corinthe?
Pourquoi font-ils silence aussi, les actes sacrés alors,
Pourquoi ne se réjouit-elle pas la danse sanctifiée?
Pourquoi ne signe-t-il pas, comme autrefois, le front de l’homme un Dieu,
N’imprime le sceau, comme autrefois, à celui qui est atteint?
Mais il vint alors lui-même et prit figure d’homme
scandale pourtant est temps et image,
7
A des balafres comparables, à Éphèse. Le spirituel aussi endure,
De la présence divine, illumine comme d u feu, pour finir.
Ivresse, oui, d’un genre à soi, quand des célestes sont là
Se creuse sa tombe, cependant sagace avec les esprits l’esprit.
Les esprits aussi, car toujours une prière arrête le Dieu,
qui aussi endurent, chaque fois que la Terre les touche.
Jamais plus d’eux n’est vert et les doux sentiers de la patrie,
Règles; pareils à des constructions les arbres et la broussaille,
Jamais plus, et les fruits d’or, et ordonnées les forêts,
Seulement quelquefois il supporte sa propre ombre, l’homme.
Mais en force les cœurs, comme sur une prairie blanche les fleurs,
Alors que c’est aride; le vert pourtant nourrit le cheval
Et le loup, dans la sauvagerie, mais à la mort pense chacun
A peine, et la maison de jeunesse, les voyants ne la saisissent plus.
Mais quelque chose pourtant est en vigueur, seul. La règle, la Terre.
Une clarté, la nuit. Cela, et le calme, connaît
Qui s’y entend sans doute, un plus princier, et il montre,
Du divin, qu’à elle aussi c’est long, comme le ciel, et profond.
8
Nommément : comme il y a quelque temps, à nous il semble long,
Vers le haut ils montèrent tous, eux qui ont fait le bonheur de la vie,
Comme le Père détourna sa face des hommes,
Et le deuil à juste titre débuta sur la Terre,
Et apparut en fin, un calme génie, célestement
Consolant, qui annonça la fin du jour et s’évanouit,
Laissa comme signe, qu’un jour il avait été là, et de nouveau
20
Reviendrait, le chœur céleste, quelques présents,
Dont humainement, comme alors, nous puissions nous réjouir,
Mais comme balances se brise presque avant d’arriver, le Partage
Se séparant quasi, en sorte que se tord l’entendement
De connaissance, et aussi vit, mais triomphe le remerciement.
Le pain est fruit de la Terre, pourtant il est béni par la lumière,
Et du Dieu tonnant vient la joie d u vin.
Voilà pourquoi nous pensons aussi avec ça aux célestes qui alors
Ont été là et qui reviennent au juste moment,
Voilà pourquoi ils chantent aussi avec constance, les poètes, l’esprit d’automne
Et non vainement inventé sonne pour l’Ancien la louange.
9
Oui! Ils disent à juste titre qu’il réconcilie le jour avec la nuit,
Conduit la constellation du ciel éternellement en bas, en haut,
Toujours heureux, telle la frondaison du pin toujours verdoyant
Qu’il aime, et la couronne qu’il a choisie de lierre
Parce qu’il demeure. Satisfait, il l’est, lui, dans la sauvagerie,
Aussi. Et doux sommeil demeure, et abeilles et repas.
Ce que le chant des anciens a prophétisé des enfants de Dieu,
Vois! nous le sommes, nous; c’est le fruit d’Hespérie!
Prodigieux et exact, c’est accompli, comme il sied, à des hommes,
Le croie qui l’a éprouvé! Car chez soi, l’esprit,
I1 n’est pas au commencement, pas à la source. Lui, la patrie le consume.
Les colonies, il aime, et vaillant oubli, l’Esprit.
Nos fleurs le réjouissent, et les ombres de nos forêts,
Le famélique. Presque aurait été calciné le vivifiant.
Des sages bienheureux le voient; un sourire, depuis la captive
Ame éclaire, à la lumière leur œil se dégèle encore.
Si longtemps cela a duré. Mais ils reposent, les yeux de la Terre,
Les tout-sachant aussi ils dorment, les chiens de la nuit.
Traduit par François Fédier
PAIN ET VIN
A Heinze
1
En cercle là autour repose la ville, silencieuse est la rue illuminée
Et ornées de flambeaux s’éloignent les voitures crissantes,
Rassasiés des joies du jour les hommes retournent au repos
Et pesant gains et pertes quelque tête pensive
Connaît la paix de la maison; vide de raisins et de fleurs
Et vide du travail des mains repose le marché affairé.
Mais des accords résonnent dans les jardins au loin; peut-être
Est-ce un amoureux là-bas, ou un homme solitaire
Qui joue pour des amis lointains ou pour sa jeunesse; et les sources
Toujours ruisselantes et fraîches bruissent sur leur lit parfumé.
Calmes dans la pénombre de l’air carillonnent des cloches sonores,
Et attentif aux heures un veilleur crie leur nombre.
Maintenant passe un souffle et remue la cime du bois,
Vois, et l’ombre de notre terre, la lune,
Survient, secrète, elle aussi; la nuit, la visionnaire, arrive
Pleine d’étoiles et bien peu inquiète de nous,
Là-bas rayonne l’étonnante, l’étrangère entre les hommes,
Et sur les collines, triste et splendide, se lève.
2
Admirables sont ses bienfaits, à elle, la plus haute, et personne
Ne sait d’où ni comment ils nous viennent.
Aussi meut-elle le monde et l’âme des hommes, leur espoir,
Aucun sage même ne comprend ce qu’elle nous prépare, car ainsi
Le veut le dieu le plus grand, lui qui t’aime, et par là
T’est plus cher encore que la nuit, le jour sobre.
Mais parfois aussi un œil clair aime l’ombre,
Et cherche par plaisir, avant qu’il soit nécessaire, le sommeil,
Et l’homme intègre plonge aussi volontiers les yeux dans la nuit.
Oui, il sied de lui vouer des couronnes er des chants,
Car elle est consacrée aux déments et aux morts,
Mais elle-même se maintient, éternelle, dans l’esprit le plus libre.
Elle, pourtant, elle nous doit, pour qu’à l’heure hésitante
Et dans l’obscurité quelque chose nous soit saisissable,
Elle doit aussi nous verser l’oubli et l’ivresse sacrée
Et une parole qui afflue et qui soit, tout comme ceux qui aiment
Sans sommeil, et la coupe plus pleine, et la vie la plus téméraire,
Et la mémoire sainte, qui nous tient éveillés dans la nuit.
3
En vain cachons-nous nos cœurs dans nos poitrines, et en vain
Cherchons-nous, maître ou disciple, à contenir la vaillance et qui donc
22
Nous voudrait entraver, qui voudrait nous défendre la joie?
Un feu divin aussi nous pousse, et le jour et la nuit
A ouvrir la brèche. Ainsi, viens! afin que nous voyions l’Ouvert
Et cherchions le bien qui est nôtre, si loin que ce soit.
Car ceci demeure : que ce soit à midi, ou même
Au profond de minuit, toujours subsiste une mesure
Commune à tous, et pourtant donnée à chacun en partage, singulière,
Par là s’en va, y parvient chacun s’il le peut.
Ainsi donc! qu’un délire joyeux se moque des moqueurs
Quand dans la nuit sacrée il s’empare des chanteurs soudain.
Là-bas, viens, sur l’Isthme! où bruit au large la mer
Contre le Parnasse et où la neige couronne les falaises delphiques,
Là au loin au pays de l’Olympe, là sur les hauteurs, Cithéron,
Sous les pins, parmi les grappes, là où
Monte la rumeur de Thèbes, de l’Ismène, au pays de Cadmos,
De là nous arrive et s’annonce à nouveau le dieu qui vient.
4
Grèce heureuse! Toi, demeure pour Eux dans le Ciel,
C’est donc vrai, ce que dans notre jeunesse nous avons entendu?
Salle de la fête! dont le sol est la mer, dont les tables sont les montagnes,
Construite, dès avant les âges, pour un seul cérémonial.
Mais les trônes, où sont-ils? et les temples, où sont les coupes,
Pleines de nectar, pour les dieux et la joie du chant?
Où donc, où s’éclairent les oracles aux portées lointaines?
Delphes sommeille, et où est la grande rumeur du destin?
Où est-il, lui qui est brusque? Où éclate, partout présent et plein de bonheur,
Et tonnant, ce qui descend à nos yeux de l’air clair?
Père Ether! c’est l’appel qui volait de langue en langue
Mille fois crié, et nul sous la charge de vie n’était seul.
Partagé, pareil bien donne joie, échangé avec l’étranger
I1 devient une acclamation, et s’accroît la force dormeuse de ce nom :
Père! Toi, le clair! et résonne, aussi loin qu’il porte, l’antique
Signe, hérité des aïeux, qui touche au loin et qui crée.
Ainsi reviennent Ceux du Ciel, par qui tremble la profondeur, et descend
Hors des ombres parmi les hommes leur jour.
5
Inaperçus d’abord, ils arrivent, et contre eux
Se débattent les enfants, trop clair survient, trop brillant le bonheur
Et plein de crainte est l’homme, à peine un demi-dieu saurait dire
Quels sont les noms de ceux qui chargés de dons se rapprochent.
Mais le courage qu’ils lui donnent est grand; et lui remplissent le cœur
Ces joies qu’ils apportent, à peine sait-il user de ce bien,
I1 crée, il prodigue, et presque sacré est devenu pour lui le profane
Que sa main, généreuse follement, touche et conjure.
Ils le tolèrent, Eux dans le Ciel, autant qu’il se peut; puis vraiment
Eux-mêmes viennent, et les hommes s’accoutument au bonheur
Et au jour et à voir ceux qui sont dévoilés, leur visage,
A ceux qui dès longtemps comme l’Un et le Tout sont nommés,
Dont la vue, librement, en silence profond, remplit et rassasie le cœur
Et d’emblée, à elle seule, contente tout désir.
23
Ainsi est l’homme : quand là est le bien, et que pour lui s’inquiète et se charge de
dons
Un dieu même, il ne peut le savoir ni le voir.
Porter la souffrance, c’esc d’abord ce qu’il doit, et alors il nomme qui lui est le plus
cher,
Alors, alors doivent les paroles, comme des fleurs, se lever.
Alors il se propose gravement d’honorer les dieux bienheureux,
En effet et en vérité doivent toutes choses proclamer leur louange.
Rien ne doit, voir la lumière, qui ne plaise à Ceux d’En Haut,
Devant 1’Ether n’ont droit de paraître d’inutiles tâtonnements.
Là autour, en leur présence dans le Ciel, pour s’en rendre dignes
Les peuples se disposent en ordonnances souveraines,
Entrelacés, et bâtissent des temples beaux et des villes
Fermes et nobles, qui se dressent au-dessus des bords Mais où sont-elles? Où fleurissent-elles, les bien connues, les couronnes de la fête?
Thèbes se flétrit, et Athènes; les armes ont cessé de retentir
A Olympie, et les chars dorés dans le jeu du combat,
Et on ne couronne plus les navires à Corinthe?
Pourquoi se taisent aussi les théâtres anciens et sacrés?
Pourquoi la joie des danses rituelles n’est-elle plus?
Pourquoi un dieu, comme alors, ne marque-t-il plus l’homme au front,
N e met-il plus comme alors son empreinte sur celui qu’il frappe?
O u bien lui-même est venu et a pris forme de l’homme
Et, consolateur, accomplit et ferma la fête du ciel.
7
Mais, ami! nous venons trop tard. I1 est vrai, les dieux vivent,
Mais au-dessus de nos têtes, là-haut, dans un autre monde.
Là ils œuvrent sans cesse, et semblent bien peu attentifs
A notre vie, tant Eux dans le Ciel nous ménagent.
Car un vase fragile ne peut toujours les contenir,
Seulement par instant l’homme supporte la plénitude divine.
Rêver d’eux, telle est ensuite notre vie. Mais l’erreur,
Comme le sommeil, nous secourt, et ce sont détresse et nuit qui rendent forts,
Jusqu’à ce que des héros, dans les berceaux d’airain, aient grandi
Et que leur cœur soit, comme alors, semblable en force aux Immortels.
Ils viendront, dans l’orage tonnant. Jusque-là, il me semble,
Mieux vaut dormir que d’être ainsi sans compagnon
Et d’attendre ainsi, et ce qu’il nous faut dans l’attente faire et dire,
Je ne sais, ni pourquoi des poètes dans les temps d’indigence.
Mais ils sont, dis-tu, comme les prêtres saints du dieu de la vigne
Qui passaient dans la nuit sacrée de pays en pays.
8
En effet quand jadis, et c’est un temps qui nous semble lointain,
Tous ils furent remontés, qui rendaient la vie favorable,
Quand le Père eut détourné des hommes son visage
Et que le deuil à bon droit eut commencé sur la terre,
Quand en dernier parut un génie silencieux, né du ciel
24
Et consolateur, qui annonça la fin du jour et s’en fut,
I1 nous laissa un signe, attestant qu’il fut là et allait
Revenir, et que le chœur du ciel laissait en retour quelques dons
Dont nous, comme alors, nous pourrions nous réjouir en hommes :
Car la joie de l’esprit, le plus grand des dons devenait
Trop grand pour les hommes, encore et toujours manquent les forts pour les joies
Les plus hautes, bien qu’un peu de gratitude survive encore, silencieuse.
Le pain est le fruit de la terre, mais la lumière le sacre,
Et c’est du dieu du tonnerre qu’est venue la joie du vin.
Ainsi nous avons mémoire d’Eux dans le Ciel, qui alors
Étaient là et qui vont revenir au temps juste,
Ainsi chantent, gravement eux aussi, les chanteurs en l’honneur du dieu de la vigne
Et pour lui, l’ancien, il n’est pas vain d’entendre leur louange.
9
Oui, ils ont raison de le dire, il réconcilie la nuit et le jour,
Sans fin, il conduit les astres du ciel par les chemins d’en bas et d’en haut,
Joyeux en tout temps, pareil au feuillage du pin toujours vert
Et qu’il aime, ou à la couronne qu’il s’est choisie dans le lierre,
Car lui demeure, et la trace des dieux enfuis
Lui-même l’apporte ici-bas aux sans dieux, au-dessous, dans l’obscur.
Ce que le chant ancien a prédit des enfants de dieu,
Vois! nous le sommes nous-mêmes; le fruit des Hespérides est là!
Admirable et exact ce qui s’accomplit en l’homme,
Le croira, qui l’a éprouvé! mais tant de choses arrivent
Et rien ne se fait, car nous sommes des ombres, sans cœur jusqu’au jour
Où 1’Ether notre Père, reconnu, va être à chacun et à tous.
C’est dans l’intervalle que vient, en porteur de torche, le Fils
Du Très Haut, le Syrien, parmi les ombres en bas.
Des sages bienheureux le voient; un sourire rayonne
Des âmes prisonnières, à nouveau leurs yeux, mouillés à la lumière, scintillent.
Doucement rêve et dort le Titan dans les bras de la terre,
Même Cerbère, même lui, le jaloux, vient boire et s’endort.
Traduction par Jean- Pierre Faye
EN SOUVENIR DE
I1 vente du nord-est,
Le plus cher qui d’entre les vents
Me soit, car il prédit fougue, enthousiasme,
Et bon voyage aux mariniers.
Mais pars, maintenant, et salue
La belle Garonne,
Et les jardins de Bourdeaux
Là-bas, depuis la rive franche
Où court l’embarcadère et chute le ruisseau
Au plus profond du fleuve, mais tandis
Que loin regarde au-dessus d’eux un couple
Altier de chênes et peupliers d’argent.
i l m’en‘souvient très bien encore et comme
Largement le bois d’ormes incline
Ses cimes au-dessus d u moulin,
Mais il y a dans la cour un figuier.
Là même aux jours de fête
Les femmes brunes vont
Fouler un sol soyeux,
A la saison de mars :
Quand sont pareils la nuit et le jour,
Et que dessus les lents embarcadères,
Lourdes de rêves d’or,
Des brises endormeuses passent.
Mais qu’on me tende, pleine
De l’obscure lumière,
La coupe parfumée
Qui me permettrait le repos; qu’il serait doux
Parmi les ombres le sommeil.
I1 n’est pas bon
De perdre l’âme à coup de mortelles
Pensées. Mais il est bon
De se parler et de se dire
Ce qu’on pense en son cœur, d’entendre longuement
Parler de jours d’amour et puis
De grandes choses qui se font.
Mais où sont-ils donc, les amis? Bellarmin
Et son compagnon? Beaucoup
Ont contrecœur de se rendre à la source;
La richesse en effet commence
Dans la mer. Eux font
Comme les peintres une moisson
Des beautés de la terre et ne honnissent
Point la guerre des voilures, ni
D’habiter, à longueur d’an et seul, sous l’arbre
26
N u des mâts, où il n’est pas de jours
De fête de la ville qui transpercent la nuit
De lumière, ni chant des cordes ou danses d u pays.
Mais les hommes sont maintenant
Partis chez des Indiens,
Là-bas par la pointe venteuse,
Au long des vignes, là
Où la Dordogne descend,
Où se conjugue, ample comme la mer,
A la Garonne magnifique
Le fleuve, et part. Mais la mer qui l’emporte
Donne aussi la mémoire,
Et l’amour encore attache assidûment les yeux,
Mais ce qui reste est œuvre des poètes.
LA MOITIÉ
DE LA VIE
Lourde de poires jaunes,
Et pleine de roses sauvages
La terre est penchée sur le lac,
Et, vous, cygnes charmants,
Enivrés de baisers,
Vous trempez votre tête
Dans l’eau sobre et sacrée.
Où, malheureux, irai-je prendre,
Quand vient l’hiver, les fleurs, où
L’or d u soleil,
Et l’ombre de la terre?
Les murs sont là
Muets et froids, dans le vent
Tintent les drapeaux.
SI DE LÀ-BAS, SI LOIN ...
Si de là-bas, si loin, puisque nous sommes
Désunis, je te suis onnaissable encore, si le passé
O toi, l’associé de mes peines!
Peut te désigner quelque bien,
Dis-moi comment t’attend l’amie
En ces jardins où nous nous retrouvions
Après les temps affreux, les temps de nuit?
Au bord des fleuves ici d u monde saint des premiers temps.
I1 y avait, il faut que je le dise, quelque chose de bon
En tes yeux quand jadis aux lointains horizons
27
Un jour tu t’es joyeux tourné pour voir,
Homme toujours fermé dedans la ténébreuse
Allure. Comment ont fui les heures, dans quel silence
Mon âme fut avec la vérité, que
Je serais à ce point séparée?
Oui, je l’ai dit, j’étais à toi.
Sincèrement, ainsi que tu désires tout ce que nous savons
Me remettre en mémoire et m’écrire
En des lettres, ainsi va-t-il de moi
Que du passé il faut que tout je dise.
Était-ce le printemps? où était-ce l’été? le rossignol
Avec son chant très doux vivait chez des oiseaux
Qui n’étaient pas au loin, dans les taillis.
Et des arbres faisaient un ombrage d’odeurs.
Les clairs passages, et les broussailles basses, et le sable
Sur quoi nous avancions, nous donnaient plus de joie,
Plus de contentement quand nous regardions la jacinthe.
O u la tulipe, la violette, l’œillet.
Aux murs grimpaient les vertes façades d u lierre, et verte
Etait la ténèbre heureuse des allées hautes. Le soir
Souvent, et le matin nous fûmes là,
Parlant de maintes choses, nous regardions joyeux.
Dans mes bras il reprenait vie l’adolescent,
Qui me venait, encore en abandon, depuis les champs
Qu’il me montrait avec une âme lourde,
Mais il avait des lieux rares gardé les noms
Et toute la beauté, qui m’est très chère aussi,
Qui resplendit au long des berges bienheureuses
Dans la campagne du pays, ou bien reste
Cachée aux regards des hauteurs,
Depuis lesquelles un homme peut regarder aussi la mer,
Mais où personne ne veut être. N’en demande pas plus, et pense
A celle qui est contente encore, parce
Que le jour enchanteur a lui pour nous,
Qui avait commencé par l’aveu de l’amour ou
Les mains serrées pour nous unir. Malheur à moi!
Ce furent de beaux jours. Mais
Après eux bien triste crépuscule.
Mon amour, tu me dis toujours que tu es
Si seul dans le beau monde, mais
Tu ne le sais pas ...
Traduit par Je-P. Lefebvre
A LA SOURCE DU DANUBE
Car, tout comme d’en haut, depuis le superbement accordé, depuis l’orgue,
Dans la salle sauve,
Jaillissant pur des inépuisables tuyaux,
Le prélude, éveillant, au matin commence
Et loin tout autour, de halle en halle,
Le rafraîchissant, alors, le fleuve mélodieux ruisselle,
Jusque dans les froides ombres la maison
Emplit d’enthousiasme,
Et alors est éveillé, alors, se levant, à lui,
Au soleil de la fête répond
Le chœur de la communauté : ainsi vint
La parole depuis l’est vers nous,
Et aux rochers d u Parnasse et au Cithéron j’entends,
O Asie, ton écho et il se brise
Au Capitole et abrupte, descendant des Alpes,
Vient, une étrangère, elle,
Vers nous, l’éveilleuse,
La voix formeuse d’hommes.
Un étonnement, là, saisit l’âme
De ceux qui furent atteints, tous, et la nuit
Etait sur les yeux des meilleurs.
Car de beaucoup est capable,
Et le flot et le roc et la force du feu aussi
I1 les soumet avec art, l’homme,
Et ne tient pas, le magnanime, compte
Du glaive, mais il se trouve,
Devant ce qui est divin, frappé à terre, le vigoureux,
Et ressemble presque au gibier; lequel
Poussé par la suave jeunesse
Court sans relâche sur les monts
Et sent sa propre force
Dans l’ardeur de midi. Mais quand
Ramenée en bas, dans les vents qui jouent,
La sauve lumière, et avec le rayon plus frais
L’esprit joyeux vient vers
La bienheureuse Terre, alors il succombe, inhabitué
Au Plus beau, et somnole d’un sommeil éveillé
Avant même qu’approche un astre. Tels nous aussi. Car à plus d’un s’éteignit
La lumière des yeux bien avant, venus des dieux, les présents,
Les aimables qui d’Ionie, à nous,
Aussi d’Arabie, s’en vinrent, et heureuse ne fut,
Du cher enseignement et aussi des adorables chants
L’âme de ceux qui s’étaient ainsi endormis, jamais.
Pourtant quelques-uns veillaient. Et ils voyageaient souvent
29
En paix parmi vous, ô citoyens de belles villes,
Lors des Jeux où d’habitude invisible le héros
Secrètement auprès des poètes assis, regardait les lutteurs et souriant
Louait, le tant loué, les enfants oisifs avec zèle.
Un incessant amour, était-ce là, et c’est.
Et bien que séparés, mais c’est pour cela que nous
Pensons les uns aux autres pourtant, ô Enjoués à l’Isthme,
Et au Céphise et au Taygète,
Aussi à vous nous pensons, ô vallées du Caucase,
Si antiques que vous soyez, ô paradis de là-bas,
Et à tes patriarches et à tes prophètes
Ô Asie, à tes vigoureux, ô Mère!
Qui sans peur devant les signes d u monde,
Et le ciel sur les épaules et tout le partage,
A longueur de jours enracinés sur les monts,
D’abord s’y entendirent
A parler seuls
A Dieu. Ceux-là reposent à présent. Mais si vous,
Et c’est cela qui est à dire,
Vous, Anciens, tous, ne disiez pas d’où,
Nous te nommons : contraints par la salve, nommons,
Nature! nous te nommons, et à nouveau, comme hors d u bain, s’élève
De toi tout ce qui est de naissance divine.
A la vérité, nous allons presque comme les orphelins;
I1 en est bien comme autrefois, seulement ces soins ne sont plus;
Pourtant des juvéniles se souvenant de l’enfance,
Dans la maison ceux-là non plus ne sont pas étrangers.
Ils vivent trois fois, justement comme aussi
Les premiers fils du ciel.
Et pas en vain nous a été
Donnée en l’âme la fidélité.
Non pas nous, ce qui est vôtre aussi elle sauvegarde,
Et près des reliques, des armes de la parole
Que partant vous avez aux moins dotés, à nous,
O fils du partage, laissée derrière vous,
Ô bons esprits, là vous êtes aussi,
Souvent, quand alors la sauve nuée entoure un homme,
Là nous nous étonnons et ne savons pas lui donner sens.
Mais vous, vous nous épicez de nectar l’haleine
Et alors nous exultons souvent, ou nous assaille
Un songe, mais quand trop vous en aimez un,
I1 n’a pas de repos jusqu’à ce qu’il soit devenu l’un des vôtres.
C’est pourquoi, bienveillants! entourez-moi légèrement
Afin que je puisse rester, car il y a encore beaucoup à chanter,
Mais cette fois finit, pleurant de félicité,
Comme une légende de l’amour,
Pour moi le chant, et ainsi aussi est-il,
Pour moi, avec rougissements, avec pâleurs,
Depuis qu’il m’a pris, allé. Mais Tout va ainsi.
Traduction par François Fédier
L’ISTER
A présent viens, Feu!
Nous sommes avides
De regarder le jour,
Et quand l’épreuve
Est passée par les genoux,
Quelqu’un peut sentir les cris de la forêt.
Mais nous, nous chantons depuis l’Indus,
Arrivés de loin, et
De l’Alphée, longtemps cherché,
Ce qui convient, nous l’avons,
Non, sans ailes ne peut
Au plus proche quelqu’un atteindre
Tout droit
Et passer de l’autre côté.
Mais c’est ici que nous voulons bâtir.
Car les fleuves rendent défrichable
Le pays. Quand en effet des herbes poussent
Et que vont à ceux-là,
L’été, pour boire les bêtes,
Alors y vont aussi les hommes.
Mais on nomme celui-ci 1’Ister.
Belle est son habitation. I1 brûle, le feuillage des fûts,
Et s’agite. Sauvages ils se
Dressent, debout, les uns parmi les autres; par-dessus,
Un second Mètre, fait saillie,
De rochers, le toit. Aussi ne me surprend
Pas qu’il ait
Invité Hercule à venir,
Brillant au loin, à même l’Olympe, en bas,
Alors que celui-là, pour se chercher de l’ombre
Venait de l’Isthme brûlant,
Car pleins de cœur ils
Etaient, là-même, mais il est besoin, à cause des Esprits,
Aussi de frais. C’est pourquoi il partit, lui, plus volontiers
Vers les sources des eaux, par ici, et les rives jaunes,
Bien odorantes en haut, et noires
De la forêt de pins, où dans les profondeurs
Un chasseur volontiers se promène à plaisir
A midi, et la croissance est audible
A même les arbres résineux de 1’Ister.
Lui qui paraît pourtant presque
Aller à reculons et
J’imagine qu’il devrait venir
De l’est.
Il y aurait beaucoup
A en dire. Et pourquoi est-il pendu
31
Aux montagnes tout droit? L’autre,
Le Rhin, est de côté
Parti au loin. Ce n’est pas pour rien qu’ils vont
Dans le sec, les fleuves. Mais comment? Un signe il faut,
Rien d’autre, pur et simple, pour que soleil
Et lune il porte dans le cœur, inséparables,
Et continue, jour et nuit aussi, et
Ceux du ciel se tiennent chaud les uns aux autres.
C’est pourquoi ceux-là sont aussi
La joie du Plus haut. En effet comment viendrait-il
Vers le bas? Et verts, comme Herta,
Ils sont, les enfants du ciel. Mais par trop patient
I1 me semble, lui, pas
Plus libre, et presque se moquer. Nommément, quand
Débuter doit le jour
Dans la jeunesse, où il commence
A croître, il pousse, un autre, là,
Haute déjà, la splendeur, et pareil aux poulains
A la bride il écume, et tout au loin entendent
La poussée les vents,
Lui est content;
Mais il faut des entailles au rocher
Et des sillons à la terre,
Ce serait inhospitalier sans quiétude;
Mais ce qu’il fait, le fleuve,
Personne ne le sait.
Traduit par F. Fédier
LE RHIN
En sombre lierre assis, à la porte
De la forêt, juste là où le midi tout doré,
Visitant la source, s’en vint descendant
Les marches du massif des Alpes,
Qui pour moi le divinement bâti,
Le rempart des Célestes se nomme
Suivant l’ancienne idée, où, de plus,
En secret, encore, mainte chose, décidément
A des hommes parvient; de là
J’ai appris sans l’avoir présumé
Un destin, car à peine encore
S’était, dans l’ombre chaude,
Se parlant à elle-même de maintes choses, mon âme
Droit sur l’Italie tirée
Et loin là-bas, aux côtés de Morée.
A présent pourtant, au sein du massif,
Profondément sous les cimes d’argent,
Et sous l’heureuse verdure
Où les forêts, en tremblant, vers lui,
Et les têtes des rocs les unes par-dessus les autres
Regardent en bas, tout le jour, là
Dans l’abîme le plus froid j’entendis
Gémir après sa délivrance
Le Jeune, ils l’entendaient, comme il rageait
Et accusait la Terre Mère
Et le Tonnant qui l’avait engendré,
Pris de pitié, les parents, cependant
Les mortels s’enfuyaient du lieu
Car terrible était, vu que sans lumière il
Se roulait dans ses liens,
La furie du demi-dieu.
C’était la voix du plus noble des fleuves,
Du Rhin, le librement-né,
Et autre chose il espérait quand là-haut, des frères,
Du Tessin et du Rhône
Il se sépara et voulut partir à l’aventure, et impatiemment le
Poussa vers l’Asie son âme royale.
Cependant il est déraisonnable
De souhaiter face au destin.
Les plus aveugles pourtant
Sont fils des dieux. Car il connaît, l’homme,
Sa maison, et pour la bête il y eut
Place où bâtir, cependant à ceux-là est
Le manque, qu’ils ne sachent où aller,
Donné dans l’âme inexperte.
33
Énigme est bien ce qui est pur a surgi. Même
Le Chant, à peine lui est-il licite de le dévoiler. Car
Ainsi que tu as commencé tu vas demeurer
Quelle que soit l’œuvre de l’urgence
Et de l’élevage, d u plus en effet
Est capable la naissance,
Et le rai de lumière qui
Rencontre le nouveau-né.
Où pourtant y en a-t-il un
Pour rester libre
Sa vie entière, et le souhait d u cœur
Uniquement remplir, ainsi,
Depuis des hauteurs propices, comme le Rhin.
Et ainsi, d’un giron sacré
Heureusement né, comme lui?
C’est pourquoi sa parole est jubilation.
I1 n’aime pas, comme d’autres enfants,
Pleurer emmailloté dans ses liens;
Car là où les rives la première fois
Lui glissent au côté, les tortueuses,
Et l’étreignent dans leur soif,
L’Inconsidéré, de l’attirer
Et certes aussi de le garder sont avides
De leur propre croc, en riant
I1 déchire ces serpents et plonge
Avec la proie, et si dans la hâte
Un plus grand ne le réfrène,
Le laisse croître, comme l’éclair, il doit
Fendre la Terre, et comme ensorcelées s’enfuient
Les forêts à sa suite et s’effondrent en elles-mêmes les montagnes.
Un Dieu veut pourtant épargner à ses fils
La vie en hâte et il sourit
Quand sans retenue, mais ralenti
Par de saintes Alpes, vers lui,
Dans la profondeur, comme celui-là, grondent les fleuves.
En une telle fournaise est alors
Forgé aussi tout ce qui est sans mélange,
Et c’est beau, comme là-dessus,
Après qu’il a délaissé les montagnes,
Voyageant tranquille, dans le pays allemand
I1 se contente et apaise le désir
Dans la bonne occupation, quand il bâtit le pays
Le Rhin, le Père, et nourrit de chers enfants
Dans des villes qu’il a fondées.
Cependant jamais, jamais il n’en perd mémoire.
Car plutôt doit l’habitation dépérir
Et l’assise, et tourner à l’immonde
Le jour des hommes, plutôt qu’à un tel soit licite
D’oublier l’origine
Et la voix pure de la jeunesse.
Qui est-ce donc qui le premier
34
A corrompu les liens de l’amour
Et en a fait des lacets?
Alors ils ont, du propre droit
Et assurément du feu céleste
Osé rire les arrogants, alors seulement,
Méprisant les pistes mortelles,
Fait le choix de l’outrance
Et recherché à devenir les égaux des dieux.
Ils en ont pourtant, de leur propre
Immortalité, les dieux, assez, et ils ont besoin
Les Célestes d’une chose,
Une seule : ce sont les héros et les hommes
Et les mortels par ailleurs. En effet, comme
Les Bienheureux ne ressentent rien d’eux-mêmes,
I1 est bien nécessaire, s’il est permis de dire
Une telle chose, qu’au nom des dieux,
Prenant part, ressente un autre,
Celui-là, il le leur faut; toutefois leur justice
Est que sa propre maison
I1 renverse, lui, et ce qu’il a de plus cher
Comme ennemi il l’injurie et s’ensevelisse
Père et enfant sous les décombres,
Si un homme veut être comme eux et ne pas
Souffrir l’inégal, le fantasque.
C’est pourquoi : heureux celui qui trouva
Un destin bien départi
Où encore des voyages
Et, douce, des peines la remémoration
Murmure et monte au sûr rivage,
Que là, et au loin, volontiers
I1 puisse voir jusqu’aux frontières
Qu’à la naissance lui a
Dessinées Dieu pour son séjour.
Alors il est en repos, heureusement mesuré,
Car tout ce qu’il voulait,
Ce qui est céleste, de soi-même l’embrasse,
Non contraint, en souriant,
A présent qu’il est en repos, le téméraire.
Demi-Dieux je pense à présent,
Et connaître je dois les chers,
Parce que souvent leur vie tant
Me remue la poitrine haletante.
A qui pourtant comme, Rousseau, à toi
Insurpassable l’âme,
La fort endurante était,
Et sens assuré
Et suave don d’écouter
De parler en sorte que, lui, par plénitude sacrée,
Comme le dieu du vin, follement, divinement,
Et sans statut, elle, la langue des plus purs, il la donne
A comprendre aux bons, mais à juste titre
35
Les irrévérencieux frappe d’aveuglement,
Les valets profanateurs, comment nommerai-je cet étranger?
Les fils de la Terre sont, comme leur Mère,
Tout-aimants, ainsi reçoivent-ils aussi
Sans peine, les heureux, tout.
C’est pourquoi cela surprend aussi
Et fait sursauter l’homme mortel,
Quand, le ciel, qu’
Avec les bras aimants
I1 s’est amassé sur les épaules,
Et la charge de joie il considère;
Alors lui paraît souvent le meilleur
D’être presque tout oublié là
Où le rayon ne brûle pas,
Dans l’ombre de la forêt
Au lac de Bienne, en fraîche verdure,
Et insoucieusement pauvre en tons,
Pareil aux débutants, d’apprendre auprès des rossignols.
Et c’est magnifique, d’un sommeil sacré alors
De se relever et du frais de la forêt
Se réveillant, c’est maintenant le soir,
D’aller à la rencontre de la lumière plus douce,
Quand celui qui a bâti les montagnes
Et dessiné la piste des fleuves,
Après que, souriant aussi,
La vie affairée des hommes,
La pauvre en haleine, comme une voile,
Avec ses souffles il a dirigée,
Lui aussi est en repos, et vers l’Écolière à présent,
Le configurateur, du bien plus
Que du mal trouvant,
Vers la Terre d’aujourd’hui, le jour s’incline.
Alors ils fêtent les noces, hommes et dieux,
Ils fêtent, les vivants, tous,
Et compensé
Est, un temps, le destin.
Et les fugitifs demandent l’auberge,
Et doux sommeil les braves,
Les amants, eux,
Sont ce qu’ils étaient; ils sont
A la maison, où la fleur se réjouit
D’un feu non nocif, et les sombres arbres,
Les entoure l’esprit de son murmure, mais les irréconciliés
Sont tout changés et courent
Les mains se tendre
Avant que la lumière amicale
Ne descende et que ne vienne la nuit.
Cependant, devant certains
Cela s’enfuit vite, d’autres
Le gardent plus longtemps.
36
Les dieux éternels sont
Pleins de vie tout le temps; jusqu’à la mort
Un homme, pourtant, peut aussi
En mémoire malgré tout garder ce qu’il y a de meilleur,
Et alors il connaît ce qu’il y a de plus haut.
Seulement, chacun a sa mesure.
Car lourd est à porter
Le malheur, mais le bonheur est plus lourd.
Un sage pourtant a su
D u midi jusqu’à la minuit
Et jusqu’à ce que le jour resplendît,
Au banquet rester lucide.
A toi, puisse sur la piste brûlante sous les sapins ou
Dans le sombre de la forêt de chênes enveloppé
D’acier, mon Sinclair! Dieu apparaître ou
Dans les nuées, tu le connais, car tu connais, juvénile,
La force du bien et jamais ne t’est
Dérobé le sourire du souverain
Le jour, quand
Fiévreux et attaché il
Rayonne, ce qui est vivace, ou bien aussi
La nuit, quant tout est
Mêlé sans ordre et que revient
Une tout ancienne confusion.
Tradnit par F. Fédier
GERMANIE
Non, les bienheureux,
Images divines apparues dans le pays antique,
Je ne dois certes plus les invoquer, mais si,
Ondes de la patrie, c’est avec vous
Que retentit l’amour d u cœur qui se plaint,
Que veut-il d’autre dans son deuil sacré? Car en attente
Repose le pays, et lorsque par les chaudes journées,
Etres de nostalgie! le ciel abaissé nous entoure
Aujourd’hui d’une ombre prophétique.
I1 est lourd de promesses, mais me semble aussi
Menaçant, pourtant je veux rester en sa présence,
Et mon âme ne doit pas s’enfuir en arrière
Vers vous, ô dieux passés! qui me restez trop chers.
Car voir vos beaux visages
Comme si tout était comme autrefois, est mortel, je le crains,
Et il est à peine permis de réveiller les morts.
Ô dieux enfuis! et vous, ô dieux présents, naguère
Plus véridiques, vous eûtes votre temps!
N e rien nier, je le veux, et ne rien implorer.
Car quand tout est fini, que le jour s’est éteint,
Le premier le prêtre est frappé, mais plein d’amour
Le temple, et l’image, et le rite qui est sien
Le suivent aux sombres bords, plus rien n’en peut paraître.
Comme née des flammes d’un bûcher funèbre, seule une fumée d’or
S’élève, légende, des profondeurs,
Lueur d’aube pour nos têtes en proie au doute,
Et nul ne sait ce qui lui arrive. I1 sent
Que les ombres de ceux qui ont été,
Les anciens dieux, visitent à nouveau la terre.
Car ceux qui vont venir nous pressent,
Et la troupe sacrée des hommes-dieux
N e s’attardera plus dans le ciel bleu.
Oui, déjà verdit le champ qu’au prélude d’un âge plus rude
O n a planté pour eux, l’offrande est préparée
Pour le repas du sacrifice, vallée et fleuves sont
Large ouverts autour des cimes prophétiques,
Afin que l’homme puisse regarder jusqu’en Orient
D’où maintes métamorphoses l’émeuvent.
Mais de l’éther tombe
L’image fidèle, et les paroles divines en pleuvent,
Innombrables, les profondeurs du bois sacré résonnent
Et l’aigle qui vient de l’Indus
Et d u Parnasse survole
Le sommet enneigé et, de très haut, les collines
D’Italie vouées aux sacrifices, l’aigle antique ne cherche plus une proie agréable
Au Père, comme autrefois, mais d’un vol mieux exercé,
38
Exultant, il franchit enfin les Alpes à tire-d’aile,
Contemplant les pays aux formes si diverses.
La prêtresse, fille la plus silencieuse du dieu,
Qui n’aime que trop se taire dans sa simplicité profonde
C’est elle qu’il cherche, elle qui regardait de ses yeux grand ouverts
Comme si elle l’ignorait, naguère, quand la tempête
Déchaînait sur sa tête un tonnerre aux menaces mortelles.
L’enfant attendait mieux dans sa prescience
Mais l’étonnement finit par gagner tout le ciel
A l’idée qu’une enfant fût aussi pleine de foi
Qu’elle-même, la bénissante, la puissance des hauteurs.
Aussi envoyèrent-ils Jeur messager qui, la reconnaissant aussitôt,
Pense en souriant : O toi, ô infrangible,
Un autre mot doit t’éprouver - et il le crie avec force,
Messager juvénile regardant Germania :
(( C’est toi, tu e5 l’élue,
La tout-aimante, devenue assez forte
Pour supporter un lourd bonheur ».
Depuis ce temps où, cachée dans la forêt et les pavots en fleur
Emplis de doux sommeil, enivrée tu ne prenais pas
Garde à moi, longtemps, avant que de moindres n’éprouvent
Ta fierté virginale, et ne se demandent étonnés de qui et où tu étais,
Mais toi-même, tu l’ignorais. Je ne te méconnus pas,
Et en secret, pendant que tu rêvais, je te laissais
Au départ, à midi, en signe d’amitié,
La fleur de la bouche, et tu parlas dans ta solitude.
Pourtant, ô bienheureuse! tu épanchas tes paroles d’or
A foison, et dans le cours des fleuves elles coulent intarissables
Dans toutes les contrées. Car presque comme à la sainte,
Mère de toute chose et qui porte l’abîme,
La secrète autrefois nommée par les hommes,
Comme à elle, d’amour et de douleur,
De pressentiments et de paix
Ta poitrine est pleine.
ô, bois les brises matinales
Jusqu’à ce que tu sois ouverte
Et nomme ce qui s’offre à tes yeux,
L’inexprimé ne doit pas
Rester plus longtemps un secret
Après avoir été longuement voilé;
Car aux mortels la pudeur sied
Et il est sage, le plus souvent,
D’ainsi parler des dieux aussi.
Là où des sources plus pures
Ont rendu l’or superflu, où le courroux du ciel est chose sérieuse,
Une fois, entre le jour et la nuit,
Une vérité doit apparaître.
Dis-la trois fois et par détour,
Mais inexprimée, telle qu’elle est là,
O innocente! elle doit rester.
O, toi, fille de la terre sacrée! nomme
39
Enfin ta mère. Les eaux bruissent le long du roc
Et le tonnerre dans la forêt, et à l’énoncé de son nom
Résonne à nouveau, venu du fond des âges, le divin disparu.
Comme tout est changé! et de tout son éclat brille et parle,
Du lointain, un à venir joyeux.
Pourtant, au milieu du temps,
L’éther vit calmement
Avec la terre virginale et consacrée
Et ils aiment en souvenir à se montrer hospitaliers,
Eux, les sans-besoins, avec les sans-besoins
Aux jours de tes fêtes,
Ô Germanie, lorsque tu es prêtresse
Et, sans armes, dispenses alentour conseil
Aux princes et aux peuples.
Traduit par J . Hervier
TOUT COMME AU JOUR DE FÊTE ...
Tout comme au jour de fête, pour voir le champ
Un paysan s’en va, le matin, quand
D’une très chaude nuit les éclairs rafraîchissants sont tombés
Tout le temps, et loin encore résonne le tonnerre,
Qu’en ses rives revient le torrent,
Et, frais, le sol verdoie,
Et de la pluie réjouissante du ciel
La vigne s’égoutte et, scintillant
Dans le soleil tranquille, se dressent les arbres du bosquet :
Ainsi vous dressez-vous sous un climat propice,
Vous qu’aucun maître seul, que miraculeusement
Toute-présente éduque en accolades légères
La puissante, la divinement belie Nature.
Voilà pourquoi quand elle semble dormir à certaines saisons de l’an
Au ciel ou parmi les plantes ou les peuples,
Alors est en deuil la face des poètes aussi;
Ils semblent être seuls, pourtant ils pressentent toujours,
Car pressentant elle repose elle aussi.
Mais à présent voici le jour! J’attendais, le vis venir,
Et ce que j’ai vu : Salve soit ma parole.
Car elle, elle-même, plus ancienne que les siècles,
Et au-dessus des dieux d u Soir et de l’orient,
La Nature est à présent réveillée à grand bruit d’armes,
Et d’en haut, de l’Ether, jusqu’à l’abîme en bas,
Suivant ferme statut, comme jadis, engendrée d’un saint Chaos,
L’ivresse à nouveau se sent,
Elle, la Toute-Créatrice, encore une fois.
Et tout comme en l’œil un feu scintille à l’homme,
Quand c’est haut ce qu’il a projeté, ainsi est
A nouveau aux signes, aux gestes du monde à présent
Un feu allumé en des âmes de poètes.
Et ce qui avant a eu lieu, mais à peine ressenti,
Voilà que c’est manifeste seulement à présent,
Et celles qui, souriantes, nous ont cultivé l’arpent,
Sous figure serve, elles sont connues, elles,
Les Toutes-Vivantes, les forces des dieux.
Les interroges-tu? En louange souffle leur esprit,
Quand du soleil du jour et de la Terre chaude
Elle s’éveille, et que tempêtes qui dans l’air, et autres,
Qui plus préparées en des profondeurs du Temps,
Et plus pleines de sens et plus à apprendre pour nous,
S’en viennent en voyageant entre Ciel et Terre et parmi les peuples.
Ce sont les pensées de l’esprit commun,
En paix finissant dans l’âme du poète.
41
ô! que vite frappée, elle, de l’Infini
Connue depuis longtemps, de souvenir
Ebranlée, et que lui soit, embrasé par un rayon salutaire,
Le fruit amoureusement porté, Grand-CEuvre des dieux et des hommes,
Le Plain-chant, pour qu’il témoigne des deux, réussite.
Ainsi tomba, comme disent les poètes, alors que visiblement
Elle convoitait de voir le dieu, sa foudre sur la maison de Sémélé
Et la divinement atteinte mit au monde
Le fruir de l’orage, le salutaire Bacchus.
De là vient que boivent Feu céleste à présent
Les fils de la Terre, sans péril.
nourtant à nous revient, sous les orages de Dieu,
O poètes! tête nue de nous tenir debout,
Er le Rayon du Père, lui-même, de notre propre main,
De le saisir et au peuple, en l’ode
Revoilée la donation céleste .de la tendre,
Car ne sont de cœur pur,
Comme des enfants, que nous, sont innocentes nos mains.
Le rayon du Père, le pur, ne l’enflamme pas
Et profondément remué, aux souffrances d’un plus fort
Compatissant, demeure dans les tempêtes s’abattant de très haut,
Du Dieu, quand il approche, le cœur cependant ferme.
Cependant malheur à moi! si de
Malheur à moi!
Et je dis aussitôt,
Que je me suis approché pour regarder les Célestes,
Eux-mêmes, ils me jettent loin sous les vivants,
Faux-prêtre, dans les ténèbres, pour que je
Chante l’ode de mise en garde aux dociles.
Là-bas
Traduit par F. Fédier
FÉTE DE LA PAIX
Je demande qu’on lise cette feuille avec bonne foi seulement. Ainsi elle ne manquera
sûrement pas d’être comprise et elle heurtera encore moins. Si pourtant certains devaient
trouver ce langage trop peu conventionnel, je dois leur avouer que je ne puis faire
autrement. Lors dune belle journée, il n’est manière de chanter qui ne se laisse entendre,
e t la nature qui a donné, reprend aussi. L’auteur a deJsein de soumettre au public tout
un recueil de pareilles feuilles, e t ceci voudrait en être un exemple.
Des sons célestes, dans le silence résonnant,
D’un pas mesuré cheminant, pleine
Et aérée est la salle anciennement édifiée,
Coutumière de félicité ; autour de tapis verdoyants embaume
Le nuage de joie et, resplendissantes au loin, se dressent,
Des fruits les plus mûrs pleines et de calices couronnés d’or,
En belle ordonnance, somptueuse rangée,
Sur les côtés ici et là s’étageant au-dessus
Du sol aplani, les tables.
Car venant de loin
C’est ici, qu’à l’heure du soir,
Des hôtes aimants ont voulu se rendre.
Et d’un œil qui s’enténèbre, je pense déjà,
Souriant de son grave labeur,
Le voir lui-même, le prince du festin.
Mais si volontiers tu renies la terre étrangère qui est tienne,
Et si comme las de la longue campagne de héros,
Tu baisses ton regard, oublieux, voilé d’ombres légères,
Et revêts figure d’ami, ô toi partout connu, pourtant
La hauteur ploie presque les genoux. Devant toi, je ne sais rien,
Une chose seulement, mortel tu n’es pas.
Un sage peut m’apporter mainte lumière, mais
Où un dieu aussi paraît,
I1 y a une autre clarté.
Mais d’aujourd’hui il n’est pas, il fut annoncé;
Et un qui n’a craint ni flot ni flamme,
Étonne, quand le silence s’est fait, et ce n’est pas en vain, maintenant
Que la domination ne se voit nulle part chez les esprits ni chez les hommes.
C’est dire que l’œuvre qui depuis longtemps,
Du levant au ponant, prépare, ils l’entendent maintenant seulement,
Car immensément rugit, se perdant dans les profondeurs,
L’écho du Tonnant, la tempête millénaire,
Pour s’abîmer dans le sommeil, couverte par les sons de paix.
Mais vous, devenus chers, ô vous, jours de l’innocence,
Vous portez aujourd’hui encore la fête, ô vous bien-aimés! et fleurit
A l’entour, vespéral, l’esprit dans ce silence;
Et je dois conseiller, et la boucle serait-elle
Gris argent, ô vous amis,
43
De vous soucier de guirlandes et de banquet, semblables maintenant à d’éternels
adolescents.
Et il en est plus d’un que je convierais, mais ô toi,
Qui, avec une affable gravité aux hommes, dévoué,
Là-bas sous une palme syrienne,
Où proche était la ville, à la fontaine aimait rester;
Les blés bruissaient à l’entour, dans le silence s’exhalait la fraîcheur
Venue de l’ombre des monts consacrés :
Et les amis chers, la fidèle nuée,
D’une ombre t’entouraient aussi, afin que dans sa sainte audace
Bénin parmi les brousses ton rayon à des hommes parvînt, ô adolescent!
Las! mais plus noire est l’ombre dont t’entourait, en pleine parole,
Terriblement décisive, une meurtrière fatalité. Ainsi passe vite,
Éphémère, toute chose céleste; mais ce n’est pas en vain;
Car avec ménagement, un dieu qui toujours sait la mesure,
Un instant seulement les demeures des hommes
Effleure, à notre insu, et quand? nul ne le sait.
Et puis alors l’insolence peut marcher sur la trace,
Et elle doit venir jusqu’au lieu sacré, la fureur
De confins lointains, tâtant avec rudesse elle exerce sa rage
Et atteint là un destin, mais gratitude
Jamais ne vient à la suite d u présent par le dieu donné;
I1 n’est qu’un profond examen qui le tienne.
Aussi, n’était la parcimonie du donateur,
Depuis longtemps déjà la profusion du foyer
Nous aurait enflammé cimes et sol.
Mais du divin nous reçûmes
Une belle part pourtant. La flamme nous fut
Dans nos mains donnée, et rivage et flot marin.
Bien plus que d’humaine manière
Elles sont avec nous, ces forces étrangères, en confiance.
Et t’enseignent des astres qui sont
Devant tes yeux, jamais pourtant tu ne peux leur ressembler
Mais du Tout-Vivant, par qui
Est abondance de joies et de chants,
Si l’un est le fils, il est de ces tranquilles puissants,
Et en ce jour nous le reconnaissons,
En ce jour où nous connaissons le Père
Et où pour célébrer des jours de fête
Le sublime, l’Esprit
De l’univers s’est vers des hommes penché.
Car pour être Seigneur d u temps il était, lui, depuis longtemps trop grand
Et au loin s’étendait sa terre, mais quand l’a-t-elle épuisé?
Mais pour une fois un dieu même peut choisir travail des jours
Pareil aux mortels et prendre sa part de tout destin.
D u destin la loi est telle que tous s’apprennent,
Et quand revient le silence, que soit aussi un langage.
Mais où l’esprit œuvre, nous sommes à ses côtés, et disputons :
Que serait le mieux? Ainsi le mieux est maintenant à mes yeux
Que soit achevée son image et qu’il en ait fini le maître,
44
Et que lui-même par elle illuminé, il sorte de son atelier,
Le tranquille dieu du temps, et que de l’amour seule la loi,
Qui la belle harmonie dispense, vaille d’ici jusqu’au ciel.
Ample, dès l’aube,
Depuis qu’un entretien nous sommes et l’écho les uns des autres,
Est l’expérience de l’homme; mais bientôt nous serons chant.
Et l’image du temps, que le grand Esprit déploie,
Elle est là devant nous, tel un signe qu’entre lui et d’autres
Une alliance entre lui et d’autres puissances s’est faite.
Lui, et les Incréés aussi, les Eternels,
Peuvent tous se connaître en elle, comme en les plantes
La terre mère et l’air et la lumière se connaissent.
Mais à la fin il y a pourtant, ô puissances sacrées, pour vous
Le signe d’amour, le témoignage
Que vous êtes encore, le jour de fête,
Qui tout assemble, où des célestes ne sont
Dans le miracle révélés, ni à la vue dans la tempête dérobés,
Mais où, parmi les chants, comme des hôtes l’un à l’autre mêlés,
Présents dans des chœurs, un nombre sacré,
Les Bienheureux, selon toute manière
Sont ensemble, et où leur plus cher amour aussi
Auquel ils tiennent, n’est pas absent; c’est pour cela que je t’appelais
Au banquet qui est tout prêt,
Toi, inoubliable, toi, au soir du temps,
O adolescent, toi, pour que tu viennes vers le prince du festin; et elle ne se couchera
Pas
Pour dormir, notre race,
Que vous, les Promis, tous,
Vous, tous les Immortels,
Pour nous dire de votre ciel,
N e soyez là en notre maison.
Brises à l’haleine légère
Déjà vous annoncent,
Vous annoncent les fumées de la vallée
Et la terre, encore pleine du grondement de la tempête,
L’espérance pourtant rougit les joues,
Et devant la porte de la maison
Est assise la mère avec l’enfant,
Et elle regarde la Paix
Et peu semblent mourir;
Un pressentiment tient l’âme,
Par la lumière d’or envoyée
Une promesse arrête les plus vieux.
Sans doute les épices de la vie
Sont-elles d’en haut préparées et aussi
Conduites à un terme les peines.
Car tout plaît à présent,
Mais le naïf
Par-dessus tout, car longtemps cherché,
Le fruit d’or,
45
D’un antique tronc
Dans les seccousses de l’orage tombé,
Mais alors, comme le bien le plus cher, par le destin sacré lui-même
Avec des armes pleines de tendresse protégé,
La figure des divins, c’est lui.
c o m m e la lionne, tu as gémi,
O mère! quand tu les as,
Nature, les enfants, perdus.
Car te les déroba, ô toi trop aimante,
Ton ennemi, quand tu l’eus presque
Comme tes propres fils reçu,
Et qu’à des satyres tu eus les dieux associé.
Ainsi tu as construit mainte chose
Et mainte chose ensevelie,
Car te déteste ce que
Toi, avant l’heure,
Toute-Vigoureuse, tu as au jour tiré.
Maintenant tu connais, maintenant tu laisses cela;
Car volontiers repose, insensible,
Jusqu’à l’heure de mûrir, ce qui, craintif, s’affaire dans le bas.
Trahit par Jean Bollack
FÊTE DE LA PAIX
Veuillez, je vous prie, ne lire ces feuilles qu’avec bonté. Je suis sûr qu’ain.si ce poème
ne sera pas incompréhensible, et encore moins choquant. S’il se trouvait cependant certaines
perJonnes pour estimer cette langue trop peu conventionnelle, il f a u t bien que j’avoue une
chose : c’est que j e ne peux pas faire autrement. N’est-on pas disposé, quand la journée
est belle, à entendre toute façon de chanter, et la nature, dont ce chant provient, le
reprend aussi.
L’auteur songe à proposer au public toute une collection de feuillets de ce genre, et
il f a u t prendre celui-ci comme un échantillon.
C’est une salle emplie de musiques célestes, dont les échos tranquilles,
Qui vont paisiblement et viennent, se répondent,
Où l’air circule, une salle d’ancienne facture
Habitée de bonheur; le nuage de joie
Va parfumant les verts tapis et les tables dressées,
Resplendissent très loin, chargées de fruits très mûrs et de calices adornés d’or,
Bien alignées en rangées magnifiques, montent
De chaque côté au-dessus
Du sol aplani.
Car venus de très loin,
Ici, pour l’heure du soir,
Se sont conviés des hôtes animés d’amour.
Et l’œil crépusculeux il me semble déjà
Que souriant de l’œuvre rigoureux du jour
Je le vois en personne, le prince de la fête.
Mais bien que tu te plaises à renier ton étranger pays,
Et que, comme harassé de la longue campagne héroïque,
Tu baisses, oublieux, l’œil, voilé d’ombre légère,
Et prennes aspect d’ami, toi que chacun connaît, cette grandeur
Pourtant me plie presque le genou. Je ne sais devant toi
Rien, sinon cette chose : tu n’es rien de mortel.
Un Sage peut m’éclairer bien des points; mais quand, de plus
C’est un Dieu qui nous apparaît,
I1 s’agit d’une autre clarté.
I1 n’est pas d’aujourd’hui, pourtant, il nous est annoncé;
Et ceux qui n’ont pas craint les flammes ni les eaux
N e sont pas, maintenant que le calme est venu, étonnés vainement, maintenant
Qu’il n’est plus chez les hommes, ni dans les esprits de domination visible.
C’est-à-dire que maintenant seulement ils entendent
L’ouvrage qui depuis longtemps prépare, du matin vers le soir,
Car l’écho du tonneur, l’orage millénaire, démesurément
Gronde et s’éteint, se perd er va dormir
Dans l’abîme, couvert par les bruits de la paix.
Mais vous, jours d’innocence, qui êtes devenus si chers,
47
Vous nous portez aussi aujourd’hui, mes bien-aimés, la fête, et l’esprit
Resplendit alentour, vespéral, dans ce silence;
Et quand bien même mes boucles
Seraient grises d’argent, mes amis, il faudrait que je vous conseille
De ne pas oublier couronnes ni repas, vous qu’orne comme une jeunesse éternelle.
Et j’aimerais en inviter plus d’un, mais, oh, toi
Qu’inclinait vers les hommes ta sévère bonté,
Qui là-bas sous les palmiers syriens,
Aimais non loin de la ville être près de la fontaine;
Le champ de blé bruissait autour de toi, l’ombre fraîche respirait
Silencieuse sous la montagne consacrée,
Et la nuée fidèle, les chers amis,
T’adombraient eux aussi, pour que ta sainte lumière, l’audacieuse
Parvînt doucement par les déserts jusqu’aux hommes, ô Jüngling.
Mais, hélas, plus sombre encore fut la destinée mortelle qui coupa ta parole,
Tranchant terriblement ta vie. Ainsi périt
Si tôt tout ce qui est céleste; mais ce n’est pas en vain.
Car le dieu qui ménage et toujours connaît la mesure
N e touche qu’un moment les demeures des hommes,
Et brusquement, et personne ne saurait dire : quand?
Et l’insolent peut alors passer ce même chemin,
I1 faut qu’au lieu sacré l’esprit sauvage arrive
Venu des fins lointaines, exerçant à tâtonnements rugueux l’illusion,
Et rencontre là un destin, mais le merci, jamais
N’est dit de suite pour le cadeau divin après qu’il est donné :
I1 faut le prendre à mains qui profondément cherchent
I1 est vrai que si celui qui donne n’avait ce ménagement,
Depuis longtemps déjà le foyer généreux
Nous aurait incendiés de la terre aux sommets.
Pourtant nous recevons d u divin
Abondance. C’est la flamme qui fut
Mise en nos mains, et les berges, et le flot de la mer.
Et beaucoup plus encore, car d’humaine façon
Ces choses nous paraissent, ces forces inconnues, nous être familières.
Et l’astre que tu vois t’apprend,
Quand bien même jamais tu ne peux l’égaler.
Mais de l’immense Tout vivant d’où viennent
Les joies nombreuses et les chants
I1 est un fils, c’est une force puissante et tranquille,
Et maintenant nous le reconnaissions,
Maintenant que nous connaissons le père,
Et que l’esprit d u monde, le Très-Haut,
Pour que nous tenions des jours de fête,
S’est incliné vers les hommes.
Car il était depuis longtemps trop grand pour être le seigneur du temps
Et son champ s’étendait très loin, mais quand cela l’aura-t-il épuisé?
48
Mais un jour un dieu peut aussi élire un ouvrage de jour,
Comme font des mortels et partager toute destinée.
C’est la loi d u destin, que tous s’apprennent,
Que lorsque revient le silence, il y ait aussi un langage
Mais où œuvre l’esprit, nous sommes là aussi, et disputons
De quoi serait le mieux. Et maintenant, ce me semble, le mieux,
Lors qu’est achevée son image et que le maître a terminé,
Et lui-même illuminé d’elle sort de son atelier,
Le silencieux dieu d u temps, est que seule la loi d’amour,
La loi de belle harmonie règne d’ici jusques au ciel.
Nombreuses sont depuis le matin,
Depuis que nous sommes gens qui nous parlons et entendons de l’autre,
Les choses apprises par l’homme; mais bientôt nous serons un chant.
Et l’image du temps que déploie le grand esprit,
Est là devant nous, signe qu’entre lui et les autres
I1 y a une alliance entre lui et d’autres puissances.
Non seulement lui, mais les non-engendrés, les éternels
Se reconnaissent là, tout comme aux plantes
Se connaissent la mère terre, et la lumière et l’air.
Mais le signe d’amour pour vous enfin, vous les forces sacrées,
Le témoignage que vous êtes
Encore celles-ci, c’est ce jour de la fête,
Qui rassemble le tout, où les célestes ne sont plus
Présents pour nous dans le miracle, ni cachés à nos yeux dans l’orage,
Mais où parmi les chants, dans le chœur d’hospitalière présence
De chacun à chacun, en leur nombre sacré,
Les bienheureux de toutes les manières
Sont ensemble, tandis que ce qu’ils aiment
Plus que tout, ce à quoi ils sont attachés, ne manque pas; car c’est pour cela
Qu’au banquet qui est préparé, je t’ai
Appelé toi, l’inoubliable, toi, au soir du temps, toi, le jeune homme
Que je veux mener au prince de la paix; et notre engeance
Ne se couchera pas pour dormir avant
Que vous tous, les prédits,
Que vous les immortels, tous,
Pour nous dire de votre ciel,
Vous ne soyez ici dans votre maison.
Des souffles légers déjà
Annoncent votre venue.
Et la vallée qui fume se fait votre hérault
Et le sol, qui rugit encore de l’orage,
Mais l’espoir met le rouge aux joues,
Et devant l’huis de la maison
Sont assis la mère et l’enfant,
Et regardent la paix
O n dirait que peu d’hommes meurent,
Un sentiment retient l’âme,
Une promesse, portée par la lumière d’or,
Retient les plus âgés.
49
On a d’en haut bien dispensé toute la saveur
De la vie et l’on a bien
Distribué les peines,
Car tout désormais plaît,
Mais principalement
Le simple, car le fruit désiré
De toujours, le fruit d’or
Tombé de l’archaïque
Tronc dans les secousses des tempêtes,
Est alors, bien suprême, par le destin sacré lui-même
Protégé d’armes tendres,
La figure même des célestes.
Comme la lionne, tu t’es plainte,
Mère, quand tes enfants,
Nature, tu les as perdus.
Car te les a volés, ô toi. la trop-aimante,
Ton ennemi, quand tu l’as comme
A l’égal de tes propres fils recueilli,
Et mis ensemble avec les satires les dieux.
Ainsi as-tu mainte chose construite
Et mainte chose ensevelie.
Car ce que, toute-puissante,
Avant l’heure tu as tiré
A la lumière te déteste.
Maintenant tu connais cela, maintenant tu laisses cela être;
Car il veut bien reposer insensible
Dans les tréfonds, attendant d’être mûr, l’être de craintive besogne.
Traduit par Jean-Pierre Lefebvre
L’UNIQUE
(première version)
Qu’est-ce, aux
Vieux rivages heureux,
Qui m’enchaîne, que plus encore
Je les aime, que ma patrie?
Car d u ciel
Captif moi-même, comme vendu,
Là je suis, où passait Apollon,
Souverain,
Et, à une jeunesse pure, se
Laissait Zeus fléchir, et fils, d’un mouvement divin,
Et filles, il procréait,
Lui, le Très-Haut, parmi les humains.
Et hautes pensées
Sont en nombre
Jaillies du front du Père,
Et grandes âmes
De lui à hommes parvenues.
Bruit j’ai eu
D’Elis et Olympie, ai
Stationné, là-haut, sur le Parnasse,
Et par-dessus montagnes de l’Isthme,
Et, par-delà encore,
Près de,Smyrne, et, plus bas,
Près d’Ephèse j’ai pu aller;
Tant j’ai vu de la beauté,
Et chanté de Dieu l’image,
Vivante parmi
Les hommes, mais
Cependant, vous, dieux de jadis, et tous,
O vous, les fiers enfants des dieux,
I1 en est un, encore, que je cherche, que
J’aime d’entre vous,
Où ce dernier de votre race,
Et de la demeure ce joyau, à moi
L’étranger, votre hôte, me le dissimulez.
Mon Maître, mon Seigneur!
Toi, ô mon conseil!
Pourquoi es-tu au loin
Demeuré? Et, comme
Je cherchais, d’entre les anciens, une réponse,
Des héros et
Des dieux, pourquoi te tenais-tu
En dehors? Et, à cette heure, est comble
D’une tristesse mon âme,
51
Comme si, jalousement, Célestes, vous-mêmes veilliez
A ce que, vaquant à l’un, sitôt
L’autre me manque.
Je le sais, cependant, mienne
Est la faute! Car à l’excès,
O Christ! Je tiens à toi,
Quand même le frère d’Héraklès,
Et, hautement je l’avo,ue, tu
Es ce frère aussi de 1’Evios qui
A son char attacha
Les tigres, et, plus bas,
Jusqu’à l’Indus
Prescrivant office de joie,
A la vigne planté, et
Le courroux contenu des peuples.
Me retient, cependant, comme une honte
A rapprocher de toi
Les hommes de ce monde. Et, à l’évidence, je sais
Qui, toi-même, t’a engendré, ton Père,
Le même qui
Car jamais il ne règne seul
A l’un, cependant, reste seul attaché
Mon amour. Excessif, oui,
Le chant sera, pur élan du cœur,
Allé cette fois.
Cette faute, je veux la réparer
Si à nouveau je chante.
Jamais je ne frappe, comme je le souhaite, au juste
La mesure. Mais un dieu sait
Quand viendra ce que je souhaite, à la perfection.
Car, de même que le Maître
S’en fut par la terre,
Aigle captif,
Et beaucoup, qui
L’avisèrent, eurent une crainte,
Cependant qu’à la limite œuvrait
Le Père, et à la perfection entre
Les humains donna une forme en vérité, et
Le Fils connut grande tristesse lui aussi, jusqu’à ce
Qu’au ciel il s’en fût allé par les airs,
A lui pareille est l’âme des héros captive.
Les poètes, aussi, doivent,
Eux de l’esprit, être du monde.
52
(deuxième version)
Qu’est-ce, aux
Vieux rivages heureux,
Qui m’enchaîne, que plus encore
Je les aime, que ma patrie?
Car du ciel
Captif moi-même, comme ployant, dans l’air en flamme,
Là je suis, où passait, ainsi que des pierres le disent, Apollon,
Souverain,
Et, à une jeunesse pure, se
Laissait Zeus fléchir, et fils, d’un mouvement divin,
Et filles, il procréait,
Lui, le Très-Haut, parmi les humains.
Et hautes pensées
Sont en nombre
Jaillies d u front du Père,
Et grandes âmes
De lui à hommes parvenues.
Bruit j’ai eu
D’Elis et Olympie, ai
Stationné, là-haut, sur le Parnasse,
Et par-dessus montagnes de l’Isthme,
Et, par-delà encore,
Près de,Smyrne, et, plus bas,
Près d’Ephèse j’ai pu aller;
Tant j’ai vu de la beauté
Et chanté de Dieu l’image,
Vivante parmi
Les hommes, oui, car tout à l’espace pareil est
Le Céleste riche de
La jeunesse qui le chiffre, mais
Cependant, toi, des étoiles de vie, et tous,
O vous, les fiers enfants de la vie,
I1 en est un encore, que je cherche, que
J’aime d’entre vous,
Où ce dernier de votre race
Et de la demeure ce joyau, à moi
L’étranger, votre hôte, me le dissimulez.
Mon Maître, mon Seigneur!
Toi, ô mon conseil!
Pourquoi es-tu au loin
Demeuré? Et, comme
Je cherchais, d’entre les anciens, une réponse,
Des héros et
Des dieux, pourquoi te tenais-tu
En dehors? Et, à cette heure, est comble
53
D’une tristesse mon âme,
Comme si, jalousement, Célestes, vous-mêmes veilliez
A ce que, vaquant à l’un, sitôt
L’autre me manque.
JI: le sais, cependant, mienne la faute! Car à l’excès,
O Christ! je tiens à toi, quand même le frère d’HCraklès,
Et, hautement je l’avoue, tu es ce frère aussi de 1’Evios qui
Dans la ruée à la mort les peuples retient, et déchire le rets,
Les hommes, alors, voient bien, qu’eux-mêmes
N’aillent pas le chemin de la mort et gardent la mesure, que chacun
Est chose pour soi, du laps,
De la fatalité aussi des grandes époques, comme
De leur feu ayant une crainte, ils frapperont juste, et là
Où son chemin un autre va, eux ils voient
Aussi où peut une fatalité avoir carps, mais feront
De cela chose assurée, et telle que dans les hommes ou les Lois.
Mais alors, elle brûle, sa colère; oui, que
Le signe à la terre atteigne, graduellement
Hors les yeux, comme par une échelle.
Pour aujourd’hui. Opiniâtre sinon, démesuré,
Sans limites, que de l’homme la main
Alors étreigne le vivant, au-delà même de ce qui est institué
Pour un demi-dieu, le dessein outrepasse
L’arrêt du ciel. Car depuis qu’un esprit mauvais
A l’antique bonheur supplanté, interminablement
Pour lors vague une chose, au chant ennemie, vide de son, qui
Va par degrés excédant, effraction du sens. Ce qui se découvre sans attaches, cependant,
Dieu le hait. Mais, intercesseur
Le contiendra d’une telle époque le jour, et il œuvre dans le silence,
Lui qui va son chemin, la fleur des ans.
Et fracas de la guerre, et l’histoire des héros, un soutien,
fatalité au cou roidi,
Le soleil de Christ, jardins des pénitents, et
Du pèlerin les randonnées, et des peuples, le soutiennent, et du veilleur
Le chant et l’écriture
Du barde et de l’Africain. De ceux destitués de la gloire aussi,
La fatalité le rient, et qui au jour
N e viennent qu’en cette heure, ce sont princes paternels.
Car davantage s’accorde à Dieu
Telle station qu’autrefois. Car aux hommes davantage
Appartient de la lumière. Jeunes, non.
La patrie, de même. Car fraîche,
Non épuisée encore et pleine de boucles.
Le Père, oui, de cette terre a joie,
Aussi, de ce qu’il existe des enfants, ainsi demeure une certitude
De la bonté. Et il a joie, aussi,
A ce qu’il en demeure un.
Mais aussi quelques-uns, sauvés, comme
Sur de belles îles. Eux sont instruits.
54
Car tentations se sont
A eux offertes sans bornes.
Tombés, innombrables. Ainsi en était-il, quand
De la terre ici le Père apprête ce qui perdure
Dans les orages du temps. Mais cela n’est plus.
(troisième version)
Qu’est-ce, aux
Vieux rivages heureux,
Qui m’enchaîne, que plus encore
Je les aime, que ma patrie?
Car du ciel
Captif moi-même, comme ployé, au plus près du jour proférant,
Là je suis, où passait, ainsi que des pierres le disent, Apollon
Souverain,
Et, à une jeunesse pure, se
Laissait Zeus fléchir, et fils, d’un mouvement divin,
Et filles, il procréait,
Séjournant, muet, parmi les hommes.
Mais hautes pensées,
Pourtant, sont en nombre
Issues du front du Père,
Et grandes âmes
De lui à hommes parvenues.
Bruit j’ai eu
D’Élis et Olympie, toujours ai
Stationné, à côté de fontaines, sur le Parnasse,
Et par-dessus montagnes de l’Isthme,
Et, par-delà encore,
Près de,Smyrne, et, plus bas,
Près d’Ephèse j’ai pu aller.
Tant j’ai vu de la beauté
Et chanté de Dieu l’image,
Vivante parmi
Les hommes, oui. Car tout, à l’espace semblable, est
Le Céleste riche de
La jeunesse qui le chiffre, mais
Cependant, vous, dieux de jadis, et tous,
O vous, les fiers enfants des dieux,
Il en est un, encore, que je cherche, que
J’aime d’entre vous,
Où ce dernier de votre race,
Et de la demeure ce joyau, à moi
L’étranger, votre hôte, me l’avez préservé.
Mon Maître, mon Seigneur!
Toi, Ô mon conseil!
Pourquoi es-tu au loin
55
Demeuré? Et, comme,
Mêlés à eux, je pouvais voir, entre les esprits, entre les anciens,
Les héros et
Les dieux, pourquoi te tenais-tu
En dehors? Et, à cette heure, est comble
D’une tristesse mon âme,
Comme si, jalousement, Célestes, vous-mêmes veilliez
A ce que, vaquant à l’un, sitôt
L’autre me manque.
Je le sais, cependant, mienne
Est la faute, car à l’excès,
O Christ! Je tiens à toi,
Quand même le frère d’Héraklès,
Et, hautement je l’avo,ue, tu
Es ce frère aussi de 1’Evios qui, prévoyant, jadis
La revêche errance redressa,
De la terre le dieu, et donna en partage
Une âme à l’animal qui, vivant
Au hasard de sa faim, allait comme la terre épars,
Mais droits chemins comme imposant, et des lieux à la fois,
Pour chaque chose alors fit valoir un usage.
Me retient, cependant, comme une honte
A rapprocher de toi
Les hommes de ce monde. Et, à l’évidence, je sais
Qui toi-même t’a engendré, ton Père est
Le même. Oui, Christ, seul, est demeuré lui aussi
Debout sous le ciel visible, et les étoiles, visible,
Et qui a franchise sur le prescrit, Dieu l’avouant,
Et les péchés du monde, l’opacité
Du savoir, oui, comme, sur ce qui demeure, une agitation empiète,
Des hommes, et la vigueur des étoiles passait par-dessus
lui. Oui, toujours avec un cri de joie le monde
Se soustrait A cette terre, en sorte qu’il la
Déserte; où sur lui l’humain sera sans prise. Et il demeure une trace,
Pourtant, d’une parole; elle, un homme l’appréhende.
Mais le Lieu fut
Le désert. Aussi sont-ils l’un à l’autre semblables. Toute
joie, richesse. Splendide, verdoie
La feuille du trèfle. Et difforme, quant à l’esprit, tel dût-il
de leurs pareils
Ne point dire, d’un savoir rompu à méchante prière, que là
Sont pour moi les maîtres du champ, et les héros. Cela est
aux mortels nécessaire, pour ce que
Sans halte incompréhensible est Dieu. Mais comme sur des
chars
Assujettis
avec violence
Le jour ou bien
Avec des voix Dieu apparaît tel
Que la nature dehors. Médiat
Dans la sainte écriture. Célestes sont,
56
Et les hommes sur la terre, les uns auprès des autres toute
la durée
Du temps. Un grand homme, et une grande âme
pareillement
Quand même au ciel,
Penche vers un autre sur la terre. Toujours
Demeure que, enchaîné toujours, entier tout le jour est
Le monde. Plus d’une fois il ressort, cependant,
Que grand n’est point accordé
A grand. Tous les jours ils stationnent, cependant, comme
à un gouffre l’un
A côté de l’autre. Ces trois-là sont tels, cependant,
Qu’eux-mêmes sous le soleil
Comme chasseurs de la chasse, eux, ou
Laboureur qui, reprenant souffle, au labeur
Découvre sa tête, ou le mendiant. I1 est beau,
Oui, et bon, de rapprocher. Grand bien produit
La terre. A fraîchir. Toujours, cependant
Traduit par André du Bouchet
d’après le texte établi dans l’édition Beissner
PATMOS
A u Landgrave de Hombourg
Proche
et dur à saisir, le dieu.
Mais aux lieux du danger, la
délivrance croît aussi.
Dans l’obscur séjournent
les aigles et les fils des Alpes
s’en vont sans crainte par-dessus
l’abîme sur des ponts
légèrement bâtis.
Aussi, comme sont amassées alentour
Les cimes du temps et que les bien-aimés
ont séjour proche, languissant
sur les monts au plus loin séparés,
donne une eau innocente,
ô donne-nous des ailes, pour traverser
d’un cœur constant, et revenir.
Ainsi parlai-je, que me ravit,
plus vite que je ne l’eusse supposé
et si loin que jamais je n’eusse
pensé arriver, un génie
de mon propre foyer. Brillaient, crépusculaires,
dans la lumière double, comme j’allais,
la forêt ombragée
et les ruisseaux nostalgiques
de la patrie; inconnus me devinrent les pays;
mais bientôt me fleurit, éclatante de fraîcheur,
mystérieuse
dans la fumée d’or,
subitement dressée,
aux marches du soleil,
odorante de ses milles cimes,
l’Asie, et je cherchai, ébloui,
un être que je connusse, car je n’avais pas
coutume de ces larges allées, d’où
descend du Tmolus
le Pactole orné d’or
et se dresse le Taurus et le Messogis,
et pleins de fleurs, les jardins,
- un feu tranquille; mais dans la lumière
fleurit très haut la neige argentée,
et, signe de vie éternelle,
aux inaccessibles parois,
ancestral croît le lierre, et supportés
de colonnes vivantes, de cèdres et de lauriers
58
sont les majestueux palais
contruits par les dieux.
Bruissent cependant autour des portes de l’Asie,
étirées ci et là
sur la plaine incertaine de la mer
assez de routes sans ombre,
mais du marin les îles sont connues.
Et comme j’appris
que parmi les plus proches l’une
était Patmos,
un désir, très fort me saisit
de m’y rendre et d’y
approcher la grotte obscure.
Car non pas comme Chypre,
la riche en sources, ou
telles des autres,
splendide, ne séjourne Patmos,
hospitalière cependant,
dans la maison plus pauvre,
est-elle toutefois
et lorsqu’à la suite d’un naufrage ou pleurant
la patrie ou l’ami disparu
un étranger
s’approche d’elle, elle l’entend volontiers, et ses enfants,
la voix du fourré sacré,
et, là où tombe le sable et se ravine
la surface du champ, les voix,
elles l’entendent, et avec bienveillance elle
résonne des plaintes de cet homme. Ainsi portaitelle jadis réconfort à l’aimé d u dieu,
au Voyant, qui en bienheureuse jeunesse était
allé avec
le fils du Très-Haut, inséparable, car
le Porteur d’orages aimait l’innocence
du disciple et l’homme déférent
vit le visage du dieu avec précision,
comme au mystère du cep, ils étaient
assis ensemble, à l’heure de la Cène,
et dans son âme vaste, tranquille
prescience, le Seigneur proféra la mort
et l’amour ultime, car jamais
n’avait-il, de la bonté, dit assez
de paroles, en ce temps-là, ni fini de rasséréner, comme
il la voyait, la fureur du monde.
Car tout est bien. Sur quoi il mourut. De cela
maintes choses seraient à dire. Et le virent encore - comme triomphant il
regardait, lui, le plus joyeux - ses amis, une dernière fois,
Mais ils s’emplirent de deuil, le soir
étant venu, frappés de stupeur,
car l’âme de ces hommes s’était
59
affermie de résolutions profondes,
mais ils aimaient la vie
sous le soleil et ne voulaient pas
s’éloigner du visage d u Seigneur
ni de leur pays. Pénétrés,
tels le feu dans l’acier, étaient-ils de cela et l’ombre de l’Aimé
allait avec eux.
Aussi leur envoya-t-il
l’esprit et, certes, la
maison trembla et les orages de Dieu roulèrent,
grondant au loin, sur les
têtes pressentantes, comme, pleins de tristesse,
les héros de mort étaient rassemblés,
maintenant que se séparant d’eux
il apparut une dernière fois.
Car maintenant le jour du soleil s’éteignit,
le royal, et brisa,
qui rayonnait droit,
le sceptre, douleur divine, de lui-même,
car en temps prescrits cela
devait-il revenir. N’eussent pas été
favorables, plus tard, mais une rupture abrupte, infidèle,
les œuvres humaines et ce fut une joie
dès lors,
de vivre dans la nuit aimante et de maintenir
dans des yeux candides, sans en départir,
des abîmes de sagesse. Et, aux flancs profonds
des montagnes, des images vivantes verdissent aussi,
mais terrible est-ce comme Dieu
infiniment ici et là disperse le vivant.
Car déjà de quitter le visage
des amis bien-aimés,
et d’aller au loin par-dessus les montagnes,
seul, où deux fois
reconnu, unanime,
était l’esprit céleste; et cela n’était pas annoncé, mais
saisissait les boucles, présentement,
lorsque se hâtant
de loin le dieu soudain
retourné les regarda, et eux, le conjurant
de faire halte et de nommer, tel noué
à des cordes d’or désormais,
le mal. ils se tendirent les mains mais lorsque meurt alors
celui qu’au plus haut
revêtait la beauté, dont merveille
était la figure et que les Célestes
se désignaient et lorsque, lui-même
devenant pour eux une énigme sans fin, ils ne peuvent l’un
l’autre se saisir, eux, qui vivaient ensemble
dans la mémoire et que non seulement le sable
ou les prairies sont emportés et saisis
les temples, lorsque s’efface
la gloire du demi-dieu et des siens
et que le Très-Haut même détourne
son visage de cela, et que nulle part
ne soit plus visible un Immortel au ciel
ou sur la terre verdoyante, qu’est ceci?
C’est le jeu du semeur lorsqu’il saisit
le froment de sa pelle
et le jette sur l’aire vers le jour.
La balle lui tombe aux pieds, mais
à la fin mûrit le blé
et ce n’est pas un mal si
s’en perd une partie et de la parole
s’estompe le son vivant,
car l’œuvre céleste aussi ressemble à la nôtre,
et le Très-Haut ne veut pas tout à la fois.
Car la mine porte du fer
et l’Etna de la lave en feu,
ainsi aurais-je richesse
pour former une image et le voir,
tel qu’il fut, le Christ,
mais si un être s’éperonnait de lui-même,
et, discourant tristement, en chemin, me trouvant sans défense,
m’assaillît, que j’en fusse frappé de stupeur et qu’un serf
voulût imiter l’image du dieu manifeste dans la fureur vis-je une fois
le Seigneur du ciel, non que je dusse être quelque chose, mais
pour apprendre. Bienveillants sont-ils, mais leur plus grand objet de haine
tant qu’ils règnent, est l’imposture et
l’humain n’a plus cours alors parmi les hommes.
Car ceux-ci, non, ne gouvernent pas, mais gouverne
le destin des Immortels et d’elle-même
leur œuvre s’étend et se hâte vers sa fin.
Lorsqu’au plus haut se porte le chiant
du triomphe divin, est nommé, à l’égal du soleil,
par les vaillants, le fils exultant du Très-Haut,
une devise, et voici la baguette
du chant qui fait signe vers le bas,
car rien n’est commun. I1 réveille
les morts qui de l’inculte ne sont pas
encore prisonniers. Mais
nombre d’yeux timides attendent de
voir la lumière. Qui ne veulent
fleurir au tranchant du rayon,
bien que la bride d’or retienne le courage.
Lorsque toutefois, telle
de sourcils abondants,
oublieuse du monde
une force luisant en silence tombe de l’esprit sacré ils peuvent
61
réjouis de la grâce,
s’exercer au calme regard.
Et si, maintenant, les Célestes
m’aiment comme je le crois,
combien plus t’aiment-ils encore toi,
car je sais ceci,
que pour toi prévaut
du Père éternel le vouloir. Silencieux, son signe
au ciel tonnant. Et l’Un se dresse en dessous,
sa vie durant. Car encore vit Christ.
Et les héros, ses fils,
sont tous venus et de lui les Écritures
saintes et les exploits de la terre
élucident l’éclair jusqu’ici,
un concours sans halte. Lui cependant y assiste. Car ses œuvres
lui sont connues de toujours.
Depuis trop, trop longtemps déjà
la gloire des Célestes est-elle invisible.
Car c’est par les doigts, presque, qu’ils doivent
nous mener et honteusement
une puissance nous arrache le cœur.
Car chaque être céleste exige sacrifice,
et lorsque l’un d’eux est oublié,
jamais cela n’a mené à bien.
Nous avons servi la Terre Mère
et avons, voici peu, servi la lumière du soleil,
ignorants, mais le Père aime,
qui règne sur tout,
au plus haut, que soit servie
la lettre ferme et ce qui demeure
interprété sûrement. Ainsi va le chant allemand.
Traduit par John E . Jackson
Colomb
Mnémosyne
Le plus proche,
le meilleur
Apriorité de l'individuel
0
1
7
Holderlin
T r a d u c t i o n e t notes de
B. Badiozl e t J.-C. Rambacb
LÉGENDE DES CARACTÈRES
ET DES SIGNES TYPOGRAPHIQUES
première esquisse
deuxième esquisse
esquisse tardive
PREMIÈRE PHASE D'UN AUTRE TEXTE
seconde pbase d u n autre texte
(texte biffé ou surchargé)
-3
[
: illisible
: supprimé par les traducteurs (lettres isolées, hésitations, etc.) : se reporter au manuscrit original.
63
KOLOMB
fHORET DAS HORN DES WACHTERS BEI
NACH?I,I
NACH MJTTERNACHT ISTS UM DIE FÜNFTE STUNDE
So Mahomed +, Rinald,
Kolomb.
Barbarossa, ais freier Geist,
Wünscht’ich der Helden einer zu seyn
des Schafirs, Oder eines Hessen, < dessen eingeborner
Und dürfte frei, mit der Sti?ne
es bekenen
Sprach
Kaiser Heinrich.
So war’ es ein Seeheld. Thütigkeit zzr gewitïen neinlich
PP.
(1st) Uin nichts zu (verderben),
ist dus freundlichste, das
Wir bringen aber die Zeiten
Unter allen
untereinander
und Ordnung, durch Demetrius PoliorHeirzische, Wohnirng kurzgefuJ
aas bzïndig
cetes
f / z u lernen fJ und Gestalten
Peter der GroBe
(s)Heinrichs
lm den Sand, GefaJe (b)gebrant, dzïrre Schonheit
Nacht und
Alpenübergang und daB
Au5 Feuer, voll, von Bildern, reingeschliffenes
DIE LEUTE MIT EIGNER HAND GESPEISET
UND GETRANKET U . SEIN SOHN KON-
(Seerohr) Fernrohr (hohes Gesez) hohe Bi1 und es ist noth
dung, neinlich fzïr das
Den Himel zu fragen.
RAD AN G[I]FT
Leben
S(P)TARB
Muster eines Zeitveranderers
Reformators
Conradin U . s. w.
Wen du Sie aber nenest
Anson und Gama und Fli(st)bustier, und Aneas
Und (Doria)?, Jason, Chirons
Felsenhohlen und
Schüler, in Megaras (Gotten) (und)
zittenden
lin Reegen der Grotte bildete sich
alle, als Verhaltnisse
bezeichnend.
[ I
Als auf dein wohlgestimten Saitempiel ein Menschenbild
Airs Eindrzï&en des Walds, und die Tempelhewen, die (gefahr) gefahren
Flibustiers, Entdekunssreisen
Nach Jerusalein f ./ (Bou)Bouillon, Rinaldo,
Bougainville
ais Versuche, den (orbis) (d)hesperischen
Gewaltig ist die Zahl
Gewaltiger aber Sind sie selbst
orbis, im Gegensaze gegen den
o(b)rbis der Alten zu bestimen.
Und machen stum
die Maner.
64
COLOMB
+ÉCOUTEZ LE COR DU VEILLEUR LA
NUIfl,]
APRÈS MINUIT C’EST VERS LA CINQUIÈME HEURE
Ainsi Mahomet +, Renaud,
Colomb
Barberousse *,en esprit libre,
Si je souhaitais être un des héros
du pasteur ou d’un Hessois 3 (dont la langue
Et pouvais librement, avec la voix
le reconnaître
natale)
l’empereur Henri ‘.
Alors ce serait un héros des mers I . Gagner de l’efficacité en effet
(-1
(Cest) Pour ne rien (gâter),
c’est ce qu’il y a de plus amical, ce qui
Mais nous mettons les temps
Parmi tous
sens dessus dessous
et l’ordre, tout à fait Demetrius PoliorFamilier, logis bref
concluant
cetes
( /pour apprendre/,/ et les f i m e s
Pierre le Grand
Henri
Dans le sable vaisseaux (,)brûlés, aride beauté
traversant les Alpes et que
Nuit et
De feu, pleine, d’images, finement polie
DE SA PROPRE MAIN I L AIT DONNÉ AUX GENS À MANGER
ET À BOIRE ET S O N FILS K O N -
(Lunette marine) Longue-vue (haute loi) haute et c’est nécessité
formation, en effet pour la RAD
vie
D’interroger le ciel.
MOURUT
EMPOISONNÉ
Modèle de modificateur de temps
de réformateur
Conradin, etc.
Mais si tu le nommes
Anson et Gama et flibustier ’, et Énée
Et (Doria)? n, Jason, de Chiron
les antres rocheux et
L’élève dans les (grottes) de Mégare (et)
tremblante
Sous la pluie de la grotte se formait
tous, autant qu’ils caractérisent
des circonstances.
[ I
Cotntne sur le jeu de cordes (bien accordé) une image humaine
Tirée des impressions de la forêt, et les TeTnpliers l o qui ont fait (voyage) uoyage
flibustiers, uoyages de découvertes
A Jérusalem(. J (Bou)Bouillon, Renaud,
‘I
Bougainville
pour tenter de déterminer (orbis)
Formidable est le nombre
l’or&is hespérique, à (l’opposé) contre
Mais plus formidables sont-ils eux-mêmes
l’orbis des anciens “.
Et rendent muet
les hommes.
65
[Hl *
Detïoch
Und hin nach Genua will ich
Zu erfragen Kolombos Haus
WO er, als wen
Eines (Go)der Goiter eineJ ware
und wunderbdr
Der Menschen Geschlecht, vieleicht
sizend
Vortn Kornhaus, von Sicilien her
In süi3er Jugend gewohnet.
Licht
aber man kehret
Wesentlich um, wie ein
Bilderman, der (d)stehet
Und die Bilder weiset der
meinest du
(U)[u]nd singt, Lander Der Gropen
auch
Der W e l t Pracht,
[I
So du (mich aber fr)
Mich aber fraglelst
So weit das Her(z)z (mir)
Mir reichet, wird es geh(en.)n
Nach Brauch und Kunst
wie auf dem Markte
Kolombus in eine Landcharte siehet
66
Néanmoins
Et là-bas à Gênes je veux aller
Questionner la maison de Colomb
Où i l , comme si
Un(e) des diecix cine serait
et merveilleusement
La race des ho?ntnes, peut-être
(assis)
Devant la halle au blé, venu de Sicile
En sa douce jeunesse avait habité.
lumière
mais on s’en retourne
Essentiellement, comme un
Imagier qui est là
E t désigne les images des pays
Penses-tu
Des grandsfE)Et chante
aussi
Le faste d u monde,
[I
Mais comme
Tu m’interroges
Aussi loin que le cœur (me)
Me porte, cela ira.
Selon I‘usage et l’art
comme a u marché
Colomb examine une c[h]arte géographique
67
Zu Schifle aber steigen
ils crient rapport, et fermés maison,
tu es un sais rien
wührend da! sie schrien,
Mafia und
Ein Murren war es, ungedultig, den
Hi fielsbrod
Von Wengen geringe Dinge
Die
Verstimt wie vom Schnee war
Erde
Die Gloke, womit
zornig,
Man Iautet
und eilte
Zum Atiendessen
(da])(Sie)
Sauer wird mir dieses
wenig
Ge(l)duld und Gütigkeit
mein Richter und Scbuzgott
[ J mit Prophezeiungen und
/des Gebets
gropen Geschrei,/mit Gunst.
Und Sie [gllaubten, sie seien Monch[ 1.
Und einer, als Redner
De@Menscben Sind wir
Stürzet herein, ibr Bache
@)(con)
Aufrat
Vom Plaze Von Lieb und [ J
entiere persone content de son
Cottes Gnad
ame (co)dificultes conoissance
Wir komen, also rief und [ J Glük im seinem,
und als
[ J rapport tire
Pfarherr Gewaltig richtend Kràpe zu begreiffen,/o ihr Bilder
Der Jugend,
Im tilauen Die Gesellen die Stime des Meergotts, als in Genua, [J damals,
Die reine, daran(n) (D)de(r)s Erd(k)reich, griechisch, kindlich gestalte
Mit Gewalt unter meinen Augen
Wams
Heroen erkeiïen, ob Sie recht
Einschlajërnd, kurzgefaJtem [ J Mohngeist,
gleich mir
Gerathen Oder nicht Erscbien
CI
/(ihm)J
Das bist d u ganz in deiner Schonheit
Doch da hinaus, damit
68
Mais monter à bord d u navire
* ils crient rapport, il fermés maison,
* t u es u n sais rien
pendant qu’ils criaient
manne e t
pain céleste
C’était un grondement impatient, car
Par peu de cboses infimes
La
Désaccordée comme par la neige était
Pour moi cela tourne à l’aigre
peu de
patience et bonté
inon juge et dieu protecteur
([ f ) avec des prophéties et
/ d e grandes clameurs
de prières,/avec faveur
terre
La cloche avec laquelle
en colère
On sonne
et se hâtait
Le repas d u soir
(pour qu‘)(elle)
E t ils [clroyaient être des moines[
E t l’un, en orateur fit son entrée
I.
Car nous sonvnes des hommes
Pourtant là dehors, pour que
Précipitez-vous y , ruisseaux
(ce)
* entière personne content de son
* âme dificultés connaissance
et en
De cet endroit D‘amour et [ f
prêtre
Nous partions, ainsi appela
Dans son
pour conpendre les fOrces, Ô vous images
De la jeunesse
Les compagnons la voix d u dieu des mers lorsqu’à Gênes, f f autrefois,
La pure, à laquelle Le inonde terrestre, grec, conçu de façon enfantine ‘’
Avec violence sous mes y e m
Les héros reconnaissent s’ils sont tombés
Soporifique, esprit de pavot [ f condensé
aussitôt m‘
Juste O U non Apparut
[ I
/(lui)f
C’est t o i tout entière en ta beauté
grâce divine
pourpoint
bleu
et
/ f bonheur dans le sien
[ ] * rapport tire
Dirigeant violemment
69
Das bist d u ganz in deiner Schonheit apocalyptica.
iii i
a les
moments tirees hautes someils, der Scbiffer
Kolombzis aber beiseit
plriires
Hyostasirzmg des vorigen
[Staitvute der WissenscbaJ
Leidendaft z i ~ z
[ChriJten t i m ] *
Und seufzeten miteinander, um die Stunde,
orbis
[ I
Nach der Hizze des Tags
Sie sahn nun,
Es waren nemlich viele,
Der schonen (Stadte) Inseln,
damit
(M)Mit Lissabon
Und Genua theilten;
Den (nicht) einsam kan
Von Himlischen den Reichtum tragen
Nicht ein(e)s; wohl nemlich mag
Den Harnisch dehnen
ein Halbgott, dem Hochsten aber
fast zu wenig (das)
W O d(ie)as Tagslicht scheinet,
Das Wirken
Und der Mond (darum)
Darum auch
1st
70
* lui
*a
les
* pleures l4
C’est toi tout entière en ta beauté apocalyptica.
* moments tirées hautes sommeils, /e navigateur
hypostasie du précédent
[statut de la science]
passion pour
[chrétien té]
E t soupiraient ensemble, à Pheure,
orbis
Après la chaleur du jour
Colomb mais à l’écart
Ils voyaient alors,
II y en avait en effet beaucoup,
De belles (villes) îles,
pour qu’
(A) Avec Lisbonne
Et Gênes [ils] aient partagé;
Car solitaire (ne) peut
Porter la richesse des célestes
Pas un; en effet sans doute pourrait
Relâcher le harnais
un demi-dieu, mais pour le plus-haut
C’est presque trop peu (que)
où luit la lumière du jour,
D‘œuvrer
Et la lune, (c’est pour cela)
c’est pour cela
71
so
Ursprung der Loyoté
Eovopia, Kaoiyvqrui r&,pa Nemlich (damals) ofters, wen
De(s)n Himlischen (es) zu einsam ûpov noLiwv, aa@,crAqq6 i m
Kai oporponos Etpava, rupiai
(Zu einsam)
(W)Es wird, dan Sie
civ6pCxo1 nhourou, XpUoEQ'
rai& mpooLoo &p i roç
Allein zusamenhalten
Oder die Erde; den (es leidet) allzurein ist
Entweder
Dan aber
[
72
3 die Spuren der alten Zucht,
ainsi
Origine de la * Zoyoté
En effet (autrefois) plus souvent, quand Eovopia, Kaaiyvqrai SE, pa Les célestes de trop de solitude
ûpov noÂiov, ao@aÂqs &Ka
ai opospoiroq cipava, sapiai
(Trop de solitude)
üV6pUol d.OUSOU, ~pUOECi1
Se lassent, qu’ils
n E 1 6 ~Eypovaov
~
o ~ P ~ S 1 5O ~
Sont seuls solidaires
o u la terre; car (il souffre) bien trop p u r est
O u bien
Mais après
> les traces de l’ancienne éducation 1 6 ,
NOTE DES TRADUCTEURS
Si D.E. Sattler entreprend de publier une nouvelle fois l’œuvre de Holderlin, c’est pour en donner
enfin une restitution globale. En effet, selon lui, les éditions antérieures sont toutes gouvernées par des
préjugés idéologiques ou esthétiques qui sont à l’origine de maints gauchissements et mutilations du
texte.
La première anthologie de poèmes de Holderlin procurée par les poètes Kerner, Schwab et Uhland
en 1826 omet les hymnes révolutionnaires de Tübingen et la plupart des odes et des chants postérieurs
à 1802; dans les @:uvrer compléter éditées dès 1846 par les soins de Christoph Schwab, on ne trouve
que très peu d’œuvres tardives; les éditions suivantes sont certes enrichies, mais en 1895 Berthold
Litzmann trouve encore dans la (( folie B de Holderlin une justification à son parti pris anthologique.
Le travail de Norbert von Hellingrath (19 11) complété par Franz Zinkernagel qui reproduit aussi
les traductions de Pindare et, pour la première fois, les esquisses tardives, jette enfin les bases d’une
véritable édition critique, mais il est resté inachevé. En 1943, Friedrich Beissner reprend le projet et
Adolf Beck pourra mettre en 1974 un point final à la N Grosse Stuttgarter Ausgabe ».
Néanmoins, observe D.E. Sattler, cette édition, certes complète, n’est pas sans défauts, particulièrement pour ce qui concerne l’établissement des poèmes de la seconde moitié de la vie N de Holderlin.
Biographie et pathologie sont mises en avant pour expliquer une sorte de restauration du texte: on
distingue poèmes et variantes, texte principal et fragments dans un apparat critique d’une extrême
complexité, on découpe le manuscrit - en n’échappant pas toujours à l’arbitraire -, établissant ainsi
différentes versions d’un même texte. Cette approche a jusque-là conditionné les traductions françaises.
L’intention de D.E. Sattler dans sa Frankfurter Ausgabe commencée en 1975, et par là même
de cette traduction, est autre : il s’agit de reproduire les textes dans la disposition originale des manuscrits,
de les montrer dans tous leurs états, de faire voir simultanément les étapes de rédaction, les reprises,
les hésitations, les repentirs, les surcharges. Cette volonté de transcrire intégralement le manuscrit n’obéit
pas à un culte du brouillon, elle est ici simplement nécessaire dans la mesure où le texte achevé a
disparu ou n’a jamais existé. Du reste, D.E. Sattler met en exergue à ses exercices d’éditeur N un
fragment de Patmos )) qui pourrait définir l’essence même du fragment : n athletircher/lm Ruin (plus
athlétique en ruine). La redécouverte du travail du poète suscitera peut-être un nouveau commentaire!
((
((
))
((
((
I)
A la publication du manuscrit s’ajoute une analyse des phases de rédaction, étude trop technique
pour être reproduite ici, qui permet à l’éditeur d’établir le plus légitimement possible un texte de lecture
ou une reconstitution. Le décryptage de Sattler aboutit parfois à des leçons résolument différentes de
celles de la tradition.
Les notes, enfin, qui accompagent cette traduction française sont rédigées à partir du volume
d’introduction de la Frankfurter Ausgabe N (le tome consacré aux hymnes tardifs n’ayant pas encore
paru à ce jour), de l’ouvrage de D.E. Sattler Friedrich Holderlin, 144Jiegende Briefe, sorte de n Clavis
Hoeldedinina Y paru en 1981 et des éditions antérieures lorsqu’elles ne s’excluent pas les unes les autres.
((
73
Éric David et Jacques Halwisen ont accepté de relire ce travail; qu’ils soient remerciés pour leur
patience et leurs conseils amicaux.
B. B, et J.-C. R.
NOTES
Cette version de Colomb a été probablement esquissée à Nürtingen durant l’automne 1801, puis reprise
à Hombourg dans les années 1805-1806. Mais le projet est plus ancien; dès décembre 1789, Holderlin
annonce dans une lettre à son ami Neuffer (lettre 28, trad. D. Naville, Gallimard, 1948) : (( Au cours
de quelques heures privilégiées, j’ai composé un hymne à Colomb qui sera bientôt terminé. N
Ce texte ne nous est pas parvenu; il s’inscrivait dans un plus vaste dessein, celui de chanter les héros
mythologiques, antiques et modernes, ceux qui proliféreront dans le sillage de Colomb, déjà évoqués par
le poète le 12 mars 1804 (lettre 244, ibid) : (( J’ai saisi dans l‘ensemble les différentes destinées des
héros, des chevaliers et des princes, la manière dont ils servent le destin ou se comportent à son égard
de façon plus ambiguë. ))
1. Cf. le roman de Wilhelm Heinse, Ardinghello et 12s Iles bienheureuses (1787) dont on connaît
l‘influence sur l’auteur d’Hypérion : ((Je fis, dès la pointe du jour, une promenade sur la colline et
contemplais le site de Gênes. Un ravissant théâtre qui avait de tout temps incité ses habitanrs à dominer
l’espace marin et dont sont issus depuis toujours les plus grands héros des mers. Saint Colomb et toi,
André Doria, qui maintenant déambulez dans les Champs-Elysées, deux par deux avec les Thémistocles
et les Scipions, vous, demi-dieux parmi les hommes, de ma poussière, je vous implore. Hélas, que ne
m’est-il réservé à moi aussi, un tel sort! ))
2. Cf. Stuttgart, v. 49-51.
3. D.E. Sattler intègre au texte la parenthèse ouverte : <( avec la voix d’un pasteur ou d’un Hessois
(dont c’est la langue natale) ».
D’après lui, le pasteur serait Herder qui réapparaît comme orateur et prêtre (v. 18-27 de la page III
du manuscrit); le Hessois pourrait désigner Siegfried Schmid, un ami de Holderlin qui, pour échapper
à une charge de précepteur, s’était enrôlé dans l’armée autrichienne en 1799-1800. Mais il est encore
plus probable, poursuit Sattler, que Holderlin ait songé ici à un autre ami, Friedrich Emerich, qui
s’était engagé dans les troupes françaises du génie en 1795, avait pris part l‘année suivante à l’occupation
de Mayence, et en 1801, après s’être démis de ses fonctions, avait radicalement changé de position en
écrivant des articles qui s’insurgeaient contre le gouvernement post-révolutionnaire. I1 mourut à Wurzbourg en 1802 des suites physiques et psychiques de persécutiotis dont il fut l’objet.
4. Cf. la version tardive de (( Patmos »,v. 158-161.
5. On retrouve les navigateurs dans (< Der Wanderer )) et dans les deux dernières strophes de
U Andenken ».
6. Eobald Toze avait fait paraître en 1749 une traduction des récits de voyages de l’amiral anglais
Lord George Anson, édités à Londres en 1748. (Richard Walter, George Ansons Voyage Round the World
in the Years 1 7 4 0 - 1 7 4 4 , Londres, 1748.) Goethe mentionne Anson dans Poésie e t Vérité (1“ partie,
livre 1).
7 . Une Histoire des flibustiers due à J.W. Archenholz avait paru à Tübingen en 1803.
8. Cf. la note 1. Doria apparaît en outre dans la pièce de Schiller, fa Conjuration de Fiesque, dont
parle Holderlin dans une lettre de septembre 1799 (lettre 194).
9. Holderlin a traduit par deux fois l’épisode de l’éducation de Jason, qu’il place à Mégare, au lieu
de Magnésie. Cf. Pindare, Pythiques, IV, v. 180-192 et Fragments (« Untreue der Weisheit »).
10. Cf. U Patmos)), v. 159-160.
11. Sattler cite à propos I‘Adrustea de Herder (dixième partie) : (< Et si dans une ” colombanade ”
par ex. celui qui était au début le découvreur si heureux d’un nouveau monde devenait le héros d’une
épopée; quel grand sujet! Un nouveau monde moral = physique est sous les yeux du poète et il nous
le présente en opposition à l’ancien hémisphère. De longs siècles, l’esprit protecteur de cette plus jeune
partie du monde la cachait au regard de sa sœur plus âgée, mais le destin commandait; le temps de
la découverte approche; précipité par la cupidité des peuples, irrésistible. C’est en vain que l’esprit
protecteur de ces nations enfantines au-delà des mers met tout en œuvre pour retarder leur découverte,
jusqu’à ce que la civilisation et la politique européennes qui selon les voies de la destinée doivent les
cultiver, soient elles-mêmes plus pures et plus humaines; la fièvre des découvertes attisée par les croisades,
les sciences, les vices et l’indigence propage son feu; elle atteint Colomb. ))
12. En marge du fragment 41, on peut lire : c Orbis erclesiae. Y
74
13. Cette expression fait référence à la conception ptoléméenne de l’univers. Colomb se rappelle dans
son discours convulsif, écrit Sattler, la scène de l’imagier qui lui enseigna dans son enfance la fausse
cosmologie.
14. Sattler renvoie à l’essai de Herder Etnrnanuel Swedenborg, le plus grand visionnaire d u X V I I I siècle,
~
paru dans I’Adrastea (sixième partie) : (( C’est ainsi que des impressions de l’enfance s’animaient lorsqu’il
tombait dans son étrange état ... Dès notre jeunesse, nous pensons en images; des mots font naître des
formes sous nos yeux ... Et c’est un bonheur si d’emblée et pour toujours de vraies formes ont fait
impression sur nous et non pas de fausses images mentales... Comment Swedenborg parlait-il donc à
ses anges? Comme on parle à ses pensées; les anges et les esprits étaient les produits de son imagination ...
en tant que visions ils étaient devant lui ou en lui; cet état était d’ordre maladif ... Et un homme
raisonnable, qui, avant tous les autres a mis en œuvre son potentiel de rêve, doit aussi savoir, à l’état
de veille, cesser de rêver. n
15. Pindare, Olytnpiques, XIII, v. 6-1 1. (( Eunomie, l’ordre, et ses sœurs, le ferme / Fondement des
cités, et l’inébranlable justice, Dikè, / Et conforme à elle, Eirènè, la paix, qui gouvernent / la richesse
pour les hommes, filles / Dorées de Thémis, la bonne conseillère. N
16, On retrouve ici le commentaire que fait Holderlin du fragment de Pindare intitulé <( les Asyles N :
a Comment l’homme se pose, fils de Thémis, quand, du sens pour le parfait, son esprit, sur terre et au
ciel, n’a trouvé aucun repos, jusqu’à ce que, se rencontrant dans le partage, aux traces de l’ancienne
éducation, le dieu-et-l’homme se reconnaît à nouveau, et en souvenir d’une plus originelle détresse, est
heureux là où il peut se maintenir. B (traduction de F. Fédier, L a Pliiade, Gallimard, 1967).
* En français dans le texte.
COLOMB
*
Si je souhaitais être un des héros
Et pouvais librement, avec la voix d’un pasteur, ou d’un Hessois
Dont la langue natale, le reconnaître
Alors ce serait un héros des mers. Activité, pour gagner en effet
C’est ce qu’il y- a de plus amical, ce qui
Parmi tous
Le logis familier et l’ordre, tout à fait concluants,
Pour apprendre l’aride beauté et les formes
Brûlées dans le sable
De nuit et de feu, pleine d’images, finement polie
La longue vue, haute formation, en effet à la vie
Pour interroger le ciel.
Mais si tu les nommes
Anson et Gama, Enée
Et Jason, l’élève
De Chiron dans les grottes de Mégare, et
Sous la pluie tremblante de la grotte se formait une image humaine
Tirée des impressions de la forêt, et les Templiers qui ont fait voyage
A Jérusalem, Bouillon, Renaud,
Bougainville
Voyages de découvertes
pour tenter de déterminer
l’orbis hespérique contre 1’
orbis des anciens
Formidable est le nombre
Mais plus formidables sont-ils eux-mêmes
Et rendent muet
les hommes
Néanmoins
Et là-bas à Gênes je veux aller
Questionner la maison de Colomb
Où il, comme si
Une des dieux une serait et merveilleusement
La race des hommes,
En sa douce jeunesse avait habité. Lumière
Mais on s’en retourne
Essentiellement, comme un
Imagier qui est là
Devant la halle au blé, venu de Sicile peut-être
Et désigne les images des pays
Des grands aussi
Et chante le faste du monde,
*
76
((
Colomb », (( texte de lecture proposé par Sattler.
))
mais comme
Tu m’interroges
Aussi loin que le cœur
Me porte, ça ira
Selon l’usage et l’art.
Mais monter à bord des navires
ils crient rapport, il fermes maison
tu es un saisrien
C’était un grondement impatient, car
Par peu de choses infimes
Désaccordée comme par la neige était
La terre en colère et se hâtait, pendant qu’ils criaient
Manne et pain céleste
Avec des prophéties et
Grandes clameurs, de la prière avec faveur,
Au repas du soir.
Pour moi cela tourne à l’aigre [un] peu de
Patience et de bonté mon juge et dieu protecteur
Car nous sommes des hommes
Et ils croyaient être des moines.
Et l’un, en orateur
Fit son entrée et en prêtre
Dans son pourpoint bleu
entiere personne content de son
ame dificultes connaissance
rapport tire
Pourtant là dehors, pour que
De cet endroit
Nous partions, elle appela
Dirigeant violemment
Les compagnons, la voix du dieu des mers,
La pure, à laquelle
Les héros reconnaissent, s’ils sont
Tombés juste ou non Précipitez-vous-y, ruisseaux
D’amour et grâce divine et bonheur dans le sien,
Pour comprendre les forces, ô vous images
De la jeunesse, lorsqu’à Gênes, autrefois
Le globe terrestre, grec, conçu de façon infantine,
Avec violence sous mes yeux,
Soporifique, esprit de pavot condensé aussitôt m ’
Apparut
C’est toi toute entière en ta beauté apocalyptica.
moments tirees hautes sommeils le navigateur
77
Colomb mais à l’écart hypostasie de l’orbis précédent
Natueté de la science
Et soupiraient ensemble, à l’heure,
Après la chaleur du jour.
lui a les pleures
Ils voyaient alors
11 y en avait en effet beaucoup,
De belles îles.
pour qu’
Avec Lisbonne
Et Gênes aient partagé;
Car solitaire ne peut
Porter la richesse des célestes
Pas un; en effet sans doute pourrait
Relâcher le harnais
un demi-dieu, mais pour le plus-haut
C’est presque trop peu
où luit la lumière du jour,
Que d’œuvrer
Et la lune,
C’est pour cela aussi
ainsi
En effet plus souvent, quand
Les célestes de trop de solitude
Se lassent, qu’ils
Sont seuls solidaires
ou la terre; car bien trop pur est
Ou bien
Mais après
les traces de l’ancienne éducation,
Traduit par B. Badiou et J.-C. Rambacb
GRÈCE
Ô vous, voix du destin, vous, chemins du voyageur
Car au bleu école [des yeux],
De loin, au tumulte du ciel
Résonne comme le chant du merle
Des nuages la [sûre] sereine disposition bien
Disposée par l’existence de Dieu, l’orage.
Et des appels, comme regarder au-dehors, vers
L’immortalité et les héros;
Beaucoup sont de réminiscences. Où là-dessus
Résonnant, comme le cuir du veau
La terre, depuis des dévastations, tentations de saints
Car initialement forme l’œuvre soi
De grands statuts suit, la science
Et la tendresse, et tout le ciel, limpide voile, ensuite
Apparaissant chantent des nuages hymniques.
Car ferme est le nombril
De la terre. Recueillies en effet en bords d’herbe sont
Les flammes et les universels
Éléments. Pure méditation pourtant, en haut vit l’Éther. Mais d’argent
Les jours clairs
Est la lumière. Comme signe de l’amour
Violette la terre.
[Mais ainsi que le cortège s’en va
Aux épousailles,]
Vers un Moindre aussi peut parvenir
Un grand commencement.
Tous les jours pourtant merveilleusement pour l’amour des hommes
Dieu porte un vêtement.
Et aux reconnaissances se retire sa face
Et couvre les airs avec art.
Et air et bruit couvrent
L’effroyable, pour que trop, pas un
Ne l’aime avec des prières ou bien
L’âme. Car longtemps déjà se tient ouverte
Comme des feuilles, à apprendre, ou bien des lignes et angles
Parfois pourtant
Quand sortir veut l’ancienne formation
De la terre, par histoires en effet
Devenues, courageusement combattantes, comme sur des hauteurs conduit
Dieu la terre. Les pas immesurés
I1 les limite pourtant, pourtant comme des fleurs d’or se mettent
Les forces de l’âme alors les affinités de l’âme ensemble
Pour que plus volontiers sur terre
La beauté habite et quelque esprit
Plus communément s’associe aux hommes.
I1 est doux alors, sous de hautes ombres d’arbres
Et collines d’habiter, ensoleillées, où le chemin est
79
Pavé vers l’église. Aux voyageurs pourtant, à qui,
Par amour de la vie, mesurant toutefois,
Les pieds obéissent, fleurissent
Plus beaux les chemins, où le pays
Tradait par F. Fédier
Troisième version, suivant l’édition Beissner (GStA, II, p. 257 sq.). Les deux vers se trouvant entre
crochets sont empruntés à la seconde version; les mots <( yeux )) et a sûre », également entre crochets,
sont attestés dans les manuscrits.
EN BLEU A D O R A B L E
En bleu adorable fleurit
Le toit de métal du clocher. Alentour
Plane un cri d’hirondelles, autour
S’étend le bleu le plus touchant. Le soleil
Au-dessus va très haut et colore la tôle,
Mais silencieuse, là-haut, dans le vent,
Chante la girouette. Que quelqu’
Un au-dessous de la cloche descende les degrés, alors
Le silence sera une vie; car,
Lorsqu’une figure à ce point se détache, la
Forme aussitôt ressort, de l’homme.
Les fenêtres, d’où les cloches tintent, sont
Comme des portes, par vertu de leur beauté. Oui,
Les portes encore étant de la nature, elles
Sont à l’image des arbres de la forêt. Mais la pureté
Est, elle, beauté aussi.
Du départ, au-dedans, naît un Esprit sévère,
Si simples sont les images, si saintes,
Que parfois on a peur, à la vérité,
Elles, ici, de les décrire. Mais les Célestes,
Eux-mêmes bienfaisants, du tout, comme riches,
Ont une telle retenue, et la joie. L’homme
En cela peut les imiter.
Un homme, quand la vie n’est que fatigue, un homme
Peut-il regarder en haut, et dire : tel
Aussi voudrais-je être? Oui. Tant que dans son cœur
Dure la bienveillance, toujours pure,
L’homme peut avec le Divin se mesurer
Non sans bonheur. Dieu est-il inconnu?
Est-il, comme le ciel, évident? Je le croirais
Plutôt. Telle est la mesure de l’homme.
Riche en mérites, mais poétiquement toujours,
Sur terre habite l’homme. Mais l’ombre
De la nuit avec les étoiles n’est pas plus pure,
Si j’ose le dire, que
L’homme, qu’il faut appeler une image de Dieu.
B
Est-il sur terre une mesure? I1 n’en est
Aucune. Jamais monde
Du Créateur n’a suspendu le cours du tonnerre.
Elle-même, une fleur est belle, parce qu’elle
Fleurit sous le soleil. Souvent l’œil
Trouve en cette vie des créatures
Qui seraient bien plus belles, encore, à nommer,
Que les fleurs. Oh! comme je le sais! Car
A saigner de son corps, et au cœur même, de n’être plus
Entier, Dieu a-t-il plaisir?
Mais l’âme doit
Demeurer, je le crois, pure, sinon, de la Toute-Puissance avec ses ailes approchera
81
L’aigle, avec la louange de son chant
Et la voix de tant d’oiseaux. C’est
L’essence, c’est la forme de l’être.
Joli ruisseau, touchant, quand tu parais,
Et que tu roules, clair comme
L’ceil de la Divinité, par la Voie lactée.
Comme je te connais! Des larmes, cependant,
Sourdent de l’mil. Une vie allègre, je la vois dans les formes mêmes
De la création alentour de moi fleurir, car
Sans erreur je la compare à des colombes seules
Parmi les tombes. Le rire,
O n le dirait, m’afflige cependant, des hommes,
Car j’ai un cœur.
Voudrais-je être une comète? Je le crois. Parce qu’elles ont
La rapidité de l’oiseau; elles fleurissent de feu,
Et sont dans leur pureté pareilles à l’enfant. Souhaiter un bien plus grand,
La nature de l’homme ne peut en présumer.
L’allégresse d’une telle retenue mérite elle aussi d’être louée
Par l’Esprit, sévère, qui d’entre
Les trois colonnes souffle, du jardin.
Une fille aimable doit couronner son front
De fleurs de myrte, parce qu’elle est simple
Par essence, et, de sentiments.
Mais les myrtes sont en Grèce.
Que quelqu’un voie dans le miroir, un homme,
Voie son image alors, comme peinte, elle ressemble
A un tel homme. L’image de l’homme a des yeux, mais
La lune, elle, de la lumière. Le roi CEdipe a un
CEil en trop, peut-être. Ces douleurs, et
D’un homme tel, ont l’air indescriptibles,
Inexprimables, indicibles. Lorsque la pièce
A pu produire une chose pareille, du coup la voilà. Mais
De moi, maintenant qu’advient-il, que je songe à toi?
Comme des ruisseaux m’emportent la fin de quelque chose, là,
Et qui se déploie comme l’Asie. Cette douleur,
Naturellement, CEdipe la connaît. Pour cela, oui, naturellement.
Hercule a-t-il aussi souffert, lui?
Certes. Les Dioscures dans leur amitié n’ont-ils pas,
Eux, supporté aussi une douleur? Oui,
Lutter, comme Hercule, avec Dieu, c’est là une douleur. Mais
Être de ce qui ne meurt pas, et que la vie jalouse,
Est aussi une douleur.
Douleur aussi, cependant, lorsque l’été
v n homme est couvert de rousseursEtre de la tête aux pieds couvert de maintes taches! Tel
Est le travail du beau soleil; car
I1 appelle toute chose à sa fin. Jeunes, il éclaire la route aux vivants,
Du charme de ses rayons, comme avec des roses.
Telles douleurs, elles paraissent, qu’CEdipe a supportées,
D’un homme, le pauvre, qui se plaint de quelque chose.
Fils de Laïus, pauvre étranger en Grèce!
Vivre est une mort, et la mort elle aussi une vie.
Traduit par André du Bouchet
EN BLEU A D O R A B L E
En bleu adorable fleurit, avec
Son toit de métal, le clocher. Alentour
Planent les cris d’hirondelles, et
L’environne le bleu le plus émouvant. Le soleil
Passe bien au-dessus et colore la tôle,
Là-haut, pourtant, dans le vent
Grince doucement la girouette. Si quelqu’un
Alors descend sous la cloche, descend ces marches,
C’est un tableau paisible, car
Lorsque la silhouette à ce point se détache, la
Plasticité de l’homme ressort avec force.
Les fenêtres d’où s’échappe le son des cloches
Sont comme des portails, à être si belles. Car
Selon la nature tels qu’ils sont encore, ces portails offrent
La semblance d’arbres de la forêt. Or pureté
Est aussi beauté.
Au dedans, du divers, naît un esprit sérieux.
Si simples pourtant sont les images, si
Saintes, que réellement
L’on n’ose souvent les décrire. Mais ceux du ciel
Qui toujours sont bons, tout à la fois, comme les riches,
Ils ont cette vertu et cette joie. L’homme
A le droit d’imiter cela.
Lorsque la vie n’est plus que peine, un homme a-t-il le droit
De lever les yeux et de dire : ainsi
Je veux également être? Oui. Aussi longtemps que la gentillesse,
La pure, subsiste au cœur, il ne se mesure pas
Pour son malheur, l’homme,
A la divinité. Est-il inconnu, Dieu?
Est-il manifeste comme le ciel? C’est cela
Plutôt que je crois. C’est la mesure des hommes.
Riche de mérites, certes, mais poétiquement habite
L’homme sur cette terre. Mais plus pure
N’est pas l’ombre de la nuit avec ses étoiles,
Si je puis ainsi dire, que
L’homme, qui a nom image du divin.
Y a-t-il sur terre une mesure? I1 n’en est
Aucune. Certes, ils n’entravent jamais le cours du tonnerre, les mondes
Du créateur. Une fleur aussi est belle, car
Elle fleurit sous le soleil. I1 trouve,
L‘œil, souvent dans la vie, des êtres qui
Seraient à nommer encore plus beaux
Que les fleurs. O! je le sais bien! Car
Saigner en sa forme et son cœur et
Ne plus du tout être, cela plaît-il à Dieu?
Mais l’âme, à ce que je crois, doit
Rester pure, sinon il atteint au Puissant
83
De son aile, l’aigle, avec un chant de louange
Et la voix de tant d’oiseaux. C’est
L’entité, c’est la forme.
O joli ruisselet, tu as l’air émouvant
Lorsque tu roules, aussi clair que
L’œil de la divinité, à travers la Voie lactée.
Je te connais bien, mais des larmes jaillissent
De l’œil. Une vie allègre je vois
Fleurir autour de moi dans les formes de la création, car
Je ne la compare pas à tort aux colombes solitaires
Dans le cimetière. Mais le rire
Des hommes, il semble m’affliger,
Car c’est que j’ai un cœur.
Aimerais-je être une comète? Je crois. Car elles ont
La rapidité des oiseaux; elles fleurissent en feu
Et sont comme des enfants en pureté. Souhaiter un plus grand,
La nature de l’homme ne peut s’y risquer.
L‘allégresse de la vertu mérite aussi d’être louée
Par l’esprit sérieux qui, entre
Les trois colonnes du jardin, souffle.
Une belle adolescente doit couronner sa tête
Avec des fleurs de myrtes, car elle est simple
De par son être et par son sentiment.
Mais des myrtes, il y en a en Grèce.
Si quelqu’un regarde dans un miroir, un homme, et
Qu’il y voit son image, comme peinte; elle ressemble
A l’homme, elle a des yeux, l’image de l’homme, par contre
La lune a sa lumière. Le roi CEdipe a un
CEil de trop, peut-être. Ces souffrances de cet
Homme, elles semblent indescriptibles,
Indicibles, inexprimables. Quand le spectacle
Représente une telle chose, cela vient de là. Mais
Qu’éprouvé-je si maintenant je pense à toi?
Comme des torrents m’entraîne la fin de quelque chose, tout au loin,
Qui s’étend comme l’Asie. Naturellement
Cette souffrance, E d i p e la ressent. Naturellement, c’est pour cela.
A-t-il aussi souffert, Hercule?
Certes. Les Dioscures, en leur amitié, n’ont-ils pas eux aussi
Supporté des souffrances? En vérité,
Comme Hercule lutter avec Dieu, voilà la souffrance. Et
L’immortalité, jalousée par cette vie,
Y avoir part est aussi une souffrance.
Toutefois c’est aussi une souffrance quand
De rousseurs un homme est recouvert,
D’une foule de taches être tout recouvert! Voilà
Ce que fait le beau soleil : en effet,
I1 tire tout vers en haut. Les jeunes gens, il les guide sur la route
Avec le charme de ses rayons comme avec des roses.
Les souffrances paraissent telles, celles qu’endura (Edipe, que lorsque
Un pauvre homme se plaint qu’il manque de quelque chose.
Fils de Laïos, pauvre étranger en pays grec!
Vie est mort, et mort aussi est une vie.
Traduit par J . Hewier
MNEMOSYNE
( D I E SCHLANGE.)
aber
KS
haben
Zu singen
Das Zeichen.
Schon ist
wir aber
Der Brauttag bange sind (aber bunge)
Der Ehre wegen. (Den) furchtbar gehet
Es ungestalt, wen Eines uns
5
10
U N D AN DER
Zu gierig genomen. Zweijillos
(t)der kan tagiich
1st aber der Hochste; Tügiich Ran er
Viel Maner mochten da
(Viel) (Es)(ü)Andern.Kuurn bedutf er
wan nernlich es
Gesez , (dafl)
DEN BESTEN ZIEHEN DIE VOGEL
15
(Das)Seyn, wahrer Sache, lang ist
20
Bel Menschen bleiben sol[. Vtel Müner
mochten da
Die Zeit, es ereignet sich aber
Nicht vermogen
Seyn, wuhrer Sache, Lang 1st
Das Wahre.
Die Himlischen alles. Nemlich es reichen
Die Zeit,
25
30
ej
ereignet sich aber
Die Sterblichen Das Wahre.
eh’an den Abgrund.
W(en)o aber, h b e s ? Spnenschein
Mit diesen, Also wendet es sich
wir/
Am Boden seben,/ und trokenen Staub
mit
die
bliihet
Und tief(e) Schatten (der) Wülder, und es steiget
A m Feigenbaum
( D ) (Von)An Düchern der Raziche, (an)bei alter Krone
35
es girren
friedsam, (doch) und verloren girret
1st mir Achilles gestorben
Der Thürrne und die Lerche gitret
Girrt
40
die Lerche
unter
Verloren in der Li&, und (es waiden) unter dem Tag,
waiden
Wohlangeführt die Schaafe des Himels,
( A ) Und Schnee, wie Majenblumen
WO (es seie)/
Das
Edelmüthige,
/ (bedeutend), mit
45
glanzet au€
Es seie, bedeutend, (gla)
(Glanzt) auf der grünen Wiese (Alp)f f
halftig/
5 O Der Alpen/ du gieng
redend
Vorn Kreuze (sprechend), das
86
MNÉMOSYNE
(LE SERPENT)
mais il lezrr faut
Chanter
Le signe.
I l est beair
mais nons
Le jour des noces soinvies a n x i m x (mais anxietix)
A cazrse de cet honneirr. (Car) cela devient terriblement
Informe, quand l’Un nous a
5
1O
ET À LA
Trop avidemment pris. Maij sans doute
(-)
LE MEILLEUR LES OISEAUX LE TIRENT
il peut chaque j o w
Est le Très-Haut; Chaque jour il peut
Beaucoup d’hommes là voudraient
(Beaircoirp) (Le) (-) Changer. A peine a-t-ilbesoin
quand en effet elle
Loi, (que)
15
(L’)Être, chose vraie, il est long
Doit rester parmi les humains. Beaucoup d’hommes
voudraient là
Le temps, mais il advient
Le vrai.
20
Ils n’ont pas tout
Être, chose vraie, il est long
Pouvoir les Célestes. En effet ils atteignent
Le temps, mais il advient
Les mortels Le vrai.
plus tôt l’abîme.
25
Mais (qziand) O&, chère? La clarté du soleil
Avec ceux-là. Ainsi cela change
nous/
Voyons a u sol, ,
i
et la poussière sèche
avec
les
fleurit
E t les ombres profonde(s) (des) forêts, et elle monte
30
Près d u figuier
(-)(Des) A u x toits la fumée, (à) près de l’antique couronne
elles grisollent
paisiblement, (pourtant) et perdue grisolle
Achille m’est mort
35
Des tours et I’alouette grisolle
Grisolle
l’alouette
sous
Perdue dans l’air, et (ils paissent) sous le jour,
paissent
40
Bien guidés les moutons d u ciel
(-)
E t la neige, comme les muguets
où (qu’elle soit)/
la noblesse de cœur, / (signifiante), avec
brille sur
Si elle est signifiante ( h i )
(Brille) stir la verte prairie (alpe) [ ]
par moitié/
Des Alpes, / là il s’en allait
discourant
45
50
(Parlant) de la croix qui
87
55
ist
Gesezt wird unterweg(e)s einmal
der schroffen
/en auf tiefer StraB’ einmal
Gestorb/nen ein Wandersman mit
(Einmal) (e)Ein Wandersman mit
Dem andern aber was ist diB?
(Auf tiefer)
60
Am Feigenbaum ist mein
Achilles mir gestorben
.............................................................................
(fin de page dans le manuscrit de Hoideriin)
Die Nymphe
Mnemosyne.
65
70
75
80
85
90
95
88
(d) aber es haben
Ein Zeichen sind wir, deutungsios
Zu singen
Scbmenios sind wir und haben fast
Die Spracbe in der Fremde verloren.
Wenn nemlich ein Streit ist über Menschen
Blumen auch Wasser und fühlen
Defi Wen am SchiM ]
Am Hiniel, und gewaltige
Schon ist I
Ob noch ist der Gott.
Es hoch über Menschen
Gestime gehn, (blind), ist die Treue dan, wen aber sich
I Ein Streit ist an (dem)
Der Brauttag, bange Sind wir aber
Himel und
Zur (Erde) neiget der Beste, (eigen) wird (dan)
Der Ehre wegen. Defi furchtbar gehet
Die Monde redet
(WO)
(g)gehn gewaltig
Lebendiges, (den W O eines kehret zu I sich)
zürnet
so erkrank(t)et
Es ungestalt, wen Eines uns
(selber)
Das Meer (auch)
das Me
(Den Weg sich suchen. und es findet eine I Heimath)
und (die) Strome
Zu gierig genomen. Zweifellos
Der Girt. Einer
I Den P
müssen
1st aber (der Hochste.) Der kan taglich
haben
Ka# tüglich
Es andern. Kaum bedarf er
I
Gesez, wie nemlich es
und die Schrifi tont E(ch)s mochten aber
und
Bei Menschen bleiben soll. Viel Mafier mochten da
Und es tonet das Blart.
Vie1 Mdner
Den
Eichbüume wehn dan neben
Seyn wahrer Sache. Nicht vermogen
Den Firnen.
a été
Est plantée en chemin (-) jadis
55
l’abrupte
/ (-) sur la route profonde
Pour les mor/ts de jadis, un pérégrin avec
(Jadis) (-) Un pérégrin avec
L’autre mais qu’est-ce que ceci?
(Sur la profonde)
60
Près du figuier mon
Achille m’est mort
........................................................
....................................................................
(fin de page)
La nymphe
Mnémosyne.
(-) mais il leur faut
Un signe sommes-nous, sans signification
Chanter
65
Sans douleur so?nmes-nous e t nous avons presque
Perdu la parole en pays étranger.
Quand en effet il y a une dispute au-dessus des humains
Les fleurs l’eau aussi et sentir
Car Quand au dest[ ]
Au ciel, et de violents
I1 est beau I
S’il est encore le dieu.
Loin au-dessus des humains
Des astres passent, (aveugle) est alors lu fidélité, mais quand se
Le jour des noces, mais nous sommes anxieux I I1 y a une dispute (au)
Vers la (terre) penche le meilleur, (notre propre) devient (alors) ciel et
parle
Les lunes
A cause de cet honneur. Car terriblement cela
(où)
(-) vont
violemment
Le vivant, (car 02 l’on revient 2 / soi)
se courrouce
(-) si malade
Devient informe, quand l’Un nous
(soi-même)
La mer (aussi)
la me
(Pour chercher son chemin, et elle trouve un I pays natal)
et (les) fleuves
Trop avidemment pris. Sans doute
L’esprit. Mais un
I Le (-)
doivent
avoir
Est (le Très-Haut.) Il peut chaque jour
70
75
80
85
Peut chaque jour
Changer cela. C‘est à peine s’il a besoin
De la loi, comme en effet elle
I
et l’Écriture résonne Mais i(-)ls voudraient
et
Doit rester parmi les humains. Beaucoup d’hommes voudraient là
E t la feuille résonne.
Beuucoup d’hommes
Car
Puis des chênes frémissent à côté
Etre chose vraie. Ils n’ont pas tout pouvoir
Des névés.
90
95
89
100
105
110
115
120
125
130
Die Himlischen alles. Nemlich es reichen
Die Sterblichen eh’ an den Abgrund. Also wendet es sich, das Echo
Mit diesen. Lang is die Zeit
Die Zeit, es ereignet sich aber
Das Wahre.
Wohl ist uns die Gestalt
Der Erd
Wie aber liebes? Sofienschein
Am Boden sehen wir und trokenen Staub
heimatlich die /
Und tief mit / Schatten die Walder und es blühet
An Dachern der Rauch, bei alter Krone
es gefallen nemlich hat
Der Thürme, friedsam; und es girren
Jahres
Tageszeic hen
Die Lebenszeichen, hat ein Himlisches
Verloren in der Luft die Lerchen und unter dem Tage waiden
Entgegenredend getroffen
Tages
Die Sifie betaubt; die (Lebens)zeichen
Ein Himlisches
Wohlangeführt die Schaafe des Himels.
Die Seele,
Und Schnee, wie Majenblumen,
Das Edelmüthige, WO
(wohl) gut sind nemlich
es gefallen nemlich, (hat)
genommen
her/ (G) Hat
Fern/ (Ent)gegenredend die (ge)Seele (getroffen)
verwundet (b(g)etroffen)/
Ein Himlisches, / (helltonend) die Tageszeichen.
Den Schnee, wie Majenblumen
Das Edelmüthige, WO
Es seie bedeutend, glanzet au€ der grünen Wiese
............................................................................................................................
mit
Es seie, bedeutend, glanzet (auf)
Der grünen Wiese
(dort) da, uom Kreuze redend, das
135 Der Alpen Der Alpen, (halftig) d(a)ort (gieng) geht der Alpen, dort
hüitig
140
90
Vom Kreuze redend, das gesezt
Gesezt ist unterwegs einmal
geht
(heiler) auf hoher
Gestorbenen, auf der srhroffen StraB’
geht zornig, m i t
Ein Wandersmafi (mit)
Fernahnend m i t
Dem andern, aber was ist diB?
( f n de page)
Les Célestes. En effet ils atteignent
Les mortels, plus tôt l’abîme. Ainsi il change, l’écho
Avec ceux-là. II est long le temps
Le temps, mais il advient
Le vrai.
100
Pour nous elle est bien la forme
De la terre
Mais comment, chère? La clarté d u soleil
N o u s la voyons au sol et la poussière sèche
du pays natal les/
105
Et profondes avec/des ombres les forêts et elle fleurit
Aux toits la fumée, près d e l’antique couronne
cela en effet a plu
Des tours, paisiblement ; et elles grisollent
de l’an
signes du jour
Ces signes de vie, un Céleste a-t-il
110
Perdues dans l’air les alouettes et sous le jour paissent
Touché en contredisant
du jour
Engourdi les sens; ces signes (de vie)
Un Céleste
115
Bien guidés les moutons d u ciel
l’âme,
Et la neige, comme les muguets
La noblesse d e cœur, où
120
(bien) bons sont en effet
ils plaisent en effet, (a)
pris
ici/(-) A
Loin/(En) contredisant (-) l’âme (touché)
blessé (- touché)/
Un Céleste, / (clairsonnant) ces signes du jour.
Car la neige, comme les muguets
La noblesse de cœur, où
Qu’elle soit signifiante, brille sur la verte prairie
......................................................................................................................
avec
Qu’elle soit, significativement, brille (sur)
La verte prairie
(là-bas) là, parlant de la croix qui
Des AlpeJ Des Alpes, (par moitié) là(,)(-bas) (allait) va des Alpes,
détenteirr
Parlant d e la croix qui plantée
Est plantée en chemin
(plrds claire) sur la haute
va
Pow les morts de jadis, sur la route abrupte
va furieux, avec
U n pérégrin (avec)
Pressentant de loin avec
L’autre, mais qu’est-ce que ceci?
LÙ-baJ
125
130
...... cf;n de page)
135
140
91
145
150
155
160
165
Am Feigenbaum ist mein
Achilles mir gestorben,
Und Ajax liegt
An den Grotten, (nahe) der See,
An Bachen benachbart dem Skamandros.
An Srhlàfën Sausen (bist)ist
( A )Vein
bei Windessausen nach
(Vom) Genius kühn ist
unbewegten
Der heimatlichen Salamis (süBer) steter
Gewohnheit, in der Frem’d ist groB
Ajax gestorben.
Patroklos aber in des Koniges Harnisch,. (U) Und es starben
Am (Oly?npos aber lag)
Noch andere viel, Mit eigener Hand
Ein (weniges aber)
Elevthera
Am Kithüron aber lag
Vie1 traurige, wilden Muths, doch gottlich
Elevthera, der MneGezwungen zulezt, die anderen aber
inosyne Stadt. D(ie)er aurh
(dam)
Im Geschike stehend, im Feld. Unwillig nemlich
Den Mantel ablegt’
Die Seele schonend sich
Sind Himlische, wen einer nicht die Seele schonend sich
als
Zusamengenomen, aber er mui3 doch; dem Ablegte den Mantel
Gott,
170
175
92
Gleich fehlet die Trauer.
D(er)as (u)abendlirhe narhher
loste
Die Loken, Hitdische
neinlirh sind
Unwilllig, wen einer nirht
die Seele srhonend
sirh
ZusaînengenoiBen, aber er .zuJ
doch; dein
Gleirb fehkt die Trauer.
Près du figuier mon
Achille m’est mort
Et Ajax gît
Près des grottes, (proches) de la mer,
Près de ruisseaux voisins du Scamandre.
145
Aux temps (as) il y a un siflement
150
(-)Du
(Du) génie audacieux il est
avec les sifflements du vent vers
impassible
Salamine natale (à la douce) à l‘immuable
Coutume, en pays étranger, avec grandeur
Est mort Ajax.
Mais Patrocle dans la cuirasse du roi,.
155
(-)
Et il en mourut
(Mais) près de (l’Olympe s’étendait)
Encore d’autres, nombreux. De Sa propre main
(Mais) un (peu)
Mais près du Cithéron s’étendait
Éleuthère
160
Beaucoup d’affligés, d’une sauvage hardiesse, pourtant par les dieux
Eleuthère, de Mné-
Contraints en définitive, mais les autres
mosyne la vziie. (Qui) A laquelle aussi
Se tenant face à la destinée, sur le champ de bataille. En effet mécontents (-1 165
Le manteau enleva
Son âme ménageant
quand
Sont les Célestes, quand quelqu’un, son âme ménageant, ne s’est pas
Ressaisi, mais il faut qu’il en soit ainsi pourtant; à celui-ci Enleva le manteau
Pareil, le deuil commet une faute.
Dieu
( L a ) Le (-) crépusculaire, ensuite, 170
coupa
Les boucles. Les Célestes
sont en effet
Mécontents quand quelqu’un ne s’est
175
ménageant son
âme
Pas ressaisi, mais il f a u t qu’il en soit ainsi
pourtant; à celui-ci
Pareil, le deuil commet une faute.
NOTES
L’antique couronne des tours ». Cf. Antigone de Sophocle traduit par Holderlin : (( DTEcouronne des tours ».
V. 42. Et la neige, comme les muguets ... I1 est fait allusion au passage de l’hiver au printemps
où les prairies sont encore à moitié N enneigées. Cf. les Remarquer SUY Antigone ; ...tandis que l’esprit
s’éveille au comble de sa puissance là où prend feu la seconde moitié. )) (Trad. F. Fédier, Bibliothèque
10/18, 1965.)
A cette époque, la neige fond rapidement, elle est fugace comme le muguet qui se fane vite : ce qui
est pur et beau est fugace. La neige est aussi le symbole de toute existence héroïque où qu’elle soit
(« La noblesse de cœur / où qu’elle soit »; v. 43-44) car la fugacité, la mort précoce est un trait
caractéristique du destin héroïque. Plus loin il est question d’Achille (( à la vie brève )) comme l’appelle
Homère.
V. 5 1, Parlant de la croix ». Le pèlerin parle de la croix, c.-à-d. du monument érigé à la mémoire
de ceux qui sont morts en passant le col. La croix, tout comme la neige et le muguet est un symbole
de la fugacité. Ce pérégrin qui chemine sur la route abrupte parle du souvenir (« Mnémosyne »)
V. 34-37.
((
<pilvops nupyov )) v. 126 :
((
((
))
((
((
93
des héros. II désigne sans doute le poète lui-même. Cf. une variante de Courage du poète », v. 19 et
Ganymède », v. 8.
V. 60. (( Près du figuier ». II s’agit sans doute d’une réminiscence de Richard Chandler, Travels in
Asia Minor and Greece paru à Oxford en 1775-1776 et traduit en allemand dès 1776-1777 dont
Holderlin s’est servi pour Hypérion. On y lit dans une description du tertre funéraire d’Achille et de
Patrocle : K From thence the road was between vineyards, cottonfields, pomegranate und figtrees. n
Chez Homère, le figuier esc également souvent évoqué: (( E P I V E ~ < » iliade 6 , 433; 11, 167; 22, 145
comme point de repère pour les combattants de la guerre de Troie.
V. 61. Achille m’est mort ». Cf. la traduction des Bacchantes d’Euripide, v. 10-1 1 : c Ich lobe doch
den heiligen Kadmos, der im Feld hier / Gepflanzt der Tocher Feigenbaum... n, où Holderlin aurait
V (( figuier
pour (( oqitos : (( sanctuaire désignant la tombe de Sémélé ».
sciemment traduit c ~ K O »,
Cf. également (( Souvenir », v. 16 : (( Mais dans la cour pousse un figuier. )) Sattler commente : ((A
qui d’autre comparer le poète sinon à Achille? Comme à celui-ci, on lui prend sa bien-aimée. Comme
celui-ci, il ne trouve pas d’alter ego, il sait ce qui lui arrive et est assis la moitié du temps dans la
stupeur et la solitude, il finit par tomber “ frappé par Apollon ” ” près du figuier ”. n
V. 62. (( Mnémosyne : (( Mvqwoobvq N (la mémoire). Lune des Titanides, fille d’Ouranos et de Gaïa,
elle donne à Zeus neuf enfants : les Muses. Cf. Hésiode, Théogonie, v. 135, 53 sq., 915-917.
V. 64-66. Sans significations / sans douleur ». Sans douleur n est négatif, à prendre dans le
sens d’insensibiiis et renvoie à la perte de la sensibilité, de la capacité d’avoir un destin. Cet état de
fixité, de paralysie intérieure, correspond aussi l’assertion : l’humanité est devenue un signe sans
signification ». De cet état de dépérissement relève aussi la perte de la parole (v. 67), le mutisme de
celui qui est devenu sa propre proie une coupure complète d’un monde devenu étranger. Ce monde
apparaît dans le vers suivant totalement sorti de ses gonds.
V. 75. Le jour des noces ». Cf. Le Rhin », v. 180
V. 91. N Beaucoup d’hommes voudraient être là. II s’agit probablement de (( rester en vie N (cf. (( La
paix », v. 32 et (( L’unique », 2‘ version, v. 54-61) au milieu du trouble des périodes de mutation.
V. 92. (( Et la feuille résonne ». Cf. N Le Rhin », v. 105-1 14.
((
((
((
))
))
))
((
))
((
((
-
((
((
))
V. 99-100. (( ...mais il advient / Le vrai. N (( Advenir N (ereignen) est à prendre au sens étymologique
de erüugnen : se donner à voir N (de Auge : (( œil »). Le vrai désigne, ailleurs aussi, chez Holderlin, la
révélation, la manifestation divine, la divinité manifestée. Cf. (( Germanie », v. 94.
V. 141. (( Furieux ». C’est dans la fureur que se manifeste la présence divine lors des périodes de
mutation. Cf. (( Patmos », 1“ version, v. 171 sq. et (( Ganymède )), v. 11.
Le poète-pérégrin est rendu furieux parce qu’il est douloureusement troublé par l’indicible plénitude
du souvenir des existences héroïques.
V. 147. (( Ajax ». Rappelons que Holderlin a traduit trois extraits de l’Ajax de Sophocle. Cf. aussi
Hypérion, avant-dernière version où on lit : (( L‘Ajax de Sophocle était ouvert devant moi. C’est par
hasard que je l’ai parcouru et je suis tombé sur le passage où le héros prend congé des fleuves, des
grottes et des bois en bordure de la mer : “ Vous m’avez longtemps retenu ”, dit-il, ” mais à présent, à
présent, je ne respirerai jamais plus le souffle de vie parmi vous! Vous, les eaux voisines du Scamandre,
qui ont accueilli si amicalement les Argiens, vous ne me verrez jamais plus. Je suis étendu ici sans
gloire. ”
((
))
V. 149. Scamandre ». Le Scamandre est le principal fleuve de la plaine de Troie.
V. 150. Aux tempes il y a un sifflement ». Cf. Pians et fragments, 60 : (( ... Tous simplement / cette
fois, mais souvent / Arrive quelque chose autour de la tempe, cela n’est pas / A comprendre, mais
quand sur un chemin / Un homme libre sort, il trouve / Là même cela préparé. B (Trad. de la Revue
de Poésie, 1964.)
V. 154. Salamine natale ». Cf. Hypérion, II, 1‘‘ lettre : ((Je vis maintenant à Salamine, l’île d’Ajax. ))
V. 155. (( En pays étranger ». I1 s’agit de la colonie que l’esprit aime d’abord (cf. (( Pain et vin n,
v. 152-156) mais où il ne peut trop longtemps demeurer pour ne pas perdre sa singularité et devenir
un signe sans signification, une lettre morte, perdre sa sensibilité, sa capacité d’avoir un destin et de
vivre heureux
((
((
V. 157. (( Mais Patrocle dans la cuirasse du roi ». Épisode relaté au chant XVI de l’lliade.
V. 157-159. (( Et il en mourut / Encore d’autres, nombreux. D I1 n’est plus seulement question de
la mort des héros, mais aussi de la mort de Mnémosyne, dë la (( mémoire ».
V. 160. (( Éleuthère ». Ville nommée d’après Euleuther, fils d’Apollon et d’Aithusa, fille de Poséidon
(Apollodore, III, 10.1); située à la frontière de la Béotie avec l’Attique, sur 15 versant sud d u Cythéron.
Hésiode dit de Mnémosyne (Théogonie, 54) qu’elle règne sur la contrée d’Eleuthère. Pausanias cite à
plusieurs reprises les ruines d’Eleuthère dans sa Description de la Grèce.
V. 166. Le manteau enleva ». Cela signifie lorsque le séjour des dieux grecs a pris fin.
((
94
V. 168, (( ...mais il faut qu’il en soit ainsi pourtant. )) Insiste sur le caractère nécessaire de la mort
des héros dans des périodes de mutation.
V. 170. Le crépusculaire. n Dus Abendiirbe P désigne la fin des temps, l’eschatologie et la mort en
général. Cf. Sophocle, adipe roi, traduit par Holderlin, v. 184 sq.
Jochen Schmidt (op. rit.) y voit aussi la fin des temps.
V. 171-172. (( Coupa / Les boucles. )) Le messager porteur de mort envoyé par les dieux coupe,
d’après la croyance antique, une boucle au front de celui qui doit mourir. Cf. par ex. Virgile, Enéide,
IV, 702-704 traduit par Schiller a rrnd Iort die Locke 8 .
V. 177. ...mais il faut qu’il en soit ainsi pourtant ». Cf. note v. 168 et Matthieu, XVIII, 7 :
(( Malheur à celui par qui le scandale arrive!
V. 199. Le deuil ». Le deuil commet la même faute que celui qui cède à ce qui le pousse vers la
dissolution ( K dus Ungebundene Y , cf. L’apriorité de l‘individuel, 307-390, v. 2 3 ) , qui se laisse entraîner
dans la mort. Mais parce qu:il s’agit d’une erreur tragique, fatale et nécessaire, le châtiment sera levé
dès qu’il aura été proféré; le poète se désigne lui-même à la fin du poème (comme dans d’autres textes)
lorsqu’il est ému par la mémoire des héros, par la Mnèmosynè )) et menacé de ce fait par le deuil ))
destructeur, qui le met en danger mortel, qui l’empêche de N rester en vie ». Cf. la fin de la première
version de (( l’Unique )) et l’ode Larmes ».
((
))
((
))
((
((
((
((
MNÉMOSYNE
Un signe sommes-nous, sans signification
Sans douleur sommes-nous et nous avons presque
Perdu la parole en pays étranger
Quand en effet au-dessus des humains
I1 y a une dispute au ciel et que violemment
5
Passent les lunes, alors la mer
Parle et les fleuves doivent
Chercher leur chemin. Mais sans doute
I1 en est un qui
10 Chaque jour peut changer cela. A peine a-t-il besoin
De la loi. Et elle résonne la feuille puis des chênes frémissent à côté
Des névés. Car ils n’ont pas tout
Pouvoir, les Célestes. En effet, ils atteignent,
Les mortels, plus tôt l’abîme. Ainsi il change, l’écho
15 Avec ceux-là. I1 est long
Le temps, mais il advient
Le vrai.
Mais comment, chère? La clarté du soleil
Nous la voyons au sol et la poussière sèche
20 Et profondes avec leurs ombres, les forêts, et elle fleurit
Aux toits la fumée, près de l’antique couronne
Des tours, paisiblement; ils sont bons en effet,
En contredisant l’âme
Un Céleste l’a blessée, ces signes du jour.
25 Car la neige, comme les muguets
La noblesse de cœur, où
Qu’elle soit signifiante, brille sur la verte prairie
Des Alpes, par moitié
Là, parlant de la croix qui
30 Est plantée en chemin pour les morts
De jadis, sur la haute route
Un pérégrin s’en va furieux,
Pressentant de loin avec
L’autre, mais qu’est-ce que ceci?
35 Près du figuier mon
Achille m’est mort,
Et Ajax gît
Près des grottes de la mer,
Près de ruisseaux voisins du Scamandre.
40 Aux tempes il y a un sifflement vers
L’impassible Salamine à l’immuable
Coutume, en pays étranger, avec grandeur
Est mort Ajax.
Mais Patrocle dans la cuirasse du roi. Et il en mourut
45 Encore d’autres, nombreux. Mais près d u Cithéron s’étendait
Eleuthère, la ville du Mnémosyne. A laquelle aussi, quand
Dieu enleva le manteau, le crépusculaire coupa ensuite
96
50
Les boucles. Les Célestes sont en effet
Mécontents, quand quelqu’un ne s’est,
Ménageant son âme,
Pas ressaisi, mais il faut qu’il en soit ainsi pourtant; pareil
A celui-ci, le deuil commet une faute.
Traduit par B. Badiou e t J.-C. Rambacb
DAS NACHSTE BESTE.
und freigelassen
unbündigen
(d) offen die Fenster des Himels
5
10
15
20
25
unbündigen
Und freigelassen der Nacbtgeist
bi~~elstürmende
unfriedlicben
Der ungebaltene, (irt Gescbwüz),
der bat unser Land
unendlicben
Bis diese Litunde.
Bescbwüzet, mit Spracben viel, (undichtrisrben), und
Das, was irh will,
Den Scbutt gewülzet
Des (Feindes) Gtt,
Bis diese Stunde.
Docb korftt das, wa(cb)s ich will,
Vie1 thuet die gute Stunde. Weti
Drum wie die Staaren
(D)Mit Freuden(s)geschrei, wefi auf Gasgone, Orte(n)n, WO (die)viel
Wen im Olivenland, und
Garten, (sin[ I)
In liebenswürdiger Fremde,
Spring-/ Und die
An grasbewacbsnen Wegen
(Auf feuchten Wiesen)
Unwissend in der Wüste
brufien
(Die Sotie stich,)
Die
(Im Thal)
Baum
30
Die Sone sticht,
Und das Herz der Erde thuet
35
40
45
98
Sich auf,(u)wo um
Den HügeL von Eirhen
Aus brenendem Lande
und WO
Die Strome
Des Sotitaags unter Tünzen
Gastfreundlich die Schwellen sind,
blüthen/
An be(g)kranzte(r)n StraB(',)en, stillegehend.
Sie spüren nemlich die Heimath,
Weti grad
aus fulbem Stein,
Die
weir
(Wen) Wusser silbern rieseln
Und heilig G.ün sich zeigt
Auf feuchte(n)r Wiese der Charente,
LE PLUS PROCHE, LE MEILLEUR
et libéré
indomptables
(-)
Jets
d’eau
ouvertes les fenêtres du ciel
imprécises
Et libéré L’esprit de la nuit
L’assaillant du ciel
inapaisables
L’indigné, (c’est du bavardage)
qui a notre pays
infinies
Jusqu’à cette heure.
Circonvenu de bavardages, avec nombre de langues (apoétiques)et
Ce que je veux.
Fait rouler les décombres
De (L’ennemi)Dieu.
Jusqu’à cette heure.
Et pourtant il advient ce (%) que je veux,
Elle fait beaucoup, la bonne heure. Quand
C’est pourquoi comme les étourneaux
(,)Avec des cris de joie, quand en Gascogne, endroith), où (son[ ](les)
Quand au pays des oliviers, et
beaucoup de jardins,
En aimable pays étranger
Et les
Le long de chemins herbeux
Ignorant dans le désert
5
10
15
20
25
(Le soleil darde,)
Les
(Dans la vallée)
arbres
Le soleil darde,
30
Et le cœur de la terre
S’ouvre, (-) là où autour
De la colline aux chênes
D’unpays brûlant
et où
Les rivières
Le dimanche sous des pas de danse
Hospitaliers sont les seuils,
de fleurs/
Le long de route(s) cou( )ronnée(s), marchant en silence.
ils sentent en effet le pays natal,
d’une piewe fauve,
Quand tout droit
Les
quand
(Quand) Les eaux ruissellent, argentées
Et que la verdure se montre, sacrée
Sur la prairie humide(s) de la Charente,
35
40
45
99
Die klugen Sine pflegend,
die Luft sich b a h ,
wen aber,
Und ihnen machet waker
50
(Die A) Scharfwehend die (d)Augen der Nordost, fliegen sie auf,
............................................................................................................................
cf;n de page)
Zwei Bretter und zwei
Brettchen apoll envers terre
55
60
Und Ek um Eke
Das Liebere gewahrend
Den imer halten (s)die sich genau an das Nüchste,
Sehn sie die heiligen Wülder und die Flame, blühendduftetzd
Wolken des Gesanges fern
und athmen Othem
Der Wachstums und die
Der Gesünge. Menschlich ist
Das Erkentnip. Aber die Himlischen
mit sich/
DER KATTE(S)N LAND
Auch haben solches, / und des Morgens beobachten
Die Stunden und des Abends die Vogel. Himlischen auch
UND DES WIRTEMBERGES
65
Gehoret also solches. (Sonst) Wolan nun. Sonst in
Zeiten
KORNEBENE,
70
Des Geheimnisses hütt icb, als von Natur, gesagt,
Sie koihen, in Deutschland. Jezt aber, Weil, wie die See
Die Erd ist und die Lander, Münern gleich, die nicht
Vorüber gehen konen, einander, untereinander
UND WO BERÜHMT WIRD
Sich schelten fast, so sag ich. Die (Burg) ist, W O ,
seitwürts
Abendlich wohlgeschmiedet
IHR EWIGEN BESANFTIGUNGEN
75
Von Wien an (,) (die) geht Eine Stadt,
(WO)(Sich)
sich
(w)Wohl
Vom Oberlande (,) biegt das Gebirg Wiese die Walder sind an
WO auf hoher (Ebne)
WO DICH, UND DER WINKEL,
80
Theresien/Und Hirten auf der (Ebne) bairischen Ebne
strap,
Der bairischen Ebne. Nemlich Gebirg
UND WO KNABEN GESPIELT
85
Geht weit und streket, hinter Amberg sich und
Frankischen Hügeln. Berühmt ist dieses. Umsonst nicht hat
Seitwarts gebogen Einer von Bergen de(s)r Jugend
und, rauschen, über spizem Winkel
VIEL SIND IN DEUTSCHLAND
90
1O 0
Das Gebirg(e), (und)
Frohlolokende Baume. Gut(,) is/, (w) das gesezt ist. Aber
Eines
Anhang, der bringt uns fast
um heiligen Geist
Barbaren auch
Das ficht uns an
und gerichtet das Gebirg
Cultivant les sens subtils.
C’air se fraye une voie,
mais quand
Et qu’il leur rend plus vigilants
(Les (-) Les (-) yeux, de son souffle âpre, le Nordé, ils prennent leur envol,
50
............................................................................................................. cf;n de page)
Deux planches et deux
planchettes apollon +t envers terre
Et de lieu en lieu
Apercevant le plus cher
Car (-) ceux-là s’en tiennent toujours exactement au plus proche,
Ils voient les forêts sacrées et la flamme aux senteurs fleuries
nuages du chant au loin
et respirent le soufle
De la croissance et les
Des chants. Humaine est
La connaissance. Mais les Célestes
DU PAYS DES CATTE(-)S
près deux/
Ont aussi semblable chose, / e t le matin ils obsewent
Les heures et le soir les oiseaux. Aux Célestes aussi
55
60
ET DU WURTEMBERG
Appartient ainsi semblable chose. (Sinon) Eh bien de l’avant. Sinon en des
temps
65
LA PLAINE DE BLÉ
De mystère, j’aurais, comme selon la nature, dit
Ils viennent, en Allemagne. Mais maintenant, parce que, comme la mer
Est la terre et les pays, pareils aux hommes, qui ne
Peuvent passer, mutuellement, entre eux
70
ET O ù DEVIENT CÉLÈBRE
Presque s’injurient, voilà ce que je dis. La (citadelle) est là où
Vers l’occident bien forgée
de côté
VOUS ÉTERNELS ADOUCISSEMENTS
75
A partir de Vienne(,) (la) s’étend Une ville,
(Où) (Se)
se
(-) Bien
De l’Oberland(,) s’infléchit la montagne prairie les forêts sont près
où sur la haute (plaine)
O ù TE, ET LE COIN
Theresien/Et des bergers dans la (plaine) la plaine bavaroise
strasse
La plaine bavaroise. En effet la montagne
80
ET où DES GARÇONS ONT JOUÉ
Va loin et s’étend derrière Amberg et
Les collines de Franconie. Cela est célèbre. Ce n’est pas en vain 85
Qu’il en est Un qui a infléchi latéralement venu des monts de (-) la jeunesse
e t bruissent au-dessus d’un coin escarpé
IL Y A EN ALLEMAGNE BEAUCOUP
La montagne (-) ,(et)
Des arbres jubilants. Ce qui est bon(,) est, (-) ce qui est arrêté. Mais il est
une chose
Parti qui nous enlève presque
Qui nous trouble
l’Esprit-Saint
les barbares aussi
et orienté la montagne
90
10 1
Auch ieben, WO allein hewschet Sotie und Mond
95
WOHNSIZE SIND DA FREUNDLICHER GEISTER, DIE
Heimatlich. Und Mond. Gott aber hait uns, zu sehen einen, der woile
Umkehren mein Vateriand.
so
ZUSAMENGEHOREN, (WEN) DIE KEUSCHEN
100
WildniB nemlich sind ihm die Alpen und
hdt uns, weti zu sehn isr einer, der woiie
EIN
SIE(B) BINDET GLEICHES
die Tale und
Das Gebirg, das theilet die Lange lang
105
UNTERSCHEIDET EIN GLEICHES GESEZ.
Geht über die Erd. Dort aber
Der Rosse
110
nun.
hatt
Gehn mags (also). Fast, unrein,
sehn lassen und das
Eingeweld
Bei llion aber auch (schien)
Lelilb (w)War Sehn lassen und das Eingeweid
(Der Erde)
der Gei[s]t. (War auch) das Licht der Adler.(herein). Aber in der
Mitte
Der Erde
Der Himel der Gesange. Neben aber,
Des G
DAS
Entscheidung nemlich, die alle
115
WEN (ABER) TAGWERK ABER BLEIBT,
Am Ufer zorniger Greise, der
(WEN)
D(1E)ER (MENSCHEN) ERDE VERGESSENHEIT,
Drei unser sind.
120
(DER EWIGE VATER)
(EIN WOHLGEFALLEN ABER)
0
125
WAHRHEIT S C H E N K ï ABER DAZU
DEN ATHMEN
DEN
DER EWIGE
VATER.
DER EWIGE VATER
102
Vivent aussi, où seuls règnent soleil et lune
95
IL Y A DES DEMEURES D’ESPRITS AMICAUX Q U I
Vers le pays natal. E t la lune. Mais Dieu nous tient den voir un qui voudrait
Retourner mon pays paternel.
AINSI
SONT UNIS, (QUAND) LES CHASTES
Contrée sauvage en effet sont pour lui les Alpes et
nous aurait, quand on peut en voir un qui voudrait
UNE
100
LES (N) LIE SEMBLABLE
Les vallées et
La montagne qui partage sur toute la longueur
105
DISTINGUE UNE LOI SEMBLABLE.
Passe au-dessus de la terre. Mais c’est là
Des chevaux
Le corlpls (-) Était
l’esp[r]it.
De l’es
à présent
aurait
cela peut (donc) aller. Presque, impur,
laissé voir et
l’entraille
Mais près d’Ilion aussi (brillait)
Laissé voir e t I’entraille
(De la terre)
(Était aussi) la lumière des aigles. (vers l’intérieur.)
Mais au milieu
De la terre
Le ciel des chants. Mais à côté,
110
CELA
de la décision en effet qui tous
115
(MAIS) QUAND LE TRAVAIL DU JOUR RESTE,
Sur la rive des vieillards furieux dont
(QUAND)
L’(ES) (HOMMES) OUBLI DE LA TERRE,
Trois sont nôtres.
120
(LE PÈRE ÉTERNEL)
(MAIS UN AGRÉMENT)
A CEUX Q U I RESPIRENT
0
MAIS LA VÉRITÉ OFFRE EN
LE PÈRE ÉTERNEL
sus
LE PÈRE
ÉTERNEL.
125
NOTES
V. 1. Le titre pose un problème de traduction : en effet, < dus ndchste beste Y est une expression
idiomatique rendue habituellement par N la première chose venue ». Cependant le v. 5 : (( Car ceux-là
s’en tiennent toujours exactement au plus proche ... )) impose une autre traduction autant que le
commentaire de Beissner. L’esquisse commence par le temps de nuit hivernale entre les temps. L’aube
d’un nouveau temps de plénitude après le retournement du pays paternel est représentée par l’image
du printemps qui fait sentir (( en pays étranger n le pays natal aux oiseaux migrateurs, des étourneaux;
ces oiseaux migrateurs, symboles de l’esprit qui revient de la colonie au pays natal (cf. a Pain et vin »)
s’en tiennent exactement au plus proche.
V. 4. (( Ouvertes les fenêtres du ciel B expression biblique désignant une pluie torrentielle. Cf. par ex.
Genèse 7.11, 8.2; Rois 7.2; lsuïe 24.18.
V. 17. ((Gascogne)). Souvenir du voyage à Bordeaux. Cf. l’hymne ((Souvenir)) et ~Aprioritéde
l’individuel ».
103
Pour Sattler, les ajouts tardifs U jardins », U jets d’eau D et a arbres )) accentuent le contraste caché entre
les trois paysages : a Gascogne », U pays des oliviers N et N Charente ». Les jardins de Gascogne sont
abandonnés par (( les étourneaux avec des cris de joie »,bien qu’ils doivent voler contre le rude U Nordé ».
Dans l’aride a pays des oliviers N jaillissent des fontaines; dans l’humide a Charente », les arbres oublient
le (( désert N qui est caché sous les prés et les chemins. Holderlin met en évidence le phénomène du
retournement des véritables relations qui s’accomplit dans la conscience dans ses Remarques sur Antigone.
Antigone, vouée à la mort, blasphème ce qui est bien agencé : U Je sais que pareille au désert elle est
devenue ... )) (Trad. F. Fédier, Bibliothèque 10/18, 1965.)
La graphie U Gascone » pour U Gascogne » résulte d’une contamination par l’image : U Le soleil darde/
Et le cœur de la terre/ S’ouvre... N (v. 3 1-33) U gè goné Y, traduit librement par U terre qui enfante N).
De même, le nom U Charente N (charis entos) est traduit dans le poème par U en aimable pays étranger ».
V. 49-50. U Plus vigilants les yeux ». Expression biblique, voir Samuei I. 14, 27-29 et Proverbes 20.13.
V. 57. N Les nuages du chant ». Cf. v. 63 : U le ciel des chants ». N Grèce B v. 13 (2‘ version); v. 15
(3‘ version).
V. 58. U La croissance ». Cf. U LIster », v. 39.
V. 61. U Pays des Cattes », désigne la Hesse. Cf. N Colomb », v. 2.
Holderlin a appris à connaître cette région pendant l’été 1796 lorsqu’en compagnie de Heinse et de
Diotima, et pour fuir la guerre, il s’est rendu de Francfort, via Kassel à Dribourg en Westphalie.
V. 73. U Les oiseaux ». Cf. (< Ménon pleurant Diotima », v. 64.
V. 73. U Vers l’occident », I abendiicb Y (U au crépuscule du soir ») est à interpréter dans le sens
d’« hespérique ».
La montagne qui se courbe de l’Oberland vers le nord avec pour limite a la plaine bavaroise derrière
Amberg et les collines de Franconien, c.-à-d. les forêts de Bavière et de Bohême, indique l’occident,
I’Hespérie, l’Allemagne, et servira aux dieux de protection U bien forgée N contre les puissances de l’abîme.
Que cette montagne soit U orientée vers le pays natal », c.-à-d. nord-sud est significatif: a Ce n’est pas
en vain », tout comme le cours des fleuves n’est pas dû au hasard. Cf. par ex. < La migration w , v. 9496, ou U Le Rhin n, v. 34-37.
Les Alpes sont un rempart opposé au retour des Célestes qui veulent venir de l’Indus en Allemagne
en passant par la Grèce et l’Italie. Les Alpes semblent s’étendre principalement au sud le long de
l’Allemagne; la majorité des vallées suivent la même direction, de ce fait, U sur toute la longueur », ne
peuvent mener les Célestes directement jusqu’en Allemagne : c’est pour cela qu’ils sont confrontés à la
sauvageté de cette période intermédiaire, contrairement à une conception première selon laquelle les
Célestes auraient pu descendre de leur château << marche à marche les monts des Alpes n (Cf. U Le Rhin »,
v. 4-9) directement en Hespérie. D’après cette conception plus tardive, le poète semble reconnaître dans
l’orientation des montagnes un signe des forces créatrices à travers le temps comme dans le cours des
fleuves sacrés. La montagne s’étend depuis la grande Grèce : c’est l’Apennin, à travers l’Italie, puis s’élève
dans les Alpes sans avoir encore d’orientation précise en tant que sauvageté de la période intermédiaire
et s’infléchit près de Vienne sur la rive gauche du Danube en contreforts peu élevés vers le pays natal
- dirigés vers l’Allemagne, c.-à-d. latéralement, jusqu’à reprendre dans la forêt de Bohême U derrière
Amberg et les collines de Franconie )) l’altitude du château des Célestes. Cette nouvelle signification que
prend la topographie a probablement son origine dans le voyage à Ratisbonne en automne 1802.
V. 73. U Bien forgée ». La montagne est U bien forgée B comme une armure. Cf. U Le loisir », v. 21 sq.
V. 79. a Et le coin ». Cf. (( Le Coin du Hahrdt ».
C’est à proximité d’un roc situé dans la forêt près de Hahrdt qui aurait, d’après la légende, permis
en 15 19 au duc Ulrich d’échapper à ses poursuivants, que Holderlin et son demi-frère Karl ont lu, U en
buvant du cidre N (comme il le rappelle dans une lettre du 13.X.1796) La Batailie d’Arminius de
Klopstock. Lors de son dernier séjour à Nürtingen (1802-1804), Holderlin a souvent fréquenté cet
endroit.
V. 80. (( Theresienstrasse ». On ne sait à quelle ville renvoie ce nom de rue : Ratisbonne, Ingoldstadt?
V. 109. U Le corps ». Il y a là une hésitation Leib/Leb ; U corps/vis )) qui ne peut être rendue en
français.
V. 109 sq. U Mais près d’Ilion aussi... n Ces vers font allusion aux trois phases de la présence divine
chez les Grecs qui commence à Ilion; Homère est à l’origine de l’art grec car il a U ramené à son empire
d’Apollon la proie de la sobriété junonienne et occidentale )) (lettre à Bohlendorff du 4.XII.1801). L’aigle
est le héraut qui annonce les dieux et la lumière (cf. <( Germanie n et U L’aigle P). La deuxième phase
est le a milieu N du temps, l’apogée grecque avec le (< ciel des chants ». La troisième phase, celle du soir
et du crépuscule, est caractérisée par les U vieillards furieux )) U sur la rive de la décision ». Selon Sattler,
Holderlin a ici dans une suite de phrases elliptiques commenté la structure du poème. Dans un premier
temps, il convient de compléter les phrases qui suivent L’esprit était le corps des chevaux ». Cf. Isaïe,
3 1.3 : U Des chevaux sont chair er non esprit. N Ce n’est que dans la dernière phrase que cet esprit est
précisé par N de la décision en effet N qui indique que les phrases précédentes doivent s’accompagner de
cette définition cachée. Dans l’ellipse paratactique : (( Mais près d’Ilion/ la lumière des aigles N qui vient
(<
104
s'ajouter à : L'esprit était le corps des chevaux », cet esprit est qualifié d'esprit prémonitoire, tout
comme devant Troie l'avenir était lu dans le vol des aigles (cf. iliade, XII,v. 2 16-243 et XXIV,v. 3 15321). De la même façon, Holderlin interprète l'orientation des montagnes dont les torsions tels des
serpents w («Apriorité de l'individuel ») mènent de la limite occidentale des Alpes en passant par la
Schwabisch et la Frankisch Alb, puis par les monts du Mittelgebirge jusqu'à la forêt de Teutoburg où
elles se terminent dans l'avancée de la mer. Pour l'esprit qui a parlé au (( milieu )> de l'hymne, la
caractéristique apparaît déjà dans le texte : Humaine est la connaissance ». Ces trois notions, prophétie,
connaissance et décision, qui du reste concordent avec la théorie des trois tons : naturel, idéal et héroïque,
élaborée en 1799-1800 à Hombourg, peuvent toutes être envisagées par la conscience. Les discours de
U l'esprit nocturne N et ceux de son (( parti N à la fin de l'hymne sont appelés sans doute par référence à
la parole prophétique U la rive des vieillards furieux ». Cf. Daniel, 12.5-10.
LE PLUS PROCHE, LE MEILLEUR
5
ouvertes les fenêtres du ciel
Et libéré l’esprit de la nuit
L’assaillant du ciel qui a circonvenu notre pays
De bavardages, avec nombre de langues, indomptables, er
Fait rouler les décombres
Jusqu’à cette heure.
Et pourtant il advient ce que je veux,
Quand
C’est pourquoi comme les étourneaux
10 Avec des cris de joie, quand en Gascogne, des endroits, aux nombreux
jardins
Quand au pays des oliviers, des jets d’eau et
En aimable pays étranger les arbres
Le long des chemins herbeux
Ignorant dans le désert
15 Le soleil darde,
Et le cœur de la terre
S’ouvre, là où autour
De la colline aux chênes
D’un pays brûlant
20 Les rivières et où
Le dimanche sous des pas de danse
Hospitaliers sont les seuils,
Le long de routes couronnées de fleurs, marchant en silence.
Ils sentent en effet le pays natal,
25 Quand tour droit d’une pierre fauve
Les eaux ruissellent, argentées,
Et que la verdure se montre, sacrée,
Sur la prairie humide de la Charente,
Cultivant les sens subtils.
mais quand,
30 L’air se fraye une voie,
Et qu’il leur rend plus vigilants
Les yeux, de son souffle âpre, le Nordé, ils prennent leur envol,
Et de lieu en lieu
Apercevant le plus cher
35 Car ceux-là s’en tiennent toujours exactement au plus proche,
Ils voient les forêts sacrées et la flamme aux senteurs fleuries
De la croissance et les nuages du chant au loin et respirent le souffle
Des chants. Humaine est
La connaissance. Mais les Célestes
40 Ont aussi semblable chose près d’eux et le matin ils observent
Les heures et le soir les oiseaux. Aux Célestes aussi
Appartient ainsi semblable chose. Eh bien, de l’avant. Sinon en des temps
De mystère, j’aurais, comme selon la nature, dit,
Ils viennent, en Allemagne. Mais maintenant, parce que comme la mer
45 Est la terre et les pays, pareils aux hommes qui ne
Peuvent passer, mutuellement, entre eux
1O6
50
55
60
65
Presque s’injurient, voilà ce que je dis. Vers l’occident bien forgée
De l’Oberland s’infléchit la montagne où sur la haute prairie sont les forêts
Bien près de la plaine bavaroise. En effet la montagne
Va loin et s’étend derrière Amberg et
Les collines de Franconie. Cela est célèbre. Ce n’est pas en vain
Qu’il en est un venu des monts de la jeunesse qui a infléchi latéralement
La montagne et orienté la montagne
Vers le pays natal. Contrée sauvage en effet sont pour lui les Alpes et
La montagne qui partage les vallées et sur toute la longueur
Passe au-dessus de la terre. Mais c’est là
et bruissent au-dessus d’un coin escarpé
Des arbres jubilants. Ce qui est bon est ce qui est arrêté. Mais il est une chose
Qui nous trouble. Parti qui nous enlève presque l’Esprit-Saint. Les barbares
Vivent aussi, où seuls règnent soleil
Et lune. Mais Dieu nous tient quand on peut en voir un qui voudrait
Retourner mon pays paternel.
Cela peut aller à présent. Le corps des chevaux
Était l’esprit. Mais près d’Ilion aussi
La lumière des aigles. Mais au milieu
Le ciel des chants. Mais à côté
Sur la rive des vieillards furieux, de la décision en effet, qui tous
Trois sont nôtres.
Trud. par B. Badiou et J.-C. Rumbach
APRIORITAT DES INDIVIDUELLEN
AUF FALBEM LAUBE (SCH) (LIEGT) RUHET
DIE T ~ R ~ A U B E ( N )DES
,
WEINES HOFFNUNG, ALSO RUHET AUF DER WANGE
in Feuer getaucht,
DE(S)R SCHATTEN (AUF) VON DEM (D)GOLDENEN SCHMUK, DER HANGT
Reif sind, genühret, gekochet
Die Frücht(e) und auf der Erde geUnd ein Gesez, dap alle(in)s Und freundlich in Wohnungen prüfet
Himels
und ein
hineingeht Und Pforten des und vieles
Gesez
Schlangen gieich ist
ist
wie auf den Schultern eine
Und vie1
Prophetisch, trüume(t)nd auf
Den Hügeln des Himeis. Last von Scheitern, ist
5
AM OHRE DER (0)JUNGFRAU.
10
U N D LEDIG SOLL ICH (ICH) BLEIBEN
15
Zu behalten. Aber bos(e) sind
LEICHT
(ES) FANGET ABER (DAS KALBLEIN) SICH
IN DER KETTE. DIE
20
ES ABGERISSEN, DAS U L B L E I N .
Die Pfade. Nemlich
gehn unrecht
Wie Rosse, durch gehn die
gefangenen
Element’(.) und alten
Geseze der Erd. Und imer
Ins Ungebundene gehet eine
(eine Sehnsucht)
Sehnsucht. (Ab) Vieles aber
Cüciiia.
1st zu behalten. Und
25
30
Noth die Treue. Votwürts
(w) aber und
rükwarts wollen
Nicht sehn. Uns wiegen lassen, wie
wir
, auf der See.
Auf schwanken
FLEIBIG
Reif sind, in Feuer getaucht, gekochet
35
ES LIEBET ABER DER SAMAN
zu SEHEN EINE,
Die Frücht und auf der Erde geprüfet
und ein Gesez ist
Dai3 alles hineingeht, Schlangen gleich,
(DE)
Prophetisch, triiumend auf
DES TAGES SCHLAFEND ÜBER
Den Hügeln des Himels. Und vieles
40
DEM STRI(ST) KSTRUMPF.
Wie auf den Schultern eine
Last von Scheitern ist
Zu behalten. Aber bos sind
108
APRIORITÉ
DE L’INDIVIDUEL
SUR LE FEUILLAGE FAUVE ( N ) (EST ÉTENDU) REPOSE
LE(S) RAISIN(S), L’ESPOIR DU VIN, AINSI REPOSE SUR LA JOUE
plongés dans le feu,
(-)
L’OMBRE (SUR) DU BIJOU D’(-)OR
Q U I PEND
Mûrs sont, nourris, cuits
Les fruit($ et sur la terre éEt amicalement dans les demeures prouvés
Et m e loi, qiie tout(s)t(y)
ciel
et une
entre Et les portes du et beaucoup
tels des serpents est
loi
est
comme sur les épaules un
Et beaucoup
Prophétique, rêv(e)ant sur
Les collines du ciel. Fardeau de bûches, doit
À L’OREILLE DE LA
(-1
5
JEUNE FILLE
ET IL FAUT QUE JE (JE) RESTE EN LIBERTÉ
FACILEMENT
Etre
retenu. Mais mauvais
sont
10
15
MAIS (IL) SE PREND (LE JEUNE VEAU)
Les sentiers. En effet
vont à tort
Comme des chevaux s’emballent les
éléments
Captifs (.) et les anciennes
DANS LA CHAîNE QU’IL
A ARRACHÉE, LE JEUNE VEAU.
20
Lois de la terre. Et toujours
Jusqu’à la dissolution va une
(une nostalgie)
Nostalgie. (Ma) Mais beaucoup
25
CéciZe.
Doit être retenu. Et
Nécessité la fidélité. Mais en
avant ( N ) et
en arrière nous ne
ASSIDU
30
Pas regarder. Nous laisser bercer comme
voulons
, sur la mer.
Sur balançant
Mûrs sont, plongés dans le feu, cuits
MAIS IL AIME, LE SEMEUR
E N VOIR UNE,
Les fruits et sur la terre éprouvés
et c’est une loi
Que tout y entre, tels des serpents,
35
(N)
Prophétique, rêvant sur
DORMANT DE JOUR SUR
Les collines du ciel. Et beaucoup
40
SON BAS ( N ) DE TRICOT.
Comme sur les épaules un
Fardeau de bûches doit
A
Etre retenu. Mais mauvais sont
109
45
NICHT WILL WOHLLAUTEN
Die Pfade. Nemlich unrecht,
DER DEUTSCHE M U N D
Wie Rosse, gehn die gefangenen
ABER LIEBLICH
50
RAUSCHEN
AM STECHENDEN BART(.)
Element’ und alten
Geseze der Erd.
(U)
Und imer
(W) DIE KÜSSE.
Ins Ungebundene gehet eine Sehnsucht. Vieles
aber ist
Zu behalten. Und Noth die Treue.
wiegend
Vorwarts aber und rükwarts wollen wir
55
Nicht sehn. Uns wiegen lassen, wie
Auf schwankem Kahne der See.
60
............................................................................................................................
65
(fn de page)
Die aprioritat des Individuellen
und kehr’ in Wahnenschrei
über das Ganze
de(r)n Augenblik des Triumps
Werber!
keine Polaken Sind wir
VOM ABGRUND (NEMLICH) HABEN.
Der
WIR ANGEFANGEN und gegangen M(p)cr TOV opicov
Gelehrten
in Zweifel und aergenii3,
70
Dem (Leuen) gleich, (d)
halb
Den sinlicher Sind Menschen
Der (lieget)
In dem Brand
Mit
Der Wüste,
Lichtrunken und der Thiergeist ruhet
Bald aber wird, wie ein Hund, umgehn
ihnen
(1)In der Hizze meine Stime auf den Gassen der Garten
75
(DER SCHOPFER.)
In den wohnen Menschen
80
85
110
Inl? In Frankreich
neues t u sagen
Indessen aber
an meinem Schatten [(r)Richt’]
ich
(U)und Spiegel die Ziïie
Frankfurt aber, nach der Gestalt, die
Der Schopfer
Meinen Fürsten
Abdruk ist der Natur, zu reden
Nicht urnsonst
De(r)s Menschen nemlich, ist der Nabel
Die Hüfte unter dem
1st des Menrchen betrüblich, Aber
45
ELLE N E VEUT PAS BIEN SONNER
Les sentiers. En effet, à tort,
LA BOUCHE ALLEMANDE
Comme des chevaux, vont les éléments
MAIS ADORABLES
BRUISSENT
50
Captifs et les anciennes
SUR LA BARBE PIQUANTE(.)
Lois de la terre. (-) Et toujours
(.v)
LES BAISERS.
Jusqu’à la dissolution va une nostalgie. Mais
beaucoup doit
Être retenu. Et nécessité la fidélité.
55
bercant
Mais en avant et en arrière nous ne voulons
Pas regarder. Nous laisser bercer comme
Sur une barque balançant sur la mer.
60
............................................................................................................................
@n de page)
L’apriorité de l’individuel
et tourne en chant de coq
sur le tout
(-) l’instant du triomphe
des Polaques, nous n’en sommes pas
Enrôleur!
65
C’EST PAR L’ABIME (EN EFFET) QUE NOUS AVONS
A cause
et nous sommes partis M(p)cl TOV o p ~ o v
dans le doute et l’indignation,
Tel le (lion), (-)
Car plus sensibles sont les hommes
savants
Qui (est couché)
COMMENCÉ
des
70
Dans l’incendie
Du désert,
Avec
Ivres de lumière et l’esprit animal repose
Mais bientôt, comme un chien, s’en ira
eux
(-)
75
Dans la chaleur ma voix par les ruelles des jardins
(LE CRÉATEUR)
Où habitent des hommes
Mais pendant ce temps
d’après mon ombre j[’(-)oriente]
En / En France
pour dire du nouveau
(-) et miroir le pinacle
Mais Francfort, d’après la forme qui
Le créateur
Vers mes princes
Est l’empreinte de la nature, parler
N’est pas en vain
La hanche sous 1’
De(.r) (P)homme(s) en effet, est le nombril
Désolant pour l’homme. Mais
80
85
111
Dieser Erde. Diese Zeit auch
Stern
nationell
90
1st Zeit, und deutschen (Schmelzes.)
Germania
Ein wilder Hügel aber stehet über dem Abhang
DAMIT SIE SCHAUEN SOLLTE
95
Meiner Garten. Kirschenbaume. Scharfer Othem aber wehet
Um die Locher des Felses. Allda bin ich
Alles miteinander. Wunderbar
Aber sch(reg)wer ge(ben)htneben
der frohe weg.
Bergen
Recbts liegt
Ein Nupbaum und sicb Beere, wie Korall
aber der Forst
Hangen an dem Straucb über Robren von Holz.
Aus denen
bevestiger Gesang
Ursprünglirb aus Kom, nun aber zu gesteben,
von Blumen
Bis zu Schmerzen aber der Nase steigt
als
Neue Bildung aus der Stadt.
Citronengeruch auf (und) der Oi, auf der Provence, und
Aber über Quellen beuget schlank
100
105
110
WO
es baben diese
Langst auferziehen und der Mond und
Und Natürlicbkeit
Dankbarkeit
Schiksaal
Und Gott, euch aber,
Dankbarkeit mir die Gasgognisrben Lande
gebraten Fleisch
Gezahmet
und genahrt
Gegeben(,). (enogen) aber, nocb zu seben, bat micb der Tafel und
Die Rappierlust (und des Festtaags) (braune) Trauben. braune
(und) (micb) leset O
115
120
Untrügbarer
x
Ihr Blütben von Deutschland,
Ktystal[jan dem
Das Licbt sicb prüfet wen
[(w)
O
x
mein Hen wird
] Deutsrbland
............................................................................................................................
DIE PURPURWOLKE, DA VERSAMELT VON DER LINKEN SEITE
DER ALPEN UND DER RECHTEN SIND DIE SEELIGEN
GEISTER, UND ES TO
125
112
Heidni I s Iches
Bacche, da8 Sie lernen der Hande Geschik
Samt selbigem,
Gerachet Oder vorwarts. Die Rache gehe
Nemlich zurük. Und daB uns nicht
(Ho)
Dieweil wir roh (,gleich) sind,
JO
! f n de page)
De cette terre. Ce temps aussi
étoile
nationellement
90
Est le temps, et (de la fusion) allemande.
Germania
Mais une colline saiivage surplombe le versant
POUR QU’ELLE SOIT OBLIGÉE DE REGARDER
De mes jardins. Des cerisiers. Mais un souffle âpre tourbillonne
95
Autour des cavités du rocher. Partout en ce lieu je suis
Tout à la fois. Mais
Mais (de biais) difficilement (donne) passe le long
Merveilleusement au-dessus des sources se penche svelte Le chemin joyeux [/.I
Des montagnes
Mais à droite
1O 0
Un noyer et des baies, comme du corail,
s’étend la forêt
Pendent à I‘arbrisseau au-dessus des chalumeaux de bois
De ceux-ci
chant raffermi
A I’origine, de blé, mais pour I’avouer maintenant,
de fleurir
Mais jusqu’à la douleur monte a u nez
comme
L’ne nouvelle formation née de la ville,
Une odeur de citron (et) d’huile sur la Provence, e t
où
ils m’ont
Depuis longtemps éduquer et la lune et
cette reconnaissance
destin
Et Dieu, mais vous
de viande rôtie
Cette reconnaissance les pays de Gascogne ils me
Rendu docile
et nourri
Les ont donnés (,) (éduqué) mais, à voir encore, m’a de la table et
Le plaisir de la rapière ( e t du jour de fête) les raisins (bruns), bruns
(et) (me) recueillez ô
x
x
105
110
Et ce naturel
Infaillible
115
120
Vous fleurs de I’Allemagne, ô mon cœur devient
Cristal [ ] OU
La lumière s’éprouve quand [(-)
] l’Allemagne
............................................................................................................................ cf;n de page)
LA NUE POURPRE, RASSEMRLÉE LÀ, DU CÔTÉ GAUCHE
DES ALPES ET DU CÔTÉ DROIT SONT LES BIENHEUREUX
ESPRITS, ET RÉSO~NNEI
Du païleln
Io Bacchus, pour qu’ils apprennent la destination des mains
Avec le même,
Vengés ou de l’avant. Que la vengeance en effet
(su Ir e m 1)
Recule. Et que ne nous batte
Car nous sommes (pareils) rudes
125
113
Schwerdt
130
Mit Wasserwellen Gott
und heimlich Messer, wen einer
schlage, Nem(m)lich
geschiiffen
Gottlose auch
Mein ist
135
Die Rede vom Vateriand. Das neide
(wohi) mitteimaJig
Wir aber sind
(DaJ un)
Mir keiner. (So) Auch so machet
Gut,
Gemeinen gleich, die
DaJ aber uns das Vateriand
Das Recht des Ziniermatïes
nicht werde
140
Die gleich
Nicbt zusaniengehe zu kieinem
Das Kreuz
dran schuldig.
Raum
E(I)d(I)eln Gott versuchet, ein Verbot
Arm und Bein
Zum kieinen Raum. Schwer ist der
1st aber, dei3 sich riihrnen. Ein Herz sieht Zu liegen, mit F@en (Oder) den Hand
aber
145
den schlank steht
en
Helden. Mein ist
Nur Luft.
auch
Und gehet
Mit getreuem Rüken des
Beim Hochzeit
150
reigen und Wanderstra us.
der die Gelenke verderbt
rein Gewissen
und traget in den Karren
der Deutschen Geschlecht.
155
Es wiil uns aber geschehen, um
Die warme Scheue
(ein linkisches)
Abzulegen, an der Leber
Ein iinkisches.
160
nicht der (Sone)
Wohl mufl ehren Geist
Den Umsonst
Will
Das Schiksaal. Das (heipt) heipen
Herz betrüblich.
Des Menschen
114
Der Sone Peitsch und Zügel. Das
W i l l aber heiflen
Épée
130
A v e c des flots
e t couteau en secret, yuund un
D i e u . En ef(,)fet
aiguisés
Les athées a u s s i
I l est mien
Le discours du pays paternel. Cela que personne
(probablement) un médiocre
135
M a i s nous sommes
(Pour nou)
Ne nie l‘envie. (Ainsi) De même c’est ainsi
bien,
P a r e i l s a u x communs que
Mais pour nous que le pays paternel
Que le droit du charpentier
ne devienne
Ne se rétrécisse un petit
Que p a r e i l s
140
Fait la croix
espace
bras et jambe
En un petit espace. Dificile est le
Est f a i t e de s’en glorifier. M a i s un cœur D’être couché, avec les pieds (ou) les main
responsable d e cela.
A u x no()bI()es, D i e u t e n t e , m a i s i n t e r d i c t i o n
voit
car svelte se tient
Des héros. I1 est m i e n
Rien que de ï a i r .
s
aussi
145
E t allez
Avec le dos fidèle d e
Lors de la ronde
nuptiale et le bouquet de la promenade qui corrompt les membres
pure conscience
150
et porte dans les chariots
la race des Allemands
Mais il va nous awiver pour
Abandonner
155
ne p a s l’(soleil)
La chaude crainte, au foie
Doit probablement honorer esprit
Car En vain
Une gaucherie.
veut
Le destin. Cela (c’est-à-dire) dire
Pour le cœur désolant.
D u soleil le fouet et la bride. Mais
De (’homme Cela veut dire
(une gaucherie)
160
NOTES
le
V. 2.
U r ».
V. 4.
V. 5 .
((
Le raisin ». En fait Holderlin écrit
c
Taube P
: ((
la colombe ». Toutes les éditions rétablissent
Bijou d’or ». Cf. Les Titans », v. 3 1 sq.
Cuits ». xtaasiv )) : Homère, Odyssée, VII, v. 119 en latin coquere Y chez Varron, par ex. :
Res rusticae, I, 7, 4. En hébreu, mûrir N et cuire )) sont un seul et même mot.
V. 6-7. (( Éprouvés ». Cf. L’Ister », v. 4.
V. 7-9. (( Que tout (y) entre ». II faut comprendre (( entrer dans la mort ». Cf. Remarques sur Antigone,
((
((
((
*(
((
(<
((
3.
V. IO. (( Tels des serpents ». La comparaison s’explique par le fait que les serpents s’insinuent dans
les endroits les plus sombres et les plus reculés, inaccessibles à toutes les autres espèces animales. Les
115
serpents sont aussi des incc.rnations de toutes les forces chtoniennes. Zeus lui-même a pris la forme d’un
serpent pour suivre Perséphone au royaume des morts. Cf. Ovide, Métamorphoses, 6, 114.
V. 12. (( Prophétique ». C’-st une loi prophétique. Cf. U L’unique », 3‘ version v. 71-73.
V. 12-15. (( Et beaucoup ,’ comme sur les épaules un / Fardeau de bûches, doit / Être retenu ».
Cf. Le Rhin », v. 157.
I1 s’agit de rester en vie, de la possibilité d’un arrêt face au mouvement menaçant qui pousse vers
la M dissolution ». Cette pensée est reprise aux v. 25-27 : U Mais beaucoup / Doit être retenu ». Jochen
Schmidt renvoie à cet endroit à la deuxième lettre à Bohlendorff (no 240) : U Puissé-je me souvenir
(“ behaiten ”) comment je suis arrivé jusqu’ici.
V. 60. U Sur une barque balançant sur la mer ». L’image se trouve aussi dans Hypérion, I, livre 2, 2 :
U Je me laissais aller, insoucieux de tout, ne demandant rien, ne pensant à rien; je me laissai bercer par
un demi-sommeil et me crus dans la barque de Charon. I1 est doux de boire ainsi à la coupe de
l’oubli. B (Trad. Ph. Jaccottet, Mercure de France, 1966.)
V. 61-63. N L’apriorité de l’individuel/ sur le tout ». Comme il n’y a pas de titre au sens propre du
terme, cette notice théorique en fera office : elle est une sorte de structure-programme.
Le concept d’apriorité dans sa forme substantivée se trouve chez Hegel au début de l’essai sur les
Différences des systèmes philosophiques de Fichte et de Schelling paru en 1801 ; il marque, stricto sensu, les
débuts du philosophe, encore dans le sillage de Schelling et plus précisément dans une critique sommaire
des catégories kantiennes. On se reportera à la traduction française de cet ouvrage due à Marcel Méry,
Paris, Vrin, 1952.
V. 65. M Enrôleur des Polaques, nous n’en sommes pas ». (( Enrôleur )) et (< Polaques entretiennent le
même rapport que chasseur et gibier dans l’acception militaire étroite qu’avait le terme à l’époque. La
métaphore (( enrôleur n pourrait être empruntée à l’essai Guerre de succession de la première partie
de 1’Adrastea de Herder qui relate les guerres de succession d’Espagne en faisant allusion aux divisions
contemporaines, polonaises ou napoléonniennes.
V. 68. Ma TOV opitov n . Exclamation signifiant a par le serment », empruntée vraisemblablement à
Pindare : a vai pà y a p Bpicov N (Néméider, XI, 24) que Holderlin citerait de mémoire. I1 rappelle ainsi
aux savants les engagements qu’ils ont pris envers le pays et qu’ils n’ont pas tenus.
V. 70. M Tel le lion ». Selon Sattler, ce lion a son référent dans une sculpture qui se trouve sur la
façade d’une maison, Bursagasse, voisine de la tour où vécut Holderlin. L’inscription qu’on y lit
commémore l’humaniste et cabbaliste Reuchlin, mort en 1522, qui aurait habité là à la fin de sa vie.
V. 74. U Désert », désigne la période intermédiaire où les dieux sont absents, que Holderlin appelle
par ailleurs (( sauvageté » ( a Wildnis P) Cf. N Lorsque pourtant ... »,v. 41.
V. 77. Dans la chaleur n. Cf. (( A la source du Danube », v. 56 et Hypérion, I, livre l“, 6. U ...les
bêtes sauvages errent dans la chaleur du jour en cherchant des yeux la source. N
V. 78. U Par les ruelles des jardins ». Cf. (( Le plus proche, le meilleür », 307-373, v. 19-20.
Souvenir du séjour à Bordeaux. Cf. aussi plus loin v. 57.
V. 80. (( J’oriente ». Contrairement à l’édition de F. Beissner qui lit a stellt ich P, Sattler établit c richt
ich Y et propose les trois lectures suivantes : 1) U J’oriente n en rapport avec U la hanche sous l’étoile B
ou avec le miroir dirigé (( vers les princes N 2) M J’érige »,mis en rapport avec le pinacle. 3) M Je redresse »,
mis en rapport avec la hanche : le poète guérit la hanche de Jacob que l’ange avait luxée, d’où le nom
prophétique d’Israël. Par ailleurs, Sattler rappelle le boitement d’CEdipe, celui d’Héphaïstos et celui du
diable.
V. 82. Le pinacle ». En se fondant sur deux aphorismes de Holderlin pour Sur l’organe de l’âme de
Samuel Thomas Sommering, Sattler rappelle que le pinacle appartient au temple au même titre que le
parvis ou le sanctuaire. Autant de symboles qui résolvent le conflit entre l’individualité et la totalité, le
moi et Dieu.
V. 82. U Miroir ». Sur ce motif, Sattler renvoie à a En bleu adorable N : N Que quelqu’un voie dans
le miroir, un homme, ,/ Voie son image alors, comme peinte, et elle ressemble / A cet homme. N
(Trad. A. du Bouchet, in Poèmes de Holderlin, Mercure de France, 1963.)
Cf. églament l’hymne en esquisse : (( Qu‘est-ce donc que la vie des hommes? Une image de la
divinité. n (Trad. G. Roud, La Pléiade, 1967) et Jacob Boehme, Six points théosophiques (III, 6.14.) :
N Car la vie des hommes est un véritable miroir de la divinité étant donné que Dieu s’y regarde. n
V. 87-89. (( ...est le nombril/de cette terre ». Allusion à I’Omphalos, déposé au temple d’Apollon
à Delphes. Chez Holderlin, Francfort, où résidait Diotima, est mis sur le même plan.
V. 90. N Nationnellement ». Ce terme apparaît dans la deuxième lettre à Bohlendofi (no 240); (( La
lumière donnant forme riationelle, en tant que principe et à la manière du Destin ... )) (Trad D. Naville,
Gallimard, 1948.)
V. 91. U De la fusion allemande ». Cf. Germanie », v. 90-91.
V. 93 sq. (( Mais une colline sauvage surplombe le versant ... ». Description topographique exacte de
l’endroit où l’étroit plateau de la Tek se termine. Cf. U La Tek », v. 37-41.
))
<(
((
((
116
))
V. 101 sq. (( Un noyer ... )) Plutôt que d’un noyer, il s’agit vraisemblablement d’une description du
sureau (Heirrnder/ Holder), donc d’une allusion de Holderlin à son propre nom. Sattler complète la
syllabe K Ho (307-76, v. 8) en U HoIrinder M dans son analyse du texte.
V. 104- 106. (( Chant raffermi/ de fleurs ». Selon Sattler, les fleurs correspondent au topos de la poésie.
Le jeune Holdrrlin a publié le deuxième cycle des hymnes de Tübingen dans l’almanach de Staudlin
intitulé Fioriiige poétique (Poetrsche BIctmenkse) bien qu’il ait combattu l’idée de réduire les poèmes i
une collection de fleurs. En ce sens, chant raffermi )) désigne le contenu de vérité transmis précédemment
par la philosophie. Comme il le confiait à sa mère au début de l’année 1799 : (( Mais ce que je sais,
c’est que je me suis trouvé dans un état de profond désarroi et de mécontentement à force de poursuivre
avec une attention et des efforts exagérés des occupations probablement moins conformes à ma nature,
telle que la philosophie; et je l’ai fait par bonne volonté, par crainte de passer pour un poète vide
(Trad. D. Naville, Gallimard, 1948).
Et pourtant ce n’est pas cela qu’il avoue, mais une nouvelle formation n qui n’a rien à voir ni avec
l’odeur de citron de I’Acifklarung, ni avec ce qui, plein d’onction, émane de la province où est située
cette ville diaphane, pénétrante au point qu’il doit presque s’excuser de cette double simplicité qui lui
est advenue en France.
V. 109. (!,Une odeur de citron et d’huile sur la Provence ». Contrairement à Beissner, Sattler lit d’une
part der 01 (Gerrtch) er c uuf der Provence d’autre part. I1 rappelle qu’on utilisait les citrons pour
leurs vertus odoriférantes lors des enterrements par temps de grande chaleur.
V. 12 1. Vous fleurs de l’Allemagne ». Cf. la traduction de Holderlin des Nétnézdes de Pindare, v. 87 où les héros sont désignés par le terme de fleurs ».
V. 125. Io Bacche ». Cri rituel du culte de Dionysos.
V. 135-137. (( Cela que personne/ Ne me l’envie ». Cf. (( Au très célèbre », v. 5 .
V. 1.39. Le droit du charpentier ». Le charpentier marque la poutre qu’il a préparée pour une toiture
de sa croix ou d’un autre signe, comme le fait un tailleur de pieme.
V. 140-141. Un petit espace ». Cette conception est justifiée par la fonction du poète et par une
reprtsentation non limitée du pays paternel; elle s’oppose à l’essai de Fichte paru en 1800 : Der
geschIossene Handeh t u a t .
Par ailleurs, on lit dans une variante du Fragment tardif de (( Patmos N (v. 117) : (( Pour maint
homme, le pays paternel était un petit espace. N
V. 157. Au foie ». Rappelons que chez les Grecs, le foie était considéré comme le siège des sentiments.
Cf. Eschyle, Euménides, v . 135.
((
))
((
))
f,
J)
((
((
((
((
APRIORITÉ DE L’INDIVIDUEL
(Reconstitution de la Ireesquisse)
C’est par l’abîme en effet que nous avons
Commencé et que nous sommes partis
Tel le lion
Qui est couché
5 Dans l’incendie
Du désert
Mais bientôt comme un chien s’en ira
Dans la chaleur ma voix par les ruelles des jardins
Où habitent des hommes
10 En France
Mais Francfort, d’après la forme qui
Est l’empreinte de la nature
De l’homme en effet est le nombril
De cette terre. Ce temps aussi
15 Est le temps, et de la fusion allemande.
20
25
30
35
Mais une colline sauvage surplombe le versant
De mes jardins. Des cerisiers. Mais un souffle âpre tourbillonne
Autour des cavités du rocher. Mais à droite s’étend la forêt. Partout
en ce lieu je suis
Tout à la fois. Mais
Merveilleusement au-dessus des sources se penche svelte
Un noyer, et des baies, comme du corail,
Pendent à l’arbrisseau au-dessus des chalumeaux de bois,
De ceux-ci, chant raffermi de fleurs,
A l’origine, de blé, mais pour l’avouer maintenant,
Une nouvelle formation née de la ville où
Mais jusqu’à la douleur monte au nez
L‘odeur d’huile sur la Provence, et ce naturel
Et cette reconnaissance les pays de Gascogne me
Les ont donnés, mais éduqué, à voir encore, m’a
Le plaisir de la rapière et les raisins bruns du jour de fête
et me recueillez ô
Vous fleurs de l’Allemagne, ô mon cœur devient
Infaillible cristal où
Allemagne Et allez
La lumière s’éprouve quand
Lors de la ronde nuptiale et le bouquet de la promenade.
L’APRIORITÉ DE L’INDIVIDUEL SUR LE TOUT
(Reconstitution de la 2’ esquisse)
Enrôleur! de l’abîme des Polaques, nous n’en sommes pas
Mcr TOV oplcov
A cause des savants et partis dans le doute et l’indignation,
Car plus sensibles sont les hommes
118
Dans l’incendie
Du désert,
Ivres de lumière et l’esprit animal repose
Avec eux Mais bientôt, comme un chien, s’en ira
Dans la chaleur ma voix par les ruelles des jardins
10 Où habitent des hommes
En France
Mais pendant ce temps d’après mon ombre
J’oriente et miroir le pinacle
Vers mes princes
15 La hanche sous l’étoile et tourne en chant de coq
L’instant du triomphe
Mais Francfort, pour dire du nouveau, d’après la forme qui
Est l’empreinte de la nature
Est pour le cœur
20 De l’homme désolant. Car ce n’est pas en vain que l’esprit doit honorer
Du soleil le fouet et la bride. Mais
Cela veut dire le destin.
5
APRIORITÉ DE L’INDIVIDUEL
(Reconstitution de la 3’ esquisse)
Germania
5
10
15
20
Mais une colline sauvage surplombe le versant
De mes jardins. Des cerisiers. Mais un souffle âpre tourbillonne
Autour des cavités du rocher. Mais difficilement passe le long des montagnes
Le chemin joyeux. Partout en ce lieu je suis
Tout à la fois. Mais
Merveilleusement au-dessus de la source se penche svelte
Un noyer et des baies, comme du corail,
Pendent à l’arbrisseau au-dessus des chalumeaux de bois,
De ceux-ci, plus affermi que de fleurs
Le chant, à l’origine, de blé, mais, pour l’avouer, maintenant
Nouvelle formation née de la ville où
Mais jusqu’à la douleur monte au nez
L’odeur d’huile sur la Provence, et ce naturel
Et cette reconnaissance les pays de Gascogne me
Les ont donnés. Mais rendu docile, à voir encore, et m’a nourri
Le plaisir de la rapière viande rôtie de la table et raisins, bruns
et lune et destin
Depuis longtemps éduquer
Et Dieu, mais vous, ô recueillez
Vous fleurs de l’Allemagne, ô mon cœur devient
Infaillible cristal où
La lumière s’éprouve quand
Allemagne Et allez
Lors de la ronde nuptiale et le bouquet de la promenade.
..........................................................................................................................
119
Mûrs sont, plongés dans le feu, cuits
Les fruits et sur la terre éprouvés et c’est une loi
Que tout y entre, prophétique,
Tels des serpents, rêvant sur
5 Les collines du ciel. Et beaucoup
Comme sur les épaules un
Fardeau de bûches doit
Etre retenu. Mais mauvais sont
Les sentiers. En effet, à tort,
10 Comme des chevaux, vont les éléments
Captifs et les anciennes
Lois de la terre. Et toujours
Jlusqu’à la dissolution va une nostalgie. Mais beaucoup doit
Etre retenu. Et nécessité, la fidélité.
15 Mais nous risquant en avant et en arrière nous ne voulons
Pas regarder. Nous laisser bercer comme
Sur une barque balançant sur la mer.
..........................................................................................................................
Mais il va nous arriver pour
Abandonner
La chaude crainte, au foie
Une gaucherie, pour qu’ils apprennent la destination des mains
5 Avec le même
Vengés ou de l’avant. Que la vengeance en effet
Recule. Mais nous sommes
Pareils aux communs, que pareils
Aux nobles, Dieu tente. Mais interdiction
10 Est faite de s’en glorifier. Mais un cœur voit
Des héros. I1 est mien
Le discours du pays paternel. Cela que personne
N e me l’envie. De même, c’est ainsi
Que le droit du charpentier
15 Fait la croix.
20
Épée
et couteau en secret, quand un
aiguisés
médiocre bien.
Mais que le pays paternel ne devienne pour nous
Un petit espace. Difficile est le
D’être couché, avec bras et jambes, les mains aussi
Rien que de l’air.
Traduit par B. Badiou et J.-C. Rambacb
L’ARCHIPEL
Ton rivage a-t-il vu le retour des oiseaux voyageurs? Et la voile
De nouveau cherche-t-elle à s’enfuir sur tes bords? Les souffles souhaités
Font-ils frémir ton flot longtemps calme? Et vois-tu se chauffer au soleil
Le dos des dauphins attirés hors des fonds par la neuve lumière?
Est-ce l’heure où fleurit l’Ionie, est-il temps? Ah! quand vient la saison
Où le cœur des vivants rajeunit, où l’amour retrouvé les réveille
Et les baigne à sa source première et rappelle et promet l’âge d’or,
Père Archipel! me voici près de toi saluant ton repos!
Car tu vis, ô Puissant! et toujours sans vieillir tu reposes dans l’ombre
De tes monts, comme alors, et toujours étreignant de tes bras de jeune homme
La terre que tes vagues entourent, le pays ravissant de tes filles.
Pas une île perdue! Oh, pas une des fleurs de tes eaux n’est perdue!
Crête est debout et Salamine a reverdi, et, sous la lueur des lauriers
Ornée d’une auréole de rayons, à l’heure où s’enflamme l’aurore
Délos élève son front inspiré! Et Ténos et Chios
Regorgent de fruits empourprés, et, du haut de ses collines ivres,
La boisson de Cypros ruisselle, et, sur les pentes de Kalauria
Comme alors, les ruisseaux argentés gagnent l’onde ancestrale du Père!
Toutes sont là, les îles, les mères immortelles des Héros.
Les printemps successifs voient leurs fleurs; mais au temps où du fond de l’abîme
La flamme de la nuit, l’ouragan souterrain déchaînant sa fureur,
Saisissait tout à coup l’une d’elles et jetait dans ton sein la mourante,
Tu restais patient et divin car ta face impassible aura vu
Plus d’un monde apparaître et sombrer sur les gouffres remplis de ténèbres.
Et toujours, les Pouvoirs des hauteurs, les divins habitants de la nue,
Dont la force paisible à jamais fait pleuvoir sur la tête des hommes
La joie du jour, le suave sommeil et le pressentiment,
Eux aussi tes anciens compagnons débordant d’éternelle puissance,
Près de toi comme alors sont restés, et souvent, quand le soir se répand,
Quand du fond des montagnes d’Asie apparaît la lumière sacrée
De la lune et qu’au fil de tes flots les reflets des étoiles se croisent,
La lueur de tes eaux change et bouge à mesure que passent
Les clartés cheminantes du ciel, et la voix de tes frères, là-haut,
Retentit, merveilleuse, et leur chant redescend sur ton cœur plein d’amour.
Et plus tard, quand revient le soleil dont l’éclat transfigure le monde,
Lorsqu’il brille à nouveau, lui le Fils de l’orient, le porteur de miracles,
Et quand vont les vivants commencer à revivre dans l’or de ce rêve
Radieux que prépare pour eux chaque jour l’enchanteur du matin,
Son magique pouvoir de nouveau rend la joie à ton âme attristée,
Et sa propre lumière amicale elle-même a bien moins de splendeur
Que le signe vivant de l’amour, la couronne de feux toujours fraîche
Dont il songe, fidèle, à parer les cheveux grisonnants de ton front.
Et du haut de l’éther qui te joint, tes flottants messagers, les nuages
N e reviennent-ils pas t’apporter le présent que les dieux leur confient,
Le rayon? Et voici que ton souffle les pousse à tes rives brûlantes,
Pour que grondent là-bas les forêts où le vent plonge et creuse une houle,
Et que tombe l’orage attendu, et, bientôt, que pareil à l’enfant égaré
121
Revenant à l’appel de son père, le Méandre avec mille ruisseaux
Précipite sa course affolée, et que vole vers toi le Caystre
Joyeux d’abandonner la plaine, et qu’enfin ton premier-né, le Nil,
Après s’être caché si longtemps dans le sein des lointaines montagnes,
Tel un vainqueur majestueux, porté dans le fracas des armes, s’avance,
Superbe, ouvrant ses bras à l’épouse enflammée de désirs.
Et pourtant, tu te sens solitaire, et, dans l’ombre des nuits taciturnes,
Le rocher peut entendre ta plainte, et ta vague en colère, souvent,
Se soulève, et, volant vers l’azur, fuit le triste séjour des mortels.
Car tes fils préférés, car tes nobles enfants ne sont plus près de toi,
Eux qui t’ont vénéré, qui savaient autrefois couronner de beaux temples
Et de belles cités ton rivage. Et ton cœur affligé désormais
Vainement les appelle. Ah! de même qu’il faut aux héros des couronnes,
I1 faut aux divins éléments la gloire que donnent les hommes!
..................................................................................................................................
Ici la musique holderlinienne, sans changer de rythme, emprunte un mode plus familier pour ramener
la vie sur les bords abandonnés de l’Archipel. Le temps s’efface, et peu à peu la puissance du chant,
comme dans le mythe du thébain, fait apparaître et s’édifier devant les yeux du poète, avec les
mouvements aisés que prennent toutes choses dans les rêves, les murs, non de Thèbes, mais d’Athènes;
le même pouvoir peuple les places et les rues de la ville retrouvée, l’Agora où, (( mouvementée-commel’orage gronde la voix de la foule, et, plus loin, au-delà des portes, le Pirée, où le marchand (( dontla-pensée-se-porte-au-loin s’apprête à s’embarquer afin d’assembler les biens dispersés de la terre et
d’unir le proche au lointain ».
Cependant l’ennemi du génie, le Perse qui-aime-à-commander », amassant tout au long de 1’anni.e
des monceaux d’armes et dénombrant avec orgueil ses milliers de soldats, médite d’envahir la terre des
Grecs - et soudain passe à l’acte. Le poème, d’un élan puissant, prend sa course, tantôt nombreux et
grondant comme l’invasion, tantôt rapide et heurté comme le choc des escadres dans la rade de Salamine.
Ainsi que l’a écrit Gundolf, la défaite de Xerxès représente pour Holderlin, non pas un simple événement
historique, mais le triomphe de l’Esprit sur les puissances de la lourdeur )).
Le Roi s’enfuit avec ses hordes, et la terre Hellène accueille ses héros triomphants. La musique du
poète, une fois encore, reconstruit les temples abattus, les demeures incendiées; les mesures de chaque
vers, spacieuses, transparentes, s’emplissent de syllabes claires. Mais le génie bâtisseur n’est pas seul : la
forêt lui donne ses arbres, la montagne son marbre et ses métaux pour que l’œuvre, la vie et les dieux
soient d’accord.
(( Et longtemps encore a fleuri la colline d’Athènes et plus d’une fois ses fils réunis sur le promontoire,
ont chanté de nouveau le chant de gratitude en l’honneur du dieu de la mer. )) Les derniers vers de
cette strophe sont seuls écrits au prétérit pour signifier que le temps rétablit sa solennelle hiérarchie : le
passé glorieux prend sa place au plus haut échelon, d’où son visage nous sourirait si nous savions
l’apercevoir. Mais, un coup d’aile funèbre, les siècles d’oubli, et notre monde exilé loin de la divinité
le cachent de nouveau comme une épaisse et charbonneuse fumée passe devant le soleil. Le poète va
dissiper ce nuage : il prévoit ce que sera, non pas le retour du dieu parmi les hommes, mais le moment
où nous serons dignes de reconnaître en nous une éternelle présence. I1 court au-devant de la révélation
et l’annonce dans !es strophes finales.
))
))
((
((
((
..................................................................................................................................
Tant de nobles enfants, fils pieux que leur mère Fortune a nourris,
Est-il vrai qu’oubliant leurs destins révolus les voilà loin de nous,
Retournés au refuge éternel de leurs pères là-bas? Est-ce vrai
Que leur foule a passé sans regret le Léthé, sans désir d’un retour?
Est-ce en vain que mes yeux chercheront, ah! sur tous les chemins de la terre,
A vous voir vous lever de nouveau, grandes formes semblables aux dieux?
Est-ce en vain que j’appris à parler votre langue, est-ce en vain que je sais
Ce que disent de vous les récits? Est-ce afin que, d’une aile attristée,
Loin de moi, avant l’heure, mon âme au séjour de vos ombres descende?
Mais non! Plus près de vous, là où l’arbre des bois consacrés
Toujours croît, où le Mont solitaire et divin se voile de nuages,
Jusqu’aux pieds du Parnasse j’irai, et, dès que, dans l’ombre des chênes,
122
Brillera la lueur de ton flot surgissant, Castalie! Ah! je veux
Dans la vasque puiser, à travers le parfum de tes fleurs, et répandre,
Sur le sol où renaît la prairie, l’eau sacrée et mes larmes, afin
Qu’une offrande pourtant vienne encore, ô dormeurs délaissés! vous atteindre!
Et, plus loin, dans le val qui se tait, près des rocs suspendus de Tempé,
Près de vous j’élirai ma demeure à jamais, près de ‘vous, noms splendides!
Et la nuit m’entendra à voix basse appeler et, parfois, si le soc
Profanant vos tombeaux vous réveille irrités et vous force à paraître,
Le chant d’un cœur pieux viendra vous calmer, Ombres saintes!
Et si toute mon âme enfin à vivre avec vous s’accoutume,
Laissez, ô Morts! que celui qui vous est consacré interroge
Sans relâche votre ombre, et vous, les vivants, hautes forces du ciel,
Chaque fois que portant sans effort vos années, au-dessus des décombres
Vous passez, immortels voyageurs d’une route au parcours sans péril,
Vous aussi, répondrez-vous enfin? Car souvent, quand je vais sous les astres,
Épiant un conseil, tout à coup, comme si l’air des nuits retombé
M’étouffait, cette atroce pensée qu’à présent mon attente est bien vaine,
Me saisit à la gorge! Ah! depuis trop longtemps, ô Dodone!
Ton bois prophétique a cessé de répondre à notre âme indigente.
I1 s’est tu, sol de Delphes, ton Dieu! et depuis trop longtemps sont déserts
Les sentiers qu’autrefois, vers la ville où l’attend le devin sans mensonge,
Gravissait le passant que l’espoir doucement accompagne et conduit!
Mais, là-haut, la lumière encore aujourd’hui parle aux hommes et laisse
Deviner des propos pleins de sens merveilleux, et le dieu du tonnerre
Dit : (( Pensez-vous à moi? )) et le flot désolé du divin Archipel
Retentit : (( M’avez-vous oublié? Suis-je seul et perdu pour vos songes? ))
Car il plaît, aujourd’hui comme alors, aux grands souffles du ciel de descendre
Dans un cœur qui s’émeut et connaît en secret leur présence, et toujours
Les maîtres tout-puissants qui dispensent le trouble sacré ont plaisir
A conduire quiconque s’élève, et toujours, pays grec, sur tes cimes,
Repose et règne, et vit, partout présent, l’éther,
Afin qu’un peuple aimé des dieux, dans les bras de l’Ancêtre,
Humainement joyeux comme au temps d’autrefois, se rassemble
Et ne soit de nouveau qu’Un seul esprit commun à tous.
Cependant, ô douleur! notre race, oublieuse des dieux, est plongée
Dans la nuit. Sa demeure est semblable aux enfers. Et chacun, dans les chaînes
D’un geste défini, au milieu du tonnant atelier, n’entend
Que son propre travail. Ah! le labeur de ces hommes farouches,
L’effort puissant des bras, la peine persévère, et pourtant
Se révèle inféconde et pareille aux stériles Furies, et sera
Telle encor, jusqu’au jour, où sortant de son rêve anxieux, l’âme des hommes
Juvénile et joyeuse soudain se lèvera! Où l’haleine divine
De l’amour, comme aux temps où sa grâce comblait les enfants de l’Hellade,
Soufflera dans le siècle nouveau, et où, sur nos fronts délivrés
Désormais, nous verrons reparaître l’Esprit de la Nature, lui
Qui descend des lointains jusqu’à nous, dans l’or des nuages, le dieu!
Ah! pourquoi tardez-vous, ô réveil! Et pourquoi tous ceux-là de naissance divine
Sont-ils encore, ô jours! dans la terre profonde couchés
Solitaires, en bas, cependant qu’un printemps au retour immortel
Rallume, non chantés, au-dessus de leurs fronts de dormeurs, ses feux pâles?
Mais notre âme ne veut plus attendre! Déjà j’entends au loin
Le chant choral clamant le jour d’allégresse, qui sonne
Sur les pentes des monts verdoyants, j’entends déjà l’écho
Des bois sacrés répondre aux voix des jeunes hommes, quand
Libre et calme, par l’hymne jailli de son peuple, s’exhale
L‘âme unique en l’honneur du dieu à qui l’altitude convient.
Mais sainte est aussi la vallée, et là où s’accroît le torrent
A travers mille fleurs, et là, où, s’offrant au soleil de la plaine, le grain
Devient mûr, où mûrissent les fruits d u verger, c’est là que s’assemblent souvent
Pour la fête, le front couronné, tous ceux qui révèrent les dieux,
Et c’est là qu’au-dessus des coteaux dominant les cités, resplendit,
Semblable aux demeures des hommes, le céleste parvis de la joie.
Et voici qu’alentour toute vie a pris un sens divin,
Et le peuple aperçoit ton pouvoir, qui toujours accomplit et parfait,
En tous lieux, ô Nature! et, ainsi que d’un roc riche en sources, ruissellent,
Issues de toutes parts, les divines faveurs dans les âmes.
Et voici, et voici, dans Athènes la joie et les actes dans Sparte! ô printemps,
Précieux renouveau sur la terre des Grecs! Ah, quand vient notre automne,
Quand vous aurez mûri, vous tous, esprits du monde antique,
Alors, alors, revenez et voyez : notre année est bientôt accompli?!
O flots à jamais fugitifs des torrents, chantez ce que dit le destin!
Mais toi, si le chœur des Hellènes sur ta vague n’est pas revenu
Comme alors te louer, ô grand dieu de la mer! ô toi qui ne meurs pas!
Résonne encor souvent dans mon âme, afin que, volant sur les eaux,
Mon esprit, d’un élan de nageur, agile et sans crainte, s’exerce
Au vigoureux bonheur des forts et comprenne la langue des dieux :
Le mouvement, le devenir! et si le temps impétueux saisit trop violemment ma tête,
Et si, près des autres mortels, ma mortelle existence, ébranlée,
Frémit de détresse et d’erreur, alors, ah! permets à mon âme
D’aller, au fond de ton abîme, se souvenir de la Tranquillité.
Que soient donc retenus près de nous, célébrés comme une autre moisson,
Vos miracles, ô jours disparus! Que le peuple en liesse regarde
Vers l’Hellade! et, qu’au fond de l’esprit qui regrette et rend grâces,
Le jour triomphal s’adoucisse en touchant l’immortel souvenir!
Cependant, fleurissez, avant que nos fruits dans nos vergers commencent,
Fleurissez, frais jardins d’Ionie, et vous, sur les ruines d’Athènes,
Herbes tendres, cachez tout ce deuil au jour qui regarde et comprend!
Couronnez d’un feuillage éternel, ô forêts de lauriers! les collines
Qui s’élèvent autour de vos morts, sur cette terre auprès des champs de Marathon
Où vos fils triomphants ont péri! et là, plus loin, ah! sur le sol de Chéronée
D’où se sont envolés tout armés, fuyant le grand jour de la honte,
Pour toujours les derniers Athéniens, là, là, depuis la cime des montagnes
Jusqu’en bas, sans repos, en tombant dans le val de la guerre, ah! pleurez,
Voix des sources! du haut de 1’CEta descendant votre plainte inlassable,
Traduit par J. Tardieu
A propos de la traduction d’un rythme
<< L’archipel D de Holderlin, - long décbaînemerit lyrique dont les deux cent quatrevingt-seize vers sont soulevés par un soufle presque ininterrompu - exprime et figure
l’identité entre la voix divine qui ravit un poète dans les plus lumineuses régions d u n
monde intemporel, et l’inspiration profonde d u n de ces brefi moments du temps où parut
124
se réaliser le plus complètement sur la terre l’union du divin et de l’humain : l’Athènes
de Périclès.
Dans ce poème, le rythme, par l’intention qui a guidé le choix de la forme, est
encore plus important, s’il est possible, que dans toute autre création lyrique :<< L’archipel »,
en effet, est écrit en vers hexamètres, forgés sur le modèle des hexamètres grecs. Holderlin,
de bonne foi, sans la moindre intention de parodie, retrouve la K longue ligne U des anciens;
il reprend du fond de son être et comble d’une inspiration enfin vraiment païenne ce
rythme que Klopstock avait su acclimater dans la langue allemande en faisant coi’ncider
exactement e t harmonieusement la loi de la quantité ou durée des syllabes qui, en prosodie
allemande, est une loi surajoutée, savante, e t la loi primitive e t spontanée du rythme
germanique dont la base est l’accent.
Cette prosodie allemande quantitative, bien qu’arttficielle, peut trouver aussi sa
justification dans le langage parlé : l’accent dit K d’intensité N entraîne nécessairement un
certain allongement de la syllabe qui le porte, un certain accroissement de durée :lorsqu’on
prononce une syllabe avec plus de force que le reste du mot, on marque un léger temps
d’arrêt sur elle. Cette part de durée, cette insistance de la voix en certains points a
permis aux poètes allemands, e t à Holderlin en particulier, de faire toujours coïncider un
accent avec le K temps fort U de chacune des K mesures U qui forment l’hexamètre, - de
sorte que chaque vers de << L’archipel n comprend six accents et six temps forts superposés
à autant de syllabes longues, par exemple :
Kehren die Kraniche wieder zu dir und suchen zu deinen Ufern ...
I l serait absurde, il serait inutile de vouloir faire passer dans la langue francaise
un tel poème, où la milsique joue le rôle d’un indispensable, d’un primordial élément, si
l’on se bornait à traduire uniquement ce que l’on est convenu d’appeler le N sens U , si l’on
n’essayait pas de donner simultanément un équivalent français du rythme et de la mélodie,
- si l’on ne cherchait pas à traduire la musique du poème de même que l’on en traduit
le sens N. La musique des vers est déjà elle-même près de la moitié de leur signification,
en même temps que la signification entre pour plus de moitié dans l’enchantement musical
que procurent les œuvres des poètes. s’il est vrai que, dans le cercle de la vie, le rythme
a pour mission d’organiser un mouvement qui se prolonge, de lui permettre de durer en
lui offrant des points d’appui et de repos, on aperçoit comment le rythme de l’expression,
en organisant de telle ou telle manière l’expression de l’émotion, prend un sens, est luimême un sens. Mais il y a aussi l’importance des sons eux-mêmes, leur valeur symbolique,
I‘harmonie expressive que f a i t naître l’enchevêtrement complexe des consonnes e t des voyelles :
rythme, harmonie, - cette musique du vers est inséparable de son sens. Vouloir traduire
U à froid U , c’est-à-dire traduire seulement les idées e t les images d’un poème sans le bain
musical qui les porte, qui les pénètre, qui est leur élément naturel, cela équivaut à peu
près à I‘eweur d u n romancier qui, voulant décrire l’épouvante, parlerait seulement de ta
représentation, ou de l‘image du danger, du jugement rapide qui reconnaît e t comprend
la menace, e t négligerait tout le grand bouleversement de l’émotion que cette image e t ce
jugement engendrent instantanément par tout le corps.
Ces remarques expliquent pourquoi le seul moyen de traduire l’hexamètre holderlinien
paraît être d’employer un vers français basé non sur le nombre des syllabes mais sur
l’accentuation : un vers qui aurait six accents principaux. Peu importe le pr$ugé admis
qui veut que l’accent dans la langue française soit ou semble être peu prononcé. Cela
vient peut-être de ce que, à l’opposé de l’accent allemand par exemple, il ne souligne pas
nécessairement le sens radical ou principal d’un mot. Tel quel, situé presque unqormément
sur la dernière syllabe (à moins que celle-ci soit muette GU que le mot ait plus de trois
syllabes) l’accent tonique français est cependant nettement perceptible. Sa particularité,
sa nuance est d’être représenté surtout, à la différence de l’accent allemand, par un léger
accroissement de quantité e t de n’admettre qu’à un degré moindre l’accroissement d’intensité: on traîne la voix plutôt qu’on ne la renforce.
Cette relation entre l’intensité e t la quantité peut permettre de construire un vers
(Y
125
français en prenant pour appui non pas un nombre déterminé de syllabes supposées d’égale
durée et d’égale valeur, mais une mesure véritable qui aurait pour temps fort L’accent,
c’est-à-dire une syllabe qui dure e t qui, en même temps, est plus fortement prononcée.
Cependant, le principe d’un vers ainsi forgé ne serait nullement nouveau. Alors
même, en effet, qu’ils feignaient de suivre uniquement la règle d’une prosodie syllabique
(nombre de syllabes, rimes, césure) les poètes français ont, de tout temps, obéi en secret
aux lois du rythme tonal, lois qu’ils n’ont avouées que récemment. I l serait banal de
rappeler ce fait aujourd’hui bien connu si L‘on ne le complétait d’une remarque nécessaire :
la plupart des personnes qui, à la suite des poètes et en exagérant leur pensée, se sont
spécialement intéressées au rythme poétique, ont affecté de ne voir surtout, dans L’énigme
proposée, qu’une pure question de mécanismes, comme si leur effort tendait à réduire tout
le qualitatif à quelques formules numériques. Mais, de leur côté, les écrivains se sont
toujours obstinés, avec un superbe dédain, dans une K erreur w qui est leur raison d’être :
ils réclament avec insistance que l’on ne touche pas à cette part de qualité qui est l’objet
de toute leur tendresse. Sans omettre de s’incliner avec respect devant la majesté des
nombres, dont ils ne peuvent d coup sûr se passer, ils ont toujours demandé que le côté
qualitatif des choses de leur art f g t considéré en lui-même e t comme étant non point tant
connaissable que perceptible. C‘est à la condition de réserver ce qui échappe au mécanisme
que L’on peut se permettre de porter une attention curieuse aux éléments mécaniques dont
le plus fluide poème est armé.
Comme le rythme de la musique (lorsqu’elle est perçue e t non lue), le rythme poétique,
en effet, paraît naître de L’intime alliance de deux principes, - ou plutôt il est cette
magique étincelle qui jaillit lorsque sont rapprochés, à une distance que l’instinct seul
apprécie, deux pôles de nature opposée : celui de la quantité mesurable, - figure de la
nécessité - e t celui de L’impondérable, de L’incommensurable qualité sensible - fraîche
figure du hasard e t de la nouveauté.
Le premier de ces termes, le terme mécanique, pourrait être, en ce qui concerne la
poésie française, brièvement analysé ainsi : le rythme de chaque vers, et, dans certains
cas, d’une suite de vers, s’appuierait essentiellement sur Le retour, à des intervalles égaux
ou sensiblement égaux, de temps forts, c’est-à-dire de syllabes naturellement accentuées
dont L’accent est encore renforcé par l’importance, dans le poème, de la signification des
mots qui portent cet accent, renforcé aussi par comparaison avec la valeur moindre des
syllabes faiblement accentuées, atones ou muettes, qui les entourent. Les K mesures marquées
par les accents principaux du vers seraient comblées par un nombre variable de ces syllabes
à tonalité moindre, à signijcation moins riche, qui, les intervalles entre les temps forts
étant égaux, se prononcent plus ou moins vite : chaque syllabe des K temps faibles w
occuperait ainsi tantôt la moitié, tantôt le tiers ou le quart d’une K mesure w ,
Les six vers suivants d’Andromaque, par exemple, selon la prosodie française
classique, sont réguliers .v e t égaux entre eux : en réalité, les mouvements différents des
sentiments qu’ils expriment les font correspondre à six coupes rythmiques différentes :
((
HERMIONE
(à Pyrrhus)
Vous ne répondez point? Perfide! Je le voi,
Tu comptes les moments que tu perds avec moi.
Ton cœur, impatient de revoir ta Troyenne,
Ne souffre qu’à regret qu’une autre t’entretienne,
Tu lui parles du cœur, tu la cherches des yeux.
Je ne te retiens plus, sauve-toi de ces lieux.
On voit par exemple que la première mesure du premier vers se prononce environ
dans le même intervalle de temps que la seconde mesure de ce même vers, et que, par
conséquent, un groupe de six syllabes peat, en raison de la coupe, e t non de la nature
phonétique de ces syllabes, être affecté à peu près de la même valeur de durée qu’un
groupe de deux syllabes, ou parfois qu’une seule syllabe : celle du temps fort.
126
De ces différents rythmes, celui du cinquième vers paraît être le plus capable de
donner une impression de longue haleine analogue à celle qu’impose l’hexamètre, à condition
de réunir pour chaque vers, non plus quatre, mais six mesures de cette sorte; c’est le
rythme qui a été choisi pour un essai de traduction U sonore U de << L’archipel n de
Holderlin .
Mais ces brèves remarques sur I’élément mécanique des vers ne sauraient aucunement
faire perdre de vue l’autre pôle du mystère rythmique, inséparable du premier : le terme
qui n’est point mesurable, celui de la qualité sensible. Celui-là par définition ne souffre
pas I’approche du compas et de la règle e t l’on ne peut davantage fixer sur un exemple
ni sur dix, ni sur dix mille I’infinie diversité qu’il suppose. La manière la plus commune
et, peut-être ici la plus juste, de le dejinir est de ne pas le dejinir, de lui laisser la
puissance d’inconnu qu’il a dans le langage de tous les jours. On peut pourtant le cerner
de prudentes images : la qualité ici serait un décalage insaisissable - tout-puissant parce
qu’insaisissable -, qui rappelle l’infime déviation momentanée, l’obliquité indéterminée et
inintelligible qu’Épicure est obligé de prêter à la chute parallèle des atomes pour qu’ils
se rencontrent e t fassent naître les corps. La qualité dans le rythme serait comparable
surtout à cette avance légère qui f a i t qu’un sentiment court à l’assaut de ce qui risque
de lui échapper ou au léger retard d’un cœur qui attend ce dont il est sir.
Crainte e t sécurité, le rythme naîtrait de I’union de ces deux termes : l’un qui nous
tient, l’autre qui nous fuit. Et particulièrement le rythme poétique - semblable en cela
au rythme de la musique lorsqu’elle descend de ses inhumaines jigures pour venir tourner
autour de notre tête -, apparaît tantôt comme une allusion à la régularité e t à la nécessité
dans un monde où tout serait libre, tantôt comme une allusion à la liberté dans le cadre
strict de la mesure e t de la loi. II nous atteint, il nous frappe avec douceur comme la
fuite d’une aile tendre et palpitante qui serait née d’une courbe absolue e t qui, dans sa
structure e t dans sa forme aurait gardé l’empreinte de son aidguste origine. II allume sa
flamme à cette minute où l’aveugle mouvement des choses se rencontre avec l’imprévisible
souBe de la vie. Par là, il nous f a i t souvenir de deux domaines à la fois, tantôt nous
montrant l’espace illimité à travers la grille qu’il enlace, tantôt nous apportant, au
moment même de la fuite e t de l’oubli, la certitude rassurante du poids de nos pas sur
la terre.
Mais il f a u t encore ajouter ceci : que l’on crée ou que l’on écoute, le corps e t sa
compagne qu’il ne f a u t pas nommer, échangent leurs pouvoirs comme deux sorciers complices.
Toujours le corps commence un rythme ou feint de commencer; ce peut être, comme on l’a
dit souvent, le battement du cœur ou encore la cadence de la marche, ou le soufle. Montée
sur ce galop, la compagne file comme l e vent. Soudain, c’est elle qui reprend l’empire, elle
saisit le thème, et, d’un poing solide, inflexible, traîne e t emporte le cheval pendant qu’il
médite ses ficondes traîtrises.
Ton rivage a-t-il vu le retour des oiseaux voyageurs? Et la voile
De nouveau cherche-t-elle à s’enfuir sur tes bords? Les souffles souhaités
Font-ils frémir ton flot longtemps calme? Et vois-tu se chauffer au soleil
Le dos des dauphins attirés hors des fonds par la neuve lumière?
Est-ce l’heure où fleurit l’Ionie, Est-il temps? Ah! quand vient la saison
Où le cœur des vivants rajeunit, où l’amour retrouvé les réveille
Et les baigne à sa source première et rappelle et promet l’âge d’or,
Père Archipel! me voici près de toi saluant ton repos!
Jean Tardieu
Témoignages
Témoignage *
Michel Deguy
Pour des hommes plus âgés que lui deux cents ans, et qui s’appellent (( nous »,
et qui, fraqais », entendent mal sa langue, a Holderlin )), ce qui nous parle en
s’appelant Holderlin, se donne pour commencer, et pour recommencer, ne s’est donné,
que peu à peu, c’est-à-dire en lectures et en expériences liées (d’une certaine manière
comme des hypothèses et des expérimentations pour vérifier), grâce à des médiations,
c’est-à-dire des médiateurs.
Et je pense à ION, bien sûr, si dès le début, in principio, quelque chose comme
Homère n’était, déjà, plus ou moins là que par I’Hermeneia de Ion et l’ironie
philosophiqzre qui manœuvre Ion.
Dans le cas de Holderlin, c’est tout un réseau de médiations, un labyrinthe que
des fils d’initiation inventaient à mesure, une transduction complexe qui à la fois le
rapprochaient et l’éloignaient - de (( nous N : ce que cherche à murmurer le titre en
français de l’ouvrage heideggerien Approche de Holderiin (que je ponctuerais volontiers
d’un point d’interrogation). Toute une carte d u temps où s’inventent temps du sujet
et temps historique dont les termes de coalescence et de scissiparité diraient l’agencement complexe, temps perdu et temps retrouvé, carte de léthargies et de latences,
de quête et de désoubli; je veux dire que s’il n’y avait pas mémoire de Holderlin et
semblables poètes, s’il n’y avait, comme dit Corbin, notre amour du passé qui seul,
ii proportion de sa force, donne source à l’avenir, il n’y aurait pas de temps.
L’allemand fait entendre pour nous (( français )) la parole holderlinienne dans une
langue parlée mais non parlante (si l’on peut transposer cette fameuse distinction
spinoziste); et sans doute la nécessité de traduire nous força-t-elle à le lire - (( épreuve
de l’étranger D dont se dispense parfois le natif, le compatriote -; mais nous n’entendons
Holderlin qu’en français! Lapalissade que je voudrais nourrir tout à l’heure en faisant
* Ce texte reproduit sans grands changements la communication présentée en mai 1986 à Tübingen,
à l’occasion d’une rencontre organisée par B. Boschenstein et Jacques Le Rider, dont le principal objet
était de témoigner de la présence de Holderlin. - Nous remercions les Editions Gunter Narr (Tübingen)
d. P E . )
de nous avoir aimablement autorisé à republier ce (c témoignage ». (N.
13 1
entendre que son transport, sa (( traduction »,y fait entendre quelque chose d’inouï.
Cependant que - la provenance étrangère ne pouvant être rapatriée - cette distance
le retient de telle sorte que le risque couru par les générations éloignées, je veux dire
qui par vagues successives s’éloignent léthargiquement de la source dans la descendance,
est de ne plus chercher à l’entendre parce qu’il n’aurait plus rien à nous dire. Ma
seule préoccupation, qui n’est ni de philologue ni d’historien, mais philopoétique, si
je puis dire, à savoir celle qu’il continue à (( y avoir de la poésie », donnant donnant,
ma préoccupation, donc, étant, à l’horizon de ces notes, ouverte par la question
téléologique (( à quoi bon Holderlin aujourd’hui, et comment, dans ces temps sombres? ».
*
I1 y a la langue; et il y a les intermédiaires; il y aurait donc à raconter, les Zon
que nous furent Jean Beaufret, Heidegger, et à travers eux les éditeurs allemands toute une mise en perspective. (( Intermédiaire )), dit en français, fait entendre dans
l’ambivalence du mot la position médiatrice et troublante, de ce milieu à la fois
relationnant et préoccupant qui fut, qui est, dans la version plus singulièrement
(( française )) de la métaphysique, la place de l’imagination, a traversée N par Descartes,
accusée par Malebranche ou Pascal, enfin réhabilitée par Baudelaire, de sorte que
pour finir - et grâce à l’irresponsabilité que m’autorise ma rapidité d’écrivain - je la
dirais : (( maîtresse d’erreur et de vérité ».
Toute une (( optique N donc, de réflexion et de réfraction, de foyers et d’horizons
changeants, d’évaluations se réévaluant elles-mêmes.. . Avec peut-être aussi cette évidence U pour commencer )) : nous nous tournons vers Holderlin, nous essayons de nous
retourner vers son œuvre, son temps, le devenir de sa parole. Affaire de respect, de
recul, que ce geste! par où, ce faisant, nous nous opposons - puisque on ne peut
faire tous les mouvements à la fois - aux gestes de la culture actuelle qu’on appelle
(( culturelle )), qui consiste à se tourner vers l’à-venir, par une imagination qui emprunte
l’un de ses plus puissants vecteurs à la science-fiction; et à projeter le futur, par
exemple (( l’horizon 2000 D comme le meilleur, le proche. Un renversement a eu lieu,
plus fort que toute révolution, un renversement pour lequel la perfection devenue
fiabilité n’est plus en arrière, mais (( pour demain )); qui a fait basculer l’Ancien dans
l’intéressant, le plus ou moins intéressant, c’est-à-dire équivalemment (( l’inintéressant )), et tel que, par exemple, le poète n’est plus un type humain héroïque, une
figure de civilisation. Et nous ne pouvons pas omettre - même s’il n’y a lieu maintenant
de s’y étendre - ce danger le plus puissant et le plus trivial qui est celui qu’encourt
la poésie, de n’être plus ni (( chose dangereuse N ni (( chose innocente D; soit le devenir
richesse culturelle de Holderlin, par exemple dans le tourisme, par exemple à Tübingen,
c’est-à-dire son devenir ruine au sens ordinaire à son tour transformé par la technique
en son ère U post-moderne », c’est-à-dire culturelle, sa métamorphose en ruine prestigieuse ou (( patrimoine )) comme si un ultime (( enchantement », que ne pouvait
absolument prévoir le Quichotte dans sa lutte contre (( les enchanteurs », précipitait
l’identité ruineuse du désenchantement moderne et du mauvais enchantement contemporain dont le Merlin technicien serait l’ordinateur, et contre lequel les fameuses
sorties du chevalier-poète seraient sans pouvoir ; absolument préwnues par leur transmutation culturelle.
Quelques mots, donc, à coloration autobiographique et valables pour quelquesuns de ma génération. C’est par l’herméneia de Heidegger, c’est-à-dire par Jean
Hippolyte et Jean Beaufret que notre amour des noms entendit d’abord celui de
Holderlin. Ce dactyle, si l’on veut, ou cet amphibraque peut-être, qui, pour des
adolescents vaguement a germanistes )) par le lycée, commence par l’aspiration et
132
l’appel, la hauteur et la matière, et la grâce propice (Hohe ... Holz ... Hold); s’articulant
par une marque grammaticale plurivoque (der), et pour une fin qui ne rime pas à
Lin mais à Lin’(e), doucement féminisée ... Et sans doute faudrait-il évoquer ici Pierre
Jean Jouve qui nous guidait au chevet de la (( démence N du poète, conduit par
Bettina et Weibiinger - donc dans un certain rapport avec la préférence d’André
Breton pour le romantisme allemand, et par exemple pour Arnim; évoquer un instant
autour de ce beau mot de Démence (lui-même favorisé par le poème de Trakl, et
n’est-ce pas Hypérion lui-même (19 1 I ) qui parlant des chemins pourpres du soir nous
y prépare à la rencontre du jeune Étranger de Trakl?), autour de la Démence, dis-je,
le soin intelligent du DrLaplanche qui par avance contestait les excessives conjectures
de Pierre Bertaux.. .
I1 m’est difficile de retracer ici - et sans doute aussi par défaut de mémoire, de
pensée-fidèle (Andenken) à retrouver minutieusement ce temps-perdu - de retracer la
sphère d’influence, de développer l’enveloppement, holderliniens, de ces années de
formation poétique au seuil de la maturité, où les lectures du volume bilingue Aubier
(trad. Bianquis), les tentatives de traduction en particulier de l’élégie (( Heimkunft »,
les émotions privées et partagées par un groupe d’amis, la décision de prendre les
Fragments et Ebaucbes comme des ruines et les ruines pour des (( contours spirituels »,
et non pas comme des puzzles à pièces manquantes, inspirèrent des expériences qui
furent évoquées dans la Revue de poésie.
Holderlin, ce nom nommait pour nous en propre (c’est-à-dire dans la signifiance
non conceptuelle d’un nom propre) cette topologie complexe, ces 3 en 1 ou cet 1 en
3, cet espace trilobé, trifolié, communiquant par replis avec soi-même, c’est-à-dire
dont le (4 soi-même )) consiste en ces vases communiquants : de la philosophie, de la
poésie, de la traduction, corrélés entre eux en façon de (( réciprocité de preuves )) selon
l’admirable formule mallarméenne, c’est-à-dire selon cette antidosis généralisée antérieure à tout échange effectif, déterminé - (( antidote )) à la faveur de la priorité
(ou a-priorité) de laquelle celui qui parle en première personne, c’est-à-dire au nom
d’un autre, le philosophe (( au nom de la philosophie »,ou le poète (( au nom de la
poésie », a déjà reçu en échange ce qu’il va rendre N ; antidose où celui qui donne
selon son ton a déjà été changé en le donateur qu’il peut être; a déjà reçu sa capacité,
sa contenance, de son autre : est-ce cela le milieu de la tra-duction en général?
Cette tri-logie, de la poésie, de la réflexion critique (au sens rappelé par le
profond essai de W. Benjamin que Ph. Lacoue-Labarthe vient de donner en français
sous le titre (( Le concept de critique esthétique dans le romantisme allemand n), de
la réflexion critique, dis-je, que peut-être désigne encore aujourd’hui l’appellation de
(( la poétique )),
et de la traduction (rapport de l’allemand au grec, au français...),
chacune étant milieu de la relation (médium, moyen) pour les autres et par elles, à
cette tri-logie nous invitait l’œuvre de Holderlin.
La fameuse étude de Heidegger (( Holderlin und das Mesen der Dichtung »,
dépliant les cinq leitmotive, prenait son élan dans le refus de I’induction; ce refus du
(( général », c’est-à-dire de ce qui est valable pour beaucoup qu’on ne pourrait atteindre
que par voie de réflexion abstractive, et par lequel il serait nécessaire que nous soit
préalablement proposée la plus grande variété possible de poésies et de genres
poétiques. Ce refus décidait: N Nous n’avions pas choisi Holderlin parce que son
œuvre réalisait parmi d’autres l’essence générale de la poésie (mais parce que) Holderlin
est pour nous le poète des poètes. N Ainsi la violence anti-inductive de Heidegger
d’une part nous aidait à refuser cette séparation de corps et de biens, j’allais dire
(( très française », entre littérature et philosophie, dont témoignent non seulement la
présentation scolaire du romantisme français, honteusement démunie de réflexion
philosophique, mais certaines thèses philosophiques, par exemple sartriennes, relatives
à l’imaginaire.
133
D’autre part nous confiait (à) une lecture élective, à une élection de leitmotive,
et à la quête d’intellection du (( système N de leurs relations : de beaux noms, ou
syntagmes, désignent ces motifs, ces titres », où la pensée du poème se nomme,
s’intègre, se dit elle-même en réflexion et en énigme, en mots de passe d’elle-même
à elle-même : la résolution du courage poétique, le milieu doré de la relation (Goldene
Mitte traduisant l’aurea mediocritas), le calcul poétique (Recbnung), l’habitation poétique du terrestre.. .
Dont je ne retiens ici, bien des lustres après ces premières approches, que les
motifs qui pour moi furent, et donc sont, les plus décisifs, et qui ne sont pas des
souvenirs ordinaires mais des noyaux actifs de la poétique poursuivie : Principalement :
le retentissement de la traduction de Holderlin dans la langue (le langage?) d u poème
français; la liaison de l’essence avec la figure (le génitif qui relie Wesen et Dicbtung);
et, pour quelques remarques de conclusion, la poétique paradoxale d’une relation de
l’homme avec l’habitabilité du terrestre par l’œuvre d’art.
Quelques remarques sur lu venue en français du poème de Holderlin;
du françuis-de-traduction << hdderlinien
ozl
))
I1 y a un ton, caractéristique, de la traduction de Holderlin en français - au
point que de (( jeunes poètes )) français imitent - peut-être même sans le savoir - non
pas tant Holderlin que le style de la traduction holderlinienne de la deuxième
génération, c’est-à-dire de ceux qui sont entrés en relation avec le poète par Heidegger,
et (c’est-à-dire) par les traducteurs français de Heidegger. Le volume Pléiade fait
cohabiter les deux premières générations, disons Roud et Fédier pour simplifier; je
fais allusion cependant à des jeunes poètes de la troisième génération chez qui on
trouverait, repérables parce que grossies, parfois caricaturées, les tournures dont je vais
signaler certaines.
I1 s’agit - comme toujours quand est pris en vue à un niveau de généralité
convenable le langage poétique formellement considéré, c’est-à-dire ici grammaticalement et rhétoriquement, syntaxiquement et topologiquement -, il s’agit de disjonction et de conjonction; d’un renouvellement de la puissance de dis-jonction : par
transgression d’une loi conformément à laquelle la transgression peut faire ses outrances,
parce que la loi est la loi de dis-jonction, en sorte que dans l’expérience (il ne s’agit
pas d’expérimentation formelle au sens moderne) la loi se re-trouve dans les exceptions
agrandie (augmentée) de ce qui prenait ses libertés avec elle - comme un règne
agrandi se retrouve sous son régime ...
C’est à ces deux titres, à ces deux pôles du dis et du rom (eux-mêmes associés
et renforcés dans leur opposition ’) que se répartissent, se laissent regrouper, les tours
et tournures que notre analyse pourrait pointer et rassembler plus minutieusement
que je vais faire : nouveaux effets de distension et de retension (de diastole et de
systole dirais-je pour conférer la perspective rythmique).
1. Au titre de la dis-jonction (dispersion; écartèlement)
I1 s’agit principalement de la dis-position, c’est-à-dire de la distance et de l’ordre
des mots; on sait qu’en français la place est étroitement surveillée parce que manque
la (( déclinaison )) - ces morphèmes des cas qui autorisent en latin (ou en allemand, etc.
par exemple) de grands écarts entre substantif et épithète (par exemple). Appelons
effets de tmèse et d’inversion en général - dislocation inusitée - le résultat en français
134
de la fidélité à l’ordre des mots dans le poème holderlinien (la fidélité à l’ordre
d’antéposition des épithètes pouvant conduire, par exemple. à ce tic, de répéter
l’article, le groupe article-épithète (( en attendant N la position du substantif, quand
celui-ci est accompagné de plusieurs épithètes).
2. A u titre de l a conjonction, ou condensation
Dans cette perspective, symétrique et complémentaire de la précédente dans le
grand jeu de la dis-jonction, on chercherait les effets d’apocope et de syncope en
général, de parataxe et d’asyndète en général, de zeugma en général, etc. (en tenant
compte, bien sûr, de la perversion de tels effets, je veux dire du fait que des valeurs
peuvent être obtenues à l’inverse de l’efficace supposée directe du procédé : soit à
faire de f’écart par du court-circuit, ou inversement, à la façon dont une vitesse
excessive peut se trouver signifiée et surexposée au cinéma prkisément par le ralenti).
Loin qu’il s’agisse d’une (( licence poétique )) qui (( se permet )> quelques fautes
excusables au titre du mètre ou de la signification (par exemple), nous y entendons
l’esprit de poésie qui force le cours, de la langue qui (( mime )) le frayage, le forçage
et la (( régularisation )) du cours de la langue; qui invente son régime si je puis dire.
Esprit d’audace selon le Pindare de la treizième Olympique, ou esprit du Centaure
selon Holderlin : et il faudrait citer ici le fameux fragment du (( Vivifiant N (97 1) qui
dit la fable de la brusquerie qui coupe, du revirement qui détourne, de la stagnance
qui s’attarde, de l’adversité des rives, de la passerelle du torrent jetée sur des abîmes
de différence : mythe (( chironien )) de la langue où celle-ci dit (allégoriquement et
tautégoriquement 3, la gésine de son privilège.
Les (( fautes )) ou (( écarts )) sont transgression (a-« gressions ») qui réactivent les
tournures violentes que prévoit la langue en sa rhétorique, ou : qui prévoient la langue
grâce à l’excès de, à l’outrance dans, ces tournures mêmes qui légalisent la vitesse ou
la lenteur, l’écartement ou le resserrement, la disjonction (( en général N.
Oui, il nous est arrivé de préférer (( le français de Holderlin )) (!) à la séquence
hugolienne (( bien de chez nous D; la langue de traduction faisant parler un français
(< inouï )), à la prévisibilité - quand bien même audacieuse - du dodécasyllabique;
le ton entonnant une liberté d’allure pareille à celle du fleuve Centaure se frayant,
copieuse et profonde, torrentueuse et entrecoupée, creusant par son impetus un cours
forcé qui l’arrache à la confusion (( aorgique )) (avec ces blancs, ces interruptions, ces
pertes de cours!), de les préférer à (( la liberté d’association )) surréaliste moins rythmique,
moins pensive. Plus proche pour nous ce qui venait de plus loin; plus familier dans
son étrangeté; nous (( concernant )) davantage. Holderlin devenait éponyme pour une
(( avant-garde )) dont la question préférée, la préférence, fut (et est) celle de la relation
dite de voisinage entre les plus séparés, du voisinage abyssal donc entre ((poésie et
pensée )) : qu’est-ce que voisiner par un abîme, entretenir échanges sur un abîme?
L’être-comme-la-musique de la poésie, cette quasi-musicalité qui se dit chez
Verlaine par la fameuse injonction à ce qu’elle n’est pas (parce que la poésie n’est
pas la musique), (< de la musique avant toute chose », voici que Holderlin, pour notre
attention tournée vers lui selon l’orientation heideggerienne que j’ai rappelée, nous
engageait à lui préfkrer une autre proximité, insondée - peut-être insondable si c’est
par un abîme, l’abîme entre les (( monés les plus séparés )), que, les voisins voisinent,
se parlant de chaque côté d’un sans fond, partagés en voisins par la faille infranchissable
- la proximité qu’enjoindrait alors cet optatif: (( De la pensée avant toute chose! N
L’être-comme-la-pensée de la poésie se disant, (( dans le détail »,par d’étranges alliages :
(( Le concept de centaures est sans doute celui de l’esprit d’un fleuve.../, sa $gum est
pout cela en des lieux de la nature, etc. )) Comme si le Wesen de la Dicbtung était
la Dicbtung du Wesen.
135
Quel ton? Pourquoi Philippe Jaccottet donnerait-il dans son volume de si
nombreuses lettres de la fin, d’une admirable monotonie, si notre émotion n’augmentait
auscultant ce ton pour en chercher le secret dans la tension de la répétition : comme
si cette (( pure bienveillance )) dont Holderlin créditait maints destinataires, et singulièrement la mère, se réduisait pour finir à son ton fondamental, ton de (( bleu
adorable », nous proposant plus purement l’une de ses harmoniques, celle qui règne
déjà, qui fait tenir ensemble les passages les plus complexes, toujours indéchiffrables ;
et qui se purifie dans les billets déments de Scardanelli : celle de l’excessive courtoisie,
pur oxymore donc, la précautionneuse et rigoureuse et dévotieuse attention qui respecte
le terrible en l’envisageant, en s’y risquant comme l’amiante vers le brasier. Oui,
quelques mots en francais ont changé d’accent ; tels (( fidèlement, humblement,
patriotiquement, purement.. . ».
De lu comparaison (ou Gelid et Wesen) (ou du rupport DichtungWesen)
O n connaît le geste heideggerien d’abaisser la métaphore et la comparaison
(conclusion d u Qu’est-ce que la métaphysique en QuestionsI, ou Satz vom G u n d e ou,
dans Questions IV, (( protocoles d’un séminaire sur les conférences temps & être »)
pour le relèvement d’une opération, qui ne serait pas tellement l’opération d’un poète
que la ressource de la langue (Spracbe), d u profond génie de la langue (poéticité,
Dicbtung de la langue), que la pensée, (( surmontant n la métaphysique, re-marque, va
re-quérir en son retrait; relèvement qui se dit en allemand ... comment? Eh bien,
justement parmi toutes les occurrences, il en est une que j’isole en limitant la citation
parce qu’elle est moins fréquentée (conférence sur Hebel et la Mutterspyache) et parce
qu’elle fait entendre l’effort de la néologisation pour substituer à la (( comparaison ))
une nomination plus essentielle (est-ce le mot??), plus (( poétique »!
Heidegger :
Wird denn bier Überhaupt eines mit dem anderen nur uerglicben? Vermutlich spricbt
das Gedirbt nicht in einem Vergleicb, sondem in Gieichnis. Gleicb beisst Gelich versammelt ins selbe c Lich #, in dieselbe Gestait.
Rassemblement dans le même licb; si licb s’entend comme la désinence des qualités
(et bien sûr en allemand dans une certaine paronomase à licbt), que le français rendrait
par (( ité )), finale de (( qualité », et le ge, comme préfixe traductible par cum, rom, le
néologème de traduction à risquer ici serait, pour l’intraduisible Ge-lid : com-ité 4,
(( comité », que j’aimerais aussi écrire comme-ité : la comm-ité des choses!
Et je comprends que soit inquiétée, ébranlée, rabrouée, l’opération d’après coup,
la comparaison (( facultative )) qui rapproche l’un avec l’autre par (( association libre N,
cette opération qui n’a pas coopéré originairement à la dis-jonction de l’un aver
l’autre, et qui fait planer sur le divers des uni-fications d’équivalence; et que cela, si
c’est (( métaphorisation poétique »,soit dis-qualifié au profit d’une entente d’«unité
plus originairement synthétique », s’il s’agit d’entendre la mêmeté de être et pensée en
les resserrant dans le langage (Spracbe) qui les tient ensemble, les appareille, les déplie.
O r c’est ce que Heidegger lit précisément chez Holderlin, je vais le rappeler par
quelques citations qui s’emploient, parfois furieusement, à discréditer la comparaison,
la métaphore, et peut-être tout trope.
Mais comme on ne peut accréditer dans nos langues l’usage ni de Gelid ni de
comm-ité, il me semble que : la langue étymologiquement néologisante nous laisse
136
aux prises avec la même aporie, la même difficulté générale, que le comparer, la
reméditation (fréquentatif de remède) du comme et de l’être-comme peut prendre en
charge; prendre en charge la relation du Wesen et du Gelich, du concept et de la
figure, de la Dicbtung et du Denken; le comparer n’est pas extrinsèque au Dichten.
C’est mon propos pour quelques instants :
Quand Heidegger accable Gotfried Benn sous Holderlin, c’est à propos de comme.
La splendeur de Holderlin tient - selon Heidegger - à ce qu’il ne compare pas
i la façon métaphysique (la métaphore étant métaphysique) les mots aux fleurs, mais
qu’il nomme les mots (( floraison », laissant (( la résonance de la parole s’ouvrir avec sa
couleur terrestre )) tandis que pour Benn le comme est un (( signe de rupture dans la
vision », une ruse, un acolyte.
Avec le comme holderlinien, incompris de Benn, il ne s’agirait pas d’un (( rapprochement )) qui (( va chercher », qui va chercher chaque terme ou élément rapprochable dans son domaine d’appartenance (d’élection, de valence) pour l’en extraire
(( le temps d’une comparaison »; Heidegger pense plutôt le rapprochement selon le
geste d’un dépliement, de la gerbe, du partage qui distribue; c’est-à-dire à partir
d’une unité du dire et du dit qui recèle (regorge de) une richesse entrelacée, et se
diversifie. La relation mot-fleur fait voir l’éclosion du dire et, réciproquement, parce
que l’origine est le lieu de la réciprocité de (( l’antidosis », fait voir la diction de la
fleur s’il est vrai que la fleur éclosant dit l’éclosion; et comment ((par nature D les
hommes parlent. La parole-poème va dans le sens du déploiement de l’ouverture qui
lui a permis de parler. Elle re-donne le don qui la donne. Es gibt ... ça donne ... quoi?
Ça donne elle ... qui redonne son don en le disant à son tour, remettant en jeu cela
qui (la) donne. Sans doute le poème a-t-il de la comparaison en lui (ou, si vous
préférez, il f a i t des comparaisons); sans doute; mais il se tient lui-même dans la
comparaison; il s’ouvre à ce qui l’ouvre et qu’il ouvre dans le geste de la comparaison
qu’il ne (re)connaîtra qu’en le comparant (( lui-même )) à floraison, source, partage, etc.
Comme si le principe pouvait être remis en circulation ... Comme si la (( démiurgie
transformatrice de l’art )) consistait à ajoutFr au monde ce par quoi il a été f a i t - pour
reprendre les termes de la traduction de 1’Evangile. Comme Prométhée vient redonner
au monde lefeu, principe du monde. O u comme l’évangélisation veut réinjecter dans
le monde, si j’ose dire, pour qu’il y ait (( histoire », le Verbe (fils) sans quoi rien n’a
été fait; ...ajouter au monde sa fin, la précipitation catalytique et apocalyptique de
son principe (( révélé », remis en (( levain dans la pâte )) (levain - (( relève D).Or que
f a i t l’Art; le poïein de l’Art? Sinon chercher les principes, (se) représenter symboliquement les principes, et les moyens de mise à l’œuvre, en l’œuvre qui les montre,
des constituants du Grand-(Euvre ». Le cubisme, j’allais dire comme le Timée, ou
Sophie Arp ou Paul Klee (etc.) désirent faire entrer dans le monde, par la représentation
en l’œuvre et à l’œuvre de se: éléments (stoi‘cheia), les (( principes )) 6 . Maintenant :
quel rapport de ces Principes (Eléments, etc.) à l’image (imagination) ou comparution
des comparants? Quelque chose, élément, dans l’expérience est perçu comme symbole
de l’expérience, et devient comparant pour le tout : There lives the dearest freshness
deep down things v (G.M. Hopkins).
U Wie wenn am Feiertage », (( Comme en un jour de fête », l’incipit qui ouvre en
comparatif le grand hymne, pourquoi refuser d’y entendre la comparaison, la configuration? Heidegger dit du Holzweg, du chemin forestier auquel s’apparente le chemin
de pensée, qu’il se perd dans le non-frayé (( mais il ne s’agit pas d’une métaphore »;
pas plus que la fameuse lichtung, la clairière, n’en est une de la (( vérité »!?
Alors quelle est cette (( parenté » ? Pourquoi lui refuser le nom de métaphore?
O u disons que la métaphore est beaucoup plus que la métaphore, de même que la
Nuit est plus que la nuit (cf. (( Pain et vin »). Les termes d’image, de métaphore, de
comparaison, de figure peuvent dire (en même temps que leur signification restreinte
((
((
137
à l’intérieur de ce qu’on appelle la rhétorique), disent l’être comme du chemin de
forêt et du chemin de pensée - à savoir ce que dit Heidegger quand il dit (( ce n’est
pas une métaphore )) - mais une (( parenté B :
Holderlin sur la parenté (3‘version de (( Grèce », p. 918, trad. F.F. >,énigmatique et plus encore en telle traduction : (( [...I Dieu conduit comme sur des
hauteurs la Terre; il met toutefois limite / Aux pas démesurés. Alors, pareilles à des
fleurs / D’or, les puissances de l’âme, ses parentés se rassemblent / Afin que la beauté
prenne plus volontiers séjour / Sur terre et qu’en esprit se fasse / Le compagnon
plus proche encor de ,/ Tous les hommes. )) Quelle est cette parenté rassemblée, cette
afinité du divers; quel est le lien entre beauté, esprit, compagnonnage?
Car partout règne la comparaison. I1 serait trop facile - et fastidieux - de relever
et d’énumérer des premiers aux derniers poèmes, les (( pareil à », (( tel », comme ))
et autres, typologiquement nombrables et innombrablement essaimés, a procédés )) de
la comparaison.
On peut même rapprocher le Worte wie Blumen, qui permet à Heidegger
d’admonester Gotfried Benn et le lecteur ordinaire, de la lettre à Karl de 1798 qui
dit : (( La fleur vivante se fait plus lentement qu’une fleur artificielle; de même la
parole vivante doit mzîrir longuement au fond de nous-mêmes avant de paraître »,
pour observer qu’il s’agit très explicitement d’un comparer. Et d u comparer en
question : chaque poète a ses grandes figures.
O n peut rapprocher du fameux Wie wenn am Feiertage ses prémices dans
Hypérion (205) : (( /l’artiste/ songe avec joie au jour de f ê t e où il ira reprendre vie
à la lumière du printemps »; ou citer ce passage des Remarqzles sur Antigone : (< La
conscience à son apogée se compare alors toujours à des objets qui n’ont pas de
conscience mais qui accueillent dans leur partage la forme de la conscience )) (961).
Ou ces pages qui disent d’Empédocle (( l’acte de distinguer, de penser, de
comparer, de créer, d’organiser et le fait d’être organisé est en lui-même plus objectif
[...I de sorte que sa capacité de distinguer, de penser, de comparer, de créer, d’organiser ... etc. »; où il semble que l’apposition en série place comparer dans la synonymie
du penJer ... (p. 661 sq.)
Avec la métaphore, à condition de ne pas l’entendre au sens restreint )) du
dictionnaire, qui distribue la figurativité entre différentes figures, différents tows et
pose (entre autres) l’insoluble problème de la capacité de la métonymie, ou (( ordre
de la contiguïté »,à symboliser, chaque tour, ou trope, devenant évitable, facultatif,
contournable, et donc arrogant dans sa prétention quand une école linguistique veut
amplifier son rôle; mais au sens générique, dont le verbal est le comparer, il ne s’agit
plus d’une empreinte métaphysique qu’il faudrait oblitérer, mais du schème approché
par Kant, ce ((procédé général de l’imagination pour procurer à un concept son
image », ce (( monogramme de l’imagination ». S’il n’y a pas de concept (de pensé de
la pensée) avant cette frappe sensible qui indivise primairement (( le propre et le
figuré )), il se pourrait que le procédé effectif, élaboré et réfléchi, scient de lui-même,
et j’allais dire : cette façon d’en remettre de l’imagination en poème, vienne éclairer
et éclaircir l’arcane. Le penser parlant sa pensée apprend à se connaître sur ses manières
de dire qui le réfléchissent. La capacité rhétorique où se transpose et se surexpose
l’imaginer permet d’en examiner la fabrique, et le philosophe peut apprendre chez
le poète ce que penser peut faire et veut dire. L’être-comme-la-pensée de la pensivité
poétique, c’est en cela que consisterait la (( relation de voisinage )) - à charge pour le
philosophe, ainsi que Paul Ricœur l’a entrepris dans la Métaphore vive, d’élever l’êtrecomme à la puissance ontologique d’un principe (d’une (( copule ») irréductible au
principe d’identité : la logique et la poétique, la logique et la rhétorique ne seraient
pas sans commune mesure. Ce n’est pas par une oblitération de la comparaison que
nous entendrions mieux (( Wie wenn am Feiertage D..., ou (( Worte wie Blumen »,
138
dans ce qu’ils ont de non métaphysique. Plutôt par une réhabitation rhétorique de
la langue: la replongé dans son lêthê du langage d’une langue, en faveur de l’alétheia, serait moins ménagée par le discrédit de la rhétorique, comme si ce n’était
pas le langage de la poétique, que par la réflexion (( généralisante N de celle-ci ...
Puisque la pensée manœuvre avec les mêmes mots, il me semble que refuser la
métaphore et la comparaison pour en appeler à Gleicbnis et à Gestalt, qu’on pourrait
traduire par ... Comparaison et configuration, autorise le geste de surmonter la condamnation en réservant et resservant la comparaison, en redonnant son ampleur à la
comparaison à une autre échelle, à la puissance de la (( généralisation ».
Le geste de pensée de la comparaison est celui de la balance, de la mesure, de
la calme répartition depuis un seuil rythmique, de la mise en équilibre qui partage,
et par exemple ménage le rapport équitable entre le passé et le présent, ajointés par
un comme, permettant à un homme du présent (un (( lecteur », ou un spectateur au
théâtre) de se rapprocher du passé en maintenant la distance, de (( se comparer )) sans la psychose de la jalousie féroce qui s’humilie, qui s’identije ou recule d’horreur
devant tout rapprochement (comme de Holderlin à Schiller) ; de se supporter; justice
du jugement qui dispose les deux côtés, les (( moitiés de vie », la différence rendue
supportable, apaisée.
*
Peut-il y avoir Dichterberuf et Dichtemut, courage et réencouragement poétique,
là où manque la croyance en l’enthousiasme?
Sans doute croire à, ou en, des poètes qui crurent en, ou à, la poésie est décisif,
surtout au moment mimèsiqzle de la jeunesse. Mais cela vient à ne plus suffire plus
tard, trop tard, dans la (( vieillesse », quand le vieillir du sujet s’interroge sur le vieillir
du monde ’...
Et peut-être préférais-je pour ma part le beau portrait du jeune homme génial
à ce dessin du vieux fol (dessiné par J.-G. Schreiner en 1826) dont Jaccottet a illustré
la réédition Pléiade, à moins que nous soyons invités à y lire un signe subtile en
direction de la (( sobriété N et du désenchantement moderne, de l’endurance de la
déception comme destination à sa demeure de la poésie en son vieillir (et que le sans
âge de la démence met en suspens le vieillir, arrache à (( la perte de la jeunesse N...)
( ( [ ...I Autre chose est en jeu / Confié au soin, au culte seul des poètes )) dit la
(( Vocation du poète )) (779). Croire en cette croyance, et respecter Holderlin comme
un saint de la poésie, telle dévotion (mot d’Arthur Rimbaud) est nécessaire à la
vocation poétique - que je me garderai de critiquer.
Mais quel croire, quel à-quoi-croire, si j’ose dire, est-il requis et possible? Si le
croire, et quel, c’est-à-dire déterminé par quel corrélat, est relation essentielle à ce
qui est, à défaut de quoi (et cette défection fait système avec le système de la confection
et de la réfection de notre actualité ») à défaut de quoi ce qui est ne se montrerait
plus en figurants de l’être qu’il y a, en comparants qui ((assemblent les beautés de
la terre )) (selon la ligne de (( Andenken )) qui compare les poètes, les voyageurs, les
peintres).
Le respect pour la figure préserve la beauté du terrestre ». Et la question que
nous lègue Holderlin est celle de (( l’habitation poétique du terrestre N. Mais comment
la reprendre, et la réapprendre chez lui alors même que l’orientation de son espérance
est désappointée.
Quel désappointement? Voici deux manières de le dire, brièvement ou plus
longuement :
- Le projet de jeunesse (1796) reconfiait à la poésie (( sa fonction première celle d’instruire l’humanité », concluant que (( seule la poésie survivra à toutes les
139
autres sciences et à tous les arts ». Cette prophétie est entièrement déçue et le principe
d’espérance ne peut plus se formuler dans ces termes.
-Autre façon de dire, i.e. de remémorer la voyance et de mesurer notre
dés-espérance : la question d u rapprochement. Car le rapprochement est un des grands
mots de cette poétique et l’un des grands mots des poétiques contemporaines, mais
nous devons en mesurer l’écart.
Car Holderlin dit de quoi il peut, il doit ou devrait, y avoir rapprochement à
savoir des dieux et des hommes - tandis que (( nous D (un nous qui dénote ceux de
la poétique moderne française depuis le mot de Lautréamont jusqu’à ceux de Breton
en passant par Saint-Pol Roux ou Max Ernst, etc.) mentionnons le rapprochement en
le (( prenant absolument »; en exaltant l’arbitraire des possibilités de rencontres, de
(( hasards objectifs B indéfiniment collectionnés aux anaphores (( surréalistes D.
Écoutons Holderlin; je cite la lettre à Schülz (1800) (( /Les grands Anciens /
représentaient les choses divisées de manière humaine tout en évitant la mesure
humaine proprement dite. Tout naturellement d’ailleurs, car l’art poétique, qu’il soit
enthousiaste ou modeste et sobre, était par définition un joyeux service religieux qui
ne devait jamais changer les hommes en dieux ni les dieux en hommes, jamais non
plus commettre le péché d’idolâtrie impure, mais seulement rapprocher les dieux et
les hommes. Ce que la tragédie démontre per rontrarium [...I )) (759).
En d’autres termes et dans le violent raccourci d’une perspective )) : le rituel,
sacrificiel, réglait la a bonne distance N dieux-hommes contre l’excessive hantise du
sacré, d u (( monde des morts ». (( Puis )) la tragédie faisait mémoire de la (( catastrophe N
qui survient quand une confusion humaine (soient l’inceste et/ou le propre sang,
familial, répandu) attire les dieux. (( Puis )) la poésie endure l’éloignement, l’absence,
la disparition des dieux.. .
Brutalement : peut-il y avoir une poétique quand le rapprochement (ou :
l’é-loignement) (j’allais dire : la question) n’est plus des dieux et des hommes? Que
rapprocher, pourquoi rapprocher? Peut-on éviter de faire alors un dieu, une idole, du
langage, comme milieu du rapprochement en général?
Non seulement les dieux ont disparu, comme le savait Hypérion - mais pour
nous au point que nous ne pouvons plus les nommer qu’en mimant ironiquement
la superstition ou dans l’érudition de la (( science humaine »; et le paradoxe est tel,
là aussi, que (je pense au Dionysos de Detienne) le divin est alors retrouvé (( comme
jamais », au moment où il est perdu, en tant qu’objet de recherche, dans un foisonnement
de silhouettes, une multiplicité d’apparitions et de fonctions hallucinante - si nous
pouvions encore être hallucinés ; perte de toute croyance (de toute intentionalité
réceptive à du divin) et sauvetage du passé mythologique par le savoir vont ensemble;
et le divin perdu foisonne, fourmillement d’apparitions reconstituées, de rituels, de
nominations sacrées, etc. La rétrospective admirablement érudite de Marcel Detienne
réanime une (( banden dionysiaque de réel, avec sons, noms, bonds... une levée
palpitante au passage de (( la science humaine », d’organes sans corps, érigeant,
exultant ...; le cortège d’un dieu qui naît et voyage, avec des dizaines de (( figures N
intermédiaires, à une puissance insoupçonnable encore au temps où on (les jeunes
idéalistes allemands) croyaient naïvement, nativement, que la Grèce était la jeunesse
de l’humanité, et la disparition des dieux récente.
Mais (( la nature a disparu de l’humanité », comme le savait Schiller, et nous
ne cessons de faire l’expérience d’une extinction du naturel et d’une disparition même
du par oi la nature a disparu de tout (pas seulement de l’humanité), si extrême que
la mimèsis, qui réglait leur relation, n’a plus aucune techné ni aucune phusis à mettre
en Co-opération.
Pour nous : de quel rapprochement peut-il s’agir?
Des hommes entre eux? (Socialisme.. . ou barbarie).
140
Des hommes et de la ci-devant nature? (Écologie).
Des choses entre elles, devenues des objets, en précipitant l’accélération de notre
effacement (« stratégie fatale )) de Baudrillard?).
Mais (( qu’est-ce qu’une chose? )) Y a-t-il a chose )) quand s’effondre le (( Quadriparti )) (Vierung), parce que l’un des tenseurs de ce Diastème, le divin, ou la nature
en tant que <( tonnerre de Dieu », a cessé d’être, dé-situant l’homme?
Seul
Reste le déchaînement de l’étrangeté absolue des hommes (( entre eux N ? (<<
un dieu peut nous sauver » ? phrase elle-même insensée parce que requérant une
croyance impossible?)
J’essaie de reprendre
<(
mon
))
fil... le fil... mais ...
S’orienter, telle fut la question - telle serait la question encore. S’orienter,
littéralement, déterminer l’Orient d’un étranger, d’une (< épreuve de l’étranger )) qui
puisse délimiter un retournement I occidental », le retournement d’un Retour ( c Heimkunfi N), telle fut la question.
La question : quel est mon autre; où, avec qzloi, suis-je autre que moi et ainsi
destiné (envoyé, prédestiné) à me trouver moi-même ; envoyé-promené (« Migration »)
dans la bonne direction et non pas quelconque, à savoir celle de la (bonne) perte par
où je me retrouverai(s) ... (périple de l’autoportrait où le peintre cherche sa reconnaissance; ou << comme )) Daphnis et Chloé cherchaient à quoi ils étaient destinés,
dans la fable du comment s’aimer).
Le s’orienter appartient donc à un ordre de la pré-figuration; qui requiert une
croyance à la figure, à la possibilité d’apprendre sur une géo-poétique terrestre les
signes d’une destinée spirituelle. C’est de telle maintenance de la figuration, dans la
langue, que je voudrais, pour finir, dire quelques mots.
Si la poésie maintient l’Apparition en titre, sujette à disparition, ou, plus
mallarméennement encore (( l’extatique impuissance à disparaître », alors apparition
de quoi? Quel sens donner à la parole de l’habitation terrestre par la parole poétique?
(< Mais l’homme / A le désir profond de la présence. Et c’est pourquoi / Je
suis venu vous contempler ô Iles, et vous ô / Portiques de Thétis, embouchures des
fleuves / Vous ô forêts, et vous nuages de l’Ida )) (« Migration », 848). Ou : (( Que
de / Ce qui perdure soit rendu visible / Le sens profond. Et le chant allemand lui
obéit. D («Patmos », 873).
Quels sont les êtres qui se montrent encore, ces êtres comme nous disons encore
naturellement )) en français selon l’un des derniers usages de être, comme si seul
l’être en personne pouvait offrir un aspect de l’être, comme si nous devions avoir en
vue l’autre dans l’amour pour parler encore d’être H .
<(
Suèvie, Lombardie, Rhin, ces êtres appelés par leurs noms se montraient, et ils
ne furent pas que leurs noms. Leur être traditionnel tenait à la capacité de les imaginer
i. e. de les voir dans leur configuration.
De même que le visage est reconnu par une prosopognosie spécifique, de même
le visage de ce qui n’en a pas et qui est donc << comme un visage )) est discerné, non
par une chimie neurophysiologique que la science explique, mais par le discernement
poétique dont la poétique du discernement s’entretient, réflexivement dans la langue
N maternelle n.. .
Ce à quoi ressemble notre existence, par où elle prend sens d’y être comparée,
appelons-le figare. Beaucoup de noms - c’est-à-dire de pensées cherchant à s’accomplir - lui furent donnés au cours des siècles et des œuvres; ainsi est-ce peutêtre ce que Hopkins désirait au bout de l’inspect ((( insight 1) comme son corrélat;
ou << ce )) que le << rapprochement )) veut assembler ...
141
L’énigme de cette existence s’éclaire (= devient énigme) d’être comparable-à.
Ce dont il y a (( apparition », c’est du comparant-type en image. (Et peut-être
conviendrait-il de réentendre l’expression d’«imminence de la révélation )) dans la
perspective où a son essence même impose à la beauté de n’apparaître que voilée »,
selon une formule de W. Benjamin rappelée par Ph. Lacoue-Labarthe; imminence
avancée ou mouvement de venue de l’œuvre (progression d u poème), inchoativité,
auto-révélation et concroissance du concret sont liés; paraître c’est paraître de plus en
plus, mouvement d’augmentation du (dé)voilement où ce qui va se montrer est encore
dissimulé par ce qui (se) montre.)
Ce à quoi ressemble notre vie, faisant ainsijgure (pour (( ne pas perdre la face n!)
d’y être comparable et comparée par des œuvres, appelons-le (( configuration )), traduisant
ainsi l’étrange terme forgé de Ge-Iich. Même si son tout, le tout, demeure incomparable, son (( diminutif )) (Baudelaire) peut la symboliser, et c’est cela qui est (( divin »,
nous dit la devise d’Hypérion : K Non coerceri maximo, contineri minimo, divinum
est. Y
Ce qu’est ce que nous sommes (l’ordre du Wesen) et ce comme quoi est ce que
nous vivons (l’ordre du Ge-Iich, de la Dichtung), l’être-tel (saisi donc dans un nom
ou concept) et le à-quoi-ça-ressemble (l’ah-strnktur et l’ordre d u Wie ?) sont assemblés
par l’art. K Dichtung des Wesens Y ? Notre existence est d’être-comme ce qu’elle se
figure en œuvres. Ce à quoi elle (( ressemble », les œuvres de l’art (( l’imaginent n et
le montrent. La différence entre le lieu et l’œuvre d u lieu-dit qui présente la beauté
du lieu, est ce qui nous demeure. (( C’est poétiquement que nous habitons ... ))
[...I et qu’ainsi, comme des amants
Yeux jamais clos, coupes à pleins bords, audace à vivre et sainte
Souvenance, nous traversions la nuit au comble de l’éveil ».
(U Pain et Vin Y, 809)
Michel Deguy
NOTES
1. Référence à l’édition de La Piéiade.
2 . De même que chez Celan le sulfabein, la syllabe, est l’élément dans lequel joue la puissance
disjonctive, tantôt comme dislocation du syllabisme <( établi », tantôt comme agglutination néologisation,
ad-jonction N de syllabes.
3. Tautologie + figuration = tautégorie.
4. Etymon de comes: qui va avec (cum).
5 . Holderlin dit N (du poète, le penseur dit qu’il << dit N comme les fidèles - oyant la Bible entendent. (( Et Jahwe dit )) : le seul à dire) donc : (< I1 faut que des mots comme des fleurs viennent à
naître », et Heidegger pense qu’ainsi le mot est remis à l’abri dans la provenance d’où il se déploie ».
6. Serait-ce une caractéristique du contemporain, par exemple de l’hyperréalisme ou de l’abstraction
(désymbolisée), que cela, de ne plus a représenter )) les principes à l’œuvre dans l’œuvre. Par différence
avec les siinpies de P. Klee ou les (< fondements de Kandinsky, etc.
7 . Même si le U trop tôt pour l’Être essaie de nous redonner une jeunesse...
8. Le mot français les êtres dit, en riche homonymie, la pluralité, le rapport des hommes à l’être, et
la spaciosité du séjour, de l’habitation («les êtres du foyer »).
(<
<(
(<
))
))
André du Bouchet
...car, pour peu de chose,
Désaccordée comme par de la neige était
La cloche dont on sonne pour le repas du soir..
Car, pour peu de chose
désaccordée
...denn, uon wegen geringer Dinge,
Verstimmt wie vo?n Schnee war
Die Glorke. womit man Idutet zum Abendessen ...
fêlée, la cloche.
la clarté de la neige
désaccordée, comme
de la neige - et, comme par une fêlure
sur la dislocation de la
Fenster des Himmels - ouverte.
langue ou des langues, lorsque sur leurs gonds elles vont s’élargissant.
dans sa voix
Fehle.
la fêlure.
tel
qu’élargi aussi avant qu’il se pourra, interstice dans le dénuement
de l’épaisseur demeuré interstice.
144
un interstice
insaisi.
momentané accorde, comme désaccord éclairant.
saisissant.
G t t e s Feble hi@.
qui perce
neige, sur son renversement,
- jamais sourde.
aujourd’hui la voix qui résonnera, elle est de neige.
de la neige perce.
comme à rien
pas - le support.
reconduit,
c’est
à
nouveau
-
le dénuement du support,
il ne se conjugue
145
être, ou
- globalement, peu de chose - chose qui ne se laisse pas appréhender,
irruption de futur.
hilft.
la disparition de la certitude, sitôt accomplie, vient à l’aide.
ce support - comme foudre, ou la neige - rapide, plus rapide que
la rapidité, ou lent - un météore - et la terre aujourd’hui, où
qu’à être ici je sois parvenu, elle-même en suspens - à nouveau, et
sans qu’il se conjugue, sur un blanc - enclave comme neige
stationnaire alors - du futur qui pour éclairer en retour emporte,
éteignant la voix.
ici la voix, et elle perce.
146
tombé du ciel, cela,
comme de la neige?
la voix dehors, comme la neige.
sous le pas, de même que sous ses yeux le sol lorsqu’on avance.
terre
ici comme, venue de la terre, à nouveau elle perce.
elle-même,
sur l’interstice, et la neige, au
ciel.
les yeux, quand je ne vois rien.
mais les yeux.
de la neige.
le support intermittent éclaire.
inentendu.
ouverture sur le rien vivant.
147
rappelé - pour
de mot.
wie Steine sagen.
un mot.
brèche - sur
que plus loin il parle, et sur un
l’instant
ne
comme à son timbre, prononcé déjà ou non,
à substance qui, dans la crudité - alors faisant
se différencie en rien du rien vivant.
la parole traversée.
traversée
- de même
un mot
écart, à sa mutité
wie Steine sagen.
que, parcourue, elle traversera.
une voix - inentendue, traverse la parole soudain vivante.
comme
transie.
comme respirant.
148
wie Steine sagen.
- une
fraction : la
parole.
sa substance à découvert dans l’instant où
elle émerge, elle-même
sur un sens
alors comme suspendue.
la pierre
crudité
de la parole comme celle devant soi de la première pierre venue lorsque
chemin faisant, on a pu aviser - et celle-ci
plutôt que celle-là, comme tombée
du ciel sans s’y arrêter, une
rompue.
pierre au sol, entière.
et le sol.
au ciel.
wie Steine sagen.
le muet perce.
météore.
149
avancée de la parole
sur la rudesse de sa consistance de départ inaudible à nouveau.
ne différant pas,
même matière, du tout autre, ici.
ouverture - par
les
yeux,
comme
lui-même ressort - le socle comme fond.
en cours.
ils
ont
percé,
sur
le
rien
vivant.
ce sera - et
le socle inaudible
moi inclus.
ici chaque pierre un coup
wie Steine Jagen : matière de parole sur sa fraction,
de pierre.
comme de retour à matière muette momentanément la parole.
150
parole reconduite à sa bouche, et tue - comme en coup de vent,
dans la parole ultérieure.
aujourd’hui, comme une pierre parle, sera retourné à la tranquillité des pierres.
voix du rien redevenu
matière de voix.
parole.
celle
de la voix dehors en place, comme saisie, dans sa relation à choses du
sur l’instant, étant tue aussi
monde qui la traverse.
ou éteinte.
verstimmt.
151
ouverture - la neige.
nette, aussitôt sa parole emportée.
à même la bouche, pour place
dehors
ce sont les lèvres.
coupant la parole.
-
retranchée,
temps.
sitôt
émise,
du
cours
qui
est
le
inaudible comme
sien, une fraction de
enclave de la neige confondue avec la lumière du support.
Stimmung. détimbrant.
uerstimmt.
((
le froid de nouveau.
152
aux lèvres ce froid. N
déposant comme neige.
voix - aussitôt traversée,
par le froid traversée, qui plus haut aura été
le dehors
du dehors.
..................................................................................................................................
traversée toujours,
comme
et plus loin : une face - par le souffle plus loin.
à sa face, incluse alors pour peu qu’on se soit immobilisé, la profondeur
à nouveau elle traversera cette face - pour
qui accorde.
l’effacer.
où le centre se déplace, j’ai pu moi-même cesser.
la lumière, lorsqu’elle sonne, de la parole réveillée.
retrait.
neige devenue voix.
c’est
en
en éveil,
sur le versant,
on aura pris les pierres, en été, pour de la neige.
153
une chute de la chaleur l’ayant
traversée,
eau elle-même dans sa chute comme épaisseur compacte alors
de part en part la neige.
d’une étendue de neige.
uerstimmt : voix transie.
neige, assourdissant, qui éveillera les voix.
déchiffrée.
lèvres : le seuil du support.
figeant.
une coupure de la parole
prononcera.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
154
Et les hommes sur la terre, les uns auprès des autres toute
la neige n’est pas au-dedans de la cloche.
mais, dans le temps
du désaccord, étant le désaccord même - si
laissée à soi, une cloche,
comme en suspens, elle doit comprendre ce qui tout de même sera de l’autre
côté du métal de la paroi dehors.
parole
de la pierre ou de la cloche désaccordée.
sa matière dans le temps
elle n’a pas eu à retentir.
où,
sur une mutité - comme mate - de
rapportée - soit : abandonnée - à soi,
pierres, un instant - et pierres, sur leur fraction, ouvertes.
un état de la matière - pour le temps qui écarte, et où soudain il
aura manqué, alors le prendre de court.
155
c’est la voix alors de ce qui n’a pas de
voix.
où la voix se laisse
rapporter à un support, elle se fera parole de la langue par l’entremise
de son matériau muet.
la parole : une bouche.
dans la parole doit - comme à même la bouche, ici quelquefois être
entendu l’air qui emporte cette parole.
il y a dans la fraîcheur une incurie.
un instant, tu auras touché à
à l’accord et
l’accord qui, sur son emplacement, déporte.
à ce qui - par-delà accord et désaccord,
au désaccord.
en place dans la langue, aussitôt appelle, sur la fraîcheur de la trouée,
à ton retour en désordre.
156
la fraîcheur qui annule devenue fraîcheur de langue, dans la langue son
support sans battant.
on dira de la neige tombée qu’elle perce.
que le dehors, demeuré
dehors, est au-dedans.
qu’à nouveau, et sur son emportement, de retour.
à soi.
laissé à soi - de même
comme on revient
cela, où alors comme fêlé, une
fraction de temps, ou immobile encore, peut apparaître en suspens.
et
en place.
comme confondu.
comme à un
futur indécis, non-sens momentané,
être - sur sa fraction, fera
retour, et plus avant néanmoins il se figure.
fraîchir - zu kühien.
157
la parole qui porte n’est pas celle du premier accord.
mais
d’elle-même, et dans sa gangue - matière comme métal - se référant
à un métal premier dehors et dedans.
terre sous le pas
de qui - jusqu’au front, y avancera, momentanément hors du sens
à nouveau.
la fraîcheur : une
comme - à la surface
du sol soutenu,
toucher - sur le pas bancal, à un instant où
comme neige.
cela, ne tenant pas à soi, débute.
décidément.
incurie.
tombée du ciel.
et la terre au
ciel.
dans une parole,
quelquefois la parole - interrompue, lorsque dans une parole déjà
se laissera percevoir, comme on respire, l’air qui l’emporte, et emporte.
158
le dehors - d’être
dit, il se dira - comme pour ouvrir, dedans.
avoir ouvert sur le futur qui est l’intime.
uerstimmt.
viens, être
- comme
le fêlé - pour
inentendu.
dans l’instant où, toi-même, comme tu
fendu - se figure à nouveau.
neige : être - et
le support.
pour chose.
pour peu de chose.
pour chose au monde.
pour
chose qui est monde.
cloche
la cloche qu’à ton tour tu occupes.
de résonance.
159
point monde
plus d’une fois au timbre traversé.
-
le point monde
perdu.
-
point
qui avance, alors même que le timbre aura été
retentissant et pour à nouveau se découvrir support.
ou
d’un intervalle du temps, comme il va s’incurvant,
à un autre, ciel
clair - et sourd.
du point en cours, tel - et alors jusqu’à une
au loin dehors, qu’à nouveau il pourra sonner.
sans entendre ce qui sonne, tu l’occupes
- et
élongation
cassure incluse, puis
tu l’occuperas.
neige : et non dans le réceptacle de
la cloche, mais comme d’un temps l’autre la cloche même qui en l’air
aujourd’hui ne tranchera pas sur la surdité de la neige de tout son long
dehors.
sur
le présent au loin comme dehors de nouveau.
comme fraîcheur de
métal dehors, ou à sa propre neige. accordée
alors.
160
parole transie, ouvrant, si elle sonne, à choses et choses distinctes.
jour
de nouveau se fera, la nuit, par de la neige.
le ciel sur quoi - dans la dissonance, cloche, qu’elle sonne ou non,
elle se détache, est ouvert aussi dans la cloche.
- ou
ce qui désaccorde apparaît - avec la cloche
- en
suspens : l’éclair
une fêlure.
futur indécis résolu dans le présent
présent aussitôt prononcé.
un au-dedans de la parole sera dehors au même instant.
161
la neige, dira
la cloche aussi.
aller
-
alors
- comme
elle
s’y
réaccorde,
qu’elle
est
dans
de même, la nuit tombée, qu’à un repas épars qui se partage
sur le trait du départ qui
désaccorde et répare.
- au futur aujourd’hui.
être
comme neige.
as-tu entendu?
porteur d’une parole, et pareille à de la neige.
162
uerxtimmt.
traversée
d’air qui porte, et
nous vivons dans cette cloche.
de la neige.
détimbrant.
traversée de tels êtres.
neige qui éteint.
traversée de telles neiges.
neige
retentissante.
le support : un météore.
occident.
André du Bouchet
Holderlin
et la philosophie
Les débuts
philosophiques
de Holderlin
et de Schelling
Xavier Tilliette
Malgré quelques études d’ensemble, malgré les monographies particulières, il
s’en faut que l’on ait tiré au clair la mentalité des pensionnaires du Stift de Tübingen
à l’heure française (de la Révolution), et surtout les relations et les emprunts mutuels
à l’intérieur du célèbre (( trèfle )) Holderlin-Hegel-Schelling ’. D’abord le climat général,
en ces années 1788-1793/95, était plutôt déprimant, austère; les efforts de Schnurrer
n’avaient pas encore porté leurs fruits; la rivale, la Carlsschule de Stuttgart continuait
à prospérer, et l’université semblait vouée à un lent mais inexorable déclin. Il y avait
bien une certaine effervescence, et un vent de révolte, venu de l’ouest, commençait à
souffler. Mais le seul front de résistance était dressé contre les professeurs, leur
dogmatisme désuet ou leur kantisme délavé. Dans ces conditions il n’était pas facile
d’être pieux et docile. Les plus intelligents s’impatientaient, écoutaient les échos de
l’extérieur, refusaient le monde et travaillaient avec une ardeur sélective, plus avides
des Rousseau qui circulaient clandestinement que des manuels de leurs maîtres.
Cependant nous savons peu de chose du trio et de ses années de formation. O n
peut seulement supputer, conjecturer, d’après le développement ultérieur. Holderlin
et Hegel appartenaient à la même promotion (entrés en 1788), ce qui créait un lien
plus fort et une complicité. Leur familiarité est attestée par la lettre de retrouvailles
du 10 juillet 1794 2 . Peut-être le Notara de Hypérion porte-t-il quelques traits du
(( vieux »,comme on surnommait Hegel. Mais les deux intimes de Holderlin étaient
Neuffer et Magenau, et son domaine de prédilection était la poésie, avec la tragédie
grecque, tandis que Hegel, enclin à musarder, s’intéressait davantage aux sciences et
à l’histoire. Schelling était leur cadet, de cinq ans pour l’âge, de deux ans pour la
promotion. I1 est vrai que sa précocité le rapprochait de ses aînés et qu’il avait connu
jadis Holderlin à l’école de Nürtingen. I1 l’a confié à Gustav Schwab, et même qu’il
avait été protégé par l’adolescent 3 . Néanmoins, là non plus les pôles d’intérêt n’étaient
167
pas les mêmes, et les distances n’étaient pas supprimées. Le courant de sympathie
n’a pas laissé beaucoup de traces. Le vieux Schelling l’a lui-même avoué ingénument
dans ses confidences à son élève Melchior Meyr, poète et philosophe, fin 1847. Comme
il s’agit d’un document peu connu, que j’ai été le premier à publier, je le traduirai.
(1 7février 1847) Le 1“ février ou plus tôt j’avais annoncé ma visite en vue de
prendre des notes sur Holderlin. Quelques jours plus tard je vais chez lui ... Vous
vous occupez maintenant des papiers posthumes de Holderlin? Moi : N Oui; je
désirerais beaucoup savoir comment ses amis le jugeaient, si on pressentait qu’il
pourrait finir ainsi )) Sch. : (( Non, pas cela; après coup, assurément, on s’est rappelé
qu’il y avait en lui quelque chose qui pouvait susciter de l’inquiétude. J’ai été
son condisciple à Nürtingen, j’étais son cadet de cinq ans lorsque je suis arrivé en
classe. II a été le premier à se charger de moi, il m’a appris à orthographier les
mots latins que je savais par cœur, il m’a défendu contre les autres. Sa mère le
tenait trop tendrement; solitaire, il a toujours été considéré comme un bijou. Je
l’ai retrouvé à Tübingen, plein de beauté et de grâce, mais je n’ai pas pu
m’affectionner à sa poésie, rien d’autre n’avait de valeur que les Grecs, avec la vie
du peuple il n’accrochait pas (quelque chose comme entre nous ”) : Schiller a eu
sur lui une mauvaise influence. )) Moi : <( Mais Holderlin prenait les Grecs au
sérieux. Schell. : Certes! )) Sch. : Après son retour de Bordeaux je l’ai revu; il
est venu de Nürtingen chez mes parents, en très peu de temps, il avait pris à
travers champs; malgré sa folie il était très tranquille, pour la nuit on commandait
une garde, mais ce n’était pas nécessaire, il était tout à fait gentil, c’est à lui que
j’ai pensé quand j’ai écrit sur la grâce dans le Discours des Arts piartiques. n Sur
Hypérion : je ne peux en tirer grand-chose.
((
))
))
((
<(
(9-10 avril) (( Vous m’avez envoyé les articles sur Holderlin, je n’ai pas pu
vraiment les lire, c’était un souvenir douloureux des temps de Tübingen, où j’ai
été avec lui trois ans, où il me montrait ses poésies et où je voyais combien il se
donnait de la peine en pure perte »... (( à part cela un homme exquis, il chantait
très bien; nous avions alors de véritables orgies attiques, mais la poésie lui était
malaisée, il avait besoin de beaucoup de temps (Frau von Schelling : C’est déjà
un signe qu’il n’avait pas un vrai talent! ”), il limait sans cesse. »... Lorsqu’il est
revenu de Iéna, il m’a dit que, selon Schiller, Goethe faisait sa tâche comme un
champ de patates produit des pommes de terre; Schiller a exercé une mauvaise
influence sur lui; frappant le défaut total de fibre populaire; il se croyait trop audessus. )) Moi : (< Pourtant de très beaux poèmes isolés, douze environ. )) Schelling :
e Oui, mais il faut être dans l’ambiance ad hoc pour qu’ils fassent impression; il
m’a récité à Tübingen un poème composé pour sa bien-aimée de Maulbronn, c’est
beau; je ne sais pas si vous l’avez distingué. )) I1 fait chercher le livre, déclame
pathétiquement ({ Pardon n («Abbitte »). Moi : (( Moi aussi je l’ai souligné 4 . ))
O n excusera la longueur de la citation, mais les témoignages de ce genre valent
la peine. I1 faut se méfier de la mémoire des vieillards, elle ratatine. Et l’attitude
tant de Schelling que de Hegel à l’égard de leur malheureux ami n’est pas un chapitre
glorieux de leur biographie. Les souvenirs de Schelling ne le trompent pas quant à
un secret désaccord et à une certaine désaffection. Mais ils omettent le plus important,
le refoulé, le compulsif, à savoir que ses débuts dans la carrière philosophique ont
été sans conteste influencés, plus qu’il n’en a pris conscience ou qu’il ne se l’est
rappelé, par celui que J. Hoffmeister appelait le (( docteur séraphique de l’idéalisme
allemand ».
La relation Hegel-Holderlin a été étudiée, notamment par le même Hoffmeister 6,
de manière passable, sinon suffisante; il n’est pas de travail sur le jeune Hegel qui
ne mette en relief cette amitié disparate. En revanche l’échange Holderlin-Schelling
a été peu examiné. Du côté de Holderlin l’influence schellingienne a paru inexistante,
la ForJchung étant hypnotisée par la proximité de Hegel. D u côté de Schelling la part
de Holderlin n’a été évoquée que dans la discussion suscitée par le a Plus ancien
168
programme systématique de l’Idéalisme allemand ». Mais il s’agissait d’abord de
revendiquer pour Holderlin la paternité des célèbres feuillets ou, à tout le moins, de
signaler son inspiration occulte ou manifeste. C’est cette dernière solution qui a attiré
l’attention sur un éventuel sympbilosopbein des deux Stiftler. Mais on est loin d’avoir
épuisé l’hypothèse. Les brèves allusions de Holderlin dans ses lettres sous-entendent
une sorte de débat intellectuel, avec Fichte en tiers. Schelling lui-même poursuit la
trace de son ami, on vient de le voir, jusque dans le Discours des Arts plastiqtles de
1807; mais elle était présente et même intense auparavant dans les leçons sur le
christianisme de la Métbode des études zlniversitaires, dans le chapitre esthétique du
Système de I’idéaiisme transcendantal, voire dans Philosophie e t Religion. Hypérion, sur
lequel le vieillard n’avait rien à dire, n’était pas resté sans écho dans ses débuts. En
effet, par la force des choses, ce sont les tout premiers écrits, et surtout les Lettres s z l ~
le dogmatisme e t le criticisme, qui portent l’empreinte des conversations avec Holderlin.
Si bien que pour une meilleure connaissance de la (( philosophie de Tübingen »,s’il
est permis de se servir d’une expression excessive pour des pensées effervescentes,
l’association Schelling-Holderlin est sans doute plus importante que la paire HolderlinHegel, quoique celui-ci s’informe et intervienne. O n commence à s’en apercevoir.
Manfred Frank, dans sa récente Introduction à Schelling, attribue à 1’« incitation ))
(Anregang) de Holderlin ’, incitation plus ou moins voulue, le rapprochement de
Schelling et de Fichte - en supposant, il est vrai, comme beaucoup de critiques, un
point de départ non fichtéen d u philosophe de Leonberg.
I1 est certain en tout cas que l’on ne saurait réduire le commerce des deux jeunes
gens à l’épisode du Systemprogramm, autour duquel subsistent trop de doutes. Leur
entrée en philosophie, fracassante et triomphale pour l’un, hésitante et timide pour
l’autre, s’est produite sous le signe de Fichte. Schelling l’a entendu sur place, lors du
passage à Tübingen, et il a été électrisé. Holderlin a fait partie des premiers auditeurs
enthousiastes à Iéna, mais son emballement est retombé assez vite. L’un et l’autre
n’ont pas très bien compris d’emblée l’intention du Titan », mais par une sorte de
divination ils sont allés au cœur de système, au Moi absolu, sans trop se préoccuper
de l’enchaînement déductif.
D’une façon générale la réception de Fichte est l’un des chapitres les plus difficiles
de l’histoire de la philosophie. Fichte a surgi en pleine époque de fermentation
intellectuelle, et est très désireux de graver son empreinte. Après coup, et quelque
peu aigri par l’insuccès, il s’est plaint de l’incompréhension de tous. C’est exagéré, il
n’a pas subi que des malentendus. Mais sur un point au moins il n’a pas fait recette
à Tübingen : la conception de la Doctrine de la science. Elle est pour lui la philosophie
définitive et complète dont il a établi la fondation théorético-pratique. Elle n’est pour
Schelling et Holderlin qu’une propédeutique, ou une logique de la philosophie,
admise par tous les systèmes, mais comme la Critique de Kant, elle n’énonce pas
encore la philosophie issue de ses prémisses. De plus Fichte ne semblait pas attacher
trop d’importance à son exposé (( canonique ». I1 insistait sur l’esprit de son transcendantalisme conséquent, c’est-à-dire sur la liberté qui transissait, qui transverbérait, le
système de part en part H. C’est pourquoi il tenait beaucoup à la contingence de l’acte
de réflexion originaire. La rigueur systématique, cependant, importait extrêmement,
plus que ne s’en sont aperçus les premiers lecteurs : l’origine des contresens ou plutôt
des déviations de Schelling réside dans cette méconnaissance.
Le dilemme (( Spinoza ou Fichte )), dans les cornes duquel se sont empêtrés les
interprètes de Vom I d , est en grande partie un faux problème, car Fichte a cautionné
l’accès spinoziste à sa propre philosophie, à condition de renverser le résultat de
l’Éthique, et parce que Spinoza et le spinozisme étaient filtrés par Jacobi, avec le
surprenant effet que l’éloge de l’homme absolvait le penseur, et que le mot de passe
du Hen Kai Pan, répercuté par Lessing, se chargeait d’harmoniques vibrantes, devenait
un symbole de liberté, d’enthousiasme et de vie survoltée. Mais il paraît incontestable
169
que l’apport (( spinoziste D et jacobien est subordonné, aussi bien chez Holderlin que
chez Schelling, à l’intention de rallier Fichte, de renforcer l’impulsion qu’il donnait
au kantisme. En ce sens, et malgré certaines équivoques, il n’y a pas de véritable
conversion de Vom Icb aux Lettres sur le dogmatisme et le criticisme.
Holderlin a eu l’avantage d’aborder le criticisme à la source même. Ce premier
contact ne va pas sans perplexité. Ses réactions sont mitigées. Sa lettre fameuse d u
26 janvier 1/95 à Hegel l o amorce un début de critique que les explications de Fichte
semblent pour le moment apaiser. La similitude frappante de certaines formulations
avec celles de la lettre de Schelling à Hegel d u 4 février I ’ laisse supposer que, peutêtre, du courrier Schelling-Holderlin s’est perdu, dans un sens ou dans l’autre. C’est
peu probable cependant 1 2 . Les discours comme les textes de Fichte, même sous leur
forme rigoureuse, donnaient à des têtes inflammables matière à paraphraser.
La critique esquissée par Holderlin reflète l’interprétation courante dans le milieu
d’Iéna du (( spinozisme subjectif ». Or absoluité et subjectivité ou conscience de soi
ne peuvent s’associer, en effet une conscience sans objet est impensable et, même si
cet objet est le soi, il implique une restriction, et par conséquent c’en est fait de
l’absolu. Donc une conscience n’est pas pensable dans le Moi absolu, en tant que
Moi absolu je n’ai pas de conscience et dans la mesure où je n’ai pas de conscience
je ne suis (pour moi) rien, donc le Moi absolu est (pour moi) néant I 3 )).
Le regretté Wolfgang Binder a proposé de remplacer le dernier (( pour moi )) par
((pour soi N v i r sicb), en supposant un lapsus de Holderlin 14. I1 a certainement
raison. La symétrie le veut et, sans cette correction, la phrase est redondante et
tautologique. Malheureusement l’erratum ne s’est pas imposé. Où Holderlin veut en
venir, n’est pas d’emblée très clair. Car Fichte décrète ouvertement que U ce qui n’est
pas pour soi n’est pas un Moi I s D et qu’effectivement le Dieu de Spinoza (( n’est
jamais conscient de soi I h », enfin que le (( Moi de chacun est l’unique et suprême
Substance ». L’objection est donc parfaitement perçue. Mais c’est l’équation Moi
absolu = substance qui est scabreuse, et la confusion entre le moi comme sujet (pur),
(( pure conscience », et le Moi objet de la conscience empirique. Holderlin n’a pas vu
que la conscience pure est interne à la conscience empirique. L’absolu fichtéen n’est
que l’épithète d u Moi.
Manfred Frank suppose que le reproche porte sur le modèle réflexif D appliqué
au Moi absolu I x . I1 faut choisir : ou l’Absolu ou le Moi s’épuisant dans la conscience
de soi. La critique, si critique il y a, porterait sur une apparente contradiction. Mais,
on vient de le dire, Fichte s’est prémuni contre l’objection d u spinozisme subjectif
ou renversé. Son spinozisme est un spinozisme systématique 17, ce n’est pas la même
chose. Ce qui est vrai de la conscience empirique - qu’elle s’objective - ne vaut pas
de la conscience pure, conscience (de) soi, intuition intellectuelle. Spinoza confond
indûment les deux. La distinction sauvegarde l’absoluité du Moi. D’ailleurs Holderlin
saisira mieux bientôt la perspective fichtéenne. C’est seulement par l’intervention du
Non-Moi - opposition absolue, second principe - qu’il peut être question d’objet.
Nul doute que, soit par prédisposition naturelle, soit par génie de l’interprétation
à partir d’un contact assez fugitif avec Fichte, Schelling ait compris pour l’essentiel
l’intention du criticisme. De là le satisfecit que lui décerne Fichte * O . C’est-à-dire
essentiellement la liberté, l’explosion de la liberté, coïncidant avec le sentiment vif
interne du Moi, le ((Je suis »,nerf et ressort vivant de la liberté. Là où est la liberté,
là est l’absolu, l’inconditionné * I . Tout conditionnement vient des objets, de sorte que
le Moi fini, la res cogitans, est une espèce de paradoxe, d’impossibilité. I1 est en porte
à faux, il est Moi et il n’est plus Moi parce qu’il est limité par un Non-Moi, sans
qu’il soit nettement précisé si celui-ci ressortit au sens courant d’objet ou s’il se
rapporte à l’extériorité métaphysique, objectivation transcendante que Schelling appelle,
d’après Hume, les (( terreurs du monde objectif 2 2 N. Mais plutôt Moi absolu, incon170
ditionné, et Moi fini, pensant, sont juxtaposés, séparés par un incompréhensible
accident (qui est la déchéance). C’est pourquoi Vom Icb n’est pas simplement la
proclamation triomphale du Moi absolu. La page fameuse où Schelling invoque Platon
et (( son émule Jacobi )) comme guides du U monde intellectuel 23 )) établit un contraste
entre l’extase contemplative et la situation effective, la vision lumineuse est brouillée
par la finitude et les objets, il a une rupture entre l’être simple indissoluble et la
fragmentation du savoir, entre l’intuition et la foi, l’au-delà et l’ici-bas.
La conscience de soi, incompatible selon Holderlin avec le Moi absolu, est mise
en relation par Schelling, de façon originale, avec l’effort du Moi empirique pour
sauver son identité 24: En disjoignant le Moi empirique, la conscience de soi, et la
liberté, le Moi absolu, Schelling ne tombe-t-il pas dans une dichotomie ruineuse et,
par conséquent, dans l’objection faite par Holderlin? Non, car l’effort contraint du
Moi empirique, la conscience et la tension qui en résultent, se tiennent sous la
dépendance du Moi absolu, l’identité du Moi empirique est transposée de celle du
Moi pur, la conscience de soi est l’ombre portée de la liberté, une conscience pure
est sous-jacente à la conscience empirique.
Bien qu’il dissocie conscience de soi et Moi absolu, Schelling ne mérite pas le
reproche adressé à Spinoza, et il a certainement mieux compris Fichte que ne l’a fait
Holderlin à Waltershausen, avant que Fichte éclairât sa lanterne. Mais de la (( valeur
régulative du premier principe 2 5 N il n’hésite pas à tirer des conséquences extrêmes
qui outrepassent certainement le dessein de Fichte. Elles sont hardiment indiquées
dans la seconde lettre à Hegel 2 6 , et en écho dans ce passage de Vom Icb :
Le but ultime du Moi fini est l’extension jusqu’à l’identité avec l’infini. Dans le
Moi fini est l‘unité de la conscience, c’est-à-dire la personnalité. Mais le Moi infini
ne connaît pas du tout d’objet, donc pas de conscience non plus et pas d’unité de
la conscience, de personnalité. Par suite le but ultime de tout effort peut être
représenté comme extension de la personnalité à l’infinité, c’est-à-dire comme son
anéantissement. La finalité ultime du Moi fini aussi bien que du Non-Moi, c’està-dire la fin dernière du monde, est son anéantissement en t a n t que monde, c’est-àdire en tant que somme de finitude (du Moi fini et du Non-Moi). Vers cette fin
dernière n’a lieu qu’une approche infinie - d’où continuation infinie du Moi,
immortalité *’.
Ces parages eschatologiques et mystiques sont moins infidèles qu’étrangers à
Fichte. Ils témoignent d’une passion exclusive pour la liberté sans rivages, d’un
dynamisme du progrès et de la sympathie, au détriment de la volonté de système et
du transcendantalisme. Certes Fichte insistait autant que faire se pouvait sur la liberté
U âme du système », mais il ne l’entendait pas comme << expansion des choses infinies ».
Quand Schelling déclare que (( la philosophie a trouvé dans le Moi son “Ev Kcti
nàv 2x », ce n’est pas seulement une formule superlative, comme son nec plus tlltra,
c’est une fusion du Moi libre et impatient de toutes entraves avec le sentiment
panthéistique de l’unitotalité, telle que Spinoza et son interprète, le Lessing de Jacobi,
en livraient le symbole et le mot de passe 29.
Doit-on pour autant supposer que l’influence dominatrice, énergique, de Fichte
s’est greffée sur une philosophie déjà existante, quoique confuse, que l’on pourrait
qualifier de spinozisme (revu par Jacobi), et que cette philosophie a dévié la teneur
et l’expression du criticisme? Une philosophie, c’est beaucoup dire pour une aspiration
libertaire et idéaliste, pour des enthousiasmes de lectures, qui cristallisent dans les
slogans connus, “Ev ~ c t nüv,
i
Règne de Dieu, Avent du Seigneur, Eglise invisible ...
mais il est certain que la réception de Fichte parmi les étudiants de Tübingen a
d’abord été intuitive, spontanée, et donc infléchie par des préoccupations antérieures,
en tout cas par un climat préromantique dont la Doctrine de la science n’est que très
indirectement marquée.
17 1
Cependant il ne pouvait échapper à Schelling que la veine contemplative latente
- et quelquefois évidente - de Vom Icb s’accordait mal avec l’activisme d u Moi
fichtéen. De plus l’Absolu devenait Moi par une sorte de passage à la limite, et
inversement le Moi absolutisé s’autodétruisait, s’annihilait comme Moi conscient et
se perdait. Malgré les précautions des définitions, la frontière d u dogmatisme et d u
criticisme était assez floue, C’est pour mieux distinguer leurs caractères respectifs que
Schelling s’est engagé aussitôt après Vom Icb dans la réflexion qui aboutit aux Lettres
sur le dogmatisme et le criticisme : elles attestent un approfondissement d u contraste
et, à coup sûr, une meilleure intelligence de Fichte, sans révocation de l’écrit antérieur.
L’assurance que, dans l’intervalle, Holderlin, retour d’Iéna au solstice d’été 1795, lui
aurait donnée, à savoir qu’il était allé aussi loin que Fichte 3”, a pu le tirer d’embarras
et libérer son élan. Mais sur le point décisif du Moi identifié à la conscience de soi
- presque une palinodie - cette première conversation avec Holderlin a d û être
convaincante.
Entre-temps, en effet, celui-ci avait mis par écrit notamment deux courtes notes,
Urteil und Sein et Hermocrates an Cepbalus 3’, qui reprennent l’aporie formulée avant
que Fichte ait fourni des apaisements éphémères. Ces derniers n’ont pas suffi. L’équation Moi = Moi ou (( je suis moi )) est une identité seconde, qui suppose la séparation
possible, identité de l’identique et de l’opposé. Cette séparation virtuelle originaire,
Holderlin l’appelle Ur-Teifung et, encore une fois, elle a pour type le Moi = Moi
ou le sujet-objet de l’identité. L’opposition dans l’identité exprime le Moi, la conscience
de soi. Plus tard Holderlin en fera l’essence de la Beauté, sous la forme d u “Ev
Giaqcpov EuvrQ 55. Au contraire l’Etre, 1’Etre pur, implique une liaison immédiate,
indissoluble, du sujet et de l’objet, une inséparabilité de principe. Elle est réalisée
dans le cas unique de l’intuition intellectuelle. La référence secrète au simple et à
l’indissoluble de Jacobi, que Holderlin avait pieusement recopié 34, est aisément
reconnaissable. Quant au fragment contemporain intitulé (( Hermocrate à Céphalus »,
il traite du problème de l’achèvement systématique éventuel du savoir et il est dirigé
contre Fichte auquel il reproche son (( quiétisme scientifique ” ». Que ce soit en
esthétique et en poésie, ou en philosophie et théorie de la connaissance, Holderlin
opte pour une attitude militante, dialectique, qui ne laissera pas d’impressionner
Hegel.
C’est à propos de l’intuition intellectuelle, probablement, que les jeunes gens se
sont mutuellement stimulés et que Holderlin a réorienté la direction de son ami, car
le changement d’attitude à l’égard de l’intuition intellectuelle est la plus nette, et en
définitive la seule rétractation des Lettres par rapport à Vom Icb. Mais quelques
indications chronologiques sont indispensables.
La préface de Vom Icb est d u 29 mars 1795 36 et le livre a été immédiatement
mis en circulation. Holderlin est revenu d’Iéna, déprimé et las, au début de l’été.
L’éditeur de Schelling a antidaté la fameuse rencontre des deux amis en la reportant
au printemps 3 7 . Elle a eu lieu en réalité en juillet, et Hegel s’en est fait l’écho le
30 août, déplorant de n’avoir pas été (( le troisième homme 38 ». Schelling, qui traversait
lui aussi une mauvaise phase, a d û se sentir réconforté par cette visite. I1 achevait
alors la première partie (lettres 1 à 4) des Lettres philosophiques, qu’il envoie à
Niethammer le 13 août 39. Elle a paru avec retard en janvier 1796. La deuxième
partie (lettres 5 à 10) a été rédigée pendant les mois suivants, à Tübingen et à
Stuttgart, puisqu’elle est expédiée à Niethammer le 22 janvier 1796 40. Dans l’intervalle ont eu lieu, en septembre, en décembre, de nouvelles conversations avec Ho1derlin, presque un symphilosophein. C’est sur cette seconde partie, dans la mesure où
elle se démarque légèrement de la première 4’, que l’influence de Holderlin est
vraisemblable, sinon éclatante. Mais sa présence n’est pas forcément exclue même de
la première partie et surtout de la première lettre, véritable exorde holderlinien 42. Le
courrier de Holderlin à Niethammer fait état de nouvelles convictions de Schelling,
172
d’un timide reniement, d’un changement d’itinéraire, d’un désaccord occasionnel.. . et
à sa mère il parle même de disputes 43. Cela veut dire en clair que Schelling ne s’est
rallié qu’avec réticence, et provisoirement, à la critique de Fichte.
I1 est plausible, d’autre part, qu’un Holderlin déjà dégrisé du fichtianisme ait
lu dès sa parution l’écrit de prémices Vom Zcb et qu’il s’en soit approprié l’esprit,
Cette lecture serait antérieure à la note Urteif und Sein, ce qui expliquerait la désinence
inteffektuale (au lieu d’intellektueffe) Anscbauung, caractéristique de Schelling, non
sans doute pour souligner une prononciation plus ouverte, mais pour évoquer l’arnor
Dei inteffectuafis de Spinoza. Quoi qu’il en soit, l’intuition intellectuelle est au centre
du débat, elle fait une apparition fracassante dans les destins de la philosophie. Kant
l’avait prohibée sans ambages au sens de vision (créatrice et divine, béatitude,
mystique), et l’interdit s’était communiqué à répétition chez les kantiens de stricte
observance. Mais dans le contexte d’un kantisme ouvert et implicite - celui de Fichte,
de Schelling, de Holderlin ... -, la notion n’a pas semblé à ce point déshéritée qu’elle
n’ait pas pu être reprise et réemployée dans un sens non nouménal. Reinhold, fidèle
entre les fidèles, n’avait pas hésité à parler d’intuition intellectuelle pour la ((pure
représentation intellectuelle du Moi », mais il ne rompait pas le cadre catégorial du
kantisme. C’était une première levée d’interdit, non sur la chose, mais sur le mot.
Plus hardiment Fichte, dans la Recension d’Énésidème, avait à deux reprises, de manière
laconique, attribué l’intuition intellectuelle à l’autoconnaissance du Moi absolu en
acte 44 - cas unique d’intuition non sensible et non formelle, par conséquent susceptible
de l’article défini. Derrière la discrétion de Fichte il y avait en fait une longue
hésitation, des atermoiements, une élaboration encore inchoative. O n le sait seulement
depuis la publication d’extraits de notes préparatoires à la Doctrine de f a science, par
Willy Kabitz, et mieux depuis la publication de tous les brouillons par Reinhard
Lauth. Toutefois, pour des raisons qui ne nous concernent pas ici, l’intuition intellectuelle est absente de la première WL. Mais les deux mentions de I’Énésidème
n’avaient pas échappé à des lecteurs fascinés et, de plus, Fichte se servait oralement
de l’expression, Holderlin a pu la recueillir de ses lèvres; plus sûrement néanmoins
de l’écrit de Schelling. Chez Fichte elle avait évidemment la signification du Moi en
acte, conscient de soi.
La discrétion officielle de Fichte laissait le champ libre à l’interprétation. D’emblée
Schelling a pris feu et flamme pour la notion et il en donne une version enthousiaste,
quoique pas toujours limpide, dans les feuillets brûlants de Vom Zcb 45. La thématisation
savamment élaborée de la (( huitième Lettre 46 )) enlèvera à l’intuition intellectuelle
l’ambiguïté préalable, mais l’éloignera de la conception de Fichte et suscitera de la
part de celui-ci une réaction et une réplique consignées dans la a Seconde Introduction
à la Doctrine de la science 47. )) Que si l’on répugne à attribuer à un si jeune homme
- Schelling - l’autorité nécessaire pour lancer et imposer une notion, et pour la doter
de toutes ses harmoniques, il faut répondre qu’ici et pas ailleurs un monde d’expériences et d’impressions diffuses est mis en relation avec le terme d’intuition intellectuelle, et qu’outre son génie de l’amalgame et sa virtuosité, Schelling est le
représentant d’un milieu en pleine ferveur de recherche, d’un foyer de pensées et de
rêves, où Holderlin également tenait une place prépondérante, autre génie d’horizon
différent. I1 n’en va pas autrement des notions et symboles qui cristallisent tant
d’aspirations et de pensées, le Règne de Dieu, le Dasein, le “Ev ri x&v, auxquels
l’intuition intellectuelle est directement associée, voire du Moi absolu lui-même,
auquel elle est primairement attachée 48. Loin d’êtreùne donnée fixe et bien déterminée,
l’intuition intellectuelle est une notion fascinante, mouvante, un état d’esprit et un
état d’âme, objet d’interrogation et de recherche : «: dans l’intuition intellectuelle )) se
réfère à un pouvoir sublime du Moi, et comme à une faculté dont l’exercice reste à
vérifier.
173
L‘oscillation de sens est repérable dans Vom ich. D’un côté la récupération du
pouvoir d’intuition intellectuelle sur. la critique est menée selon les règles dans la
ligne de Fichte, et le Moi absolu dans le surgissement ou l’érection de la liberté en
est le seul titulaire. N Je suis! D ou U Je suis moi! )) ou a Je pense, je suis N 49 sont
prédicats d u Moi pur et traces de l’unique intuition intellectuelle, la découverte du
Moi (inoubliable pour Jean-Paul comme pour Anton Reiser), l’autoposition. Ce texte
énonce bien le privilège intuitif du Moi :
L’incompréhensible n’est pas comment un Moi absolu.. ., intellectuel, peut-être
intellectuel, c’est-à-dire absolument libre, mais comment il est possible à un Moi
empirique d’être en même temps intellectuel, c’est-à-dire d’avoir une causalité
libre 50.
Mais d’un autre côté le mobèle contemplatif de Spinoza, de Platon et de Jacobi tend
à substituer au Moi pur 1’Etre pur, à l’énergie de la liberté la paix de l’immuable
et d u supra-sensible, désiré, a p e r 9 à travers les lambeaux d u langage 5 ’ . L‘intuition
intellectuelle est troublée, interceptée par le temps et les objets; l’Un et Tout, dans
lequel nous avons la vie, le mouvement et l’être, apparaît comme une terre étrangère;
à la vision de l’éternel et de l’inaltérable supplée une a intuition autoacquise de
l’intellectuel en nous »,qui est en somme une croyance et qui rappelle curieusement
l’effort contraint de la conscience de soi retenant le flux des représentations. Or c’est
cette conception de l’intuition intellectuelle à la Spinoza, tout à fait insolite pour
Fichte, qui prévaut dans la première et surtout la huitième (( Lettre )), assortie d’une
critique surprenante, imprévisible dans Vom Zch, qui assimile l’intuition inteliectuelle
poursuivie à une extase mortelle (comme le vertige de Jacobi enfant) et qui préconise
le réveil de la réflexion et de la conscience de soi 5 2 . Ainsi l’orthodoxie fichtéenne est
sauvée provisoirement, au détriment de l’intuition intellectuelle reversée au compte
du mysticisme et des états apparentés.
L’intervention de Holderlin est patente ici. En rattachant strictement le Moi et
la conscience de soi, il détachait en quelque sorte l’hypothétique intuition intellectuelle
et il l’assignait à une connaissance de l’être pur, connaissance d’ordre esthétique, d’une
intimité indéchirable et primordiale du sujet et de l’objet 5 3 : bref l’expérience du
Hen Kai Pan dans lequel baigne ie Moi, et dont les belles anaphores de la deuxième
Lettre de Hypérion transmettent le bercement cadencé. La cassure est nette entre cette
expérience de l’être pur et la philosophie d u Moi. Désormais Holderlin n’envisagera
sa philosophie que sous l’angle esthétique (dans l’admirable dernière lettre de la
première partie de Hypérion). L’intuition intellectuelle, dont il n’abuse pas et qui
reste chez lui une notion problématique, s’applique à l’expérience esthétique vivace
du poète et du dramaturge 54, mais il lui arrive d’être rapportée aussi à la philosophie
théorique, voire d’alterner avec une sensation divine )) voisine de l’inspiration poétique.
Le moment esthétique n’est pas absent des Lettres philosophiques, tant s’en faut,
mais il n’est pas utilisé pour relever d’un opprobre provisoire l’intuition intellectuelle.
Celle-ci s’efface avec l’hommage à Spinoza >>.Sa carrière reprendra dans la suite de
l’œuvre, d’abord par un retour à la signification fichtéenne, puis par un développement
au pluriel, arborescent et quelque peu arbitraire, auquel Hegel donnera un brutal
coup d’arrêt dans la (( Préface N de la Phénoménologie de l’esprit. Paradoxalement
Holderlin, revenu violenté et déçu des cours de Fichte, aura aidé Schelling à se
remettre dans la mouvance du Titan d’Iéna et A produire les étincelants commentaires
fichtéens des Erlduterungen.
On doit en finissant s’excuser de demeurer sur le seuil d u Plus ancien programme
systématique de l’idéalisme allemand, fragment d’auteur inconnu, copié par Hegel,
publié par Rosenzweig et attribué par lui à Schelling, par d’autres à Hdderlin. O n
174
a épilogué - Fuhrmans entre autres - sur l'éventualité et la date d'une collaboration
à ce texte étrange, qui a valeur symbolique. N i la paternité schellingienne ni la
paternité holderlinienne ne sont pleinement satisfaisantes. O. Poggeler réclame le droit
d'auteur pour le scripteur Hegel, et il ne manque pas de bons arguments. Toutefois
la restitution se heurte à des objections relatives au contenu. I1 est plus prudent de
ne pas forger trop d'hypothèses et de laisser les choses en suspens.
Xavier Tilliette
NOTES
1. Cf. par exemple W. Betzendorfer, Holderlins Studienjahre, 1922 ; Martin Leube, Die Ceschichte des
Tiibinger Stijk, 1770-1950, 1954; Carmelo Lacorte, I l Primo Hegel, 1959; Julius Klaiber, Holderlin,
HegeI und Schelling in ihren schwüùischen Jugcndjahren, Cotta, Stuttgart, 1877.
2. Briefi von und a n Hegel, I, p. 9- 1 1.
3. Holderlin, Sümtliche Werke (éd. F. Beissner), VII,2 (Adolf Beck), p. 252-254 (lettre de Schelling
à Gustav Schwab, I 1 février 1847). Cf. VII, 1 p. 463.
4. Schelling im Spiegel seiner Zeitgenossen, t. 2, p. 437, 439-440.
5. Dans Holderlin und die Philosophie, 1942.
6. Holderlin und Hegel, Mohr (Siebeck), 1931
7. Manfred Frank, Eine Einfiibrung in Schellings Philosophie. Francfort, Suhrkamp Taschenbuch, 1985,
p. 61-70.
8. Fichte, Gesatntausgabe, 111,2, p. 298-300. (« Mon système est le premier système de la liberté ».)
9. Nettement mises en lumière par Alexis Philonenko.
10. Bride von und an Hegel, I, p. 18-20.
11. Ibid., p. 20-23.
12. Contre l'opinion de Fuhrmans.
13. Bride von und an Hegel,,p. 20. Cf. SW, VI,l, p. 155.
14. SW, VI.2 (Ad. Beck), p. 724.
15. Fichtes W . (I.H. Fichte), I, p. 97.
16. Ibid., p. 100.
17. Ibid., p. 122.
18. Op.rit., p. 62.
19. Fichtes W.,I, p. 123.
20. Fichte, Gesatntausgabe, 111,2, p. 347-348 (à Reinhold, 2 juillet i795).
21. Schellings Werke (éd. Corta), I, p. 177, 1.79, 193, 199, 204, 206, 210, etc.
22. U Die Schrecken der objektiven Welt », cf. la l o ' Lettre, W., I, p. 337.
23. Ibid., p. 2 16.
24. Ibid., p. 180-181. Cf. p. 193.
25. Fichtes W.. I, p. 123.
26, Briefe von und a n Hegel, I, p. 21-22.
27. Schellings W., I, p. 200-201.
28. Ibid., p. 193.
29. Cf. Lettres sur la doctrine de Sprnoza. Jac-obi, Werke IV,l, p. 54-55.
30. Plitt, I, p. 71.
31. Holderlin, Sümtliche Werke, 4, I, p. 213, 216-217.
32. ibid., p. 216.
33. Hypérion, dernière lettre de la 1" partie.
34. SW, 4, I, p. 210. Cf. Schelling, I, p. 186.
175
35. SW, 4, I, p. 213.
36. Schelling, I, p. 159.
37. Plitt, I, p. 70-71.
38. Bride von und an Hegel, I, p. 33 (30 août 1795).
39. Horst Fuhrrnans, F. W.J.Scbeiiing. Brteje, I, p. 63.
40. Ibid., p. 59-60.
4 1. C'est une conjecture, mais la revalorisation pratique du dogmatisme ne se prédessinait pas avec
cette force.
42. Schelling, I, p. 284-285.
43. Cf. lettres de Holderlin à Niethammer (22 décembre 1795; 24 février 1796), SW, VI,l, p. 191203; et à sa mère, ibid., p. 280, 1" septembre 1798.
44. Fiches W., I, p. 10, 16.
45. Scbeiiings W . , I, p. 181, 202-204, 206-207, 210, 215.
46. Ibid., I, p. 318-319.
47. Fiches W., I, p. 459-518.
48. Scbeiiings W., I, p. 194.
49. Ibid., p. 179, 204, 206, 210.
50. Ibid., p. 235-236.
51. Ibid., p. 216.
52. Ibid., p. 325.
53. SW, IV,l, p. 216.
54. Cf. les deux écrits obscurs U Sur la démarche de l'esprit poétique B et a Sur la différence des
genres de poésie », SW, IV, p. 241-272.
55. Scbeiiings W., I, p. 317, 321-322.
Image vivante du néant
Marc Kauffmann
x Feins de poser tes yeux avec lui
Sur cet orme qui n’ose plus lui faire signe
Pour ne pas I’éveiller de sa pitoyable divinité. m
J.-P. de Dadelsen N La folie de Holderlin n I .
Figé dans une terrible immobilité, Joë Bousquet écrivit dans un de ses
Cahiers bleus D : (( C’est le privilège des misérables que la pensée ne peut se
détourner d’eux. Par eux peut-être. Ce qui passe en appelle à sa propre fin 2. N Le
silence de Holderlin n’a cessé d’inquiéter les esprits au point d’avoir recouvert
parfois l’œuvre. Mais dans pareilles retraites, il suffit qu’un vent de liberté, venu
de Grèce ou d’ailleurs, se lève pour que de telles âmes abandonnent le territoire
des ombres. L’écho des espérances les plus pures vient alors sur elles pour quelques
instants d’un bonheur immense qui les terrasse aussitôt. Ce qui est rêvé dans ces
fulgurances est plus proche de la vérité que toute la misère qu’ils endurent, que
toutes les souffrances et tout le néant dont leur humanité comme la nôtre sont
traversées. Ainsi que l’attestent plusieurs témoignages dont une lettre d’Ernst
Zimmer, Holderlin a connu pareille éclaircie à l’annonce de l’insurrection grecque
qui, à partir de 1821, mobilisa les consciences et les énergies à travers le monde.
La guerre d’indépendance nationale du peuple grec cristallisa beaucoup de choses
pour une génération n’ayant pas connu la grande révolution et qui pourtant en
appelait à des changements. La protestation romantique contre l’ordre social et
politique s’empara de l’événement et y trouva un exutoire de choix. Un peu
((
177
partout, mais de façon privilégiée en France, cet événement contribua puissamment
au mouvement d’unification de l’opinion, cette a âme de la société civile ».
Parmi les agents les plus dynamiques de cette mobilisation des esprits se
trouvaient les artistes, les philosophes et les publicistes qui, tant à Paris qu’en province,
promouvaient les idées, réclamaient la liberté des peuples et ainsi influaient sur la
conduite des affaires. C’est dans deux articles écrits à cinq années d’intervalle et insérés
dans des revues soucieuses de la liberté et de la culture des peuples que Holderlin a
été présenté pour la première fois au public de langue française. Les premières pages
consacrées à l’auteur d’Hypérion ont paru dans la livraison d’octobre 1831 de la
Nouvelle Revue germanique (t. IX, ni’ 34, p. 155-169), publiée à Strasbourg par la
maison d’édition Levrault qui disposait de distributeurs parisien (Dondey-Dupré),
bruxellois et genevois. Ce (( recueil littéraire et scientifique )) avait en 1829 pris la
suite de la Bibliothèque allemande de 1826 (2 tomes) et de la Revue germanique de
1827. Par des cahiers mensuels, on cherchait depuis Strasbourg à faire connaître en
France et dans les pays francophones l’Allemagne des années 1830 tenue pour a tout
autre, [...I et infiniment plus riche N que celle de Mmede Staël où dominaient les
fureurs des commencements. Bon nombre de préoccupations de l’époque, sa sensibilité,
ses espoirs secrets, ses errances aussi se mirent dans une telle revue, tant il est vrai
que (( les journaux et les revues sont de merveilleux sténographes, qui saisissent au
passage toutes nos folies; et des télégraphes très fidèles qui les transmettent à la plus
lointaine postérité ». Le goût pour l’Allemagne, relancé en 1814 mais ne s’installant
vraiment que vingt années plus tard, trouvait là bien plus qu’un préalable, une
préfiguration. Le maître-d’œuvre et principal rédacteur des plus riches années de la
revue (1829 à 1834) fut l’Alsacien Joseph Willm, solide connaisseur de la littérature
et de la philosophie allemandes qu’il enseignait à l’université 6 . C’est Willm, traducteur de Guizot et du Lascaris de Villemain en langue allemande, qui était à
l’origine d’une orientation philhellène si prononcée que l’éditeur de 1827 se sentit
menacé dans sa position et demanda un engagement moins explicite. Plutôt que de
mettre en avant de façon trop marquée la cause des Grecs, il fut alors longuement
traité de la U Révolution de Servie )) ou des difficultés que l’empire ottoman avait
rencontrées dans un passé plus lointain. O n continua cependant à rendre compte de
toutes les publications allemandes ayant trait à la Grèce. Sans toujours égaler la
parisienne Revue britannique, son aînée, la Nouvelle Revue germanique n’était pas
dépourvue de qualités : ainsi sur un peu plus d’une année, de Pâques 183 1 à juin
1832, et pour la seule partie littéraire et philosophique, elle engage une série d’articles
sur la vie de Fichte, traduit des poèmes alémaniques de Hebel et quelques Reisebilder
de Heine (Henri), rend compte des Lettres de Paris de Boerne, achève avec détermination une révision de (( La philosophie morale depuis Kant et Jacobi », ouvre une
biographie de Novalis, publie une nécrologie de Hegel dont est annoncé un examen
approfondi de l’œuvre (il ne viendra qu’en 1835), livre de larges extraits d’Henri
d’oferdingen et donne la Vie de Pheureux maître d’école Maria Wurz d’Auenthal.
Au milieu de tant de nobles figures, Hypérion connut sa première traduction N
française sous la forme de fragments. Le traducteur qui par précaution a voulu garder
l’anonymat choisit cinq lettres qu’il fit précéder d’une étonnante mise en perspective
de Holderlin et d’un résumé succinct mais précis du roman, (( si toutefois il est permis
de ranger son livre sous cette catégorie N note-t-il, tant est forte la charge élégiaque
qui parcourt le texte, au point de continuer aujourd’hui encore à subvertir les genres
structurant l’espace littéraire. L’esquisse biographique, qui mêle certaines indications
précises à des éléments totalement fantaisistes, offre un condensé de l’image d u poète
et de la légende qui s’étaient construites à son sujet. Les renseignements ont été
collectés sur place par un correspondant, ancien étudiant à l’université de Tübingen
puisqu’il mentionne avec exactitude les travaux de 1790 de l’étudiant Holderlin,
’
178
ayant eu la présence d’esprit de consulter le registre où étaient consignés les intitulés
des mémoires #.
De toute évidence, l’article et les lettres retenues sont adressés à des lecteurs
qui se sont battus en faveur de la Grèce : c’est l’enthousiasme de la lutte contre
l’oppresseur ottoman, c’est-à-dire un régime despotique, et le réveil du sentiment de
la liberté chez les Grecs que salue un auteur ayant passionnément suivi cette aventure
des temps modernes. De façon subtile, le traducteur anonyme gomme dans la première
lettre la mention d’un (( futur Etat libre n et y substitue le terme de (( liberté ». Sans
doute considérait-il comme Hypérion le déplorait déjà et comme le redira Dadelsen ’O,
que les combattants n’ont pas été à la hauteur des espoirs qu’ils avaient suscités. En
se contentant d’exactions et de l’habituel pillage, ils ont manqué le projet politique
auquel ils (s’)étaient destinés : fonder une république. Tel eût été et devrait être
l’accomplissement idéal de toute guerre de libération. Au mépris des sacrifices consentis
par le peuple et de l’espérance qu’on a fait naître sur son front, les dirigeants politiques
grecs ont donné une issue amère à la Guerre d’indépendance, se laissant imposer pour
roi le fils de Louis Ir’ de Bavière, le prince Othon ”. A sa manière, l’anonyme participe
de la joie du poète et prolonge l’attitude holderlinienne - commune à toute une
génération - lors de l’annonce de l’insurrection grecque qu’il avait rêvée trente années
auparavant. Contrastant avec l’indifférence (seulement feinte?) vis-à-vis de la Révolution française et le déni du nom même de Paris, l’intérêt de Holderlin pour cette
cause, à ses yeux sacrée, témoigne d’une authentique volonté d’être en phase avec le
vent de liberté venu du sud.
Durant ces heures vécues dans l’attente des nouvelles, le cœur s’est ouvert à
l’action généreuse et la noblesse d’âme des plus purs a pu se révéler dans sa beauté
ainsi qu’en témoigne la fin de la quatrième lettre. Après que ce feu divin s’est allumé
en nous, tout exil ou retour au pays, dans une contrée soi-disant civilisée, ((en
Allemagne (mettez tel autre pays que vous voudrez) D (p. 159), équivaut à un affront,
à une chute dans l’enfer des choses et la forme civilisée de la barbarie humaine. C’est
pourquoi le correspondant de la Nouvelle Revue germanique adapte librement en
atténuant quelque peu la dureté des termes, l’avant-dernière lettre d’Hypérzon, celle
que le héros adresse à l’ami Bellarmin pour lui dire la profonde désillusion et le
désespoir qui s’abat sur celui dont l’âme a grandi, s’est éployée au nom de la liberté,
vraie rose de l’esprit, et qui à présent est de retour, sans plus jamais parvenir à trouver
un chez-soi. (( Pour Holderlin, il n’y avait plus de patrie, ni en Allemagne, ni ailleurs »,
écrit Georg Lukacs I * . Rarement un poète s’est senti à la fois si étranger au peuple
au sein duquel il est appelé à vivre et si proche de son destin. Rigoureusement
parlant, Holderlin a écrit dans les dernières pages d’Hypérion un passage poétique à
l’Unheimlicbe, (( cet étrangement de soi », (( ce sentiment de l’éloignement d u proche 1)
qui finit par rendre insensés les mouvements les mieux réglés 1 3 . De même, (( la
constante invocation de la Grèce en tant qu’unité de la culture et de la nature est,
chez Holderlin, une accusation contre son temps, un vain appel à l’action, à la
destruction de cette réalité misérable l4 ». La dernière des cinq lettres que traduit le
correspondant anonyme de la Nouvelle Revue germanique est l’une des plus dures,
l’une des plus terribles attaques jamais adressées par un poète au peuple allemand l 5
et, par-delà cette circonstance, par un poète à son peuple qui demeure, volens nolens,
le destinataire privilégié d’écrits, à lui adressés. En mettant en forme la condition
tragique d u poète, analogue à celle de tout penseur authentique dans le rapport qu’il
peut avoir à sa communauté de destin ou d’origine, le propos de Holderlin s’inscrit
sur une ligne crénelée qui, du Lessing des Briefi, passe par Winckelmann et Heine,
et court jusqu’à la Gotzen-dümmerung de Nietzsche dont il annonce la violence de
ton et la sévère critique du philistinisme allemand. C’est une constante de l’esprit
allemand, ce fut aussi son salut, que d’avoir toujours produit, même avec des décalages,
les antidotes de sa puissance d’affirmation et de l’inconditionnalité qu’avec raison il
179
met à la base de soli développement. Ainsi que l’a écrit Schelling, en termes voilés
et en un temps où seule une fondation dans la pensée lui paraissait envisageable :
U La conscience de Joi irr,plique d’emblée le risque de perdre le Moi 16. D L’affirmation
de l’identité nationale à travers les traits caractéristiques d’une œuvre d’art et la
promotion sublimée d’un Soi originaire ne vont pas sans la reconduction de ce risque
immanent à la pensée qu’est l’ouverture à un (( rapport vivant )) à l’étranger. Un tel
rapport se donne aussi, en retour, sous la forme d’une critique du propre. La tentation
allemande moderne de promouvoir des formes immuables et hiératiques s’est heureusement toujours heurtée à la force de l’esprit critique, voire de l’autocritique. Peter
Szondi est bien fondé à écrire qu’ : (( [...I aucun doute n’est permis : il s’agit pour
Holderlin d’atteindre le propre sans sacrifier l’étranger, de parvenir à la sobriété sans
sacrifier le pathos - il s’agit donc, non pas de retournement natal ”, mais de
médiation des contraires ” ». Qu’au terme de la guerre de Morée, un Français
germanophile et philhellène ait ressenti une dissonance intérieure identique dans sa
dureté à celle qui affectait Holderlin, au point de s’y reconnaître, dit également
combien (( Hypérion raconte toujours quelque chose de nos aventures intellectuelles,
de nos guerres, de nos amours, de nos révolutions, de nos retours en Grèce I s )).
L’existence de Holderlin aurait pu cristalliser plusieurs sourdes attirances, mais
parmi les poètes de langue allemande qui l’ont célébré en lui dédiant un poème,
(( les romantiques brillent par leur absence l 9 ». Sans doute existe-t-il d’autres manières
plus prégnantes de rendre hommage à un poète. En France, et pour ce même siècle,
il n’en est pas allé autrement, malgré ce texte paru dans la Nouvelle Revue germanique.
a Alsacienne par son lieu d’édition et en général par l’origine de ses collaborateurs,
cette dernière n’a pu retenir l’attention des Parisiens 2o ». Cinq années après le premier
article, il y eut pourtant une autre voix pour se reconnaître dans la trajectoire du
poète : Philarète Chasles (1799-1873), celui-là même qui n’hésitait pas à dénoncer
les usurpateurs du nom de romantique, un esprit vagabond aux multiples curiosités
qui avait (( un vrai talent d’opérer des résurrections 21 ».
Le critique Chasles était, comme Holderlin, un auteur dont la vie littéraire s’est
déroulée en dehors de tout système et qui de manière incessante a marqué ses
préférences pour les vaincus, les maudits, les obscurs 22. C’est lui qui réalisa la seconde,
mais tout aussi mineure convocation ((romantique )) de Holderlin en France. A la
suite d’un séjour en Suisse et d’un passage en Alsace 23, Chasles retravailla le matériau
fourni par la revue strasbourgeoise, intégra de nouveaux renseignements sur le dernier
lieu de vie d u poète et publia dans la Revue de Paris du 18 décembre 1836 (t. XXXVI,
p. 201-209) un article simplement intitulé (( Holderlin », signé des initiales PC 24. La
lecture n’est cependant plus la même, et si elle differe sur plus d’un point, c’est parce
que Chasles ne comprend pas Holderlin sans avant tout penser à soi-même. Les
motifs que Balzac a si magistralement tressés dans les Illusions perdues, commencé à
la même époque, trouvent dans la fiction proposée par Chasles une sorte de précipité :
le même désenchantement de soi et de Paris y sont à l’œuvre. Alors que le traducteur
anonyme de la Nouvelle Revue germanique indiquait la perte de la beauté, la traduction
de Sophocle et le séjour à Bordeaux comme causes probables de la maladie, Philarète
Chasles dit que la folie de Holderlin tire surtout sa source de Paris et du maelstrom
des idées et des sentiments révolutionnaires. (( La grande ville, le monstre civilisateur
aux mille sons, aux mille voix, l’a vaincu et écrasé. I1 s’est laissé abattre et surprendre
par ce tumulte qu’il ne comprenait pas )) (p. 206-207 2 5 ) . En fidèle lecteur de
Montesquieu et Mmede Staël, Chasles souligne l’austérité des mœurs allemandes,
(( dont le mouvement
circulatoire s’opère avec. la régularité d’un métronome de
Maëlzel », et il en déduit l’impréparation de Holderlin à affronter (( un chaos dont
nul céleste son n’émane )) (p. 203). Dans un mouvement de profonde compassion, il
écrit : Pauvre Holderlin! qui a cherché dans ce monde ce que le monde ne peut
donner, dans un monde de transition et de combat, ce qui appartient à peine aux
y
180
époques de stabilité )) (p. 207). Au passage Chasles met en avant, mais de façon
distanciée, les qualités visionnaires du poète quant à l’insurrection des Grecs. L’enthousiasme qui avait fait tressaillir l’Europe devant la courageuse Grèce paraît déjà
lointain. L’intérêt majeur de cette rencontre Chasles-Holderlin pourrait tenir, au plan
de l’histoire des idées, dans l’analyse qui fait suite aux extraits 26 et qui - pour partie
- précède d’un siècle l’interprétation que fit LukAcs de Holderlin dans Goethe et son
temps.
Ainsi, tandis que Holderlin éprouvait durablement la tension du maintien dans
l’existence à travers un (( se survivre )) qui empruntait à la folie sa tunique, Hypérion
et son poète étaient réinvestis par une postérité qui a su voir en eux des figures
emblématiques, mais qui manqua également en son fond le souci qui habitait l’œuvre.
Les auteurs de ces deux articles n’ont cherché, l’un dans des fragments, l’autre dans
les stigmates du malheur d u poète, qu’un écho d’une exaltante aventure ou des reflets
d’angoisses personnelles nées d’un malaise propre au siècle. Malgré les limites de leur
entreprise, ils ne sont pas seulement. des médiateurs entre deux cultures, mais les
précurseurs d’une postérité française plus réceptive et plus attentive au génie d’une
parole poétique adossée à l’abîme. O n peut lire une œuvre, se passionner pour une
présence, sans pour autant soupçonner les limites sublimes et banales à l’intérieur
desquelles elles ont pu se produire. I1 arrive à l’esprit de trouver consolation dans
une fiction ou dans un pur rapport imaginaire. Une œuvre qui a tant mis l’imagination
poétique à contribution permet et justifie de telles lectures commandées par le temps,
car (( Hypérion partage l’erreur, l’incertitude et la faute de tous - la brillante misère,
dont parle Kant, de la culture humaine *’ ».
Marc Kauffmann
NOTES
1. Jean-Paul de Dadelsen, Goethe en Alsace et Autres Textes, postface et notes par Baptiste-Marrey,
Le temps qu’il fait, G. Monti éd., 1982, p. 24.
2. J. Bousquet : (Euvre romanesque complète, t. IV, A. Michel, 1984, p. 311. I1 est étonnant que le
solitaire de Carcassonne, pourtant familier des romantiques allemands, n’ait pu voir en Holderlin son
double.
3 . Comme l’appelle Pierre Rosanvallon, Le Moment Guizot, Gallimard, 1985, p. 65.
4. c Introduction #, non signée. I1 s’agit de l’éditorial de Joseph Willm pour l’année 1829. In Nouvelle
Revue germanique, t. I, n” 1, p. 2.
5. Chasles, dans son compte rendu de la traduction française des œuvres complètes de Walter Scott
paru dans le Journal des débats du 9 décembre 1834, cité par Claude Pichois dans Philarète Chasles et
la Vie littéraire au temps du romantisme, t. I, José Corti, 1965, p. 505.
6. Sur Willm, voir notre article : (c Joseph Willm : une vocation d’éducateur et de philosophe (17921853) n, in Saisons d’Alsace, n ” 9 0 , déc. 1985, p. 53 à 90.
Dans le troisième tome de sa monumentale Histoire de la philosophie allemande (1849), Willm souligne
les liens d’amitié qui unissaient Hegel à Holderlin a qui paraît avoir exercé sur son esprit une action
assez profonde N (p. 384). Pour permettre au lecteur d’en juger, il cite en note un fragment d’Hypérion,
extrait de la seconde lettre à Bellarmin : (( Etre un avec le tout; telle est la vie de la divinité, telle est
la félicité de l’homme. - Etre un avec le tout, avec tout ce qui vit, dans un heureux oubli de soi-même,
retourner au sein de la nature, tel est le comble de la pensée et de la joie, le lieu de l’éternel repos, où
le midi perd de son ardeur et le tonnerre sa voix, où la mer bouillonnante ressemble aux flots doucement
agités d’un champ de blé mûrissant N (p. 463). Un peu plus loin, il rappelle le préceptorat francfortois
durant lequel il [Hegel] retrouva son ami Holderlin, placé dans une position semblable, mais livré à
des passions ardentes que Hegel ne connaissait point N (p. 385).
Willm s’est servi de l’article de Karl Rosenkranz a Aus Hegels Leben n dont la première partie
consacrée à (( Hegel und Holderlin )) livrait pour la première fois au public le poème (( Eleusis N (in
Literavhistorisches Taschenbuch, 1843, Leipzig, O. Wigand, p. 9 1-103).
((
181
7. Cet auteur est, nous semble-t-il, le D Pierre Lortet (1792-1868), médecin, philosophe, publiciste
et philhellène d’origine lyonnaise que Joseph Willm avait rencontré durant ses propres années de
préceptorat. Associé au lancement de la Bibliothèque allemande, il collabora régulièrement à la Nouvelle
Revue germanique. Ayant vécu un temps à Heidelberg, lisant couramment l’allemand, il a pu découvrir
Hypérion durant ses années d’étude et être reconduit vers lui au retour de Grèce de ses amis Quinet et
Vietty. Un peu dans le même esprit que ces lettres tirées d’Hypérion,il a traduit de Fichte D e i’idée
d u n e guerre légitime (Lyon, 1831). En 1825, il avait déjà traduit les Recherches sur la nationalité, l’esprit
des peuples allemands et les institutions qui seraient en harmonie avec leurs mœun et leur caractère, un
ouvrage de philosophie sociale de Friedrich Jahn.
C’est sur le conseil de Lortet que, le 5 avril 1828, Edgar Quinet pressentit auprès du baron Joseph
Marie de Gerando le sculpteur lyonnais Jean-Baptiste, dit Eugène Vietty (1787-1842), U plus helléniste
que sculpteur )) (Amaury-Duval, Souvenirs (1829-1830) 1885, p. 56) et dont l’esprit enthousiaste
s’enflamme aussitôt (Cf. Jean Tucoo-Chala, U Introduction D à l’édition critique faite en collaboration
avec Willy Aeschimann de L a Grèce moderne et ses rapports avec L’Antiquité suivi du Journal de uoyage
(inédit) d’Edgar Quinet, Belles Lettres, 1984, p. XXXIX). - Le destin de Vietty, lecteur de Winckelmann
et dont la première œuvre sculptée fut une copie de 1’Apolline grecque, est parallèle à celui de Holderlin.
Revenu de Grèce en août 1831, donc bien après les autres membres d’une expédition qu’il avait désertée
pour parcourir librement la Morée, son séjour là-bas est aussi obscur que celui de Holderlin à Bordeaux.
Durant les dix années qui ont suivi son retour, il erra dans l’arrière-pays lyonnais, totalement démuni
et travaillant à rédiger son livre sur l’art grec, un rapport qui ne verra jamais le jour. (Cf. Léon Charvet :
U Jean-Baptiste Vietty 1) dans la Réunion des Sociétés des beaux-arts des départements, 34‘ session, 1910/
I, p. 31 à 53, et 35‘session, 191l/II, p. 192 à 239.)
Étonné par l’état moral et la santé physique dans lesquels Vietty arriva au pays, Lortet a écrit cet
article et traduit quelques pages d’Hypérion afin de s’expliquer à soi-même et aux lecteurs de la Nouvelle
Revue germanique cet état singulier. Pour rédiger l’esquisse biographique du poète, il lui aura suffi de
s’adresser à un ami médecin ou universitaire Souabe, rencontré lors de la réunion des sociétés savantes
à Heidelberg ou dans un comité philhellène allemand. L’hypothèse la plus probable demeure jusqu’ici
le docteur Wilhelm Leube (1799-1880) qui avant de s’établir à Tübingen avait en 1824 fait un séjour
à Paris, puis s’était intéressé à Holderlin. Sur Leube, voir Adolf Beck : (( Hypérion in Frankreich. Die
frühe Rezeption Holderlins. Dokumente und Erlauterungen )> in Friedrich Holderlin, Sümtliche WerRe,
vol. VII, 3, 1974, p. 190; v. aussi p. 109.
8. Traduits partiellement par Denise Naville dans les notes au volume de N La Pléiade », p. 1126 à
1143. Comme pour F.W.J. Schelling, l’importance de ces textes n’a pas encore été pleinement aperçue.
Pourtant quelle richesse est déjà contenue, comme en réserve, dans ces premières mises en forme de soi
et de la pensée!
9. Comp. avec la traduction par Philippe Jaccottet des quatre premières lettres, U La Pléiade », p. 229
à 235. Une lettre intermédiaire, courte, de Diotima à Hypérion a été laissée de côté : elle pose le
problème du rapport, dans le feu de l’action, entre l’exaltation des vertus guerrières et la capacité
d’amour.
(< Sachons
10.
après trois jours seulement d’ivrognerie surveillée sachons
pour tout viol pour tout vol pour toute exaction faire fusiller un
peloton de soldats de préférence choisis de Prusse orientale
[...I
mais the trouble realiy is que nous ne
pouvons pas réussir, réussirons jamais, devons pas réussir et que notre vocation
est comme des Russes d’occident
d’échouer et de souffrir
inutilement (Jean-Paul de Dadelsen, Jonas, Gallimard, 1962, p. 87).
11. Cf. les Alémoires d u général Macriyannis, traduits par Denis Kohler, A. Michel/CNL, 1987.
12. G . Lukacs : Goethe und seine Zeit. Trad. fr. de L. Goldmann et Frank. Nagel 1949, p. 187.
13. Philippe Lacoue-Labarthe : Mimésis et Unheimlichkeit », in Le Sujet de la philosophie, Flammarion, 1979, p. 283.
14. G . Lukacs, op. rit., p. 190.
15. Un symptôme parmi d’autres : en 1837, les invectives de Gustav Pfizer, (( médiocre poète et
propagandiste de l’âme allemande )) (CI. Pichois), contre l’article de Chasles, reprenant des fragments de
cette lettre de Hypérion à Bellarmin.
16. F.W.J. Schelling, U Du Moi comme principe de la philosophie ou sur l’inconditionné dans le
savoir humain n, Premiers Emits (1794-1795). Trad. fr. de J.-F. Courtine, PUF, 1987, p. 82.
17. P. Szondi : Le dépassement du classicisme. Sur la lettre à Bohlendorff du 4 décembre 1801 »,
Poésie et Poétique de l’idéalisme allemand. Trad. dirigée par J. Bollack, Minuit, 1975, p. 238.
18. Jean-Luc Nancy, La joie d’Hypérion », Études philosophiques, 1983, no 2, p. 191; et dans ce
Cahier, p. 181.
))
((
((
182
19. Corona Schmiele, U Toi seul tu passes, pareil à la lune », L a Nouvelle Revue de Paris, no 9, mars
1987, p. 141.
20. Claude Pichois, au sujet de la Revue germanique, dans L’lmage de Jean-Paul Richter dans les
lettresfrançaises, Corti, 1763, p. 136. Cf. également les conclusions d’André Monchoux dans L’Allemagne
devant les lettres françaises de 1814 à 1835, A. Colin, s.d., p. 218-229.
21. C. Pichois, Pbilarète Chasles, op. rit., t. I, p. 336.
22. Ce maître de la critique va dans son anticonformisme jusqu’à qualifier irrévérencieusement Goethe
d’« Apollon-Chambellan N !
23. C. Pichois, op. rit., t. I, p. 458; t. II, p. 324.
24. Le même texte se!a recueilli, après remaniement, et intégré sous le titre Holderlin. Le fou de
la révolution », dans les Etudes sur l‘Allemagne a u XIX‘ siècle, 1861 (p. 353-362). Republication partielle
par A. Beck dans (( Hyperion in Frankreich », SW, VII, 3, p. 191-195. - P. Chasles a obtenu et la
mouture même de son article et ces informations complémentaires de Xavier Marmier qui, lors de son
périple allemand, avait rendu -visite à Schwab. A partir de 1835 et pour deux années, Marmier assura
depuis Paris la direction de publication de la Nouvelle Revue germanique, pouvant ainsi disposer librement
des textes parus dans les séries précédentes.
25. U C’est qu’il [Chasles] tient à la vertu d’une explication qui vaut pour lui-même, autre victime
de la civilisation parisienne », commente C. Pichois, op. rit., c. I, p. 354.
26. Les (( traductions N de Chasles sont en réalité des réécritures de quelques extraits choisis dans les
cinq lettres de Hypérion traduites par le correspondant de la N R G . Le curieux amalgame entre Alabanda
et Adamas (p. 205) et l’oubli de Diotima révèlent que Chasles n’a fait que (( respirer cette fleur N que
Holderlin aurait voulu promettre (( à la faveur des Allemands N (Avant-propos à Hypérion).
27. Jean-Luc Nancy: art. cit., p. 181 de ce Cahier.
Y a-t-il une beauté
pour la philosophie ?
(Une lecture de Hypérion)
Marc Crépon
I
Que la lecture des philosophes ait été déterminante dans les études de Holderlin,
et dans les années qu’il consacra à la rédaction des différentes ébauches du roman
Hypét-ion, les différents essais, qui dans le même temps restèrent à l’état de fragments,
tout comme l’ensemble des lettres adressées à ses amis où il leur fait part de sa
confrontation difficile et douloureuse à la pensée de Kant et de Fichte en témoignent
suffisamment. Mais c’est pourquoi au cœur même d u roman, dans la lettre que
Hypkion adresse à Bellarmin, et qu’on conviendra d’appeler (( la lettre sur les
Athéniens », que Holderlin engage, de façon décisive, un débat critique avec la
philosophie moderne. Plus précisément, il semble que la critique, dont les lettres et
les esquisses portent la trace, trouve son accomplissement dans le roman. Cela nous
impose au moins la règle de lecture suivante. Nous ne pouvons passer sous silence
le fait que la critique, après avoir longtemps cherché sa formulation dans la langue
de l’essai, trouve à se dire dans celle d u roman. Pour le dire autrement, nous ne
pouvons distraire du roman, sinon peut-être en guise de prémisse à l’analyse, une
philosophie de Hypérion, sous peine de ne pas comprendre ce qui, dans le roman,
déporte la critique au-delà de la philosophie, et l’atteint de l’extérieur, dans une
langue qui n’est pas la sienne. Elle n’est pas plus son contenu, que le thème d’un
dialogue entre Hypérion et ses amis.
Dans le texte qui sert de préface à l’avant-dernière version d u roman, Holderlin
décrit la (( situation N qui serait celle de l’homme moderne. Elle doit aider à comprendre
et à accepter (( les contradictipns, les égarements, la force et la faiblesse, la colère et
l’amour de Hypérion N. (( L’Etre, nous dit-il, existe, comme beauté », mais (( il est
184
perdu pour nous »,et (( nous parcourons tous une orbite excentrique pour le retrouver ».
Dès la première lecture, nous sommes sensibles au fait qu’il ne s’agit pas seulement
de Hypérion mais d’un N nous U énigmatique. Que désigne ce nous? Faut-il en excepter
les philosophes modernes, ses contemporains? N’est-ce pas précisément parce qu’ils
sont inclus dans ce nous que leur œuvre, c’est-à-dire leur philosophie trouve dans le
roman le lieu de sa critique? Et, si tel est le cas, est-ce au titre d’une orbite excentrique
parmi d’autres?
Si nous pouvons montrer, avec Holderlin, que e! propre de la philosophie
moderne est effectivement de manquer l’existence de l’Etre, comme beauté, et si ce
manque est indissolublement lié à la forme à laquelle elle prétend, celle d’une science
systématique, et à la langue qu’elle requiert, nous serons peut-être en droit de penser
qu’il ne se laisse pas dire dans la langue de la philosophie moderne, pour Holderlin,
celle de Kant et de Fichte. O u encore, si l’être, comme beauté, est la source de la
philosophie, si, pour cette raison, une généalogie idéale peut lui être assignée, que la
lettre centrale du roman donne à penser, et si le manque et les errances de la
philosophie moderne sont liés à l’éloignement de cette source et à l’oubli de cette
origine, la source doit être retrouvée, la généalogie repensée, pour que le manque et
l’éloignement puissent être désignés : il est possible que la langue de Kant et de
Fichte se révèle inapte à dire ce dont elle s’est éloignée, ce qu’elle a perdu, ce avec
quoi elle a, de façon définitive, rompu. Elle ne porte pas la mémoire de cet être plus
originel du langage, qui se recueille dans le hoyoç grec. Nous nous proposons de
montrer comment le roman Hypérion fait, à sa façon, l’épreuve de l’abîme qui sépare
la langue de la philosophie moderne du hoyoç grec.
II
Dans les différentes ébauches du roman, la philosophie est toujours présentée à
travers les concepts qui relèvent de la langue de Kant et de Fichte, et dont le lecteur,
même s’il en remarque le traitement rigoureux et précis, note un emploi qui n’est
pas encore ouvettement problématique. Aussi dans la Metrische Fassung et la Jeunesse
de Hypérion, l’occurrence des concepts de finitude, entendement, nature, raison atteste
que c’est encore en partie dans leur langue (le simple fait qu’il s’agisse d’une
U metrische N Fassung incite néanmoins à la prudence) que Holderlin ouvre le débat
avec la philosophie de Kant et de Fichte. Les concepts s’intègrent dans le corps du
texte, sans que soit mise en question leur aptitude à rendre ce qui est proprement à
dire. I1 en va tout autrement avec la version définitive qui, pour cette raison semble
la plus épurée, sinon de toute a philosophie », du moins de cette langue qui travaille
de part en part les versions précédentes.
En rade de l’antique cité d’Athènes, en compagnie de Diotima et de quelques
amis, sous un soleil radieux, Hypérion sur un ton qui excède celui de la simple
(( conversation )) se livre pour eux et avec eux, à d’amples réflexions sur l’excellence
du peuple athénien, et ce qui le prédestinait à la philosophie. Comprendre cette
prédestination lui permet de faire la généalogie de la philosophie, d’en penser l’origine
et par là même la destination. Aussi est-ce, avant toute chose, à cette aune que se
trouve mesurée celle qui est désignée comme (( la froide philosophie du nord )) où se
reconnaissent sans peine les figures de Kant et de Fichte. Celle-ci n’est plus, comme
c’est le cas dans les lettres et les essais qui accompagnent, dans ses marges, la rédaction
du roman, critiquée de l’intérieur, au titre de ses contradictions internes, de ses apories,
mais par rapport à un autre, dont elle n’a pas suffisamment gardé mémoire, qui lui
est pour ainsi dire devenu étranger et qui en révèle les errances et les manques : sa
source grecque. Non pas seulement elle, mais en elle, ce qu’elle nous donne à penser
185
du rapport de la philosophie à l’art et à la religion, ce que nous nommons sa
généalogie idéale ». Par le fait que cette position d’extériorité, qui n’a rien d’arbitraire
lui donne la possibilité d’interroger la prétention de la philosophie moderne à une
totale autonomie, la critique se trouve d’ores et déjà radicalisée, et la recherche
fichtéenne et schellingienne d’un fondement absolu, garant d’une systématicité sans
faille est mise en question. Mais comment cela se laisse-t-il dire? Peut-être un travail
dans la langue se trouve-t-il par là exigé, qui puisse, sinon retrouver quelque chose
du hoyog héraclitéen, d u moins en porter, aussi peu que cela soit possible, la trace.
Il se fait de façons multiples, à des niveaux différents.
Qu’en est-il des Grecs et de leur prédestination pour la philosophie? Sur
l’excellence des anciens Athéniens, les amis de Hypérion font plusieurs hypothèses :
l’art, la religion, la politique, le climat en seraient la cause, autant de facteurs qu’une
réflexion philosophique partielle est susceptible de mettre au jour comme la caractéristique essentielle d’un peuple, son principe, autant de facteurs qui se disent dans
sa langue. Pour Hypérion, ce sont des vues abstraites qui se réfutent aisément.
Politique, art, religion sont rendus possibles dans leur perfection par le sens de la
mesure, en tant que celui-ci, par opposition à la contrainte et à l’excès, préserve avec
le plus de naturel un accord, une harmonie native et originelle de l’être humain avec
ce qui l’entoure.
((
L‘art et la discipline apparaissent trop tôt dans tous les cas où la nature de l’homme
n’est pas encore parvenue à maturité ’.
La nature, en l’enfant, doit s’être accomplie avant qu’il n’entre à l’école, afin que
l’image de l’enfance puisse ensuite lui apprendre comment on revient de l’école à
la nature accomplie *,
Mais qu’est-ce que la nature dont il est ici question? Elle ne peut être entendue ni
au sens de la Critique de la raison pure, ni dans celui des Fondements de la doctrine
de la science dont, par ailleurs, la lecture est alors un des soucis constants de Holderlin.
Kant et Fichte ne sont pas ici évoqués arbitrairement, dans la mesure où par exemple,
le recours au (( concept de nature )) dans la Metriscbe Fassung se fait beaucoup plus
l’écho de sa détermination dans les textes précédemment nommés.
Par le destin et les sages durci j’étais
De moi-mtme, en mon âme juvénile
Devenu, pour la nature, un tyran 3 .
Dans la version définitive, c’est essentiellement le registre du déploiement, de la
maturation, de l’éclosion qui sert à penser la nature, celui de l’épanouissement. I1
incite dès lors à se tourner davantage vers la pensée grecque de la pbysis que vers la
détermination idéaliste de la nature, il opère un retrait par rapport à la seconde, il
cherche peut-être à se faire l’écho de (( ce qu’est la pbysis », s’il est vrai que, comme
l’écrit Heidegger, dans Ce qu’est e t comment se détermine la pbysis, (( l’épanouissement
qui se déploie est quant à soi, un retourner en soi, cette manière de déployer l’être,
voilà la pbysis )). Et ce sens, c’est déjà le signe d’un retrait, d’une distance prise par
rapport à la langue de la philosophie critique et de l’idéalisme allemand, que
l’impossibilité où nous nous trouvons, pour entendre ce que dit Holderlin de 1’Athénien, de comprendre la nature comme divers synthétisé par l’entendement ou êtreposé par l’imagination. Déjà se trouve dit quelque chose qui ne pouvait l’être dans
cette langue, et révèle aussi les limites de la nôtre. Mais ce que disent l’épanouissement,
la maturation, l’éclosion, Holderlin le recueille dans une expression, celle de (( beau
vivant D. Quand l’ordre harmonieux de la pbysis irradie les Athéniens qui lui sont
proches et fidèles, elle se révèle comme beauté à ceux-là seuls qui ne se sont pas
encore détournés d’elle, et d’un même mouvement leur dévoile leur propre beauté.
186
Être une nature accomplie et être en harmonie avec la nature, être un (( beau vivant N
et avoir le sens de la beauté, ne font qu’un, disent une seule et même chose, et par
là même requièrent qu’on entende nature et beauté en un sens que la philosophie
moderne n’autorise pas. Ce en quoi réside la prédestination du peuple athénien pour
la philosophie ne saurait trouver à se dire dans une langue qui ne garde rien du sens
grec de la pbysis.
Comment comprendre dès lors la généalogie idéale que Holderlin assigne à la
philosophie? Tout procède de ce que, ((pour prendre conscience de soi (sich selber
füblen), l’Athénien s’oppose sa propre beauté ». L’Athénien se comprend lui-même à
travers sa beauté qu’il pose comme un autre dans la figure de ses dieux et dans
laquelle il se reconnaît. C’est dans l’accomplissement de la conscience qu’il prend de
sa propre beauté que culmine la philosophie. En tant qu’elle est cet avènement, elle
se comprend par sa généalogie idéale. L’essence de la philosophie n’a pas son principe
dans l’activité qui la fonde, mais dans la source dont elle procède, et la détermination
de son lieu d’apparition au terme drune généalogie idéale qui la rattache à l’art et à
la religion. Si l’excellence de l’Athénien le vouait à la philosophie, c’est qu’elle le
mettait à même de prendre conscience de lui-même comme d’une nature belle et,
par là, le situant àAl’opposédes errances de l’homme moderne, de la nature comme
beauté et comme Etre absolu. Mais quelle est cette généalogie idéale qui conduit à
la philosophie? I1 faut, dit Holderlin, avoir en vue les enfants de la beauté. Comme
Être absolu, pbyJis, elle est au commencement de tout, elle est la vérité de l’homme
grec. L’enjeu est celui de sa révélation qui se produit en trois temps, dont la philosophie
constitue le dernier et le plus accompli. Le premier est l’art.
L’art est le premier enfant de la beauté humaine, de la beauté divine. En lui,
l’homme divin rajeunit et recommence. Pour prendre conscience de soi (Jich selber
fühlen), il s’oppose sa propre beauté, ainsi se donna-t-il ses dieux 4.
C’est leur propre beauté que les Athéniens expriment dans celle de leurs dieux. Sans
la beauté des Athéniens, leur art n’aurait jamais pu être, et sans leur art, ils n’auraient
pu connaître leur beauté.
Le second est la religion, (( conscience n et amour de la beauté.
Le second enfant de la beauté est la religion. La religion est l’amour de la beauté.
Le sage aime la beauté elle-même, la beauté infinie en quoi tout est contenu >.
Sur ce point, la comparaison avec les dieux égyptiens est décisive. A l’amour des
Athéniens pour leurs dieux, que rend possible leur conlience de soi comme beauté,
s’opposent l’adoration et l’idolâtrie qui soumettent les Egyptiens aux leurs comme à
une puissance écrasante, hostile et énigmatique, dans laquelle il leur est impossible
de se reconnaître. Lorsque Holderlin écrit,
Les Athéniens s’égarent moins que d’autres dans les excès du naturel et du
surnaturel. Leurs dieux savent mieux que d’autres se maintenir dans l’admirable
milieu de l’humain 6,
il met au jour la mesure (par opposition à l’hybris) comme vérité de l’art et de la
religion grecque et condition de leur liberté. La distinction entre le peuple égyptien
et le peuple athénien, pensée à travers leur art et leur religion, se perpétue et se
confirme en effet dans la distinction entre peuple libre et peuple d’esclaves. La liberté
procède du sens de la beauté.
De la beauté spirituelle des Athéniens suivit nécessairement leur sens de la liberté ’.
187
Ici encore, quand on sait l’attention que Holderlin porta à la philosophie critique,
l’effort que lui demanda la lecture des livres de Kant et de Fichte, dont les lettres
portent les traces, et dont l’écho se répercute jusque dans les textes sur les tragédies
de Sophocle, on ne peut manquer de noter combien une telle approche de la liberté
témoigne d’un effort pour s’en déprendre. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’en retient
rien. Tout au contraire. Mais ce sens de la liberté ne se laisse penser ni à l’aune de
la Critique de la raison pratique, ni à celle de la Religion dans les limites de la simple
raison. Son rapport à l’art et à la religion qui, en un certain sens, le prépare, et
surtout la mémoire de la beauté dans le sens de la liberté exigent une autre langue
ou, pour mieux dire, sont rétifs à la conceptualité des philosophies critiques et
idéalistes. Aussi, avant même d’en venir à ce qui ne peut être saisi qu’ultérieurement
et sera beaucoup plus décisif, avant même d’analyser les critiques explicites que
Holderlin porte à (( la froide philosophie d u nord »,on ne peut lire (( la lettre sur les
Athéniens )) sans être sensible au travail considérable dont elle porte la marque pour
se défaire de cette langue dont l’ensemble des textes qui accompagnent Hypérion nous
feraient presque dire qu’elle était devenue pour lui une U langue naturelle )). Or toute
langue est toujours commune, s’il est vrai qu’elle est l’œuvre d’une communauté qui
se retrouve en elle, l’œuvre de ceux qui la parlent et l’écrivent, qui s’y entendent.
Ainsi la langue de Kant n’est-elle pas seulement son œuvre mais aussi celle de ceux
qui la reprennent, la commentent, s’entendent entre eux quand ils parlent de la nature
ou de la liberté, c’est-à-dire les entendent au sens de Kant. Cette langue peut être
familière ou étrangère, l’avoir été mais aussi le devenir, ce qui ne veut pas dire qu’elle
n’est plus comprise. Tout au contraire, plus elle est comprise et plus paradoxalement,
le risque est couru de ne plus s’y retrouver. Dès lors, ce n’est pas seulement la langue
de Kant et de Fichte qui devient étrangère, au sens où elle ne laisse pas dire ce qui
doit l’être, mais aussi la communauté qui vit en elle, l’ensemble de ceux qui, comme
on dit, parlent kantien ou fichtéen et pas autrement, et n’entendent rien d’autre.
I1 nous faut reprendre le fil de l’explication. Si l’opposition de la piété grecque
et de la soumission égyptienne, de la nature comme Etre et beauté chez les uns et
de la nature comme force étrangère et redoutable chez les autres est essentielle, c’est
qu’elle détermine la prédestination des uns pour la philosophie et l’impossibilité pour
les autres de devenir un peuple philosophe. Aux stades de l’art et de la religion
s’accuse le clivage qui consacre l’excellence des Athéniens. Ils révèlent à la philosophie
et préservent pour elle la liberté et surtout la beauté, dont il lui reviendra de dire
l’essence. La philosophie est l’avènement de la conscience de soi de la beauté. Elle
n’est pas une activité autonome, mais le privilège de celui que sa fidélité à la pbysis,
c’est-à-dire son accord avec elle, met en mesure d’en découvrir l’essence, et de la dire
dans une parole.
Seul un Grec pouvait inventer la grande parole de Héraclite Ëv Gicr<ptpovÉWT@ l’Un distinct en soi-même -, car elle dit l’essence de la beauté, et avant qu’elle
fut inventée, il n’y avait pas de philosophie ’.
En ce point de l’analyse, la généalogie idéale de la philosophie doit être précisée par
son rapport à la poésie. Elle est, dit Holderlin, le commencement et la fin de la
philosophie. Ici, plus qu’ailleurs, a! philosophie s’ancre dans un autre : la poésie, en
tant qu’elle a 1’« intuition )) de 1’Etre comme beauté. L’intuition de (( l’harmonie de
la beauté sans défaut »,dont Holderlin fait dans Hypévion le propre du poète, préexiste
à la possibilité d’en dire l’essence. O u encore, la philosophie procède d’une expérience
vitale, à laquelle elle n’est pas réductible, mais sans laquelle elle manque sa destination
essentielle.
Qui n’a jamais éprouvé que seules les heures d’enthousiasme révèlent le profond
concert de toutes choses créées, cet homme ne donnera même pas un douteur 9 .
188
Parvenu à ce point culminant, les critiques que Holderlin adresse à la philosophie
moderne, et ce qui, en elles, excède la critique, se laissent formuler plus explicitement.
Mais, comme c’est en réfléchissant sur la figure de l’Athénien qu’on a pu situer sa
philosophie, nous devons comprendre ce qui caractérise l’homme d u nord et le peuple
allemand, comme peuple témoin d’une modernité déchirée, pour saisir les (( faiblesses ))
de sa philosophie. Le propre de l’homme moderne, est, nous dit Holderlin de s’être
arraché <( au paisible Év K a i A ~ du
V monde )) et par conséquent de tendre à le rétablir
par soi-même.
Nous avons rompu avec la Nature, et ce qui était naguère, à ce que l’on peut
croire, un, maintenant s’est fait contradiction, souveraineté et servitude alternent
de part et d’autre ’ O .
Aussi sa philosophie ne sera-t-elle pas l’accomplissement, la révélation et le sacre
conjoints de la beauté humaine, mais le symptôme, au sens le plus fort du terme,
de cette rupture, de cet arrachement. Elle trouve en lui sa cause, mais en tâchant de
trouver d’elle-même son propre fondement, détachée de l’art et de la religion, inapte
à saisir le sens de la beauté, peu soucieuse de son accord avec la nature, elle cherche
à masquer, conformément à la structure du symptôme, cette cause : son manque
d’unité et de plénitude, le manque de ce que, précisément, son accord avec la physis
procure à la philosophie grecque. Pour approcher de plus près la figure de l’homme
du nord, par opposition à celle de l’Athénien, on peut se reporter à l’avant-dernière
lettre de Hypérion. Elle présente une analyse du peuple allemand qui met l’accent
sur le fait que sa culture, loin de rendre impossible toute forme de barbarie, en
renouvelle le risque. Lui fait défaut, en premier lieu, le sens du divin. Les Allemands
sont voués à des activités, des pensées dispersées, que rien ne relie entre elles parce
qu’elles ne sont plus irradiées par la présence éclairante des dieux et de la nature, et
ramenées à l’unité qui les rassemble, en une œuvre et une parole, dont le nom est
beauté. Sur eux, pèse la malédiction d’une perte. La pbysis a perdu son caractère de
beauté pour devenir la matière d’une activité fébrile :
On ne peut concevoir de peuple plus déchiré que les Allemands [...I Je te le dis :
il n’est rien de sacré que ce peuple n’ait profané, rabaissé au niveau d’un misérable
expédient ’ ’ .
Le signe de cette perte de l’unité spirituelle, de l’Être, Holderlin, par la voix de
Hypérion, le voit dans le sort que le peuple allemand réserve à ses poètes. Ils font
figure d’étrangers, voués à une errance sans fin, au milieu d’un peuple qui ne les
écoute pas, et surtout méconnaît le caractère sacré de leur vocation. Leur situation est
symptomatique de ce que toute pensée,*toute action ne se font plus dans la proximité
de la physis, qu’elles sont coupées de 1’Etre absolu, étrangères à l’amour de la beauté,
qui est pourtant la condition de possibilité de leur légitimation. Euvre d’art, cérémonie
culturelle ne s’accordent plus entre elles, ne s’expriment plus mutuellement, n’ont
rien de commun.
Sans cet amour de la beauté, sans cette religion, 1’Etat n’est qu’un squelette privé
d’âme et de vie, la pensée et l’action un arbre écimé, une colonne tronquée 1 2 .
Que la poésie ait ce sort est déjà le signe que la philosophie moderne n’aura rien à
voir avec la philosophie des Athéniens dont Holderlin dit justement la dépendance
à l’égard de la poésie. Qu’il n’y ait plus concordance entre l’une et l’autre témoigne
de ce que la première s’est trompée de destination, (( fait fausse route », coupée de
l’absolu, recherchant en elle-même l’unité que la poésie dans son enthousiasme sacré
lui procurait, quand la seconde reste la gardienne fidèle de la beauté divine dont elle
éprouve le retrait. L’éducation de l’homme moderne (« le nord retourne trop tôt ses
189
écoliers sur eux-mêmes D) le voue à une culture presque exclusive de l’entendement
et de la raison. Elle détermine sa philosophie dont pour Holderlin le trait caractéristique
sera alors d’être une philosophie théorique et pratique, dépourvue de sens esthétique.
Si l’on compare ce qui se dit dans cette lettre d u roman avec les lettres que Holderlin,
dans les premières années de son préceptorat adresse à son frère et à ses amis, on
mesure l’écart entre le sacre de la raison dont elles portaient l’écho et la distance qui
se trouve ici prise par rapport à elle.
Sans la beauté de l’esprit et du cœur, la raison est comme un contremaître, que
le propriétaire de la maison a imposé aux domestiques; il ne sait pas mieux qu’eux
ce qui doit résulter de leur interminable travail, et se contente de crier qu’on se
dépêche 13.
Tandis que dans les lettres de 1794 et 1795 rien ne pouvait mieux qu’elle caractériser
l’humanité, la raison se voit, dans la version définitive, détrônée au profit du sens de
la beauté, ou, plus précisément de l’idéal de la beauté. O n peut en effet rapprocher
ce qui est dit de l’entendement et de la raison dans la U lettre sur les Athéniens )) et
la philosophie moderne de la lettre que Holderlin adresse à son frère de Francfort,
en date du 2 juin 1796. Dans le texte de Hypérion, la critique s’effectue en deux
temps. Elle porte d’abord sur l’entendement puis sur la raison. La philosophie ne
peut se concevoir exclusivement comme une activité de l’entendement, parce que,
comme Holderlin l’écrit, elle (( ne se réduit pas à la reconnaissance bornée de ce qui
est ». Rien jusqu’ici pourtant, qui ne soit conforme à la doctrine kantienne. Que le
travail de l’entendement ne soit pas la vérité de la philosophie, nul, alors, ne l’a
mieux montré que Kant, dans la Critique de la raison pure. I1 suffit de songer au
sort fait dans (( la dialectique transcendantale )) à ce qu’il pense comme un (( besoin
de la raison », et à l’hommage qu’il rend à Platon.
Platon remarquait fort bien que notre faculté de connaissance éprouve un besoin
beaucoup plus élevé que celui d’épeler simplement des phénomènes, suivant les
lois de l’unité synthétique, pour pouvoir les lire comme expérience, et que notre
raison s’élève naturellement à des connaissances trop hautes, pour qu’un objet que
l’expérience est capable de donner puisse jamais y correspondre, mais qui n’en ont
pas moins leur réalité et ne sont nullement de simples chimères 14.
O n ne peut donc reprocher à la philosophie critique de prôner ’simplement la
reconnaissance bornée de ce qui est. Mais la critique de Holderlin se répercute sur le
statut même de la raison. Il la juge inapte à produire une (( philosophie )) telle que
la Grèce en donne le modèle, dès lors que ne lui apparaît pas l’idéal de la beauté.
Ainsi la raison n’est-elle pas autonome. Déjà dans la lettre précédemment signalée,
il exposait à son frère que les principes de la raison devraient être ramenés à l’idéal
de la beauté, (( le fondement de tout ». Or en assignant une telle place à la raison,
c’est en même temps le projet idéaliste fichtéen de donner à la philosophie la forme
d’un système absolu que Holderlin récuse, s’il est vrai que celui-ci doit trouver son
fondement absolu, son premier principe, dans la raison.
Ceci nous indique déjà combien le roman Hypérton porte la trace du travail
critique théorique effectué par Holderlin dans sa correspondance et dans ses essais,
sans que nous puissions ici nous livrer à une analyse détaillée de leur contenu. Mais
dans le roman, la critique se fait encore plus sobrement. Elle ne prend pas la forme
d’une longue argumentation théorique, mais d’aphorismes que Hypérion profère de
vive voix, et qui exigent d’être gardés en mémoire. C’est cette forme aphoristique
qui déporte la critique au-delà d’elle-même. Comment? Cela ne se laisse penser qu’à
approcher, autant que faire se peut, ce que Holderlin entend par beauté.
190
III
C’est donc dans la parole de Héraclite : (( l’Un distinct en soi-même », que se
recueille pour Holderlin le sens de l’être comme beauté, que seuls les Grecs étaient
à même d’entendre. Cet écho des fragments héraclitéens dans le texte de Hypérion
pose un premier problème d’ordre philologique. Quel accès Holderlin a-t-il p u avoir
aux fragments des présocratiques, et plus particulièrement à la pensée de Héraclite?
I1 revient à Uvo Holscher d’avoir répondu à cette question en montrant dans son
livre, Empedokles and Holderlin, que Holderlin, Hegel et Schelling purent disposer
au Stift de Tübingen d’une édition des présocratiques I s . Cela autorise au moins
l’hypothèse que l’auteur de Hypérion ne lut pas la parole : (( l’Un distinct en soimême )) seulement dans le Banqaet de Platon, où il est cité non sans raillerie par le
médecin Eryximaque mais aussi à même une édition, aussi imparfaite soit-elle, des
textes de Héraclite. D u même coup, cela nous impose de prendre au sérieux cette
lecture de Holderlin, et conformément aux exigences d’une écriture fragmentaire, de
chercher à entendre ce que 1’« Un distinct en soi-même )) pouvait signifier pour
Holderlin, à la lumière d’autres fragments dont il a pu avoir connaissance. I1 va sans
dire que nous ne pouvons ici que proposer une approche, que devrait compléter une
étude philologique plus étendue comparant nos éditions actuelles de Héraclite avec
celle qui était à la disposition des élèves d u Stift dans les années 1790. Avec tous
les risques d’écart que cela comporte, nous nous proposons d’entendre le sens de
1’« Un distinct en soi-même », en confrontant trois fragments dont nous donnons deux
numérotations, respectivement celle de l’édition Diel Kranz et celle de Marcel Conche,
et la traduction de ce dernier.
Fragment 5 1, 12.5 : (< Ils ne comprennent pas comment ce qui s’oppose à soi-même
s’accorde avec soi : ajustement par actions de sens contraire, comme de l’arc et
de la lyre. H
Fragment 48, 124 : (( Pour l’arc, le nom est vie; mais l’œuvre est mort. n
Fragment 54, 126 :
apparent 16.
<(
L’ajustement non apparent est plus fort que l’ajustement
P
Dans l’approche qu’il propose de l’hymne de Holderlin intitulé (( Germanie »,Heidegger, interrogeant le dire poétique de Holderlin dans l’horizon de la pensée
héraclitéenne s’attache à préciser le sens d u fragment 54 dans un passage que nous
requérons pour donner à notre analyse ses assises et dont nous proposons ici une
traduction.
L’harmonie (der Einkiang) qui n’est pas visible au regard habituel, c’est-à-dire qui
reste pour lui une opposition (Gegensatz) la réduisant en miettes (auseinsanderfaiiend), cette harmonie cachée est plus puissante que l’harmonie visible, plus
puissante, car elle est la puissance propre de l’être comme tel [...I Mais on doit
prendre encore ceci en compte : cette &ppovia - harmonie - n’est pas une harmonie
indifférente, c’est-à-dire qu’elle n’est pas un accord (Einstimmigkeit) sans tension,
ni un arrangement (Übereinkanft) qui se fasse par ajournement conciliant des
oppositions, tout au contraire, l’ouverture du conflit véritable inaugure l’harmonie.
Et cela veut dire : elle maintient les puissances opposées dans leurs limites. Cette
dé-limitation n’est pas limitation (Einu-hrdnkung) mais une retenue dans la limite
(Entschrünkung)[...I
”.
191
Comment faut-il penser (( l’Un distinct en soi-même »? L’arc et la lyre font entendre
la nécessité d’une tension. La corde de l’arc pour vibrer doit être tendue, celles de la
lyre aussi, pour qu’un son soit possible. La tension apparaît comme une condition
de l’harmonie. Si 1’« Un distinct en soi-même N dit l’harmonie du Tout, celle-ci n’est
pas une conciliation des oppositions (le terme de conciliation impliquant l’action
extérieure de ce qui concilie, et la suppression de toute tension) ni leur irrémédiable
dispersion, la perte des opposés dans le multiple (il serait alors impossible de parler
d harmonie ni même d’accord) mais la tension des contraires qui préserve et maintient
l’unité du Tout. O u encore, si N l’Un distinct en soi-même N dit l’essence de la beauté,
ce n’est pas seulement en vertu de son unité, mais avant toute chose grâce à cette
différenciation interne qu’il porte en lui-même, et qui se laisse penser comme tension.
I1 ne s’agit pas d’une opposition, telle qu’Aristote l’a codifiée, mais d’une relation
d’un autre ordre, d’une relation vivante («l’arc, un nom : vie N), d’une relation même
qui fait la vie d u Tout. Celle-ci est à comprendre comme combat (« une œuvre,
mort D). Le fragment 53 dit dans ce sens :
Fragment 53, 129 : U La guerre est le père de toutes choses, de toutes le roi; et
les uns, elle les porte à la lumière comme dieux, les autres comme hommes;
les uns, elle les fait esclaves, les autres libres. n
Dès lors que dans U l’Un distinct en soi-même )) s’entend le combat qui différencie
l’Un-Tout, il permet de penser l’être-ouvert entre les dieux et les hommes, le divin
et l’humain. Leur être ensemble n’est pas un simple rapport d’opposition (qu’il y
aurait alors à surmonter) mais d’accord dans la discorde et la différence. Le rapport
du divin à l’humain et de l’humain au divin ne consiste pas dans la recherche d’une
identification, dans l’effort fait pour surmonter une opposition et abolir une distance.
L’un et l’autre, au contraire, ne se comprennent que dans leur relation vivante, leur
rapport au Tout, auquel ni l’un ni l’autre ne s’identifient. De l’un à l’autre, il n’est
pas de médiation ni de passage; chaque terme appelle l’autre comme son contraire,
dans lequel il ne passe pas. Entre les deux est maintenue cette tension, sans laquelle
il n’est pas de différence. La place centrale qu’occupe dans le roman la parole
d’Héraclite (( l’Un distinct en soi-même N nous fait entendre comment la pensée de
la différence peut rejoindre chez Holderlin une pensée de la présence finie. Dire que
le divin et l’humain sont par la tension qui les maintient dans leur différence, c’est
dire que toute tentative de dépasser la limite qu’elle donne à penser est une cécité à
ce mouvement de différenciation qui révèle l’être comme beauté. Le passage de
Heidegger précédemment cité nous est, à ce titre, tout à fait précieux. (( L’harmonie,
dit-il, maintient les puissances opposées dans leurs limites. )) C’est le sens ultime de
a l’Un distinct en soi-même », si nous pensons que la retenue dans la limite a pour
autre nom la mesure, par opposition à l’hybris. Penser 1’«être ensemble des hommes
et des dieux )), où leur mutuelle dépendance s’accorde avec la tension qui leur assigne
leurs limites, c’est faire de la mesure, qui est fidélité dans la limite, la condition de
l’harmonie.
Fragment 43, 48 : U I1 faut éteindre la démesure plus encore que l’incendie. ))
L’Év Giu<pÉpov É ~ T @est ainsi la parole où se recueille avec le plus d’éclat le sens de
l’Être, parce qu’elle révèle qu’il n’est pas de Tout pensable comme harmonie, sans
que la mesure soit la vérité de chacune de ses parties. Limage de l’incendie est
éloquente. S’il est ce qui réduit les différences, il met en péril la différenciation. Le
fragment 43, en exigeant d’être plus vigilant, de se ,garder davantage de la démesure
que de l’incendie en fait, dans cette optique, un péril plus grand encore, comme si
rien n’était plus préjudiciable à la vie du Tout.
192
Si tel est le sens de a l’Un distinct en soi-même )), nous saisissons mieux ce qui
lie la philosophie à l’art et à la religion, et pourquoi seul un Grec pouvait inventer
cette parole. Nous nous souvenons en effet de ce que Holderlin dit des dieux grecs,
dans un passage déjà cité : (( Leurs dieux savent mieux que d’autres se maintenir dans
l’admirable milieu de l’humain. )) La phrase, prononcée comme un aphorisme ferait
presque songer aux fragments d’Héraclite : si nous savons bien entendre le verbe
maintenir, elle en porte au moins l’écho. Ce que sont l’art, la religion ne peut
s’entendre vraiment qu’à garder en mémoire ce qui s’en recueille dans la parole
d’Héraclite. Nous ne le savions pas encore à la première lecture : ce n’est que
rétrospectivement, remplis de cette parole, que nous pouvons saisir comment non
seulement l’art et la religion, premiers enfants de la beauté, préparent la philosophie,
mais aussi l’appellent pour que retentisse en une parole ce qu’ils sont véritablement.
Les phrases que Hypérion prononce pour donner à penser l’art et la religion des Grecs
retiennent quelque chose, ou du moins s’y efforcent, du hoyoç héraclitéen. Ainsi
s’accentue le clivage avec la philosophie moderne.
Ainsi que Heidegger nous y invite dans l’essai intitulé (( Logos )) (Heidegger,
Essais e t Confe,nces), on doit penser, à l’aide du fragment 50, 1% Kcti n&v que (( l’Un
distinct en soi-même )) précise, comme l’être du hoyoç. L’Un-Tout, ce n’est pas
seulement ce qu’il dit, mais, d’une façon plus essentielle, la façon dont il déploie
son être.
Fragment 50, 1 : (( I1 est sage que ceux qui ont écouté non moi mais le discours
conviennent que tout est un.
))
Le fragment 50 nous donne à entendre que le h o y o ~n’est pas un instrument au service
d’un sujet, qu’il s’approprie pour rendre compte de ce qui est, mais qu’au contraire
son être excède celui qui parle. Ce n’est pas Héraclite qu’il s’agit d’écouter, mais le
h o y o ~ c’est-à-dire
,
une parole qui ne peut être entendue comme position, expression
d’un sujet, à plus forte raison d’un moi absolu. Aussi sommaire que soit ici notre
écoute de la parole héraclitéenne, elle nous fait du moins entendre, nous semble-t-il,
le point nodal de la rupture avec la philosophie moderne, qui se joue dans la (( lettre
sur les Athéniens ». Notre façon de philosopher est toujours solidaire d’une compréhension (le terme est déjà inadéquat) de l’être du langage : si la philosophie moderne
est inapte à dire ce qui est ici en question, c’est peut-être qu’elle comprend trop le
langage comme un instrument, qu’elle prétend à une (( maîtrise )) du langage, qui va
à l’encontre de ce que la parole héraclitéenne nous apprend de son être. C’est, pour
le dire autrement, la façon que nous avons de philosopher qui consacre notre rupture
avec la physis grecque, et introduit de la démesure dans la relation entre les hommes
et les dieux. C’est aussi la façon que nous avons de parler. De même que la philosophie
grecque et la figure de l’Athénien s’éclairent mutuellement, de même, comme nous
l’avons déjà entrevu, la froide philosophie du nord et le peuple allemand se comprennent
ensemble. Non seulement parce que la tâche considérable accomplie par la philosophie
est indéniable (« Kant est le Moïse de notre nation )), écrira Holderlin quelques années
plus tard), mais aussi parce qu’elles ont un manque en commun, qui tient, en dernier
ressort, à la violence faite au langage. I1 est dans le roman de Holderlin très souvent
question de mysologie. Dès les premières pages du roman, Hypérion laisse ainsi
paraître son accablement.
Et comment des mots auraient-ils apaisé la soif d e mon âine? Des mots, j’en
trouverai partout; partout des nuages, Héra nulle part. Je les hais comme la mort,
ces misérables compromis de quelque chose et de rien. Devant l’irréel, toute mon
âme se hérisse IH.
Et encore à la fin d u roman, dans une des lettres qu’il adresse à Diotima : (( Croismoi, je te le dis du fond de l’âme : le langage est chose superflue 19. )) Avant donc,
et après la (( lettre sur les Athéniens »,les errances de Hypérion se traduisent par un
ressentiment contre le langage. Dans l’orbite excentrique, que nous parcourons tous,
et qui fait alterner la proximité et l’éloignement, qui nous écarte d’autant plus de
1’«Etre perdu pour nous )) qu’elle semblait en rapprocher davantage, notre façon de
parler tient une place prépondérante. I1 n’y a sans doute pas grand-chose de commun
entre les a égarements )) de Hypérion, ses refus du dialogue et du langage, et les
errances de la philosophie moderne, sinon qu’ils sont chacun séparément caractéristiques d’un même temps de détresse. S’ils peuvent et doivent coexister dans le roman,
c’est peut-être alors au titre de leur a excentricité )) qui n’est rien d’autre que leur
inaptitude à prendre, dans le langage, une voie, un chemin, susceptibles de (( rétablir
l’Être perdu )) l’Ëv ~ ~nolv
l du
i monde, auquel (( nous nous sommes arrachés ». Mais
alors, que l’Un distinct en soi-même )) révèle l’être du h o y o ~donne
,
aussi à entendre,
plus précisément qye nous ne l’avons fait jusqu’ici comment la philosophie (( est sortie
de la poésie d’un Etre divin infini ». Elle a non seulement l’intuition de l’être absolu
comme beauté; mais encore elle est la plus fidèle à l’être du hbyoç. Parler de la
(( poésie d’un Etre divin infini », c’est mettre en évidence que le h6yoç dont elle est
la gardienne n’est pas le fait d’un sujet, qu’il ne se réduit pas à une (( expression ))
de l’homme. En cela réside la mesure, qui est son propre. Ou, encore la philosophie
tient sa destination de la poésie, en ce que l’accord avec le hoyoç, où œuvre cette
dernière, est la figure la plus parlante de la mesure.
IV
Mais la perte de l’Être, qui se trouve consacrée par l’oubli du hoyoq grec, et
donc de l’être du langage, est aussi la perte de la beauté. Le titre de notre travail le
laissait déjà entendre, et trouve ici son explication : Les critiques que Holderlin porte
à la philosophie moderne pourraient se condenser en une question : y a-tlil une beauté
pour la philosophie, telle que l’écrivent Kant et Fichte? Dès lors que 1’Etre est perdu
pour elle, n’est-ce pas aussi de la possibilité, et même peut-être de la double nécessité
d’une beauté de la philosophie et d’une philosophie de la beauté qu’il s’agit? Or
pour peu qu’il soit question de la beauté, il ne faut plus seulement songer à Héraclite
mais aussi à Platon. Si la figure héraclitéenne occupe une place centrale au cœur du
roman, l’affirmation explicite de l’existence de l’être comme beauté, dans la Préface
à l’avant-dernière version du roman )) (« I1 existe, comme beauté ») est liée à la
reconnaissance d’une dette envers Platon.
Je crois qu‘à la fin nous nous écrierons tous : saint Platon, pardonne-nous! Nous
avons gravement péché contre toi 20.
O n sait, par ailleurs, par sa correspondance, l’importance qu’eut pour Holderlin la
lecture du Phèdre et celle du Banquet. Le problème est de savoir comment la beauté
dont Holderlin recueille le sens dans les fragments d’Héraclite peut consonner avec
celle que les textes de Platon donnent à penser. Une première lecture d u Banquet
consiste à comprendre que les leçons de Diotima portent essentiellement sur la
dialectique ascendante. La beauté, dont la pureté est divine, ne se voit alors qu’au
terme d’une initiation, d’un effort qui revient, en son fond, à se détacher du sensible
pour pouvoir appréhender les idées en tant qu’idées. Ce n’est pas de la beauté des
choses d’ici-bas qu’il s’agit, mais d’une beauté accessible dans un au-delà. Après
qu’ont été franchis les différents degrés de l’initiation amoureuse, qu’on est passé de
194
la conternplation des corps beaux à la contemplation de la beauté en soi, la beauté
dont il s’agit n’est plus la proie du devenir, N l’homme s’est élevé de ce qui passe à
ce qui demeure, du mortel à l’immortel ».
Cette beauté, il ne se la représentera pas avec un visage par exemple, ou avec des
mains, ni avec quoi que ce soit d’autre qui appartienne à un corps, ni non plus
comme un discours ou comme une connaissance, pas davantage comme existant
en quelque sujet distinct, ainsi dans un vivant soit sur la terre, soit au ciel, ou
bien en n’importe quoi d’autre, mais il se la représentera plutôt en elle-même er
par elle-même, éternellement jointe à elle-même par l’unicité d e la forme *’.
L’Être comme beauté, dont Holderlin affirme l’existence, serait en ce sens l’idée de
beauté. souveraine, pure de tout apport de la sensibilité, accessible dans un détachement
de ses manifestations sensibles qui la rendent pourtant possible. Cette interprétation
est-elle recevable? Holderlin peut-il avoir entendu en ce sens les textes de Platon? I1
faut, pour répondre à cette question, s’attarder sur les versions intermédiaires de
Hypérion qui sont, à cet égard, très explicites. La Metrrscbe Fassung et la Jetlnesse de
Hypérion racontent la rencontre d’un jeune homme et d’un sage. Un dialogue s’ébauche.
Au jeune homme qui confesse avoir été (( pour la nature un tyran », et n’avoir eu
confiance que dans la raison, le sage s’attache à enseigner la positivité de la finitude.
C’est pour lui l’occasion d’une critique de cette école qui place la destination de
l’homme dans la raison et conçoit la nature comme le matériau de sa destination
morale, ce dont l’esprit, en tant qu’esprit libre, doit s’assurer la maîtrise en un combat
sans fin. Si (( nous devons garder pur et sacré l’idéal de tout ce qui apparaît », cette
sauvegarde est ce que ni le savoir illimité ni l’action illimitée, dans la tentative
toujours repoussée à l’infini d’arracher l’homme à la finitude tie rendent possible. I1
s’agit alors de penser une corrélation plus originaire entre ce qui en nous est esprit,
et ce qui lui résiste comme nature, qui introduise de l’un à l’autre un rapport où la
lutte ne se conçoive plus comme histoire progressive d’une maîtrise. Sans doute, la
leçon du sage est encore prononcée dans la langue de Fichte, et le rapport au philosophe
d’Iéna est dans ces textes extrêmement complexe et ambivalent, mais elle donne déjà
à entendre que la beauté est liée en nous à la finitude, et qu’elle nous fait une
exigence de reconnaître sa positivité. Plus précisément, c’est, dans ces textes, l’idée
que la nature peut être saisie comme beauté, dès lors que la finitude et la structure
de la conscience sont maintenues, qu’elle est donc elus une aide qu’un moyen, qui
parachève la critique du sacrifice de l’existence de 1’Etre comme beauté, au profit de
l’infinitisation du savoir et de l’action.
Si tu vois veriir à toi sous forme d e beauté ce que tu portes en toi de vérité,
accueille-le avec gratitude car tu as besoin de l’aide d e la nature **.
La Jeunesse de Hypérion et la Metrische Fassung doivent leur caractère d’ébauche
à la tension entre la détermination de la nature comme objet et sa compréhension
comme beauté. Tandis que la pensée holderlinienne de la beauté s’ancre déjà dans
une méditation des textes de Platon, ia finitude, caractérisée comme conscience d’objet,
est liée au débat de Holderlin avec la philosophie moderne. C’est cette conjonction
de deux langues, de deux philosophies, celle de Fichte et celle de Platon, qui rend
leur corrélation si difficile à problématiser. Elles jouent l’une contre l’autre, s’atteignent
mutuellement. Mais aussi, leur conflit, le fait qu’elles doivent s’opposer l’une à l’autre,
est précisément ce qui permet de saisir la nature du (( platonisme N de Holderlin.
Tout le texte le confirme, et telle est la leçon du sage : il faut reconnaître la
beauté dans les plus petites choses. Pour cela, il faut d’abord passer de la détermination
de ce qui vient à la rencontre dans la nature comme objet à sa reconnaissance comme
simple étant. Reconnaître la beauté dans les plus petites choses implique qu’on ne
195
se laisse plus aller à penser l’étant comme objet. La beauté est alors pensable comme
resplendissement de l’être dans l’étant.
Le beau renferme un sens caché. Interprète son sourire! Car c’est ainsi qu’apparaît
à nous l’esprit qui abolit la solitude du nôtre. Dans les plus petites choses se
manifeste ce qu’il y a de plus grand. La très haute effigie de tout accord vient à
notre rencontre dans les’mouvements paisibles du cœur, elle s’expose ici dans le
visage de cet enfant. N’entends-tu pas les mélodies du destin? Ses dissonances
signifient le même 2 3 ,
La beauté est donc la manifestation dans les plus petites choses d’une harmonie (« la
très haute effigie de tout accord »). Or c’est précisément la notion d’harmonie qui
permettait de penser 1’«Un-Tout »,tel que la parole d’Héraclite en recueillait le sens.
Par ailleurs, cette harmonie reste cachée à qui ne sait pas la voir, elle (( vient à notre
rencontre dans les mouvements paisibles du cœur »,(( le beau renferme un sens caché ».
Là encore nous entendons comme un écho de cette (( harmonie invisible plus essentielle
que l’harmonie visible ». Enfin l’expression de Holderlin : (( ses dissonances signifient
le même », semble bien consonner avec ces fragments où le combat est aussi un
concert, la discorde une harmonie qui se cache en elle. Le plus éloigné (l’Eue, l ’ v n Tout) se manifeste dans le plus proche. Mais surtout cette manifestation de 1’Etre
dans les plus petites choses, la beauté conçue comme présence de l’être dans l’étant
telles que Holderlin, dès la Jeunesse de Hypérion les met au jour, permet de concilier
l’ascendance héraclitéenne et l’hommage rendu à Platon, pour peu qu’on se risque à
une autre lecture du Banquet. C’est ce qu’a montré Jacques Taminiaux dans la
Nostalgie de la Grèce à l’aube de l’idéalisme allemand.
La beauté platonicienne surgit en ce lieu où l’être se révèle en sa lumineuse présence
au cœur même de l’étant qui pourtant le dérobe.
La beauté n’est plus ce qui se dévoile au terme de l’initiation, comme être suprasensible.
Ce n’est p l u ~ ~ l ’ ê t rstable,
e
fixe, donné dans l’idée et opposé au devenir, mais la
présence de 1’Etre dans l’étant sensible (a dans le visage de cet enfant ») qui le recèle
et le masque à la fois. Avec cette interprétation, le rôle de Diotima (celle de Platon,
mais aussi celle de Holderlin) prend une dimension autre. Elle n’enseigne plus la
nécessité d’un passage du sensible au suprasensible, mais apprend à voir la beauté
dans les choses les plus petites, à condition qu’on ne la comprenne pas comme qualité
accidentelle, contingente de l’étant, mais rayonnement de 1’Etre dans l’étant. Dire
que l’homme doit (( se représenter la beauté en elle-même et par elle-même », et non
U avec un visage ou avec des mains », c’est dire qu’il ne doit pas réduire la beauté à
un attribut, une propriété de l’étant, mais reconnaître en elle la présence de l’être.
C’est, nous semble-t-il, à la seule condition d’une semblable lecture qu’on peut
comprendre pourquoi nous devons tous, et la philosophie moderne avec nous, demander (( pardon )) à Platon. Si on prêtait à Holderlin une lecture traditionnelle du Banquet
et du Phèdre, on comprendrait mal comment ils peuvent jouer un tel rôle, dans le
travail entrepris par Holderlin pour se dessaisir de l’idéalisme de Kant et de Fichte.
I1 y aurait en outre contradiction entre le (( saint Platon, pardonne-nous )) de la
(( Préface à l’avant-dernière version ... », et la méditation de la beauté qui s’effectue
dans la dernière sous le signe de la pensée de Héraclite. O n yoit difficilement comment
pourraient être affirmés à la fois le resplendissement de 1’Etre comme beauté, vérité
de l’Un-Tout, et la récusation du sensible au profit d’un royaume des idées. I1 n’y
a, en effet, pas grand-chose de commun entre (( l’Un distinct en soi-même )) et la
dialectique ascendante du platonisme traditionnel. Enfin, on peut difficilement croire
que de l’avant-dernière version à la dernière, la référence à Héraclite ait récusé la
fidélité à Platon, d’autant plus qu’à d’autres égards (notamment grâce à la figure de
196
Diotima) les références au Phèdre et au Banquet sont, quoique implicites, aisément
repérables dans la version définitive. Comprendre ce que signifie (( l’existence de l’être
comme beauté N implique donc la double référence à la pensée d’Héraclite et à celle
de Platon. L’une et l’autre se conjuguent pour rendre possible, de façon différente,
une critique de la philosophie moderne.
Leur conjonction peu: être confirmée par une dernière analyse : nous n’entendrions
pas vraiment ce qu’est l’Eue, dont parle le roman Hypérion, si nous ne le précisions
pas par la détermination de l’amour comme lien souverain de toute présence ».
C’est, en effet, en tant que (( l’Un distinct en soi-même »,comme beauté, dit l’harmonie
d’une unité sans défaut que l’amour, le cpihdv précise son sens. 11 est ce qui permet
à l’unité de se composer dans l’opposition d’elle-même à elle-même, ce sans quoi
l’être ne pourrait se rassembler dans la différenciation de soi. Ici encore nous devons
convoquer la pensée de Heidegger. Dans Qu’est-ce que la philosophie?, il écrit en effet :
Ceci qu’un étant s’ajointe à l’autre dans la réciprocité, que les deux sont l’un et
l’autre originellement ajointés parce qu’il leur est dévolu d’être ensemble, cette
harmonie est ce qui caractérise le qihciv tel que le pense Héraclite, ce qu’est
aimer 24.
L’amour est donc ici ce sans quoi, dans l’harmonie, la discorde ne serait pas aussi
concorde. I1 est au principe de l’unité du tout. Mais dans la pensée de Holderlin,
s’il renvoie indiscutablement aux fragments d’Héraclite, il se laisse encore plus
facilement comprendre à la lumière du Banquet. C’est encore une fois aux pages de
la Jeanesse de Hypérion qu’il faut se référer. Dans ce texte, en effet, se trouve repris
comme figure de la corrélation entre finitude et beauté, le mythe du Banquet, où
Diotima révèle à Socrate la Co-naissance de l’amour et de la beauté. L’amour, fils de
l’abondance et de la pauvreté fut conçu le jour de la naissance d’Aphrodite au cours
d’une fête qui la célébrait. Pour Holderlin, c’est le signe de ce que :
...la pauvreté d e la finitude est inséparablement unie à la surabondance de la
divinité [...] Le conflit des tendances, toutes deux indispensables est harmonisé par
l’amour fils d e l’abondance et de la pauvreté 2 5 .
L’amour, en ce sens, est amour de la beauté. Cela ne veut pas dire qu’il est aspiration
immodérée à un ailleurs, puisque la beauté ne peut être pensée comme telle. Certes,
il aspire à ce que (( lui soit rendu visible l’invisible », à ce que (( lui soit proche
maintenant ce qui lui était si lointain ». Mais ce dévoilement de l’invisible, cette
proximité du lointain, nous l’avons vu, n’impliquent pas qu’on se détourne du visible.
C’est dans le visage d’un enfant, dans la venue du printemps que l’invisible devient
visible. Qu’est-ce que cet invisible? Peut-être cette harmonie qui est le propre de
l’Un-Tout. L’amour alors n’est pas ce qui caractérise l’ajointement d’un étant à l’autre
dans la (( réciprocité )) (le qihsiv héraclitéen), mais d’une autre façon, la relation vivante
de l’être humain à ce qui l’entoure. Si la beauté est le resplendissement de l’être dans
l’étant, l’amour est le saisissement par cet être, par l’harmpie invisible, l’Un-Tout
que l’étant recèle et dérobe à la fois. MAaisêtre saisi par 1’Etre dans l’étant, ce n’est
pas s’essayer à une contemplation de l’Etre, d’un Etre, indépendamment de l’étant.
L’amour ne saurait être sa négation. Au contraire, comme le dit expressément la
Jeunesse de Hypérion, il allie en lui l’impatience et l’affection. 11 affectionne l’étant
parce qu’en lui seulement l’être se révèle comme beauté, et s’impatiente contre lui,
parce qu’il le lui cache. Cette double conjonction de l’aspiration et de la résistance,
de l’affection et de l’impatience permet de comprendre ce que Holderlin appelle (( les
infinis égarements de l’amour )), dont le roman donne tant d’exemples. Ils traduisent
la difficulté de l’être humain à trouver une juste mesure dans sa relation à ce qui
l’entoure.
197
Une juste mesure, c’est-à-dire une parole juste, une façon de parler qui ne fasse
pas violence à l’Etre, comme beauté. a Je crois qu’à la fin nous nous écrierons tous :
“ saint Platon, pardonne-nous »,écrit Holderlin. Si la philosophie moderne doit se
faire pardonner, c’est peut-être qu’en dépit de l’énorme travail d’éducation qu’elle
accomplit, elle reste à l’encontre de cette parole. I1 n’y aurait plus de beauté pour la
philosophie, aux deux sens de l’expression. D’une part, la langue de la philosophie
critique et idéaliste consacre la rupture avec le h o y o ~grec, parole sans sujet. D’autre
part, elle n’est pas à mêmeA,sans doute pour cette raison, de rendre compte, en une
parole, de l’existence de 1’Etre comme beauté : nous l’apprendrions des Grecs. Que
la beauté exige une parole mesurée harmonieuse, Hypérion en fait, dans le roman le
douloureux apprentissage. C’est à Diotima, prêtresse de l’amour et de la beauté qu’il
lui faut maintes fois demander pardon.
Je devrais me taire, oublier et me taire. Mais la flamme me fascine jusqu’à ce que
je me sois jeté contre elle pour y périr, comme la phalène. Un jour, au milieu de
ces échanges sans réserve je sentis Diotima devenir de plus en plus silencieuse 26.
Marc Crépon
NOTES
1. Holderlin, @uvres, Gallimard, <( La Pléiade », 1967, p. 200.
2. Ibid., p. 201.
3. Holderlin, Metrisrbe Fasmng, G.St.A, t. III, p. 201.
4. Holderlin, Euvres, op. r i t . , p. 201.
5. Ibid.
6. Ibid., p. 202.
7. Ibid.
8. Ibid., p. 203.
9. Ibid.
10. Ibid., p. 1150.
1 1 . Ibid., p. 268.
12. Ibid., p. 201.
13. Ibid., p. 205.
14. Kant, Critique de la raison pure, trad. Tremesaygues et Pacaud, Paris, PUF, p. 263.
1 5 . Uvo Holscher, Empedokies und Hoideriin, Insel Verlag, Francfort-sur-le-Main, 1965. Selon
U. Holscher, la bibliothèque de l’université de Tübingen comportait le volume de Henri Estienne ou
Henricus Stephanus, le Poésis Pbiiosopbira de 1573, dans lequel on trouvait, outre une bonne moitié
des vers connus d’Empédocle, les fragments d’Héraclite. Nous avons en outre la certitude qu’il s’est
servi pour la rédaction de son travail de magistère d’un livre de Georg Christoph Hamberger, datant
de 1756,‘Zuveriassige Nacbrirbten von den vornebmsten Scbr$tsteilern vonz Anfange der Welt bis 1500, où
l’ouvrage de Stephanus se trouve mentionné dans un chapitre consacré à Empédocle. Cela nous assure
au moins de ce que Holderlin avait entendu parler de cette édition et renforce la probabilité qu’il l’ait
eue entre les mains.
16. Héraclite, Frugments, trad. Marcel Conche, Paris, PUF, 1986, p. 423, 425, 430.
17. Heidegger, Geramtausgabe, Francfort, Klostermann, 1980, t. XXXIX, p. 124.
18. Holderlin, Euvres, op. rit., p. 113.
19. Ibid., p. 235.
20. Ibid., p. 1150.
2 1 . Platon, Le Banquet, trad. Léon Robin, Paris, Budé, 195 1, 2 11 a,b.
22. Holderlin, L a Jeunesse de Hypérion, cité et traduit par Jacques Taminiaux in L a Nostalgie de la
G è r e à I’aube de i’idéaiisme allemand, La Haye, Martinus Nijhoff, 1967, p. 154.
198
23.
24.
25.
26.
Cité ibid., p. 153.
Heidegger, Qu’est-ce que fa philosophie?, cité ibid., p. 151.
Holderlin, La Jeunesse de Hypérion, ibid., p. 239.
Holderlin, Euvres, op. rit., p. 197.
La joie d’Hypérion”
Jean-Luc Nancy
U L’image de l’homme a des yeux, mais la lune, elle,
de la lumière. a
(En bleu adorable.)
Bellarmin à Sélénion
Voici bien longtemps, il est vrai, que Holderlin a cessé de m’écrire. Depuis lors,
tant de troubles, et de si grands, ont affligé la patrie où il s’exila que je puis bien
croire à la perte de quelques lettres. L’une ou l’autre, pourtant, n’aurait pas manqué
de m’atteindre : il lui suffisait de le souhaiter pour employer à cet office quelque
rescapé d’une armée, ou quelque réfugié chassé par la misère ou le bannissement.
Combien n’en avons-nous pas vu surgir parmi nous! Quant à la nouvelle de sa mort,
comment imaginer qu’elle ne me soit point parvenue par l’un des innombrables
voyageurs qui font aujourd’hui le pèlerinage de ce pays désormais rendu à la paix,
ou du moins, comme tant d’autres, à son pénible simulacre? I1 vit donc, crois-le
bien, mais il ne vit plus pour nous, il ne vit plus pour nous parler de lui, comme
je le lui avais demandé, ni pour se remettre en mémoire les heures passées. I1 vit c’est ainsi que je l’imagine - pour un présent ou pour un avenir dont nous ignorons
tout, et dont peut-être il ne saurait rien nous communiquer. Nous laisse-t-il ainsi la
tâche de comprendre par nous-mêmes son silence? Y a-t-il là quelque dessein à
réfléchir, quelque chère énigme que nous aurions à déchiffrer? Cela même, je ne
saurais le dire. Compagnons de mon temps!, m’écrivait-il un jour, ne questionnez ni le
médecin ni le prêtre, si vous dépérissez au-dedans! J’ajoute désormais, pour toi et pour
nous tous : ne questionnez pas non plus celui qui nous a fuis. Dans sa nuit, dans
l’abîme du deuil, le pouvoir de parler se perd aussi.
*
200
Ce texte reprend et prolonge une première version parue dans Les Études philosophiques (2), 1983.
Quoi que j’aie pu moi-même souhaiter, et quoi que tu aies pu me suggérer ou
me demander, il m’apparaît en définitive tout à fait impossible d’écrire une étude
philosophique sur Holderlin. O u plus exactement, je soupçonne cette entreprise d’être
vouée à de bien étroites limites - s’il est vrai par ailleurs qu’il est toujours possible
d’écrire une pareille étude, et s’il est non moins vrai que la chose a été faite, à
plusieurs reprises, et bien faite. Je ne citerai personne, par crainte d’offenser à la fois
ton savoir en ce domaine et ta modestie. I1 est vrai que tu me priais d’examiner en
particulier les liens discrètement mais étroitement noués entre Kant et Holderlin, ces
liens que n’a disposés aucune proximité des personnes ni des travaux, et pas non plus
à proprement parler quelque continuité de doctrine, mais qui se laissent déceler
comme la secrète correspondance de deux pensées, ou qui ne sont eux-mêmes peutêtre rien d’autre que la communauté de la pensée dans l’incommensurable de deux
pensées dont les sources et la nature different autant que la Prusse de la Souabe, ou
que l’Allemagne tout entière de la Grèce (ainsi du moins que l’un et l’autre - mais
différemment - le croyaient).
En vérité, ce n’est pas d’une communauté de la pensée qu’il faudrait parler, si
l’on entreprenait une telle étude. Une pareille communauté, Holderlin l’a connue à
Tübingen, ou à Iéna avec Sinclair, ou à Francfort, avec Hegel encore. Avec Kant, il
faudrait parler d’une mêmeté de la pensée. Une même pensée pense chez l’un et
l’autre, en deçà et au-delà de l’idéalisme spéculatif, une même pensée partagée, divisée
dans sa mêmeté - entre le X V I I I ~ et le XIX‘ siècle, entre la fin des Lumières et le
début d’une modernité qui ne se reconnaît pas comme (( modernité )) (que ce concept
soit romantique, positiviste, progressiste, ou mallarméen), mais bien comme la froide
nuit des hommes, vers laquelle Hypérion se retourne encore une fois, et ne cesse pas,
peut-être, de se retourner.
Séiénion à Bellarmin
[...I Qu’aurait pensé Kant de Hypérion, s’il l’avait lu? Qu’en a-t-il pensé, s’il l’a
lu? Nous ne le saurons pas. Heinse, l’ami, et le dédicataire de Brot und Wein, plus
tard, pensait en savoir quelque chose. I1 écrit en 1797, peu après la parution du
premier volume : (( I1 y a là des passages d’une chaleur et d’une pénétration telles
qu’elles devraient saisir le vieux Kant lui-même et le détourner de sa pure apparence
de toutes choses. )) I1 écrit cela à Sommering (pour qu’il le répète à Holderlin), au
D Sommering dont Kant, l’année précédente, a accompagné de remarques l’ouvrage
Sur I‘organe de Pâme, et qui est le médecin des Gontard, le médecin de Diotima. Se
forment ainsi, pour nous, d’étranges compositions : Kant, Hypérion, la médecine,
Suzette, et l’âme (l’organe de l’âme, Holderlin s’en souviendra sans doute en parlant
de l’organe de l’esprit dans l’essai Sur la manière de procéder de I’esprit poétique). Ce
ne sont ni des allégories, ni des scènes que l’on pourrait reconstituer ou imaginer. Ce
sont des constellations, des entrelacements arrachés à l’histoire, privés de genre et de
figure. Tout ce que l’on peut dire, c’est que non seulement la pensée, mais le cœur
de Holderlin côtoient Kant de bien des manières. Quelques années plus tôt, Wilhelmine, dont il eut un enfant, lui demandait de lui parler de la Critique de la
faculté de juger (on a perdu, m’écrivais-tu, les notes de Holderlin sur ce livre). Au
début de 94, elle lui avait apporté (( le dernier écrit paru de Kant ». Cela pouvait
être Sur le lieu commun ..., ou bien De I’injuence de la lune sur le temps [...I.
Bellarmin 2 Sélénion
Je n’avais pas achevé de te répondre. Ce que je crains, peut-être l’as-tu soupçonné,
n’a rien à voir avec ce que d’aucuns invoqueraient comme l’intouchabilité du poète,
20 1
avec la peur de massacrer le chant par le concept. Je crains que la philosophie soit
encore incapable d’affronter la froide nuit des hommes. O u bien, ce qui est le même,
qu’elle ne puisse guère entendre ceci :
Et peu de savoir, mais de joie beaucoup
Est donne aux mortels.
(« Le
Gothard »)
Sélénion à Bellawnin
[...I
I1 l’a nommé, tu le sais bien,
((
le Moïse de notre nation
N
[...I.
Bellamin à Sélénion
Ton insistance m’aura vaincu. Tu jugeras toi-même du bien-fondé de mes
réticences, lorsque tu m’auras vu tenter de les surmonter.
La mêmeté de Kant et de Hoiderlin ne leur est pas propre à la manière d’une
exclusivité absolue, qui les distinguerait d’emblée à tous égards de tous les autres.
Je ne pourrai te la faire apercevoir qu’en allant d’abord la chercher au sein de la
communauté de l’époque tout entière, en deçà de ses partitions et de ses oppositions
internes. L’époque est en effet celle de Kant, c’est-à-dire, pour ce qui fait alors époque,
celle de l’exigence de l’unité inconditionnée. La Critique a tout divisé - l’empirique
et l’idéal, !e théorique et le pratique -, mais elle a du même coup requiJ avec d’autant
plcs de force une nouvelle production de l’unité. A partir de Kant, l’Un n’est plus
rien de simple, ni de donné - mais l’objet, ou la visée de l’exigence dernière :
L’expérience, dès lors qu’elle est possible, à la considérer objectivement dans sa
généralité, doit constituer (en Idée) un système de connaissances empiriques possibles, selon des lois tant universelles que particulières. Car l’unité de la nature
l’exige, d’après un principe de la connexion complète de tout ce qui est contenu
dans cet ensemble de tous les phénomènes (« Première Introduction N à la Critique
de la faruité de jager).
Fichte, Schelling, Schlegel, Hegel ou Novalis partagent un même souci - et
c’est le souci de l’Un. C’est-à-dire à la fois le souci de l’Un et du Tout - èn Rai
panta, ce fut à Tübingen une sorte de devise commune à Hegel et à I-Iolderlin - et
de la différence interne de l’Un qui doit composer la pluralité - èn diapheron heautô,
(( la grande parole d’Héraclite N répétée par Hypérion. Ce qui leur est à tous arrivé,
par Kant, ce qui les a commandés ou destinés, c’est la nécessité par laquelle la pensée
(la philosophie, la politique, l’art) ne pouvait plus penser dans la distinction et la
complémentarité du particulier et de l’universel (ainsi que Kant, malgré tout, pensait
encore), mais selon la totalité, et par conséquent selon l’unité. Selon l’unité, et par
conséquent, puisque l’unité doit se conquérir dans le procès multiple d u tout (et ne
peut être disponible pour elle-même, à part, comme l’universel), selon l’exigence et
donc la tension, le suspens, voire la déchirure de l’unité (ainsi que Kant le pensait
déjà). Hypérion parle pour tous :
Mais qu’est-ce que la vie divine, le ciel de l’homme, sinon de ne faire qu’un avec
toutes choses?
Tous ont ensemble le souci de l’être-un - de l’Être-un et de l’être-Un -, d u
passage par la différence de l’Un et de la réconciliation, de l’unique réconciliation.
202
Les dissonances du monde sont comme les querelles des amants. La réconciliation habite
la dispute, e t tout ce qui a été séparé se rassemble.
Ce sont les mots d’Hypérion, ce sont les mots de tous. Ils ne témoignent pas,
comme on le dit souvent, d’un {{ optimisme )) de Holderlin en 1779. Ils témoignent
d’une très large et très contraignante nécessité de la pensée. Cette nécessité n’est rien
qui soit croyance ou confiance dans l’unité, son instauration ou sa restauration. Elle
répond plutôt, dans son affirmation même, à ceci que l’unité n’cst pas donnée. La
réconciliation habite la dispute, mais elle n’est pas donnée, elle n’est posée ni disponible
en aucun lieu, ni transcendant, ni immanent. C’est ce que signifie la perte de la
Grèce, qui ne fait qu’emprunter à la nostalgie son apparence. La nostalgie n’est
(presque) rien ici : elle dit la conscience d’un destin inédit - de l’inédit de tout destin
- à qui rien n’est donné, que l’aspiration infinie - unendlicbes Streben - vers l’Un,
c’est-à-dire, encore une fois, la non-disposition, la non-possession de l’Un, mais l’unité
comme tâche, comme chemin, comme procès, comme départ et comme envoi jusqu’à nous, mon ami, et pour nous.
Holderlin appartient à cette communauté réunie dans l’habitation de la réconciliation, dans la pensée de l’union et de la réunion. Ce n’est pas chez lui une pensée
de la première période. Bien plus tard, il écrira pour Zirnmer :
Les lignes de la vie sont opposées entre elles
Comme sont les chemins, les tracés des montagnes
Ce que l’on est, un Dieu pourra le compléter
Avec des harmonies et la paix kternelle.
La différence de Holderlin - de cet un qui differe dans l’identité de son temps,
dans l’identifiable de notre temps - ne tient pas au souci de l’Un. Elle ne tient donc
pas non plus - quoi qu’en aient ceux dont le pathos le sollicite sans pudeur-, à
l’inverse, à une pensée de la dissonance irrémédiable, de la déchirure, d u saccage ou
de l’errance purs. Ces fragments à quoi se réduit toute œuvre humaine et dont lui parle
Diotima ne font pas plus un désenchantement qu’ils ne font (comme pour Novalis)
un enchantement magique. Mais la pensée de l’Un, chez Holderlin, si elle comporte
comme chez les autres la représentation et le désir (la représentation, donc le désir)
de la figure de l’Un, de sa stature et de sa nature (la Nature, la Grèce, les Dieux),
forme cependant avant tout, au plus profond, une pensée de l’inavènement de l’Un.
L’inavènement n’est pas la rupture, ni l’inachèvement. I1 se distingue aussi bien
d’une (( vision tragique N au sens courant de cette expression que de la projection de
l’Un dans le mauvais infini d’une tâche interminable - et pourtant il se sépare tout
autant du bon infini de son effectuation dialectique. L’inavènement de l’Un ne signifie
pas que l’Un, n’advenant pas, ne pourrait être l’Un qu’il doit être, et s’abandonnerait
à la détresse d’une pure dislocation, ou à l’épuisante et plutôt risible fuite d’une
course asymptotique (ces motifs pourtant sont bien aussi chez Holderlin). Mais l’Un
comme tel n’advient pas. I1 est l’Un qu’il est dans son inavènement. I1 ne compose
pas l’unité de son être-un et de son inavènement, il les laisse se poser, ensemble et
séparés, dans une sorte de cadence :
I1 est une éclipse de toute existence, un silence de notre être où il nous semble
avoir tout trouvé.
I1 est une éclipse, un silence de toute existence où il nous semble avoir tout
perdu, une nuit de l’âme où nul reflet d’étoile, même pas un bois pourri ne nous
éclaire.
C’est ainsi que Holderlin est alors, au plus près, le même que Kant - à travers leur
différence extrême.
..................................................................................................................................
203
Et ceci fait toujours loi
Que le monde, jour après jour, demeure un tout. Mais on dirait souvent
Qu’il n’y a point entre deux grands hommes réciproque
Convenance. Les voici en tout temps comme au bord
d’un gouffre, l’un
A côté de l’autre.
(«L’unique. »)
..................................................................................................................................
Leur différence, on pourrait la dire en ceci : Kant se sert de la beauté pour
penser l’Un; la beauté ne lui est donc rien, elle défait seulement - mais sans appel
- la possibilité d’un concept de l’Un (telle est bien la pierre d’achoppement de la
troisième Critique, diversement mais en somme unanimement évitée ou évacuée par
les Fichte, Hegel, Schlegel, et même par Schelling). Holderlin pense la beauté à partir
de l’Un : cela ne signifie pas un instant qu’il opposerait l’Un du poète à l’un inadvenu
du philosophe, selon le diagramme et la dialectique bien connus, trop connus. (Au
contraire, la différence de Holderlin, c’est aussi d’être le poète (( qui eut l’audace de
devenir penseur », comme l’écrit D. Janicaud dans Holderlin e t la Philosophie d’après
Hypérion. Mais cela signifie qu’il pense la beauté à partir de l’Un sans concept - à
partir de l’Un qui n’est pas Sujet, qui n’est pas Idée ni Substance, mais de l’un qui
en tant qu’un n’est pas. Que l’Un en tant qu’Un n’est pas, qu’il inadvient essentiellement, c’est ce qu’il fallait savoir lire dans la troisième Critique (tandis que les autres
y cherchaient à commentaire forcé la règle ou l’esquisse d’une production de l’Un,
ou tout uniment d’une production) :
Or l’esprit entend en lui-même la voix de la raison, qui, pour toutes les
grandeurs données, et même pour celles qui ne peuvent jamais être complètement
appréhendées, mais que l’on considère cependant comme entièrement données
(dans la représentation sensible) exige la totalité, par conséquent la Compréhension
dans une intuition et réclame une présentation pour tous les membres d’une série
continûment croissante, sans même exclure de cette exigence l’infini (l’espace et le
temps écoulé), faisant bien plutôt de la pensée de l’infini (dans un jugement de
la raison commune) comme entièrement donné (dans sa totalité) quelque chose
d’inévitable.
Cependant l’infini est absolument (et non pas simplement comparativement)
grand. En comparaison avec celui-ci, tout le reste (de la même sorte de grandeur)
est petit. Mais, et voici ce qui est le plus important : que l’on puisse seulement
penser l’infini comme un tout, c’est là ce qui indique une faculté de l’esprit qui
dépasse toute mesure des sens. II faudrait à cet effet exiger une compréhension
qui livrerait une mesure en tant qu’unité possédant un rapport déterminé à l’infini,
susceptible d’être exprimé en nombres; et cela est impossible. Toutefois pouvoir,
sans contradiction, même seulement penser l’infini donné, ceci suppose en l’esprit
humain une faculté qui est elle-même suprasensible.
I1 fallait lire qu’une (( faculté qui est elle-même suprasensible », autrement dit
une faculté absolument grande - un sens de l’Un - ne peut plus être elle-même une
faculté, ni une, ni faculté, et ne saurait advenir que dans l’excès sur tout avènement.
Toute la Critique s’épuise à discourir un tel excès, et sa nécessité. Mais Hypérion :
Comment se fait-il que l’homme ait de si grands désirs? me demandais-je
souvent. Que vient faire l’infini dans son cœur? L’infini? Où se situe-t-il? Qui l’a
perçu? L’homme veut plus qu’il ne peut : cela, oui, pourrait bien être vrai. Tu
en as fait souvent l’expérience. Mais cet état de chose est nécessaire. L’homme doit
le doux, l’exaltant sentiment de sa force au seul fait que celle-ci ne s’écoule pas
à son gré; il doit tous ses beaux rêyes d’immortalité, tous les fantômes immenses
et charmants qui le ravissent, son Elysée et ses dieux, au seul fait que la ligne de
204
sa vie n’est pas droite, qu’il ne vole pas comme la flèche et qu’une puissance autre
barre la route à celui qui fuit.
[Suite]
La route barrée, tu le vois bien, n’est pas un obstacle ni une entrave. Elle n’est
pas non plus quelque chose qui se convertit, se relève ou se transfigure. Mais la
trajectoire rompue fait advenir cela qui n’advient pas - ce n’est pas une flèche, il n’y
a pas de rencontre avec une cible, cela s’interrompt et recommence : le sublime se situe
moins dans la grandeur du nombre que dans le f a i t que nous parvenons en progressant à
des unités de plus en plus grandes (Kant).
Mais enfin ce progrès, dont nulle fin de l’histoire, nulle perfection de l’art, ne
vient chez Kant accomplir proprement le concept de progrès ne va à rien qu’à son
excès. Son excès même n’est pas la surabondance infinie de l’Un, puisque l’Un,
l’incommensurable, n’est pas. (( Parvenir à des unités de plus en plus grandes )) ne
revient pas à accroître à l’infini la somme qui serait celle de l’Un; l’infini ne se
(( situe N même pas à cette extrémité : il n’est que la dissolution de toute unité. Mais
l’Un n’opère pas non plus par la ruse d’une pure perte où tout, du même coup,
serait gagné. Dans cette voie négative comme dans la voie positive, la richesse finale,
absolue, ne pourrait comme telle qu’échoir à un sujet, c’est-à-dire à un sujet. Mais
l’un du sujet - ce sujet dans le sujet plus abîmé qu’aucune substantialité, qu’aucune
propriété, fût-elle celle d’un (( je transcendantal )) - ultime recours, mais vide et
vacillant, chez Kant, de l’unité : (( Dans ce que nous appelons l’âme, tout est dans
un continuel écoulement, et il n’y a rien de permanent, excepté peut-être (si l’on y
tient absolument) le moi qui n’est si simple que parce que cette représentation n’a
point de contenu et, par suite, point de divers, ce qui fait qu’elle semble représenter
ou, pour mieux dire, désigner un objet simple )) -, l’un du sujet est ce qui depuis
Kant sans fin se défait ou s’interdit. Ou qui se limite : (( Une puissance autre barre
la route. )) L’excès sublime est l’excès de l’Un sur lui-même, la mêmeté même en
tant que limite, finitude et dépose de l’identité - une dépose sans repos.
N Que cette chose unique survive en moi-même ... #, N so soil dies Einzige docb micb
selber iiberleben in mir ... U , ce cri d’Hypérion (est-ce un cri? est-ce seulement audible?)
préserve et ne préserve pas l’unité. I1 ne la perd ni ne la gagne. Ueberleben, survivre,
nous le comprenons toujours comme le maintien d’une vie au-delà de la limite,
comme une perpétuation, une conservation. Mais ce pourrait bien être ... la même
chose, à peine, à peu près : vivre hors de la vie, vivre sans la vie, avec la mort, donc,
et sans la m o r t pourtant.
Le survivre déborde à la fois le vivre et le mourir, les suppléant l’un et l’autre
d’un sursaut, et d’un sursis, arrêtant la mort et la vie à la fois, y mettant fin d’un
arrêt décisif, l’arrêt q u i met un terme et l’arrêt q u i condamne d’une sentence, d’un
énoncé, d’une parole ou d’une surparole (Derrida, Survivre).
Pourquoi Holderlin (( s’est-il », comme on dit, si longtemps (( survécu N - et sa
poésie )) avec lui? Et pourquoi survit-il ainsi, non pas jusqu’à nous (comme tant
d’autres (( auteurs immortels »?), mais pour nous? Pourquoi, peut-être, nous survit-il,
déjà?
Il s’agit là d’un débordement qui rejette dans l’insignifiance les évaluations
littéraires et philosophiques, qui condamne toute célébration de Holderlin (celle-ci
comme les autres). I1 ne survit pour nous qu’à ce prix.
Qu’est-ce donc que déborder? et en quoi, par où, comment Holderlin débordet-il? Déborder (survivre) n’est pas entraîner hors des limites la logique de ces limites.
C’est défaire la limite sur elle-même, en la gardant, en la retraçant du geste qui
((
205
l’efface (quel effacement ne retrace, nécessairement, ce qu’il efface?). C’est inclure le
dedans dans le dehors, le dehors dans le dedans, mais sans expansion ni transgression
de l’un ni de l’autre
sans extension illégitime hors des limites de l’expérience
possible. L’expérience possible de Kant - la circonscription unique sans unité dernière
du phénomène, de l’apparition de tout apparaître - est l’expérience de la limite dans
l’exigence de l’Un, l’exigence de l’Un dans la limite de l’expérience.
-
[Suite]
Même dans une existence limitée, l’homme peut connaître une vie infinie, et la
représentation limitée de la divinité, issue pour lui de cette existence, peut, elle
aussi, Ctre infinie (Essai fragmentaire de la période d’Empédocle).
Même dans une existence limitée, l’homme peut connaître une vie infinie : c’est
cela survivre, c’est cela excéder. La vie infinie ne succède pas à la vie et ne la déborde
pas. Mais la vie se succède et s’excède en elle, et elle déborde dans la vie. Non coerceri
maximo, contineri minimo, divinum est (exergue d’Hypérion, fragment d’épitaphe d’Ignace
de Loyola) : cette pensée n’est pas seulement la plus constante, la plus insistante de
Holderlin. C’est sa pensée même, la pensée de la finitude. Elle n’est pas, comme
chez Descartes ou chez Hegel, pensée de la finité, qui toujours rapporte l’être fini (de
l’homme) à un infini qui le fonde et vers lequel il tend. Mais elle pense l’être fini
comme la paradoxale, l’intenable circonscription de l’infini : le maximum est dans le
minimum; il n’y a pas de dehors. L’infini déborde au-dedans : c’est toute la problématique kantienne de la (( faculté supra-sensible N de l’infini, ce qui veut dire que la
pensée de la finitude est la pensée du sublime. Cette pensée n’est pas une pensée
(( sublime )), mais simplement, patiemment, la pensée de l’inqualifiable unité de l’Un,
de son incommensurable grandeur :
I1 y a ici aussi des dieux, ils règnent,
Grand est leur Mètre, pourtant il mesure volontiers à l’empan, l’homme.
(« L’errant »)
La pensée kantienne de la finitude et la pensée holderlinienne de l’Un sont de
part en part pensée de l’homme. Elle pense (elle ne conçoit pas) l’homme à partir
de l’un, et l’un comme le partage de l’homme. Ce n’est pas un cercle : c’est une
conflagration. L’homme est la catastrophe de l’Un, l’Un est sa déchirure mortelle, et
sa survie.
..................................................................................................................................
,
206
Un signe, tels nous sommes, et de sens nul,
Morts à toute souffrance, et nous avons presque
Perdu notre langage en pays étranger.
Car lorsqu’un débat règne au ciel
A propos des humains er que les lunes
Vont leur cours, imposantes, la mer
Elle aussi parle et les fleuves doivent
Se chercher une voie. Mais Quelqu’un demeure
Indubitable. Il peut, chaque jour, changer
Le cours des choses. A peine lui faut-il
Un décret. Et la feuille bruit alors et, près des glaciers, les chênes
Agitent leurs rameaux. Car les Maîtres du ciel n’ont point
Toute-puissance. Oui, les mortels avant eux atteignent
Le bord du gouffre. Ainsi l’écho change
Avec eux. Le temps est long, mais voici paraître
Le vrai.
(« Mnémosyne », 2‘ version.)
La présentation d u tragique repose principalement sur ceci que l’insoutenable,
comment le Dieu-et-homme s’accouple, et comment, toute limite abolie, la
puissance panique de la nature et le tréfonds d e l’homme deviennent U n dans
la fureur, se conçoit par ceci que le devenir un illimité se purifie par une séparation
illimitée. (Remarques f u r Gdipe.)
Le vrai paraît inéluctablement dans la séparation illimitée d e l’homme. I1 n’y a
pas d’autre lieu pour le vrai. Et pas d’autre unité pour l’homme. Rien qui puisse
grandir, rien qui puisse tomber comme l’homme. I l compare souvent sa douleur ù la
nuit de l ’ d î m e et son bonheur ù /’Ether, et c’est encore dire si peu! (Hypérion.)
Non seulement, mon ami, nous n’avons pas fini de penser cette pensée, mais
nous n’avons pas commencé. Cela ne veut pas dire, assurément, que Holderlin l’aurait
pensée et que contre la loi du temps nous serions en retard sur lui. Je te le redis :
n’attendons rien de lui. Kant n’avait pas pensé ce que Holderlin sut y lire, Holderlin
n’avait pas pensé ce que Heidegger sut y déchiffrer. Chacun pourtant a bien pensé
la pensée de l’autre. Peut-être cette pensée n’a-t-elle ni fin ni commencedent. Mais
qu’appelle-t-on penser?...
Oui, essayons de dire que cette pensée - la seule, peut-être, que cet âge du
monde ait à penser-, on ne commence pas plus qu’on ne finit de la penser. Elle a
commencé pour nous, mais ailleurs, sans nous, avec cet âge du monde mais non pas
comme son fruit, ni comme sa raison ni comme son génie.
Cette pensée elle-même, !a plus précise et la plus incisive, n’est pas une pensée
une, avec son ordre, sa séquence et le telos de son concept. Elle commence où elle
finit, elle finit là où, comme pensée, elle commence. Le trait le plus navrant a e notre
époque est qu’on y croit encore, couramment, que la philosophie pourrait être
l’édification d’une pensée sur le monde, le graphique hasardé d’une trajectoire de
définitions, d’évaluations, d’interprétations et de prescriptions, avec quoi on pourrait
mesurer, calculer, susciter ou animer lin sens. Mais l’un du sens dans le sens n’advient
pas. Ce n’est pas qu’il n’y ait pas de sens. Mais l’inavènernent de l’un du sens est
cela seul qui compte dans le sens. Que cette chose unique survive dans le seils au
sens! (( Holderlin », pour nous, est le nom de cette survivance : de là qu’il s’efface et
ne s’efface pas, pour nous, différemment de tous les autres. De l à l’excès d ’ o u b l i et
de célébration.
Hypérion - y prend-on assez garde? - est un survivant dans le présent du roman,
un survivant de la guerre, de l’amour et de la philosophie. Toutes ses lettres sont
l’histoire de sa vie, mais sa vie n’est pas terrninée. Elle ne l’a mené à aucun terme,
qu’à elle-même - non terminée, achevée pourtant, déposée sur sa limite, sur une côte
grecque. I1 la revit, il la survit. Il est lui-même au-delà de lui-même, il n’est que
cette vie - cette existence limitée -, il l’est infiniment. Aussi est-il à la fois chez lui
et ailleurs, avec et sans Diotima, sans cesse confronté à une fin qui ne finit rien :
Arhènes était devant nous comme Lin immense naufrage, quand les rafales se
sont tues et les marins enfuis, et que le cadavre d e la flotte ankantie gît méconnaissable sur les syrres; et les colonnes orphelines se dressaient à nos yeux pareilles
aux troncs nus d’une forêt qui, Terte encore la veille, a brûle dans la nuit.
- Ici, dit Diotima, on apprend à se raire sur son destin, bon ou mauvais.
- Ici, on apprend à se raire sur tout, continuai-je.
207
Ainsi peut-être s’effectue, paradoxalement, l’exigence de l’unité e t de l’éternité en chaque
moment (Essai Sur la manière de procéder de i’esprit poétique).
[Suite]
C’est qu’il n’y a, en vérité, d’éternité et d’unité que dans le moment, dans le
passage du moment qu’est le moment lui-même (presque pareil en cela au Moment
hégélien; celui-ci pourtant, moment )) de la force d’un levier, relève impeccablement
tout ce dont la vérité n’est que de passer). Que le temps soit la forme d u sens interne
- la forme amorphe et la substance vide du sujet -, telle est la condition kantienne,
transcendantale (c’est-à-dire justement non transcendante, et pas immanente non plus :
la pensée des conditions transcendantales est la pensée de la limite de la pensée), à
laquelle Holderlin soumet toute la pensée de l’Un :
A la limite extrême du déchirement, il ne reste en effet plus rien que les
conditions du temps ou de l’espace.
A cette limite, il oublie, l’homme, soi-même, parce qu’il est tout entier à
l’intérieur du moment; le Dieu parce qu’il n’est rien que Temps; et de part et
d’autre on est infidèle, le Temps parce qu’en un tel moment il vire catégoriquement,
et qu’en lui début et fin ne se laissent plus du tout rimer, l’homme, parce qu’à
l’intérieur de ce moment, il lui faut suivre le détournement catégorique, et qu’ainsi
par la suite il ne peut plus en rien s’égaler à la situation initiale. (Remarques sur
CEdipe.)
Le virage catégorique du temps n’est rien d’autre que le temps (( lui-même )),
son impérieuse succession, et la séparation. L’impératif (avec l’idée de la rigueur, du
tranchant) est bien entendu connoté par le (( catégorique D (et sans doute, tu le verras
par la suite, plus que connoté). Mais le catégorique renvoie d’abord chez Kant (et
pour l’impératif lui-même) au concept d u jugement catégorique, qui n’est rien d’autre
que la simple attribution d’un prédicat à un sujet. I1 donne la pure position d’une
inhérence, la propriété d’une substance. Ainsi : (( Le temps n’a rien de durable. )) De
ce temps qui (( vire », tourne ou se détourne essentiellement (et l’homme avec lui),
le concept s’énonce dans le titre de l’essai : Das Werden im Vergehen, a Le devenir
dans le passer ».
La patrie agonisante, la nature et les hommes en rant que rapport réciproque
constituant un monde particulier devenu idéal et un certain rapport de choses se
décomposent dans la même mesure afin que d’eux, de la génération et des forces
de la nature qui subsistent et qui représentent l’autre principe de réalité, se forme
un monde nouveau, une action réciproque nouvelle, quoique particulière aussi, de
même que cetre agonie fut le résultat d’un monde pur mais. particulier. Car le
monde de tous les mondes, le Tout qui est en tous et qui est toujours se présente
seulement en tout Temps - ou dans le déclin, ou dans le moment, ou, plus
génétiquement, dans le devenir du moment et au commencement d’une époque
et d’un monde.
Hypérion est (quand il écrit, mais il n’est que là, qu’à ce moment qui est le
moment du roman) en tout temps de sa vie, et en tout temps il n’est que son devenir
dans son passer, l’éclosion ou le déclin - l’éclosion, donc le déclin - de son existence
particulière (et, tu viens de le lire, il n’y a pas d’existence totale). Aussi n’est-il,
perpétuant son éclosion dans son déclin, que le ressouvenir - le récit que forment ses
lettres :
Du point de vue de la réminiscence idéale, la dissolution, en tant que nécessaire,
devient, comme telle, objet idéal de la vie nouvellement éclose, regard jeté sur le
208
chemin parcouru depuis le commencement de la dissolution jusqu’au moment où
la vie nouvelle permet le souvenir de ce qui est dissous; et ensuite, explication de
la lacune et unification de l’antagonisme entre passé et renouveau présent, le
souvenir de la dissolution. Cette dissolution idéale est dénuée de crainte. Le point
initial et terminal est posé, trouvé, garanti ; aussi cette dissolution est-elle plus
assurée, plus irrésistible, plus hardie; elle apparaît ainsi comme ce qu’elle est en
définitive : un acte de reproduction par lequel la vie parcourt toutes ses étapes, ne
s’attardant à aucune, s’abolissant à chacune d’elles pour se rétablir à la suivante,
afin d’acquérir la somme tout entière.
Tu as bien lu : la somme tout entière s’acquiert ainsi. Mais as-tu bien lu? la
somme, c’est la dissolution.
Ainsi, c’est dans le souvenir de la dissolution et du fait que ses deux extrémités
sont fermement posées, que celle-ci devient l’acte infaillible, essentiellement hardi,
irrépressible, qu’en définitive elle est réellement.
[...I
Chaque point en voie de dissolution et de création est intimement mêlé au
sentiment total de la dissolution et de la création, de sorte que tout est plus
intimement engrené, se touche, se lie plus profondément dans la douleur et la
joie, dans la discorde et la paix, dans le mouvement et le repos, dans le formé et
l’informe et qu’un feu divin agit ainsi à la place du feu terrestre.
Le divin, toujours, est la discordance de l’unité et de la séparation. Le divin est
donc la discordance du divin et de l’humain. Tel est le virage catégorique du divin
chez Holderlin. I1 recouvre l’idée kantienne du sublime, qui est celle de la présentation
de l’impossibilité de la présentation de l’Un. Mais il ne se contente pas de le recouvrir :
le divin n’est plus un jugement de la subjectivité sur sa propre insuffisance, il est
cette insuffisance (et en cet excès). En un sens, il la présente donc; mais en un autre
sens, il opère un retrait de la présence au sein même de ce que Kant nommait
(( présentation négative N (en ce sens, Holderlin accorde moins que Kant aux possibilités
sublimes de la nature ou de l’art; Holderlin croit moins à la poésie...).
L’existence divine (poétique) est celle du souvenir de la dissolution, parce que
toute particularité se dissout, et n’existe que par ce passer - qui n’est pas un passé
(être-présent dans le passé et du passé), mais le passer lui-même, sans autre vérité
que son passer (« le temps, qui est la seule forme de notre intuition intérieure, n’a
rien de durable, et par suite ne nous fait connaître que le changement des déterminations, et non l’objet déterminable », 1“ (( Critique »). C’est ainsi que l’Un divinement
n’advient pas, mais passe et devient en passant, se remémorant mais s’excédant à
nouveau, se passant et se débordant dans la remémoration elle-même.
Aussi Das Werden im Vergehen revient-il presque à la fin de la Phénoménologie
de l’esprit - c’est peut-être même, à très peu de chose près, exactement cette fin du
Savoir Absolu, où l’Esprit se déborde dans l’écume de son infinité (mais cette quasiidentité est alors à double face, si ce n’est à double tranchant : car ce débordement
de l’infinité, Hegel l’énonce par le brusque virage de son discours en la citation finale
de deux vers de Schiller).
(... Pourquoi Hegel n’aurait-il pas cité son ami? Ces vers, par exemple, de (( A
l’Éther N :
Et l’air qui donne l’âme, de ta plénitude éternelle
Déborde et coule avec violence dans les veines de la vie.
- ou ceux-ci, d’Empédocle :
Et cherche, se sonvenant de son origine,
209
La vie, la beauté vivante, e t s’épanouit
De plaisir à la présence de l’Être pur ...
Oui, pourquoi Hegel.. .)
La différence entre eux, ici, est peut-être inappréciable. Hegel et Holderlin
opposent au temps de Kant une ressaisie du temps par le temps lui-même, la
remémoration qui restitue le devenir à l’être, le périssable au divin. Tous les deux
ouvrent ainsi l’âge moderne, encore voué pour nous à leur remémoration. I1 n’y a
pas de différence entre eux - sinon que pour l’un c’est l’histoire, pour l’autre le poète
qui effectue la remémoration, la récollection et la résurrection. Cette différence ellemême à son tour n’est rien quant à la forme ni peut-être quant à la nature de la
remémoration, quant à la réappropriation du passé. I1 ne faut pas faire trop de crédit
à l’inachèvement des essais de Holderlin, à leurs maladresses et aux singulières
complications où s’embarrasse parfois un esprit qui n’a pas inventé, comme l’autre,
la maîtrise absolue du spéculatif, mais qui n’en veut pas moins le spéculatif: la
volonté, ici, engage plus que la réussite. (Je glisse ici, je passe en marge, tu le vois,
de la Césure du spéculatif de Lacoue-Labarthe.) Et la réussite de Hegel engage peutêtre moins qu’on ne le croit, ou autrement, à la maîtrise - tout au moins dans la
Phénoménologie. Holderlin avec Hegel et avant lui achève l’idéalisme, il l’ordonne
autour de cet (( Un harmoniquement opposé n dont la formule blasonne en quelque
sorte Das Werden im Vergehen.
Mais la différence de l’histoire et du poète n’est pas rien quant au sujet de la
remémoration, et donc de l’unification. L’histoire, le devenir de l’Esprit qui se porte
de soi à sa récollection, c’est le temps lui-même qui s’unifie : la structure et le procès
sont ici du Sujet. I1 n’en va pas de même du poète : il n’est pas le temps lui-même,
il ne lui donne pas substance. Le poète, c’est Hypérion (Père du Soleil ou Soleil luimême, Hypérion ne s’immobilise pas au zénith, ni au nadir, il est la course du Soleil,
son lever et son déclin - Hypérion dont le nom commence et finit par les mêmes
lettres que Holderlin, comme le notait Joseph Claverie dans la Jeunesse de Holderlin
jusqu’au roman de Hypérion, ce livre dont l’auteur mourut à la Première Guerre
mondiale sans l’avoir achevé...). C’est donc aussi ce qu’en un autre sens on appellerait
un (( sujet )) : c’est un individu, c’est quelqu’un, c’est une singularité. Un fragment
posthume porte : (( L’apriorité de l’individuel sur le tout. )) G Poète )) désigne l’apriorité
de quelqu’un, d’un quelqu’un. Mais quelqu’un n’est pas un. Même le poème intitulé
(( L’unique n
ne dit l’unicité du Christ que dans la multiplicité des Divins. (( Le
poète n désigne l’apriorité de l’individuel qui n’est pas un, mais qui est le passage
obligé (étroit, resserré, angoissant) de l’inavènement de l’Un.
une mesure est là toujours, commune
A tous, et chacun cependant reçoit en propre son destin.
Chacun s’en va, chacun s’en vient aux lieux qu’il peut atteindre.
(« Pain
et Vin D)
Cet a priori dont le contenu ne doit rien à Kant préserve l’essence générale de
l’apriorité, c’est-à-dire du transcendantal : en lui se pense la limite de la pensée, et
se pose la limite de la constitution du tout. Du tout, s’il y en a, c’est sous la condition
de possibilité de l’individuel, donc de la non-totalité. En kai pan est une conjonction
disjonctive. Moins en ce que l’individu serait une partie (de cela aussi, Holderlin fait
douter) qu’en ce qu’il est résolument non-un. La non-unité est la condition de
l’identité :
Le moi n’est possible que grâce à la séparation du je et du moi. Comment pourraisje dire : Moi! sans conscience du Moi? Mais comment la conscience de soi est-elle
possible? Elle l’est quand je m’oppose à moi-même, quand je me sépare de moi-
2 10
même, mais que malgré cette séparation je me reconnais dans l’opposition comme
le même. Mais dans quelle mesure le même? Je peux, je dois poser la question
ainsi; car sous un autre rapport il s’oppose à lui-même. Par conséquent l’identité
n’est pas l’union de l’objet et du sujet qui ?e produirait sans plus, par conséquent
l’identité n’est pas = 1’Etre absolu. (Essai Etre et jugement.)
Mais c’est à cette condition qu’il peut y avoir aussi le tout particulier de la
beauté dans l’œuvre d’art. O u plutôt : la condition de l’individualité se réalise comme
beauté; ou encore : c’est la totalité singulière de la beauté qui est la condition de
l’individualité, elle-même condition d u tout. La beauté se fait (( connaître n par son
passage, par son passer dans le poème (le poème n’est pas la beauté, mais elle y
passe). L’œuvre pour Holderlin n’est pas l’opus, ni l’infini de la Dichtung romantique,
mais le lieu et le temps d’un passer, qui n’est pas le passage de la beauté, mais la
beauté elle-même, dans son inconciliable mêmeté.
... Quand enfin le poète se sera rendu compte que l’antagonisme entre contenu
spirituel et forme idéale d’une part, entre alternance matérielle et besoin de
progression identique de l’autre, trouvent leur conciliation dans les moments de
repos et les moments culminants, et que, dans la mesure où ils ne s’y peuvent
concilier, c’est précisément en eux et de ce fait qu’ils deviendront sensibles et
seront sentis; quand le poète aura compris cela, alors... (Essai Sur la manière de
procéder de l’esprit poétique.)
Alors se produit ce que dit Benjamin : (( Dans l’œuvre d’art véritable, le plaisir
sait se faire insaisissable, vivre dans l’instant, s’évanouir, se renouveler N (I‘Origine du
Trauerspiei).
O u encore : on peut se demander si, à partir de Holderlin, la beauté durable
mérite encore son nom. La beauté vire dans le passage de la beauté. << Le poète N est
la singularité - catégorique - de ce virage. C’est ainsi que Holderlin pense la beauté
à partir de l’Un sans concept - à partir de Kant. I1 y pense l’évanouissement même
de l’Un, dont Kant malgré tout voulait toujours accueillir la présence.
[Sai te]
Hypérion, quand il écrit, a certes parcouru les cercles de l’expérience, à la manière
classique - et romantique - des héros de son temps, et à la manière de l’Esprit
hégélien. Mais il ne s’élève pas pour finir au-dessus de cette vie, et ne la quitte pas
non plus. I1 la revit et la survit. I1 est ce qu’il a été : ni un héros, en vérité, ni un
demi-dieu, un homme, un individu proche d u divin (de l’amour, de la Grèce, de la
beauté et de la philosophie), et perdant cette proximité à mesure qu’elle lui advient.
D’où vient sans doute que ce roman, contrairement à tous ses modèles ou
contemporains, a si peu ou si bien vieilli, comme on dit. Hypérion raconte toujours
quelque chose de nos aventures intellectuelles, de nos guerres, de nos amours, de nos
révolutions, de nos retours en Grèce. N e prends pas cela pour la subjectivité d’un
(( jugement littéraire ». La forme d’Hypérion est à tous égards celle de’l’aliégorie
au
sens que Benjamin a su dégager : l’écriture d’un monde de fragments rompus,
renvoyant les uns aux autres sans former de totalité organique, la forme amorphe d u
(( caractère inachevé et brisé de la physis sensible et belle », et la métamorphose des
(( dieux antiques dans leur choséité morte )) (l’Origine da Trauerspiei). Hypérion n’est
pas un (( personnage allégorique »,mais l’allégorie, l’écriture non-une (artificielle, voire
artificieuse pour cela même). L’écriture du désastre comme l’entend Blanchot, et même
comme l’écrit Blanchot : dans sa composition même ce livre est à nouveau, presque,
un Hypérion.
211
Hypérion partage l’erreur, l’incertitude et la faute de tous - la brillante misère,
dont parle Kant, de la culture humaine. Comme tous, il ne fait pas ce qu’il voudrait,
il veut ce qu’il ne peut pas, il ne fait pas ce qu’il dit. I1 quitte Diotima pour une
guerre de libération qui tourne au brigandage :
Et je sais plus d’un Grec de Morée qui parlera plus tard de nos exploits à ses
petits-enfants comme d’une histoire de brigands.
Des bandes sanguinaires surgissent de tous côtés; la violence se déchaîne en
épidémie dans toute la Morée et celui qui ne prend pas l’épée à son tour est
traqué, puis abattu, au nom de notre liberté.
Mais
Cependant, ne te laisse jamais égarer par la compassion. Crois-moi, il nous reste
toujours une joie. La souffrance vraie exalte. Qui fonde sur la détresse, s’élève. Et
il est beau que nous ne commencions à sentir vraiment la liberté que l’âme dans
la douleur. La liberté! celui qui comprend ce mot ... C’est un mot profond, Diotima.
Il n’y a pas ici de réconciliation proprement dite. I1 n’y a, toujours, que ce qui
reste dans le deuil. Ce qui reste est une joie. Cette joie est la liberté. Mais ce mot
n’est compris que du poète - (et) de Diotima. Ce qui veut dire exactement l’inverse
de ce qu’on croit : non pas que la liberté, seul le poète (par privilège des dieux, ou
par génialité) la comprend, mais que celui qui la comprend sera nommé poète (ou
Diotima). Or, qu’est-ce que comprendre la liberté? C’est affirmer seulement ceci :
La loi de la liberté commande, sans nul égard au secours que peut fournir la nature.
Que la nature concoure ou non à son exercice, la loi commande. Elle suppose
plutôt une résistance de la part de la nature, sinon elle ne commanderait point
(Essai La Loi de la liberte?.
Comprendre la liberté n’est pas concevoir (et c’est de Kant, enfin, que provient
la liberté inconcevable, l’inconcevable comme liberté) - ce n’est pas concevoir, mais
recevoir : accueillir et supporter un ordre. C’est ici que le virage catégorique du temps,
de l’homme et de la beauté se fait impératif. Holderlin, malgré tout, malgré sa soif
de poésie comme belle forme - comme avènement de l’Un dans la beauté, comme
philosophie réconciliée -, a tenté de penser (( le poète )) (ce nom importe peu, il est
désormais à contresens : ce poiète ne produit pas. Depuis Holderlin, la poésie n’est
que l’évanouissement d’une production; elle est, ou elle doit être l’ombre ou la
parodie d’elle-même) comme celui qui supporte la loi, et non comme celui qui fait
éclore l’Un. Que celui qui supporte la loi se rapporte à la beauté, cela, Kant ne l’a
pas pensé - il l’a peut-être entrevu, mais il n’en a pas moins subordonné la beauté
à la moralité. Holderlin ne subordonne - à la limite ..., mais il n’est que limite aucune des deux. En les pensant ensemble (et, peut-être, en ne pensant plus ni l’une
ni l’autre comme telles), il pense l’unité qui ne peut faire l’Un. Et sa différence à
Kant s’égale ici à sa différence à Hegel. Aussi est-elle en nous, pour nous, notre
différence à tout notre passé, notre différence à nous-mêmes.
L’Un n’advient pas, parce que la loi commande. Le commandement implique
l’écart, la distance et la dureté. I1 exclut la fusion de celui qui obéit avec celui qui
commande - quelque désir qu’il en ait. Et ce qui commande n’est pas un (( celui )),
n’est pas un, mais - la loi (de la liberté). Nul ne donne l’ordre, quelqu’un le reçoit,
c’est l’ordre d’être un; mais cet un n’advient pas chez celui que définit seulement,
dans son existence limitée, le fait de recevoir cet ordre : factum rationis, disait Kant.
Holderlin pense le poète comme celui qui reçoit l’ordre et le supporte :
2 12
Nommerai-je le H a u t ? Un Dieu n’aime pas l’inconvenant.
Pour le saisir notre joie presque est trop petite.
Souvent il faut nous taire. Ils manquent, les noms sacrés.
Les cœurs battent, et le discours ferait défaut?
Mais une lyre accorde à chaque heure le ton
Et peut-être réjouit les célestes, qui s’approchent.
Prémices ... - et ainsi le souci presque
S’apaise déjà, qui venait sous la joie.
Des soucis, tels, il faut, d e son gré ou non, qu’en l’âme
Les porte un poète et souvent - mais les autres non!
(« Retour »)
I1 faut que les poètes qui sont nés d e l’esprit
Eux aussi soient liés au monde.
(« L’unique )))
Et c’est ppurquoi les fils d e la terre maintenant
Au feu céleste sans péril trempent leur lèvre.
Mais c’est à nous pourtant qu’il appartient
D e rester debout, tête nue, ô poètes!
(« Comme au jour d u repos D...)
Pour nous, Holderlin ne devrait être rien dont nous puissions nous réclamer, ni
autorité, ni modèle, ni oracle (et sa différence à tout notre passé, est aussi différence
au Holderlin de Heidegger, le plus grand pourtant des Holderlin - mais Holderlin
n’est pas (( grand »>.I1 est celui qui nous transmet seulement ceci :
C’est à nous qu’il appartient de rester debout,
tête nue. ..
Ce qui nous appartient ainsi, nous ne le possédons pas, et cela nous fait souffrir.
Cependant, ce qui nous revient ainsi, il faut le redire :
Peu d e savoir, mais de joie beaucoup
est donné aux mortels.
Avec la mémoire et les stigmates de ses malheurs, dans une patrie devenue lieu
d’exil, Hypérion trouve la joie. Mais la joie n’est rien qui se trouve et se ramasse.
La joie est dans le deuil de la joie.
Je vis maintenant à Salamine, l’île d’Ajax.
J’aime cette Grèce-là par-dessus tout. Elle porte les couleurs de mon cœur. Oii
que se tourne le regard, il voit une joie enterrée.
Mais il lui reste encore tant d e grandeur et de grâce.
[...I
Je joue en pensée avec le Destin et les trois sœurs, les Parques sacrées. Mon
être, ayant retrouvé une jeunesse divine, tire une égale joie d e lui-même et des
choses.
Ce qui reste dans le deuil n’est rien de conservé, de réservé ou de relevé. Le
deuil, ici, n’est pas la déploration, qui s’achève, mais la dissolution, qui se répète avec tant de grandeur et de grâce. Ce qu’est la joie d’Hypérion n’est pas indicible :
cela ne cherche pas à être dit, ni à être pensé. Cela se tait, sans se dérober, sans rien
dérober ni retenir. Cette joie est l’a priori de l’apriorité même de l’individuel sur le
tout. Elle e-rt la vie infinie dans une existence limitée : mais cela n’est rien, n’advient
pas, et se déborde. La joie d’Hypérion passe, essentiellement, elle passe parce qu’elle
awive, elle n’est qu’en arrivant - sans advenir.
2 13
Holderlin à Bellarmin
Et sans cesse un désir vers ce qui n’est point
Lié s’élance. I1 y a beaucoup
A maintenir. I1 fant être fidèle.
Laisse-moi maintenant me taire. En dire plus serait excès.
Nous nous retrouverons sans doute.
..................................................................................................................................
................................................................
(Holderlin, seul, écrivant.)
C’est par la joie que tu t’efforceras de comprendre le pur en général, les hommes
et tous les êtres; grâce à elle que tu saisiras tout ce qui est essentiel et caractéristique,
tous les enchaînements successifs; répète-toi dans leur connexion les parties composantes
de cet enchaînement, jusqu’à ce que la perception vivante jaillisse à nouveau de
manière plus objective de la pensée, par la joie, avant que n’intervienne le besoin;
l’intelligence qui ne procède que de la nécessité est toujours biaise.
D’autres fois encore, regardant la mer, je crois revoir ma vie, son flux et son
reflux, ses bonheurs et ses deuils, et entendre ...
..................................................................................................................................
(Bien des années plus tard)
................................................................
Astérion à Sélénion
...lorsque j’étais enfant, déjà, tu me parlais de ce Holderlin ... Peu avant mon
départ, tu m’as encore cité des phrases - tu les appelais des vers - qui parlaient de
feu céleste, et de dieux détournés. C’est si loin dans ma mémoire, si vite disparu,
comme l’image de la Terre. Pardonne-moi, l’espace est si vaste, et la navigation
délicate.. .
Sélénion à Astérion
Justement, je devine le ciel immense autour de toi, et je l’entends, lui. Je devine
le ciel où les astres s’acheminent tandis que tu te confies à la fidélité aveugle de ton
vaisseau. Lui aussi, Bellarmin me l’avait appris, lui aussi aimait à contempler l’honneur
des seigneurs du ciel, et la buée d’or sous les pas du soleil. O u bien, toujours, la
lune secrète, et la nuit comblée d’étoiles.
Astérion
Sélénion! tu me rappelles une autre phrase, que tu répétais parfois, une phrase
étrange. (( Le ciel étoilé au-dessus de ma tête ... », et puis je ne sais plus, la loi, ça
parlait d’une loi.. .
2 14
Sélénion
Ce n’était pas lui, c’était un autre, presque le même, peut-être, mais un autre.
Bellarmin m’écrivait ... Je lui demandais de me parler de ces deux-là, du poète et du
philosophe ... I1 revenait toujours à Hypérion ... I1 craignait que la philosophie ne
puisse pas affronter la froide nuit des hommes ...
Astéri on
Que dis-tu, Sélénion? Je t’entends mal. Attends, que je règle ... peut-être le relais
du satellite...
Séiénion
Non, non, Astérion. Je murmurais, j’oubliais de parler devant le micro. Tu
m’entends?
Astérion
Je t’entends à nouveau. Que disais-tu? N’as-tu pas dit
ressemble au mien. Qui est-ce? J’ai oublié.
((
Hypérion ». Ce nom
Sélénion
C’était quelqu’un comme toi, en un sens, toujours parti, toujours au loin.
Tellement qu’on ne voyait pas de fin à son histoire. Un signe, tout au plus, et
nul de sens. Est-ce que tu continues son histoire? Je ne sais pas, je ne le crois pas,
mais qui suis-je pour dire cela? Je suis bien vieux pour toi, Astérion, je suis trop
vieux, et comme à toi, au fond, ils me sont devenus étrangers et morts, les esprits
bienheureux dont nous parlons. Sans eux, pourtant, comment gagner l’abîme?
Astérion
Comme tu es sombre, Sélénion! Plus sombre que le ciel que je traverse, si
largement ouvert de partout que ce n’est plus un ciel, plus sombre et plus obscur
aussi, si tu me permets! Mais imagine donc cette envolée, cette embardée hors des
routes mêmes du ciel, la pesanteur abandonnée, et les étoiles sous mes pieds autant
que sur ma tête, les étoiles toujours plus proches et toujours si lointaines ...
Sélénion
C’est cela même, Astérion, elles sont toujours aussi lointaines. Il le savait, lui,
il savait déjà traverser les espaces - avec tant d’impatience! - dans ce silence où la
Nuit se referme. Les étoiles chez lui sont,partout. ‘On pourrait dire aussi : partout,
les étoiles sont chez lui, et le calme de 1’Ether.
215
Astérion
I1 n’y a pas d’éther, Sélénion, tu le sais bien. I1 y a la lumière, à peine celle
qui éclaire, mais le sujet du verbe (( se propager avec la vitesse de la lumière », et
plus tard, peut-être, un autre vaisseau, capable de cette vitesse... au moins, des vitesses
formidables, et des traversées sublimes.. .
Sélénion
Le ciel en sera-t-il moins infiniment ténébreux, et les dieux moins retirés? Y
aura-t-il moins à entendre, et moins de mal à comprendre? I1 disait : (( Mais là-haut,
la lumière, encore de nos jours, parle aux hommes. )) Tu dis qu’elle ne parle plus,
qu’elle se propage seulement.. .
Astérion
Je ne dis pas cela! Je voulais dire au contraire qu’on saura mieux que jamais
qu’il ne se peut voir rien d’immortel au ciel - tu me le disais aussi, Sélénion, et cela
n’est-il pas notre joie? Oh! viens! que nous voyions l’Ouvert...
(Au retow d’Astérion sur la tewe, Sélénion était mort, trèJ dgé. Astérion j t graver sur
son urne funéraire : N Là-bas, devant la pacijque iune, je m’en irai.)
Jean-Luc Nancy
Les lumières,
la France
Le meurtre de l’histoire
Jacques D’Hondt
Perdus dans les brumes d’un présent énigmatique, nous tentons parfois de
recourir à l’exemple et à l’enseignement du passé. Là encore, cependant, il nous faut
errer en cherchant. Cette recherche devient émouvante quand elle retrouve les efforts
d’un penseur ancien qui, obéissant à une même exigence, implora, en d’autres temps,
un secours semblable. L’émotion atteint le comble lorsque l’on voit cette inquiétude
s’incarner dans le poète le plus profond, Holderlin! Nos yeux fascinés ne se détachent
plus de ce regard diversement étrange.
Doutes
Dans les (Etlures compiètes de Holderlin, éditées soigneusement par Frédéric
Beissner, figurent quelques pages plus surprenantes encore que d’autres, et dont le
titre, déjà, inquiète : (( Communisme des esprits D (« Communismus der Geister »).
O n s’interroge sur leur authenticité, sur le sens de leur contenu, sur la pertinence
de ce titre : incertitudes si grandes que beaucoup d’interprètes optent selon l’humeur
et font, soit comme si elles étaient évidemment de Holderlin, soit comme si elles
n’étaient évidemment pas de lui. Frédéric Beissner, prudent, les range sous la rubrique :
douteux (Zweifielhafies) 2 !
C’est Franz Zinkernagel qui, le premier, publia ce texte, en même temps que
des poèmes encore inédits, dans la revue Netle Scbweizer Rtlndscbau, en 1926, sous
l’enseigne : (( Nouvelles trouvailles holderliniennes )) 3.
1926! cette date tardive témoigne assez de la négligence dont les manuscrits de
Holderlin furent longtemps victimes. O n sait qu’il mourut en 1843 : son héritage
littéraire subit le même sort que celui de son ami Hegel. Les Écrits tbéol0giqtle.i du
jetlne Hegel - si mal nommés - ne furent édités par Noh1 qu’en 1907, soixante-seize
’
2 19
ans après la mort d u philosophe, plus de cent ans après la date de leur rédaction.
O r ils peuvent contribuer, dans une certaine mesure, par comparaison, à éclairer le
sens d u (( Communisme des esprits )) de Holderlin. Beaucoup de manuscrits de Hegel
et de Holderlin, dont l’existence fut attestée à certaines époques, sont, depuis,
irrémédiablement perdus. I1 faut commenter et expliquer plus difficilement, sans eux,
ce qui reste.
Zinkernagel n’élève aucun doute sur la validité de sa (( trouvaille N tardive et il
souligne son importance : (( Les tentatives que le poète effectue en ce qui concerne
deux thèmes d’histoire spirituelle sont sans aucun doute plus importantes »... I1
rappelle à ce propos les projets d’éducation et de culture populaires qui étaient
communs à Holderlin et au Hegel des Écrits théologiqzres, alors qu’ils étaient ensemble
élèves de la fondation protestante de Tübingen, le fameux Stgt, et il précise : (( Dans
cette esquisse et dans cet essai de rédaction d’un dialogue romancé, nous détenons
peut-être le condensé du domaine de pensée qui hantait alors Holderlin. N
L’occasion de cet essai de Holderlin est une promenade que les deux condisciples,
accompagnés sans doute d’autres camarades, firent un jour de novembre 1790. Ho1derlin l’avait annoncée dans une lettre à sa sœur : ((Je vais faire une promenade à la
chapelle de Wurmlingen, avec Hegel qui est dans la même chambre que moi 4. ))
La chapelle de Wurmlingen, célèbre lieu de pèlerinage et d’excursion, a été
chantée par de nombreux poètes allemands, en particulier par Uhland. Comment
a-t-elle pu suggérer une méditation sur le a communisme des esprits B ?
Aux yeux de Zinkernagel, l’idée principale du texte concerne les projets académiques, l’intention d’éducation qui animent les meilleurs esprits, en Allemagne, à
cette époque. O n songe à cette Gelehrienrepublik dont rêve Klopstock, l’inspirateur
privilégié du jeune Holderlin. Lessing, Wieland, s’enchantèrent eux aussi de semblables
utopies. Une telle conformité à l’esprit de l’époque inciterait à croire en l’authenticité
holderlinienne du (( Communisme des esprits ».
Pourtant, Beissner le tient pour (( douteux ». O n pourrait ajouter : douteux en
plus d’un sens! Douteux parce que Beissner craint qu’il ne soit pas vraiment de
Holderlin. Douteux aussi parce que la doctrine qu’il porte laisse d’abord les lecteurs
dans la perplexité. Et douteux encore parce que la manière même dont Beissner le
met en doute suscite à son tour des réserves.
Beissner justifie sa méfiance dans une note :
On a aussi recueilli, dans les dossiers Holderlin de Christophe Schwab, quelques
pages écrites de sa mairi [i. e. la main de Schwab]... et qui contiennent plutôt ses
propres essais que des copies de poésies holderliniennes [...]. Dans le même dossier,
il y a aussi quelques pièces en prose, dont il convient de contester la paternité
holderlinienne [...I. On a reproduit ici le texte de trois d’entre elles >.
Le travail d’édition et de commentaire effectué par Beissner appelle la reconnaissance et l’admiration. La tâche ne manquait pas de difficultés! Toutefois, en ce
qui concerne ce texte particulier, on ne peut éviter quelques questions.
Comment se fait-il que Beissner, pour justifier le qualificatif de (( douteux »,
accumule les considérations qui devraient faire passer le texte pour inauthentique, et
qu’il n’avance aucun argument favorable à l’authenticité?
Les motifs de rejet sont matériels, philosophiques, stylistiques :
[...I La présentation extérieure du manuscrit, et déjà la manière dont le titre est
placé, excluent que Holderlin en soit l’auteur, pour ne même pas parler de
l’invraisemblance qu’il le soit du point de vue du style. La simple annonce, dans
une lettre de la période de Tübingen, qu’« il va faire une promenade avec Hegel
à la chapelle de Wurmlingen, d’où l’on a une vue si célèbre », ne peut évidemment
220
pas servir de contre-argument, aussi peu d’ailleurs que l’indication donnée par
Goethe, presque sept ans après, selon laquelle celui-ci croyait avoir remarqué chez
Holderlin a une certaine inclination pour It. Moyen Age n (Lettre à Schiller du
23 août 1797) ‘.
Beissner traite sans doute un peu légèrement ces N contre-arguments )) éventuels.
C’est son droit.
Mais puisqu’il conclut, en fin de compte, à l’inauthenticité, pourquoi publiet-il le texte dans les CEuvres complètes de Holderlin? Le faux ne se confond pas avec
le douteux.
S’il est vraiment (( exclu )) que Holderlin soit l’auteur du (( Communisme des
esprits »,si l’on ne peut imaginer aucun argument en faveur de l’authenticité, pourquoi
donc l’éditeur, en présence de plusieurs pièces de prose issues du N dossier Holderlin »,
a-t-il retenu celle-ci et en a-t-il écarté d’autres? Pourquoi l’admet-il, bien qu’en la
disqualifiant partiellement sous le titre douteux? Quel critère fonde ce choix? En
bonne logique, Beissner aurait d û laisser choir ces pages dans les œuvres complètes
de Christophe Schwab!
Or il ne l’a pas fait. En dépit de tous les arguments philologiques contraires, il
a bien senti - mais il ne l’avoue pas! - que Holderlin était pour quelque chose en
cette affaire : le contenu du texte porte une coloration holderlinienne ...
O n concédera volontiers à Beissner que ni l’écriture ni la mise en pages (il en
est bon juge!) et encore moins le style ne semblent être de Holderlin, pas plus
d’ailleurs que de Hegel. Mais un troisième compagnon a pu prendre la plume, au
nom de tous, pour rendre compte d’une conversation effectivement tenue. Le projet
de dialogue met d’ailleurs en scène quatre interlocuteurs.
Christophe Schwab, qui a glissé ces feuillets dans un N dossier Holderlin », savait
peut-être ce qu’il faisait. Premier éditeur des œuvres de Holderlin après la mort de
celui-ci ’, il connaissait les difficultés et les pièges d u travail de publication, il ne
confondait pas habituellement les auteurs les uns avec les autres. I1 y a du Holderlin
dans ce texte, même si c’est Schwab qui l’a recopié, ou restitué.
La contestation élevée par Beissner gagnerait en force probante si elle pouvait
assigner au texte une autre paternité que celle de Holderlin. Beissner suggère que
l’auteur est Schwab lui-même, dont on peut du moins reconnaître l’écriture B.
Cette hypothèse est pourtant difficilement soutenable. Schwab a vécu de 1821
à 1883. O n ne peut guère l’imaginer capable d’écrire quelque chose de ce genre
avant l’âge de vingt ans, soit vers 1840. Déjà du point de vue de l’écriture, on se
demandera si l’on orthographiait encore couramment à cette date Jeyn avec un y, et
Cornmunismus avec un c, comme il en va dans le manuscrit.
Mais l’apparition fatidique de ce dernier mot est décisive. Beissner indique que,
à son avis, le titre (( Communismus der Geister )) a été (( ajouté ultérieurement et
glissé en une petite écriture serrée sur le bord supérieur de la feuille ».
L’emploi d u mot communisme peut ici prêter aux malentendus les plus graves.
Gardons-nous de le prendre au sens plus précis et particulier que lui a conféré l’œuvre
de Marx, et encore moins au sens polémique que lui ajoute l’actualité politique de
la fin du xx‘siècle!
Admettons que, comme nous le croyons, ce texte date de la fin d u XVIII‘ siècle.
Alors ce mot communisme sonne d’une manière bien étrange. Son usage, exceptionnel,
n’est pas encore fixé. O n peut l’appliquer, à l’époque, à des objets de pensée divers,
et aussi, par exemple, à une communauté d’esprits ou à une communion spirituelle.
En même temps il suggère, comme nous le verrons, une sorte d’égalitarisme, une
utopie communautaire semblable à celles qui florissaient sous d’autres noms, en cette
fin de siècle.
22 1
Alors, si l’on crédite Holderlin, ou Hegel, ou l’un de leurs amis, de la dotation
de ce titre au texte, il faut bien admettre que l’on assiste à une sorte de grande
première allemande, et même à une grande première mondiale : jamais auparavant
le mot communisme n’avait été utilisé en ce sens! I1 ne prendra de l’essor que dans
certaines œuvres de Restif de La Bretonne, aux environs de 1795. Après avoir rappelé
le rôle de Restif dans ce lancement, Jacques Grandjonc, dans un article fort bien
documenté et très instructif, donne cette précision intéressante :
I1 faut noter cependant,pour être complet un emploi antérieur mais non diffusé,
pour cause de secret d’Etat, de. Kommtlnismus dans un des nombreux volumes infolio où sont consignés les procès-verbaux d’interrogatoired’Andreas Riedel, jacobin
viennois, qui déclare, de ses théories et de celles de son ami Franz von Hebenstreit,
que (( si le terme existait », il les qualifierait de (c Hebenrtreitismcls Oder Kommtlnismtls l o .
Jacques Grandjonc n’indique pas la date de ces interrogatoires, mais ils ne
peuvent qu’être postérieurs à 1790, après la promenade à la chapelle de Wurmlingen
- et, dans la déclaration du jacobin Riedel, nous remarquons déjà le K du mot
Kommanismas. En France, il faudra attendre 1839 pour que le mot commanisme
réapparaisse, en ce sens, dans les écrits de Lamennais.
Ces constats, et les conséquences qui s’en déduisent, permettent de forger
l’hypothèse d’une grande innovation linguistique due à Holderlin lui-même ou au
cercle de jeunes esprits réunis autour de lui. Rien n’interdisait alors d’appliquer ce
terme à l’image d’une communauté spirituelle doublée de l’utopie imprécise et précaire
d’une communauté des biens.
Par contre, vers 1840, lorsque Schwab parvient à la maturité, un tel usage du
mot est devenu tout à fait impossible. Qui donc, à cette date, aurait pu songer à
appliquer le mot commanisme à la méditation suscitée par le paysage de la Warmlinger
Kapelle? I1 avait pris désormais une teinte politique révolutionnaire, il désignait a le
spectre qui hante l’Europe »,il devenait pour un vaste public l’annonce d’un dangereux
avenir, il ne convenait plus au contenu du texte publié sous ce nom par Beissner.
Ce contenu remarquable, bien situé dans le contexte culturel de l’extrême fin
du X V I I I ~siècle, ou même des premières années du X I X ~ ,serait tout à fait anachronique
vers 1840 ou 1850. I1 ne peut guère être objet de méditation que pour de jeunes
penseurs, tels que Hegel et Holderlin, qui, dans le retard politique et social de
l’Allemagne et du Wurtemberg où ils vivent, se posent des problèmes nouveaux en
termes archaïques, mêlent les termes religieux aux thèmes nationaux ou politiques,
évoquent des idées inouïes dans un décor suranné. En 1840, on ne caresse plus le
rêve d’une <( nouvelle académie N ou d’une (( république des lettres ». Les idées, les
images, et certains mots d’un texte suffisent à le dater. D’autres indices permettent
de confirmer.
Le titre du texte, qui nous surprend, conviendrait aussi bien à des fragments
hégéliens de la période de Tübingen. Hegel et Holderlin poursuivent alors ensemble
une réflexion très caractéristique dont les échos se font entendre dans le (( Communisme
des esprits ». L’emploi du mot esprit nous avertit assez : qui donc, si ce n’est Hegel,
traite alors de manière privilégiée, et presque obsessionnelle, des (( esprits )) des peuples,
des (( esprits )) des religions, des (( esprits )) des époques historiques?
Le commzlnisme des écrits
Beissner concentrait toute son attention, comme il le devait, mais peut-être trop
exclusivement, sur l’apparence objective des textes dont il avait à apprécier l’authen-
222
ticité factuelle. Beaucoup de lecteurs n’éprouvent pas le même souci, et ne s’assignent
pas la même tâche. Que leur lecture ait précédé la publication des CEuvres de Holderlin
par Beissner, ou qu’elle en bénéficie au contraire en y puisant une garantie jugée
suffisante, ils ne se sont pas posé la question de l’authenticité. Par exemple, Rudolf
Leonhard évoque le (( Communismus der Geister )) comme appartenant, sans autre
réserve, à l’œuvre d u poète ”.
Théodore Haering, lui, publie son livre célèbre, Hegel, sein Wollen und sein
Werk, premier volume, en 1929, trois ans seulement après la <( trouvaille )) de
Zinkernagel (1926). N’a-t-il connu le texte que dans cette présentation? Sans même
s’inquiéter de son authenticité, il affirme d’emblée que deux des personnages annoncés
au départ du dialogue, Eugène et Lothaire, sont (( sans aucun doute )) (zweqellos)
Hegel et Holderlin 1 2 . Ce zwefellos contraste comiquement avec le zweifelbafi de
Beissner.
Ce qui frappe Haering, c’est évidemment la communauté d’inspiration du
(( Communisme des esprits )) et de nombreux écrits du jeune Hegel, qu’il connaît
parfaitement. C’est Z’inspiration de ces écrits divers qui est authentique, commune
aux deux Stifiler et à certains de leurs condisciples.
L’écriture ne fait pas grand-chose à l’affaire. Qui a recopié? Qui a pris le premier
la plume pour coucher sur le papier des pensées surgies dans une conversation
mémorable ?
(< Le plus ancien programme de l’idéalisme allemand », que l’on attribue parfois
à Holderlin, nous est parvenu dans l’écriture de Hegel 1 3 . Maintes lettres de Holderlin,
par exemple le brouillon de celle qu’il adressa à Bohlendorff en novembre 1803,
n’existent que dans des transcriptions, et, dans ce cas particulier, cette transcription
est due à deux copistes : Schlesier et Schwab 14!
Hegel, Holderlin, Schelling et leurs amis se souciaient peu, dans leur jeunesse,
de déterminer la part qui revenait à chacun dans l’élaboration d’une pensée nouvelle,
qu’ils voulaient universelle. Ils travaillaient en commun, élaboraient en commun leurs
projets, leurs essais, ne distinguaient pas le (< mien )) du << tien ». Ce désintéressement
ne durera pas, ou deviendra affectation. I1 caractérise une période de formation, alors
que chacun d’entre eux ne s’est pas encore véritablement trouvé. I1 concerne des écrits
qui ne manquent certes pas pour autant d’intérêt. En lui se manifeste déjà discrètement
une des formes d’un (( communisme des esprits v qui ira jusqu’à l’anonymat des
œuvres.
I1 n’y a pas là simple négligence, ou juvénile légèreté. Ce goût de la recherche
et de la création en commun se rattache à des orientations philosophiques profondes,
et caractéristiques de l’époque. L’œuvre n’appartient ni à l’un, ni à l’autre, ni à
personne. Elle émane, en dernière instance, d’un esprit impersonnel, supérieur, le seul
créateur véritable. Cette vision du travail intellectuel relève d’un panthéisme diffus,
d’un romantisme naissant, d’un idéalisme échevelé, et elle entre en contradiction,
chez les mêmes hommes, avec les visées individualistes de l’émulation, de la compétition, de la concurrence. Ce (< communisme des écrits », si l’on ose lui donner ce
nom, témoigne de l’esprit du temps.
Il se manifestera encore dans les dernières lignes de la Prqace de la Phénoménologie
de Hegel :
1.a part q u i , dans l’œuvre totale de l’esprit, revient à l’activité de l’individu ne
peut être que minime. Celui-ci doit donc comme la nature de la science l’implique
déjà, s’oublier d’autant plus 15...
L’effacement du sujet individuel s’annoncera, parfois, plus tard, sur un ton
prophétique. Ainsi dans ce Tableau littéraire de la France au X V I I I ‘ siècle, qui date
de 1808, et qui reste exemplairement anonyme :
223
Peut-être viendra-t-il une époque où il n’y aura plus de grands hommes, où les
progrès individuels se perdront dans les progrès collectifs, où rien ne tranchera
dans la masse éclairée; et cependant cette époque, si jamais elle arrive, sera
certainement la plus honorable pour l’espèce humaine, car ce sera celle où il y
aura le plus de grandeur et de véritable dignité 1 6 .
Fort éloigné d’une telle extrémité, Holderlin n’avait-il pas pourtant avoué, un
jour, qu’il n’éprouvait plus d’attachement pour les grands hommes?
En adoptant l’attitude la plus prudente, trop craintive sans doute, et en se situant
encore à un haut degré de méfiance, certainement excessive, on doit d u moins, à
propos du (( Communismus der Geister n, se rallier à l’estimation minimale proposée
naguère par Yvon Gauthier : a Bien que ce fragment soit considéré comme douteux,
on peut penser qu’il exprime fidèlement les idées de Holderlin ”. ))
La cultwe popduire
Quelles sont donc ces idées qui s’annoncent dans le Communisme des esprits ))
et qui appartiennent en commun à Holderlin et à Hegel, pendant leur ((période de
Tübingen »?
Ils éprouvent tous deux le sentiment douloureux que leur peuple dort et se
désagrège, pendant que le peuple français, dans son éclatante Révolution, se réveille
et se rassemble vigoureusement. Idéalistes, ils reconnaissent en l’esprit seul la source
de toute activité, de toute efficacité. L’esprit d’un peuple et d’un temps, à la fois
Volksgeist et Zeitgeist, végète souvent dans une sorte d’inconscience : il s’agit de le
réveiller, de lui faire prendre conscience de soi, de le révéler à lui-même et de le
former. Le peuple français, tout au long du X V I I I ~siècle, a été alerté et exhorté par
de grands esprits. C’est la tâche des intellectuels allemands que d’accomplir à leur
tour la même opération auprès de leur peuple, et au bon moment. Chez le jeune
Holderlin et chez le jeune Hegel, ces projets prennent une ampleur extraordinaire et
deviennent, pour un temps, la source principale de leurs méditations et de leurs
œuvres.
C’est cette inspiration qui frappe d’abord l’attention des lecteurs du (( Communisme des esprits ». Ils y retrouvent les mêmes intentions que dans les Écrits théologiques
du jeune Hegel.
Les deux jeunes esprits unissent constamment les plans de formation de la
conscience populaire nouvellement éveillée et les projets d’institution d’une religion
populaire (Voiksreiigion), capable d’inspirer aux Allemands une mentalité (Gesinnung)
d’effort, de vitalité, d’énergie : car tout cela n’est invoqué qu’en vue de l’action. Ce
qui leur importe, dans la religion nouvelle dont ils rêvent, et dans la culture nouvelle
qu’ils élaborent, c’est l’aptitude à susciter l’action, dans un peuple qu’ils estiment
(( inerte )) quand ils le comparent au peuple français.
Quand Eugène, donc, dans notre texte, imagine le <( puissant esprit )) qui devait
inspirer la religion du Moyen Age, subjectivement, pour qu’elle produisît toutes ces
œuvres de l’esprit, ces œuvres humaines, cet (( esprit objectif )), ces champs cultivés,
ces monastères, ces cathédrales, cette confiance et cette obéissance des foules rurales
et urbaines - c’est comme s’il proposait l’exemple, pour une fois autre que la religion
grecque, de ce que devrait être, en des termes modernes, la religion dont il éprouve
actuellement le besoin. C’est aussi le sentiment de Hegel. Comme le dit Jean
Hyppolite, a Hegel insiste sur le caractère essentiel de cette religion qui est d’inspirer
l’action lx». I1 convient de fournir aux citoyens, par la religion, des motifs intérieurs
224
d’agir qui soient conformes à leurs obligations civiles et juridiques extériezlres. Hegel
propose clairement cette vue de la religion :
I1 faut que les institutions (Anstalten) religieuses agissent (wirken) directement sur
les motifs de détermination de la volonté 1 9 .
Notre texte rappelle qu’au Moyen Age des institutions semblables (c ühnliche
lnstituten .v) agissaient (wirkten). C’est à peu près le même vocabulaire, exprimant la
même vision des conditions profondes de l’activité humaine.
Cette manière d’envisager la religion seulement par rapport aux effets qu’elle
est capable de produire dans la réalité objective (des actions, des œuvres, des
bâtiments!), et non pas seulement dans la pure intériorité spirituelle, caractérise le
point de vue commun de Holderlin et de Hegel, à cette époque de leur vie.
Les anciens ordres religieux qui, au Moyen Age, remplirent cette fonction et
rendirent ce service, ne Reuvent plus renaître. De toute manière, les deux luthériens
ne souhaitent pas une telle résurrection. I1 convient donc d’inventer d’autres institutions
qui puissent prendre le relais. A une époque où les (( lumières )) et les a sciences ))
semblent triompher, il ne peut s’agir que d’instituts scientifiques, d’académies, d’une
nouvelle académie )). L’illusion que le monde humain sera changé par l’instruction
et l’éducation fascine le X V I I I ~siècle finissant. Que cette éducation et cette instruction
s’imprègnent de religion, ni Hegel ni Holderlin ne sauraient en douter. Pour eux, la
religion luthérienne évoluée, où l’on ne distingue ni prêtres ni laïcs, se confond avec
la science accomplie, et surtout avec la philosophie. O n songe, à cet égard, aux
affirmations ultérieures de Hegel : a Nos Universités sont nos églises », et à sa thèse
constamment soutenue : a Quand le monde de la représentation est révolutionné, la
réalité ne peut se maintenir telle quelle 20. ))
La référence et la révérence au christianisme du haut Moyen Age, comme exemple
de religion vivifiante, animatrice, unifiante, ne doivent pas plus étonner chez Holderlin
et chez Hegel que, plus tard, chez Auguste Comte.
Le modèle médiéval
Pourtant, ce recours au Moyen Age suscite d’abord une gêne, car on connaît
l’aversion de Hegel pour cette période de l’histoire. Dans sa Philosophie de l’histoire,
il la charge de tous les péchés. Dans la Phénoménologie de I’esprit, il la néglige presque
totalement.
Comment pourrait-il s’être exercé, en compagnie de Holderlin, à une apologie
du Moyen Age? N e témoignent-ils pas tous deux d’une préférence fanatique pour
l’Antiquité grecque?
En fait, ce point n’offre pas de difficulté. I1 faut tenir compte de la date. A
Tübingen, ni Holderlin ni Hegel ne manifestent à l’égard du Moyen Age le mépris
et la réprobation dont ce dernier plus tard l’accablera. Ce fait, d’ailleurs, n’a. pas été
pris assez en considération, et il faudra bien tenter d’expliquer, un jour, le revirement
de Hegel.
I1 convient d’ailleurs de ne pas négliger autant que le souhaite Beissner, cette
indication de Goethe, en 1797, selon laquelle il aurait remarqué chez Holderlin (( une
certaine inclination pour le Moyen Age 2 ‘ ».
Souvenons-nous, en effet, que (( le triumvirat Holderlin-Hegel-Schelling et
quelques-uns de leurs amis se réunissaient aux jours dits Aldermanstage. Aldemanstage
225
et Aldermansfreunde rappellent l’esprit corporatif d u Moyen Age [...I. Dans ces séances,
les amis échangeaient leurs idées sur une société nouvelle qu’ils croyaient proche, le
Royaume de Dieu 22 )).
Certes, il n’est pas toujours facile de démêler ce qu’il entre de sérieux et de
ludique dans le comportement de jeunes étudiants. Ceux-ci, toutefois, avaient tendance,
trop tendance peut-être, à se prendre au sérieux. Quand, plus tard, dans leurs lettres,
ils se remémoreront mutuellement leur engagement pour le Royaume de Dieu, ce ne
serait pas pour rire!
Leur inclination éventuelle pour le Moyen Age n’aurait rien eu d’exceptionnel,
à Tübingen, en ce temps-là. Les voyages, les lectures, la découverte des aspects
déplaisants de la vie moyenâgeuse l’atténueront plus tard. Mais dans leur Wurtemberg
natal, elle s’enracine dans une tradition et se conforte dans une ambiance favorable.
Ici, en effet, les gens se réfèrent communément aux droits dont avaient joui !curs
aïeux. Cette nostalgie se réveillera à nouveau, en 1817, lors de la session des Etats
de Wurtemberg, et Hegel la critiquera, en cette occasion, au nom d’un réformisme
moderniste audacieux. Sans entrer dans le détail de l’histoire Souabe, il est utile de
rappeler que les principaux écrivains souabes avaient magnifié la période médiévale
de leur pays, un passé de liberté et d’indépendance qui leur restait au cœur comme
un regret. Charles Philippe Conz, le guide et l’ami de Holderlin et de Hegel, au
Stifi, avait composé un drame, Conradin von Schwaben (1782) et un traité Sur I’esprit
et l’histoire de la chevalerie dans les temps anciens (1786). Holderlin consacrera luimême un poème à Konradin, et magnifiera le Moyen Age Fn des œuvres diverses,
comme, par exemple, dans Die Dehmut 2 3 ou dans Die Tek. Evoquant les légendaires
coutumes et leur valeur symbolique, la parole du chevalier, son salut, sa poignée de
main, gages d’intégrale confiance dans les relations humaines, Holderlin mettait en
garde ses compatriotes :
Malheur! Malheur! murmurent dans la tourmente les esprits de jadis,
L’honnête et pure coutume de la Souabe est bannie!
............................................................................................................
Mais non! Elle n’est pas tout abolie, la loyale coutume,
Elle n’est pas tout abolie au paisible pays de Souabe 24.
Sont-ils des (< assassins », ceux qui laissèrent pratiquement évincer ou éliminer
les mœurs anciennes, et qui se présentent ainsi démunis devant les ruines archaïques?
Holderlin et Hegel ont d’abord partagé l’estime rétrospective que leurs contemporains accordaient au Moyen Age. Elle n’exclut pas l’admiration pour l’Antiquité
grecque, qui se manifeste même dans le (( Communisme des esprits )) : (( Quand il
me fallait quitter le libre éther de l’Antiquité pour revenir dans la nuit du présent »...
Ce rappel aide à mieux comprendre le sens de cet essai de dialogue. Comme il
y est précisé, il ne s’agit pas, ici, d’un respect, d’une admiration pour le contenu, la
U matière )) du Moyen Age. Les romantiques, eux, afficheront cette nostalgie et voudront
restaurer ce contenu aussi intégralement que possible : cette <( matière »,ces cathédrales,
ces mœurs, cette vassalité, ce costume. Les Burschenschafiler 2 5 les imiteront, sur ce
point, en revêtant des oripeaux surannés, ridicules.
L’intérêt que Holderlin et Hegel portent au Moyen Age, dans leur jeunesse, a
un tout autre sens. Leur nostalgie n’est plus ce qu’elle était chez d’autres. Ils ne
songent à rien moins qu’à restaurer le Moyen Age. Dans le (( Communisme des
esprits », Holderlin vante uniquement la forme dans laquelle et grâce à laquelle le
contenu, à une certaine époque, est advenu. C’est la manière de l’advenir, qui
l’intéresse : ce Verden im Vergehen, ce (( devenir dans la disparition )) qu’il tentera
d’élucider dans un autre essai 2 6 .
2 26
Comment utiliser la forme d’un dynamisme, efficace dans le passé, pour provoquer le surgissement d’un nouveau contenu? Pour Holderlin, la forme peut demeurer, ou renaître diversement, alors que la matière toujours se perd. Matière ou contenu
s’entend ici de l’ensemble des données concrètes qui caractérisent originalement et
irréductiblement une époque historique. Les ordres religieux du Moyen Age ne
reviendront pas, mais la force qui les animait peut se continuer ou se réactiver dans
des institutions différentes, dans une (( nouvelle académie ». Les hommes et les
institutions tombent, le combat de l’esprit continue 2 7 .
I1 s’agit de fortifier, dans des conditions inédites, la créativité spirituelle, de
susciter un nouvel esprit, différent certes de l’ancien, mais analogue à lui par sa
vitalité, son énergie, son unité.
Pourquoi suspecterait-on la sincérité d’un recours au Moyen Age, dans une œuvre
de Holderlin, en 1790? Les circonstances d’ailleurs le justifient et le provoquent : de
la terrasse de la chapelle de Wurmlingen, on n’aperçoit pas les ruines de l’Acropole,
mais bien les vestiges d’un Moyen Age chrétien, (( perdu, perdu à jamais )) et qui, en
son temps, avait fait preuve d’une audace que Holderlin voudrait enseigner à la
Souabe moderne.
L’unité de l’esprit objectif
Ces considérations suffiraient sans doute à attester l’inspiration hégélo-holderlinienne de ce texte.
Pourtant, elles risquent d’en masquer la signification profonde, qui importe
avant tout. O n la manquerait si l’on se contentait de relever, dans le Communisme
des esprits », le thème de l’éducation populaire et de la religion populaire nécessaires
pour requinquer l’esprit et l’activité d u peuple Souabe.
Quand on rapproche ce texte de développements théoriques hégéliens tardifs,
on saisit son caractère prophétique, s’il a été écrit, comme nous le croyons, vers 1790
- ou, au contraire, sa richesse rétrospective, s’il a été rédigé plus tard, comme il est
peu probable.
A dire vrai, les considérations précédentes ne justifieraient que bien précairement
le choix du titre qui a été donné à ce texte, d’une manière ou de l’autre, et par qui
que ce soit. De fait, il porte des idées autrement importantes, et il commande bien
d’autres implications.
L’une de ses idées principales, c’est celle de communauté spirituelle : communauté
de tous les esprits qui vivent dans une même foi, dans un même monde, parce que
cette foi et ce monde expriment un même (( esprit 1) : une communauté d u divers
impliquée dans l’identité du tout.
Cette idée fera son chemin!
Eugène est comme hanté par elle, et il réussit à la proposer en peu de mots et
en quelques images. Elle suppose l’harmonie intérieure d’un monde humain, et, en
conséquence, l’hypothèse qu’il existe des mondes humains différents, dans l’ordre des
simultanés comme dans l’ordre des successifs. Chaque monde détient son identité
propre, il suscite la communion de ceux qui y participent. Toute l’énergie de ce
monde provient d’un centre et se propage à l’infini dans la plus grande variété des
déterminations concrètes. Mais l’énergie centrale N maintient le ton de la mélodie
originaire dans toutes les variations ».
Ce qui importe à Eugène, ce ne sont pas les particularités de ces variations, ni
même la nature concrète de l’esprit qui les domine et les contrôle, mais c’est cette
227
domination et ce contrôle en eux-mêmes, cette unité dialectique de l’unité et de la
diversité, cette aptitude qu’a l’esprit d’une époque (Zeitgeist) à marquer de son sceau
toutes les activités et toutes les œuvres de cette époque.
Dans ses œuvres ultérieures, Hegel restera fidèle à cette commune intuition
première, et il en déduira infatigablement toutes les conséquences :
Il faut tenir fermement à cette idée qu’il n’existe qu’un seul esprit, un seul principe
qui s’exprime dans 1’Etat politique comme il se manifeste dans la religion, l’art,
la moralité, les mœurs sociales, le commerce et l’industrie en sorte que ces diverses
formes ne se trouvent être que les branches d’un seul tronc. C’est là l’idée principale.
L‘Esprit est un, c’est l’esprit substantiel d’une période, d’un peuple, d’un temps,
mais qui se forme de multiples façons
Cette idée se donne une magnifique illustration dans le (( Communisme des
esprits n : un monde culturel unique, le Moyen Age catholique, a été formé par un
esprit nouveau, (( d’une seule coulée )) : K Alles, wie aus Einem Gusse Y, : unité, homogénéité, soudaineté, dans une unité de ton.
Hegel préférera l’unité de couleur : dans la totalité absolue, (( l’une des puissances
est la force la plus grande, dans la couleur et la déterminité de laquelle la totalité
apparaît 2 9 . . .
C’est par l’unité de coloration que Marx, lui aussi, voudra illustrer l’idée qu’« une
unique condition historique enveloppe toute une histoire du monde (eine Weitgeschichte) 3‘) )) : (( C’est comme un éclairage général où sont plongées toutes les couleurs
et qui en modifie les tonalités particulières 3 ’ . ))
Mais qu’importe le choix du mode sensible, pour l’illustration d’une idée, si
les sensations diverses symbolisent entre elles :
Les parfums, les couleurs et les sons se répondent!
I1 y a comme une loi de corrélation des formes historiques, semblable à celle
que Cuvier - autre étudiant de Wurtemberg - établissait, à la même époque, entre
les formes organiques.
Cette thèse selon laquelle chaque monde humain, chaque (( époque )) caractéristique, chaque culture religieuse ou nationale constitue une unité structurée dans
laquelle tous les éléments se soumettent à la domination rigoureuse du tout, fait
l’objet, en notre temps, de controverses ardentes 32.
Ses conséquences soulèvent les passions. L’une d’entre elles se révèle plus décidément meurtrière : si chaque culture détient une identité radicalement différente de
celle des autres, alors elle ne peut apparaître ou disparaître, pour l’essentiel, qu’en
bloc (wie aus einem Gusse!), elle ne peut se substituer éventuellement à une autre
que totalement, sans résidu. I1 n’y a donc plus ni transition, ni héritage, ni continuité
de développement de l’une à l’autre, mais, au contraire, (( rupture radicale ».
Si l’on adopte ce point de vue, et que l’on se remémore une belle culture passée,
on ne peut alors que se sentir ((comme un criminel devant l’histoire ». Entre les
diverses civilisations se creuse un abîme : eine Klufi, comme le dit Holderlin. Plus
rien ne relie l’une à l’autre la culture grecque que Holderlin adore; la culture
phénicienne pour laquelle Hegel éprouvera, avec Volney, une préférence ; la culture
chrétienne moyenâgeuse qu’évoque la chapelle de Wurmlingen : le présent a coupé
ses racines.
En cette affaire, il ne s’agit pas de la destruction des œuvres. Le véritable crime
est bien plus grave. Si les événements considérés relèvent principalement de l’esprit,
comme le croient Holderlin et Hegel, et, donc, en quelque façon, de la connaissance;
si une sorte d’âme anime la totalité, un système d’intelligibilité particulier, une
228
rationalité spécifique, alors, dans cette perspective - fondamentalement idéaliste -, on
ne voit pas comment l’esprit d’une totalité culturelle nouvelle pourrait appréhender
fidèlement l’esprit d’une totalité culturelle périmée. La notion même de péremption
perdrait son sens. On ne saurait ni penser, ni dite le destin des choses déchues. Et
l’on s’interrogerait en vain, avec Holderlin : (( Où est donc tout cela?... Compare ce
temps avec le nôtre, où veux-tu donc trouver une communauté? ))
Qu’est-il donc advenu du christianisme? Quel a été son destin? Voilà les questions
auxquelles Hegel tentera de répondre, bientôt, notamment dans la Positivité de la
religion chrétienne 3 3 et dans I’Esprit du christianisme e t son destin 34.
Mais la réponse à de telles questions, et leur énoncé même, supposent qu’entre
les cultures successives il y ait une sotte de communauté, dont le chercheur précisera
la nature et les modalités, une sorte de (( communisme )) des esprits qui suscitent les
diverses civilisations et définissent les diverses périodes de l’histoire.
Devant la vallée du Neckar s’enfonçant peu à peu dans la nuit du présent
allemand, Eugène a d’abord le sentiment d’un enténèbrement spirituel absolu. En le
provoquant, on ne se comporte pas seulement comme un criminel devant l’histoire,
qui en éliminerait certaines séquences, ou qui trancherait les liens entre les époques
significatives, mais on assassine l’histoire elle-même, car on prive de toute intelligibilité
le surgissement des actions et des événements dans le temps (Res gestae-Geschichte)
comme on en prive aussi leur récit (Historia-Historie).
Pour sauvegarder l’homme, le genre humain, l’histoire, Eugène en vient alors à
proposer une sorte de compromis. Laissons les matériaux morts sombrer dans les
abysses (a ce que cette époque nous a transmis », le (( matériau mort »> et préservons
la forme vivante, la forme universelle de l’humaine activité : l’énergie transformatrice
et créative, l’activité radicale de l’esprit, gage de continuité dans l’innovation, d’identité
et de cohérence dans la diversité. Cela implique que le (( matériau mort )) lui-même
puisse être encore saisi et contemplé, théorétiquement utilisé, révéré en quelque
mesure :
... Vois se pencher les dquntes Années,
Sur les balcons du ciel, en robes surannées ...
Mais cela permet surtout d’appréhender le geste manipulateur de ces figures
éphémères, la source des phénomènes historiques.
Dans ce simple début d’un essai de dialogue, Eugène pose assez clairement le
problème. Son propos cesse trop tôt pour qu’il puisse en proposer une solution
explicite. I1 suggère seulement une issue. Nous nous interrogeons, en général, sur la
manière dont on passe, ou ne passe pas, d’une culture ancienne détruite et dont on
a du mal à restituer le sens, à une culture nouvelle. Eugène, lui, ne se maintient pas
dans une attitude purement théorique, il adopte un point de vue pratique : devant
les vestiges d’une grande culture religieuse et nationale disparue, il se demande ce
qu’il faudrait faire pour instaurer une nouvelle culture religieuse et nationale, aussi
efficace, aussi grande, mais différente. Comment convient-il d’agir pour créer une
Allemagne moderne avec la même énergie qui se déploya dans la cité athénienne, ou
dans le christianisme du haut Moyen Age, ou dans la Révolution française contemporaine. Où puiser cette énergie?
I1 admet donc la réalité d’une communauté humaine, d’un (( communisme des
esprits N individuels, d’une harmonie des existences, dans la belle période chrétienne :
un même esprit national et religieux unissait les Souabes. Et ce constat est important.
Mais il y ajoute toute autre chose lorsqu’il interroge : (( Compare maintenant
cette époque avec la nôtre, où trouveras-tu une communauté? )) Car sa question se
dédouble : (( Où trouveras-tu actuellement, en Souabe, une communauté de même
229
qualité? N et : Quelle communauté y a-t-il entre l’esprit de cette époque passée et
celui de notre temps? )) Quel lien pourrons-nous établir entre cette lumière du passé
et la nuit d’un présent qu’il s’agit d’illuminer?
Le problème est celui du Vergleicbungspunkt : le point de comparaison, le (( fait
comparatif ». Quelles sont les ressemblances et les différences, quel pont pouvonsnous jeter sur l’abîme qui sépare, à première vue, deux cultures et deux époques? La
communauté alléguée, c’est celle qui règne synchroniquement, dans l’ordre des simultanés; et aussi celle qui règne diachroniquement, dans l’ordre des successifs. L’histoire,
pour être, réclame à la fois un (( communisme )) des simultanés et un (( communisme ))
des successifs.
L’esprit de communauté
Hegel et Holderlin vivent dans le déchirement et le conflit, dans l’émiettement
et l’inertie de l’Allemagne. L’espoir d’une réconciliation, d’une réunification, d’une
harmonisation les soutient. Ils rêvent de contribuer activement, par le développement
de la politique et de la philosophie - et Holderlin, de plus, par le développement
de la poésie -, à établir dans leur pays un a communisme des esprits ».
Holderlin voudrait agir, penser, chanter,
Afin qu’un peuple aimé des dieux, dans les bras de l’Ancêtre,
Humainement joyeux comme au temps d’autrefois se rassemble,
Et ne soit de nouveau qu’Un seul esprit commun à tous 35.
I1 souligne : Un seul esprit commun à tous.
En 1799, dans une lettre à son frère, il déplorera (( cette insensibilité pour
l’honneur commun et pour la propriété commune, sans doute très générale chez les
peuples modernes, mais qui, chez les Allemands, atteint à mon avis un degré
suprême j6.
Dans cette même lettre - une sorte de profession de foi -, il assigne à la poésie,
complice en cela de la philosophie et de la politique, la tâche (( de rapprocher et de
réunir les hommes ». Elle doit établir entre eux (( un lien qui se resserre jusqu’à
devenir un tout vivant et profond aux mille articulations 37 ». I1 s’agit d’assurer
l’a harmonie humaine )), ou plutôt de la rétablir, puisque, comme il le dit ailleurs,
(( c’est de l’harmonie enfantine que les peuples sont un jour partis, et l’harmonie des
esprits (die Harmonie der Geister) sera le début d’une nouvelle histoire du monde
(Weltgesrbirbte) jK ».
O n pourrait multiplier les citations de ce genre. Elles attestent la parenté, dans
l’esprit de Holderlin, entre l’Harmonie der Geister et le Communisme der Geister.
De cette harmonie, la Grèce antique, idéalisée, lui fournit le meilleur modèle.
Lorsqu’il cherche à déterminer le point de vue auquel il nous f a u t nous placer pour
observer l’Antiquité N, il souhaite qu’« en ce qui fait le fondement originel de toutes
les œuvres, de tous les actes des hommes, nous nous sentions égaux et unis à tous,
si grands ou si petits soient-ils 37... )).
Avec une insouciante allégresse, il admet que dans (( le monde divin », tout est
commun, (( l’esprit, les joies et l’éternelle jeunesse 4” », et il souhaite (( que chacun soit
comme tous 4 ’ D.
Réconciliation, concorde, harmonie : tous les philosophes, ou presque, n’assignèrent-ils pas ce but au genre humain? Holderlin lui confère des contours plus
<(
230
précis, y insiste davantage, le fait bénéficier d’une actualité ardente, à la fin d u
XVIII‘ siècle.
L’éclairage spinoziste
Le mot communisme, même entendu très vaguement, est-il bien choisi pour
désigner cet idéal holderlinien ?
O n peut légitimement le contester.
Toutefois, en sa faveur, et pour éclairer l’une de ses significations, une pièce
singulière mérite d’être versée au dossier. Elle concerne l’attitude sociale de Spinoza
et le nom que l’on donne à cette attitude.
L’intervention deSpinoza en ce débat n’est pas intempestive. Holderlin et Hegel
le tenaient en haute estime. Hegel participera, peu après l’excursion de Wurmlingen,
à l’édition allemande des œuvres de Spinoza, sous la direction de Paulus qui était
aussi un ami de Holderlin. Hegel ne cessera de proclamer : (( Sans spinozisme, pas
de philosophie! N Holderlin avait lu les fameuses Lettres de Jacobi sur la doctrine de
Spinoza, dont il rédigera un commentaire précisément au cours d u semestre d’hiver 1790179 1. Holderlin et Hegel se réclamaient ensemble d u Hên kai pan, qui passait alors
pour exprimer adéquatement le principe même de la métaphysique spinoziste, une
sorte de panthéisme.
Ont-ils prélevé dans l’œuvre de Spinoza l’une des inspirations de leur doctrine
de la communauté humaine? Quelle est, sur ce point, la pensée de Spinoza?
Alexandre Matheron lui a consacré un grand et beau livre : Individu e t Commanauté chez Spinoza 4 2 .
Significativement, et sans qu’il se réfère le moins d u monde, semble-t-il, à l’essai
de Holderlin, il ne trouve pas d’expression meilleure pour désigner l’idéal spinoziste
que celle de n communisme des esprits! U
Rencontre suggestive! Matheron présente ainsi le projet spinoziste :
Le modèle idéal de la vie sociale, c’est donc l’union de tous les hommes en une
communauté de philosophes-savants qui se donneraient la recherche du vrai pour
but suprême, se transmettraient sans restriction leurs découvertes, et subordonneraient leur vie entière au perfectionnement collectif de l’intelligence humaine. Alors,
vraiment, l’Humanité existerait comme un Individu unique, dont le conatus global
s’exercerait sans entrave ni déformation 43.
Cette communauté humaine ne comporte, de droit, aucune exclusive :
Ce n’est pas seulement avec un petit nombre d’individus privilégiés que le sage
peut former une communauté parfaite : c’est, virtuellement tout au ,moins, avec
l’Humanité dans son ensemble. En soi, la communauté de tous les esprits est
réalisée depuis toujours; il suffit de la révéler à chacun de ses membres 44.
Le but final commande les comportements individuels. L’homme
travaille à la réforme de la cité.
((
généreux
D
Mais ses activités a mondaines »,désormais, se ,subordonnent à une entreprise métahistorique beaucoup plus vaste. Par-delà 1’Etat libéral (( bourgeois )) et l’étape
transitoire de la vie raisonnable interhumaine, il veut instaurer le communisme des
esprits 41.
23 1
L’expression communisme des esprits se voit ainsi choisie pour désigner convenablement l’effort pour (( faire exister l’Humanité entière comme une totalité consciente
de soi, microcosme de l’entendement infini, au sein de laquelle chaque âme, tout en
restant elle-même, deviendrait en même temps toutes les autres D 46.
Défions-nous, certes, des analogies! Mais les ressemblances sont parfois si saisissantes que l’on ne peut s’interdire de les exploiter. Si l’expression communisme des
esprits convient pour désigner la doctrine sociale de Spinoza, elle correspond a fortiori
aux intentions et aux formules du texte de Holderlin.
La communauté des biens
On ne saurait accorder trop d’importance à une indication complémentaire de
Matheron. I1 ajoute, dans une note :
[Le communisme des esprits] impliquerait logiquement, comme le remarque
A.-M. Déborine (Spinoza’s World Vzews, p. 115- 116), le communisme des biens :
si le moi et le toi fusionnaient, la distinction du mien et du ,tien s’abolirait.
Communisme sans lois juridiques ni contraintes institutionnelles : 1’Etatdisparaîtrait
après avoir créé les conditions de sa propre inutilité 47.
A ce propos, le U plus ancien programme de l’idéalisme allemand j, élaboré en
commun par Holderlin, Hegel et Schelling, et conservé dans la rédaction qu’en fit
Hegel, s’exprimera sans détour :
Tout État est obligé de traiter l’homme libre comme un rouage mécanique; et
c’est ce qu’il ne faut pas; donc il doit disparaître 48.
N
Quant au communisme des biens, Matheron rappelle opportunément la
Lettre 44 D de Spinoza. Celui-ci cite Thalès :
Toutes choses [...I sont communes entre amis, les sages sont les amis des dieux,
toutes choses appartiennent aux dieux, donc toutes choses appartiennent aux sages.
Spinoza commente ainsi ces propos de Thalès :
D’un mot donc, ce grand sage se faisait très riche par un mépris généreux des
richesses et non par leur quête sordide. I1 a toutefois montré ailleurs que, si les
sages ne sont pas riches, c’est volontairement et non par nécessité 49.
Holderlin, bien sûr, rattache lui aussi le (( communisme des esprits n au communisme des biens. Dans Hypérion, il lance un mot d’ordre bien proche des formules
de Spinoza, et en même temps fort engagé dans le débat politique d u début du
X I X ~siècle. O n éprouve chaque fois la même surprise à relire ces lignes enthousiastes.
Hypérion converse familièrement avec ses camarades de combat, à la veille de la
bataille décisive. Ils lui racontent leurs destinées diverses et dramatiques. Et lui, il
veut élever les cœurs en évoquant les fins ultimes de la lutte acharnée qu’ils mènent
ensemble. I1 prend la parole :
Alors je me mets à parler des jours meilleurs : leurs yeux brillent en songeant à
l’alliance qui doit nous unir, et la fière image du futur Etat libre se dessine devant
eux.
Tout pour tous, et chacun pour tous! Le feu joyeux qu’il y a dans cette devise
galvanise mes hommes ainsi qu’un commandement divin >”...
232
Devise incendiaire, en effet, que l’on ne saurait confondre avec la banale proclamation de solidarité : (( Un pour tous, tous pour chacun! )) qui, de son côté, ne
manque déjà pas d’importance sociale. L’énoncé holderlinien touche autre chose, et
va loin. (( Tout pour tous )) annonce la maxime saint-simonienne: ( ( A chacun selon
ses besoins. )) Sa signification subversive suscite, en France, l’indignation et la critique
violente des conservateurs.
Certes, le vœu de metttre tout en commun, l’exhortation au partage font écho
à une tradition invétérée : (( Tous les croyants ensemble mettaient tout en commun »,
lit-on dans les Actes des apôtres. Les contemporains de Holderlin prenaient-ils encore
ces paroles au sérieux? O n déteste l’égoïsme; saint Martin coupe son manteau en
deux; dans la disette, les victimes partagent tout (( comme le feraient des frères ». Ce
sont là des mots qui viennent aux lèvres quand les circonstances les requièrent. (( Dieu,
dit Locke, a donné le monde en commun à tous les hommes >’.)) Quel philosophe
n’a pas rêvé d’un retour de 1’Age d’or, de l’enchantement des lles fortanées?
Mais cette communauté reste une idée confuse, lointaine, reflet d’une réalité
inaccessible, Les hommes ne s’y tiennent pas. En général, ils ne souhaitent guère
revenir, ou accéder, à cette situation qui leur paraît étrange, et, quand ils y songent
plus sérieusement, ils se moquent de l’égalité originaire misérable.
Comme le dit Voltaire :
Nos bons aïeux vivaient dans l’innocence,
N e connaissant ni le tien ni le mien.
Qu’auraient-ils p u connaître? Ils n’avaient rien,
Ils étaient nus; et c’est chose très claire
Q u e qui n’a rien n’a nul partage à faire >’.
Précisément, Holderlin ne possède rien : un prolétaire. I1 envisage le partage
avec plus de faveur. Cette idée gagne à cette époque une valeur et une incidence
actuelles, pratiques, programmatiques. Le Cercle social, dont Hegel, d u moins, a bien
connu l’activité, en a fait, à Paris, son projet 5 1 : (( Fraterniser les moyens! )) Brissot,
que Holderlin et Hegel estiment, juge que (( la propriété, c’est le vol »! Un (( sansculottisme )) marginal, mais décisif, anticipateur et intempestif, voué à l’échec, mais
momentanément inquiétant va s’exprimer et se développer en France. C’est lui qui,
paradoxalement, dialectiquement, assurera le succès final de la révolution des possédants.
Dès 1790, et après cette date, le (( partage des biens )) cesse d’être une ritournelle
évangélique ou un propos de table. Le gigantesque conflit social et politique qui
bouleverse la France de manière apparemment chaotique lui confère quelque précision
et accentue son agressivité.
L’expression holderlinienne : (( Tout pour tous »,nous semble maintenant anodine
et inadéquate. Elle n’était certes pas tenue pour insignifiante et inoffensive lorsque
Holderlin l’insérait dans ses œuvres. Pour s’en rendre compte, il suffit sans doute
d’évoquer le commentaire qu’en faisait alors un publiciste bien oublié depuis, mais
qui jouissait d’une grande notoriété auprès de ses contemporains : Adrien Lezay.
Celui-ci publia en l’an IV de la République, donc e n 1795, un petit ouvrage :
De la faiblesse d’un gouvernement qai commence 5 4 .
I1 y déclarait : (( Les hommes qui ne veulent aucun gouvernement sont les
révolutionnaires )), caractérisant ainsi par anticipation, sans le vouloir, Holder$, Hegel
et Schelling qui, en 1796, envisageront la suppression pure et simple de 1’Etat.
Parmi ces révolutionnaires, Lezay distingue une catégorie particulièrement absurde
et dangereuse. I1 attaque avec véhémence ce qu’il appelle (( le droit antésocial de tout
à tous », utilisant ainsi, pour la vilipender, la formule même que Holderlin avait
233
choisie. Lezay estime que les miséreux, les gens dénués de toute propriété sont en
même temps, selon sa classification, les N a-constitutionnels )) et les (( révolutionnaires )) :
(( Ils vivent, dit-il, du principe de tout 2 tous, dans un état de chose où pourtant tout
est à quelqu’un 5 5 )) (c’est lui qui souligne l’expression tout à tous). En eux il dénonce
le plus grand danger pour la république.
I1 n’est pas impossible que Holderlin ait lu l’opuscule de Lezay, ou qu’il ait
connu d u moins l’existence de ce personnage et l’orientation de sa pensée : la revue
Klio avait accueilli certains de ses écrits, or elle était publiée par le grand ami de
Holderlin et de Hegel, Staudlin, celui-là même qui, par l’intermédiaire de Schiller,
procura au poète sa place de précepteur chez Charlotte von Kalb.
Aucun doute, Holderlin savait ce qu’il faisait en glissant ces mots sulfureux
dans son Hypérion.
La tentation égalitariste reste constante chez Holderlin et se manifeste momentanément chez Hegel : la plupart des commentateurs l’ont dissimulée. Elle ne présente
pourtant aucun danger pour notre temps, elle s’exprime en termes confus et surannés,
elle se voit éclipsée par des doctrines récentes. O n reporte injustement sur elle les
craintes - ou les espoirs - du xxesiècle.
Bientôt Hegel, plus réaliste, constatera que (( la propriété est devenue pour nous
un destin », et il en tirera toutes les conséquences doctrinales.
Holderlin, lui, semble rester jusqu’au bout fidèle à un (( communisme des esprits N
qui implique une communauté des biens.
O n connaît l’œuvre de restitution et de réhabilitation de Holderlin que Pierre
Bertaux a menée à bonne fin en France, et qui, depuis quelque temps, impose aussi
ses résultats en Allemagne. I1 s’agissait pour lui de mettre en évidence, entre autres,
le caractère profondément démocratique et révolutionnaire de la pensée politique de
Holderlin. Mais il en découvrait en même temps d’autres aspects. L’allure partiellement
(( communiste N des textes holderliniens ne pouvait échapper à un lecteur aussi vigilant.
I1 est réconfortant de pouvoir en appeler à son témoignage.
Dans son Holderlin, esmi de biographie intérieure, donc en 1936, déjà, Pierre
Bertaux caractérisait ainsi l’attitude politique de Holderlin, et son interprétation de
la Révolution française :
il a suivi le progrès de l’esprit révolutionnaire jusqu’au bout, jusqu’à la proclamation
du partage des biens. Ceci d’ailleurs avec la naïve violence de l’idéaliste qui confond
l’idylle et la guillotine, l’âge d’or et la cité future, les bergeries grecques ou les
agrestes plaisirs du préromantisme et le comité de salut public, Daphnis, SaintPreux et Robespierre 56.
Bertaux en appelle, pour montrer cela, à l’Empédocle de Holderlin, qui fut écrit
de 1797 à 1800. I1 commente ainsi le projet de réforme qu’à cette occasion, et par
le truchement du philosophe antique, Holderlin propose à ses compatriotes, pour
donner à leur Cité une vie nouvelle :
Cette régénération, Empédocle en esquisse le programme positif : un programme
jacobin, et même communiste. Lorsque la société, par ce bain dans le Styx, aura
retrouvé son innocence primitive, le contrat social sera renouvelé sur la base de la
fraternité et du partage.
Bertaux traduit certains vers d’Empédocle qui ne laissent aucun doute sur le but
qu’Holderlin propose :
... Alors tendez-vous les mains
A nouveau, donnez votre parole et partagez les biens,
234
Alors, ô mes amis, partagez les actes et la gloire,
Comme de fidèles Dioscures 57.
Et,
Que chacun soit comme tous! ))
Partagez les biens : Theilt das Gut! Y, Ce communisme des biens s’intègre
profondément au communisme des esprits. Pour l’idéalisme holderlinien, les idées
mènent le monde : c’est le partage des idées qui commande le partage des biens, non
l’inverse. Nous sommes dans cette (( idéologie allemande N dont Marx ridiculisera plus
tard des formes excessives et anachroniques. En 1790, elle est sérieuse et efficace à sa
manière, accordée aux conditions qu’impose l’époque.
((
((
Le panthéisme e t Z’unité du genre humuin
I1 se tisse en effet des liens subtils, devenus presque insaisissables pour nous,
entre l’idéal holderlinien de communauté spirituelle et sociale, d’un côté, et le
panthéisme archaïque d u poète, de l’autre. La présence de ce panthéisme dans la
pensée de Holderlin et dans celle du jeune Hegel ne saurait être contestée, ni la
manière dont ils le rattachaient, entre autres sources et attestations, à la doctrine de
Spinoza. Ce qui est moins évident, et moins connu, c’est le genre particulier de
culpabilisation du panthéisme à laquelle procéderont les premiers adversaires du
communisme et du socialisme modernes.
L’un des premiers textes où apparaisse, en France, le mot communisme est l’article
de Jacques Dupré, (( Du communisme », dans la Revue indépendante, en 1841. Or,
le premier paragraphe de cet article porte bizarrement pour titre : (( Le communisme
est la politique du panthéisme S s N!
Une telle assimilation s’était déjà antérieurement produite à propos du socialisme.
Dans un article, lui-même anonyme, on pouvait lire, en 1831 (l’année de la mort
de Hegel) :
L’école de Saint-Simon a tellement fermé les yeux sur les caractères de l’homme
en particulier, elle a tellement fui l’individualisme, qu’elle est allée se perdre dans
le panthéisme le plus complet qui ait été encore imaginé 3 9 .
Ce (( panthéisme )) se voit d’ailleurs rapidement confondu avec l’athéisme.
Il s’agit là, bien sûr, d’un (( amalgame )) malignement composé par des adversaires.
Pour mieux rendre répugnantes des doctrines abhorrées, on les met toutes (( dans le
même sac )) : chacun subit ainsi une réprobation multipliée par celle des autres.
Mais cet amalgame, s’il reste à la rigueur injustifié, ne manque pas de prétextes,
et, au besoin, Holderlin lui en fournirait un. En ce poète, et aussi chez le jeune
Hegel, se trouvèrent effectivement réunies une tendance au panthéisme et une inclination pour un vague communisme sentimental. Un communisme des esprits )) se
trouve attesté dans l’œuvre de Spinoza, au titre de pressentiment à tout le moins.
Henri Heine qui baignait dans cette ambiance culturelle prolongée, et qui connaissait
bien toute cette histoire, cherchera plus tard, longuement et obstinément, à accréditer
la thèse selon laquelle le grand mouvement de la philosophie allemande, tout autant
que le communisme moderne, doivent beaucoup, sinon tout, à un panthéisme
germanique invétéré.
De fait, l’idée d’une communauté humaine diachronique se voit principalement
répudiée par les théoriciens qui contestent la validité d’une conception totaliste du
monde, qui pensent que (( tout est séparé D, qui poussent les ruptures historiques
constatables jusqu’à la radicalité ou à l’absolutisme, et qui se sentent obligés, par cela
même, à instituer des coupures infranchissables, des (( abîmes », aussi dans la synchronie.
Nous ne comprendrons pas nos voisins si nous ne comprenons pas nos anciens.
Nous ne saurons a faire quelque chose )) dans notre monde si nous ne récupérons pas
la forme des actions et la loi des transformations qui régnèrent dans d’autres mondes,
dissemblables certes, mais pas complètement étrangers.
Mais, inversement, si nous perdons confiance en notre action, si nous n’envisageons
plus de transformer intentionnellement le monde, si la foi en l’avenir de l’homme
nous abandonne, alors nous renonçons aux explications globales du passé, nous refusons
de détecter en lui une continuité profonde, nous doutons de son intelligibilité, nous
n’entendons plus les leçons et les avertissements des temps anciens. Tout éclate.
Le panthéisme sauvegarde imaginativement, à sa manière, l’unité et l’identité
d’un monde. I1 rend précairement compte de la forme holique dans laquelle se
manifeste une civilisation particulière, (( cette forme dans laquelle cela s’est produit,
cette énergie et cette cohérence qui semblent se perdre à l’infini et qui pourtant
mettent en accord avec le centre ce qu’il y a même de plus éloigné, et qui maintient
fermement dans chaque variation le ton de la mélodie originaire »... I1 est l’avatar,
premièrement religieux, d’un monisme philosophique athée. I1 a en commun avec ce
dernier, une vue d u tout, une adoption nécessaire de cette idée de totalité qui est
devenue suspecte à beaucoup de penseurs de la fin du xx‘siècle. I1 assure l’unité
fondamentale de l’unité et de la diversité. I1 permet, si l’on en adopte le principe,
le recours à une histoire qui ne soit pas une simple collection de faits et d’énoncés,
même si elle est accidentée, tumultueuse et souvent trop brutale.
Holderlin y associait un idéal de fraternité universelle, sans bornes dans l’espace
comme dans le temps. Pourrait-on renier les hommes et les cultures passés sans trahir
les hommes et les cultures présents, et sans renoncer à toute activité efficacement et
intelligemment constructrice d’un avenir?
En 1790, sur le parvis de la Wzlrmlinger Kapelle, des jeunes gens sentirent du
moins qu’il fallait choisir. L’action actuelle a besoin que l’on récupère l’énergie du
passé, comme la connaissance actuelle a besoin que l’on aille renflouer des épistémies
submergées. O n peut entendre en ce sens une parole de Renan : a Les vrais hommes
de progrès ont un profond respect du passé. ))
I1 ne faut pas sauver seulement l’Acropole. Même le Moyen Age, Holderlin ne
se résout pas à l’assassiner.
Jacques D’Hondt
NOTES
1. Holderlin, Samtficbe WevRe, publiées par Friedrich Beissner, Stuttgart, Kohlhammer Verlag, t. IV,
vol. 1 , 1951, p. 306-309. Lire notre traduction, ci-dessous, p. 221.
2. Ibid., p. 301.
3. Neue Schweitzer Rundscbau - Wissen und Leben, 19’ année, p. 343 sq.
4. Lettre de la mi-novembre 1790.
5. Holderlin, op. rit., ibid., p. 426.
6. Ibid., p. 427.
7. Christoph Schwab édita en 1846 les (Enures complètes de Holderlin, en 2 volumes, chez l’éditeur
Cotta. Une première édition avait été procurée, du vivant de Holderlin, par Uhland et Kerner.
8. Holderlin, op. rit., vol. 2, p. 804.
9. Ibid.
10. Jacques Grandjonc, U Quelques dates à propos des termes communiste et communisme », in Mots,
Paris, CNRS, 1983, n ” 7 , p. 146-147.
11. Holderlin, ein Lesebuch für unsere Zeit, publié par Tilly Bergner et Rudolf Leonhard, Weimar,
Volksverlag, 1960; U introduction par Rudolf Leonhard, p. 14.
12. Theodor Haering, Hegel, sein Wollen und sein Werk, Leipzig et Berlin, I, 1929, p. 37, n. 1, et
p. 42-43.
13. Holderlin, Sdmtliche Werke, op. rit., vol. 1 , p. 297 et 425.
14. P. Bertaux, Holderlin ou le Temps d’un poète, 1983, p. 261.
15. Hegel, Préface de la Phénoménologie de l’esprit, trad. par J . Hyppolite, éd. bilingue, Paris, Aubier,
1966, p. 169.
16. Le U Tableau littéraire de la France au XVIII‘ siècle 3, par Roland Mortier, Bruxelles, Palais des
Académies, 1972, p. 140.
17. Yvon Gauthier, L’Arc et le Cercle. L’essence du langage chez Hegel et Holderlin, Desclée de Brouwer,
Paris-Montréal, 1969, p. 117-1 18, n. 22.
18. Jean Hyppolite, (< Les travaux de jeunesse de Hegel », Revue de métaphysique et de morale, 1935,
n,’ 3, p. 407.
19. Hegel’s Theologische Jugendschryten, éd. Nohl, Tübingen, 1907, p. 49.
20. Lettres à Neithammer du 12 juillet 1816 (in Bride von und an Hegel, t. II, Hambourg, 1953,
p. 89) et du 28 octobre 1808 (ibid., t. I, 1952, p. 253).
21. Lettre à Schiller, du 23 août 1797.
22. W. Prengel, L’Évolution morale et politique de Holderlin, Casablanca, 1958, p. 16.
23. Holderlin, op. rit., vol. 1, p. 40-41.
24. Ibid., p. 56, trad. in Euvres, Gallimard, a La Pléiade », 1967, p. 8.
25. Membres des associations d’étudiants nationalistes en Allemagne, après 18 15.
26. Sous le titre : U Le devenir dans le périssable .v, in Holderlin, Euvres, op. rit., p. 651.
27. L’association d’idées entre ordre monastique et académie persistera toujours dans la pensée de
Hegel : (( La condition des philosophes n’est pas encore organisée comme l’est celle des moines. Les
membres des Académies constituent bien quelque chose de ce genre; mais même une classe comme
celle-là - l’admission en est déterminée de l’extérieur - sombre dans l’habitude des rapports d’état, de
classe. )) (Hegel, Lecons sur l’histoire de la philosophie, trad. Garniron, Paris, Vrin, 1985, p. 1258.)
28. Hegel, Histoire de la philosophie, <( Introduction », trad. par J. Gibelin, Paris, Gallimard, 1954,
p. 134.
29. Hegel, Des manières de traiter scientifiquement du droit naturel, trad. B. Bourgeois, Paris, Vrin,
1972, p. 101.
30. K. Marx, Le Capital, trad. française, Paris, Éd. Sociales, 1967, t . I, p. 173.
3 1. K. Marx, Contribution ù la critique de l’économiepolitique, trad. française, Paris, Éd. Sociales, 1957,
p. 170.
32. J. D’Hondt, L’Idéologie de la rupture, Paris, PUF, 1978.
33. Hegel, La Positivité de la religion chrétienne, mad. Guy Planty-Bonjour, Paris, PUF, 1983.
34. Hegel, L’Esprit du christianisme e t son destin, trad. Jacques Martin, Paris, Vrin, 1948.
35. (( L’archipel », in Euvres, op. rit., p. 828.
36. Ibid., p. 689.
37. Ibid., p. 691 et 692.
38. Hypérion, in ibid., p. 187 : (( Les peuples sont partis de l’harmonie de l’enfance, l’harmonie des
esprits sera le point de départ d’une nouvelle phase de l’Histoire. N
39. Ibid., p. 595 (Werke, IV, 1, p. 222).
40. Ibid., p. 279.
41. Cité par P. Bertaux, Holderlin, essai de biographie intérieure, Paris, Hachette, 1936, p. 194.
42. Alexandre Matheron, individu et Communauté chez Spinoza, Paris, Minuit, 1969.
43. Ibid., p. 276-277.
44. Ibid., p. 610.
45. Ibid., p. 612. (C’est Matheron qui souligne.)
46. Ibid., p. 612.
237
47. Ibid., p. 612, n. 95.
48. Holderlin, CEuvreJ, op. rit., p. 1157.
49. Spinoza, @uvres complètes, Paris, Gallimard, (( La Pléiade », 1954, p. 1279.
50. Holderlin, ibid., p. 230.
5 1. Two Treatises of Civil Government, Livre I, 5 32-33.
52. Le mondain », in Méfanges, Gallimard, U La Pléiade n, p. 203.
53. Sur les relations de Hegel et du Cercle social, voir J. D'Hondt, Hegel secret, Paris, PUF, 1986,
en particulier la 1" partie.
54. Adrien de Lezay-Marnézia : D e la faiblesse d'un gouvernement qui commence, Paris, an IV.
55. Ibid., p. 12.
56. P. Bertaux, op. rit., p. 195. (Voir Holderlin, @uvres, op. rit., p. 523.)
57. P. Bertaux, ibid.
58. L a Revue indépendante, 1841, 1, p. 337.
59. Le Semeur, 1, n"3, septembre 1831, p. 28.
((
L e communisme
des esprits
(Cornmunismus der Geister)
Johann Christian Friedrich Holderlin
Thibaut et Oscar
Eugène et Lothaire
ESQUISSE
Coucher de soleil. Chapelle. Une contrée vaste et riche. Fleuve. Forêts. Les amis.
Seule la chapelle est encore dans la lumière. On en vient à parler du Moyen Age.
Les ordres monastiques considérés dans leur signification idéale. Leur influence sur la
religion et, en même temps, sur la science. Ces deux orientations se sont séparées,
les ordres religieux se sont effondrés, mais est-ce que des institutions du même genre
ne seraient pas souhaitables? Afin de démontrer leur nécessité pour notre temps, nous
partons précisément du principe opposé, de la généralisation de l’incrédulité. Cette
incrédulité se rattache à la critique scientifique contemporaine, qui a pris de l’avance
sur la spéculation positive. Rien ne sert de se lamenter à ce propos, il s’agit de faire
quelque chose. I1 faut, ou bien que la science anéantisse le christianisme, ou bien
qu’elle ne fasse qu’un avec lui, car il ne peut y avoir qu’une seule vérité. I1 s’agirait
donc de ne pas laisser la science tomber dans la dépendance de circonstances extérieures,
et, confiant en cette unité que souhaitent et que pressentent tous ceux qui connaissent
et qui aiment l’humanité, de lui ménager une existence indépendante, digne et
majestueuse. Séminaires et académies en notre temps. La Nouvelle Académie.
239
*
Une belle soirée touchait à sa fin. La lumière, en s’en allant, semblait ramasser
encore toutes ses forces pour jeter ses derniers rayons d’or sur une chapelle qui s’élevait,
dans une charmante simplicité, au sommet d’une colline couverte de prairies et de
vignes. L’éclat de la lumière n’atteignait plus la vallée, au bas de la colline, et le
bruissement des vagues signalait seul’la proximité du Neckar qui, à mesure que la
mélodie du jour expirait, élevait d’autant plus le murmure de sa voix pour saluer la
venue de la nuit. Les troupeaux étaient rentrés. Un animal sauvage n’osait que
rarement se glisser avec timidité hors de la forêt pour chercher sa nourriture à l’air
libre. La montagne était encore dans la lumière. Tout cela baignait dans un esprit
de quiétude et de mélancolie.
(( Lothaire )) - ainsi commença l’un des deux jeunes gens qui, du parvis de la
chapelle, avaient contemplé ce spectacle pendant un certain temps, et qui, maintenant,
s’étaient un peu éloignés de cet endroit pour dire adieu au dernier rayon du soleil
qui touchait le toit de l’église - (( Lothaire! Est-ce que tu ne te sens pas étreint, toi
aussi, par une douleur secrète quand l’œil du ciel est ainsi enlevé à la nature, et
qu’alors la vaste terre se trouve là comme une énigme dont il manque le mot? Voici
que la lumière s‘en est allée et déjà les fières montagnes s’enveloppent d’ombre, elles
aussi. Cette absence de mouvement suscite l’angoisse, et le souvenir de la beauté
passée devient comme du fiel. J’ai éprouvé cela des centaines de fois, lorsqu’il me
fallait quitter le libre éther de l’Antiquité pour revenir à la nuit du présent : je ne
trouvais de salut que dans la résignation, qui est la mort de l’âme. I1 y a un sentiment
qui vous torture, au souvenir de la grandeur disparue, et on est là comme un criminel,
devant l’histoire. Plus on a revécu celle-ci profondément, plus on est violemment
bouleversé en s’éveillant de ce rêve : on voit un abîme entre ici et là-bas, et moi, du
moins, toutes ces choses qui furent si belles et si grandes, je suis obligé de les tenir
pour perdues, pour perdues à jamais. Regarde cette chapelle : comme il était formidablement puissant l’esprit qui la créa, avec quelle force il dompta le vaste monde!
I1 couronna la colline paisible avec ce sanctuaire pacifique, dans la vallée il installa
son monastère, et dans le tumulte de la ville il édifia sa majestueuse cathédrale. Des
milliers d’hommes lui étaient soumis et, apôtres de cet esprit, ils allaient çà et là,
vêtus de cilices, pauvres, privés de ce que la terre produit de plus délicat, et ils
agissaient. Mais je n’ai pas besoin de te raconter tout cela, tu connais l’histoire du
monde. Et qu’est-il advenu de tout cela? Comprends-moi bien : la question ne
concerne pas ce que ce siècle-là nous a transmis. Ma question ne concerne pas le
matériau mort, mais plutôt, si tu veux, la forme dans laquelle cela s’est produit,
cette énergie et cet esprit de cohérence qui semblaient se perdre dans l’infini et qui
pourtant savaient mettre en accord avec le centre ce qui paraissait même le plus
éloigné, et maintenait fermement dans chaque variation le ton de la mélodie originaire,
La forme, prise en ce sens, est sans doute la seule chose qui, dans notre situation,
puisse nous fournir un point de comparaison, car le matériau n’est jamais que quelque
chose de donné. Mais la forme est l’élément de l’esprit humain, c’est la liberté qui
y opère comme loi, et la raison s’y actualise. Et alors, compare donc ce temps-là avec
le nôtre : où trouveras-tu une communauté? Où est le pont qui nous permettrait de
recevoir, de ce pays lointain, tant de choses magnifiques? Où est passé cet esprit pieux
et puissant qui a construit les églises, fondé les ordres religieux, et tout cela comme
d’une seule coulée? Cet esprit qui, d’un point central, s’éleva au-dessus du monde
de cette époque et qui soumit tout à son intelligence et à la force de sa foi?
240
*
ESQUISSE
Chez nous, tout se concentre dans le spirituel, nous sommes devenus pauvres
pour devenir riches.
Vieux monde
1) Monarchie, Grèce; ensuite, Rome.
Moyen Age
2) Monarchie constitutionnelle.
Temps modernes
3) République.
ad 2) Nations différentes - Une Église, auec un pape.
ad 3) Sacerdoce universel, le protestantisme comme prologue.
Johann Christian Friedrich Holderlin
Traduction J . D’ Hondt
Holderlin e n France *
Andrejz Warminski
Arb, es sei die Ietzte meiner Tranen,
Die dem beil’gen Giecbenlande rann,
Lasst, O P a n e n , Iasst die Scbere tonen !
Denn mein H e n gebort den Toten a n .
(( Griechenland N (1793)
Dans The Tyranny of Greece over Germany, E . M . Butler commence le chapitre
consacré à Holderlin, de manière fort appropriée, par un long récit sur Holderlin en
France :
Au tout début du x~x~siècle,
une jeune fille d’à peu près quatorze ans, qui
devait devenir plus tard Mmede S...y, vivait très heureuse avec son père dans leur
château près de Blois. Ce château était entouré d’un magnifique parc où se trouvait
un grand bassin de marbre bordé d’une haute balustrade. Sur cette balustrade
étaient alignées vingt-quatre statues de dieux grecs, des plus grands aux moins
grands. Un jour la jeune fille et son père, en regardant par une fenêtre, virent un
étranger à l’air triste et misérable qui errait sans but à travers le parc. I1 vit soudain
les statues et tout son comportement en fut transformé. S’approchant d’elles avec
enthousiasme, il leva les bras en signe d’adoration et sembla, dans la mesure où
ils purent en juger, leur adresser des invocations. Se demandant qui il pouvait
bien être, ils descendirent pour l’aborder. La jeune fille se trouva regarder deux
yeux rêveurs et tristes qu’elle n’oublia jamais, pas plus que les étranges choses
qu’il déclara a son père :
N Cette eau devrait être plus claire, comme l’eau du Céphise ou la source de
I’Erechthée sur l’Acropole. Se refléter dans un miroir plus sombre n’est pas digne
des dieux clairs - mais, ajouta-t-il avec un soupir, nous ne sommes pas en Grèce.
* Texte d’abord publik (« Holderlin in France ») in Studies in Romanticism. Repris in A. Warminski,
Readings in Interpretation, HoIderIin, HegeI, Heidegger, University of Minnesota Press, 1987.
242
- Êtes-vozu donc Grec? demanda le comte, seulement à demi sérieux.
- Non, au contraire, je suis Allemand, et de nouveau l’étranger soupira.
- Au contraire? L’Allemand est-il le contraire du Grec?
- Oui, dit l’Allemand sèchement; et après un silence, il ajouta : Mais alors
c’est
ce que nous sommes tous; vous, le Français, aussi bien; et votre ennemi, l’Anglais,
aussi - nous tous.
Ils le prièrent d’accepter leur hospitalité et il entra au château, visiblement dans
un état d‘épuisement extrême. Plus tard ils engagèrent avec lui une conversation
qui, sur les instigations de la tante de la jeune fille, prit bientôt un tour métaphysique et l’étranger commença à parler de l’immortalité. (( Les beaux dieux de
la Grèce sont les images des belles pensées d’un peuple tout entier, conclut-il;
c’est cela l’immortalité. Et vous, êtes-vous aussi immortel en ce sens? )) demanda
la tante de la jeune fille; car d’une certaine manière ils se sentaient tous curieusement
impressionnés par lui.
Moi? répliqua-t-il rudement : Moi? L’homme qui est assis ici en ce moment?
Non vraiment. Mes pensées ne sont plus belles. Mais le moi qui était mien il y
a neuf ans, cela est certainement immortel. I1 ne put ou ne voulut pas leur dire
son nom, déclarant, en se cachant la tête dans ses mains, qu’il le ferait le lendemain,
mais que parfois il était trop difficile de s’en souvenir. O n le persuada aisément
de rester pour la nuit; mais après une terrifiante crise de folie au petit matin, il
disparut le jour suivant dans un état de profonde dépression.
Ce récit fut fait par Mmede S...y au journaliste Moritz Hartmann en 1852. I1
est possible qu’il soit ou ne soit pas apocryphe. I1 a probablement été en grande
partie embelli; mais à moins qu’il ne soit une pure invention du début jusqu’à
la fin, le héros en fut certainement Holderlin. I1 errait à demi fou à travers la
France pendant l’été 1802; et même en supposant que quelque autre de ses
compatriotes se trouvait dans le même état au même moment, personne d’autre
que le malheureux Holderlin n’aurait pu parler comme cet étranger le fit des dieux
de la Grèce I .
))
((
))
Apocryphe ou non - 1. D’auteur ou d’authenticité contestable. 2. Faux;
contrefait N d u grec apokruptein, dissimuler; apo, à l’écart + kruptein, cacher ce récit est parfaitement approprié parce qu’il contient toutes les idées reçues qui
constituent le mythe de la Gükomanie de l’Allemagne et de Holderlin. Car nous
sont ainsi donnés non seulement une version débarrassée de tout pathos de notre
aliénation et de notre nostalgie modernes, sentimentales, schillériennes, par rapport
à la Grèce et aux beaux dieux de la Grèce, mais aussi le spectacle d’un Allemand
à demi fou s’enthousiasmant pour des imitations sans valeur de sculpture grecque
- comme une parodie de Winckelmann à Rome. En vérité, si nous en croyons le
livre de E.M. Butler - et ne lisons pas les textes - nous devrions dire que n’importe
quel Allemand autre que Holderlin, n’importe quel non-Grec ou n’importe quel
(( Hespérique », s’il n’aurait pas parlé exactement comme cet étranger des dieux de
la Grèce, pourrait néanmoins avoir fait - aurait néanmoins d û faire - ce récit, car
c’est une véritable allégorie de la manière dont on parle des Grecs et des Allemands,
de la Grèce et de l’Hespérie, de l’art grec et de la poésie de Holderlin. En d’autres
termes, si ce récit n’était pas (( vrai », il aurait fallu l’inventer : c’est-à-dire inventer
une certaine Grèce et un certain art grec, bref, inventer la catégorie de l’esthétique
en tant que grecque et les Grecs en tant que constituant le moment esthétique
dans ce qu’on appelle l’histoire de l’occident. Cette invention des Grecs présente
une telle flexibilité et une telle puissance de persuasion qu’elle est sans cesse
mécaniquement réinventée pour servir de point de référence à l’interprétation même
de ceux des penseurs et des poètes qui, comme Holderlin, ont fait le plus pour
détruire et désarticuler ce schéma et son idéologie. Pourquoi celui-ci était-il nécessaire
et quelle est la nature de sa nécessité, ce sont là les questions qui constituent la
tâche de notre lecture de Holderlin en France - une France qui, selon la deuxième
lettre de Holderlin à Bohlendorff (novembre 1802) qu’il écrivit de sa ville natale
243
de Nürtingen à son retour de Bordeaux, lui permet, assez bizarrement, de mieux
comprendre les Grecs :
L’aspect athlétique des Méridionaux, au milieu des vestiges de l’esprit antique,
m’a familiarisé davantage avec la véritable nature des Grecs (Das Athletische der
siidlichen Menschen, in den Ruinen des antiken Geirtes, machte mich mit dem
eigentlichen Wesen der Giechen bekannter) [VI, 3421 3 .
Les détails biographiques d u voyage de Holderlin en France et de son retour en
Allemagne sont assez curieux : il traverse la frontière à Strasbourg (où il est détenu
deux semaines en tant qu’étranger suspect), il voyage la plupart d u temps à pied et
passe par Lyon pour atteindre Bordeaux où il est employé comme précepteur pendant
quelques mois dans la maison d u consul d’Allemagne et ensuite, disparaissant de
manière inexplicable, il voyage à pied, passant probablement par Paris pour rentrer
en Allemagne où il arrive dans un état d’affolement et de dérangement grave (pour
trouver, entre autres choses, que sa Diotima », Suzette Gontard, est morte). Mais
en dépit du fait que nous savons très peu de chose (mis à part les (( apocryphes )) d u
genre de celui cité plus haut) concernant les (( faits )) de cet épisode d’aller et retour
- sinon exactement en Grèce, d u moins aux ruines de son esprit - son importance
pour la compréhension de l’œuvre de Holderlin devient claire dès lors qu’est pris en
compte son cadre textuel. En un sens plus large, ce qui vient (( avant )) ce cadre est
constitué par les écrits de Holderlin dits de Hombourg : les fragments théoriques,
(( poétologiques )) (portant sur le processus poétique, la théorie systématique des genres,
la théorie de l’alternance des tons, etc.) les essais non aboutis d’écrire la tragédie
d’Empédocle, et juste avant le départ de Holderlin pour la France en décembre 180 1,
certaines versions achevées et d’autres seulement esquissées des hymnes tardifs, dits
vaterlündiscbe Hymnen. Ce qui vient (( après )) ce cadre est constitué par l’achèvement
d’un certain nombre de ces hymnes (y compris certains parmi les plus grands, par
exemple (( Patmos )) et les traductions de Sophocle, accompagnées des (( Notes sur
CEdipe )) et Notes sur Antigone »,d’une exaspérante difficulté. Un cadre textuel plus
étroit et plus net d u voyage en France est fourni par les deux lettres que Holderlin
écrivit à Bohlendorff : une immédiatement avant son départ (le 4 décembre 1801) et
l’autre tout de suite après son retour (novembre 1802). La première lettre constitue
l’exposé le plus explicite et le plus complet de Holderlin au sujet d u rapport entre
la Grèce et l’Hespérie, essentiellement parce qu’elle se rapporte à la tâche du poète
(la tâche grecque en contre-distinction avec la tâche hespérique). La seconde lettre
contient non seulement les remarques concernant la nouvelle familiarité de Holderlin
avec les Grecs, mais aussi quelques lignes qui sont considérées comme le témoignage
d u fait qu’il se détourne de la Grèce et de l’art grec pour revenir à 1’Hespérie et au
Vaterland - c’est-à-dire ce qu’on appelle l’abendlündiscbe Wendung ou vaterlandiscbe
Umkebr de Holderlin :
Mon cher, je pense que nous ne commenterons plus les poètes des temps passes;
c’est la manière même de chanter qui va prendre un caractère différent, et si nous
ne réussissons pas, c’est parce que, depuis les Grecs, nous sommes les premiers à
chanter selon la patrie et la nature, vraiment originellement. (Mein lieberl ich
denke, dass wir die Dichter bis auf unsere Zeit nicht commentiren werden, sondern
dass die Sangart überhaupt wird einen anderen Karakter nehmen, und dass wir darum
nicht aufkommen, Weil wir, seit den Giechen, wieder anfangen, vateriündisch und
natürlich, eigentlich originell zu singen) [VI, 4331.
Bien qu’elle prétende se détourner de la Grèce - et bien qu’elle se détourne de
la lecture de la difficulté manifeste de ces lettres - une telle interprétation a néanmoins
besoin de réinventer cette Grèce, ne serait-ce que comme l’opposé de nous autres
Hespériques. Que nous concevions cette Grèce-ci comme quelque chose dont on se
244
détourne ou dont on a la nostalgie ou dont on déplorerait l’absence, cela ne fait
guère de différence d u moment que nous nous identifions nous-mêmes comme des
Hespériques (comme le héros d u récit apocryphe de Mmede S...y) en opposition à,
ou comme la négation des Grecs. Car une telle auto-identification (quoique négative)
impose toujours que nous nous voyons nous-mêmes d u point de vue grec, pour ainsi
dire, et que nous définissions notre poésie sur la base d’un modèle mimétique,
esthétique, grec. Cela veut dire, en bref, définir notre poésie (( sentimentale », (( romantique )), etc. en termes d’art (( naïf)), (( classique », etc. Dans le schéma d’une telle
interprétation, c’est encore une fois le fait de poser en principe les Grecs comme le
moment esthétique qui nous permet de fonder la poétique de Holderlin sur sa
philosophie de l’histoire - de réconcilier sa poétique avec ce qui est considéré comme
son herméneutique - et ainsi de donner un sens (historique) aux poèmes lyriques
tardifs de Holderlin et à son projet de traduction et de réécriture des tragédies de
Sophocle. Peu importe à qui elles sont adressées, la destination ultime des lettres de
Holderlin à Bohlendorff se révèle être la Grèce, tout comme il n’y a pas de retour
chez soi pour Holderlin ou pour sa destinée poétique en dehors de la Grèce - de
son bel art et de ses beaux dieux, tout morts qu’ils soient.
Mais de même que Holderlin ne retourne jamais tout à fait chez lui, de même
les lettres à Bohlendorff ne parviennent jamais tout à fait à leur destination : le statut
de l’expéditeur comme celui du destinataire est problématique. L’interprétation grecque,
esthétique et esthétisante, de Holderlin ferait bien de s’inspirer des détails biographiques qui, comme toujours dans le cas d’un poète dont la vie fut tout autant un
texte que tout ce qu’il mit sur papier, sont instructifs : Bohlendorff, que Holderlin
rencontra à Hombourg en 1799, était un poète et un dramaturge raté qui fut incapable
de s’installer professionnellement à Iéna, Dresde, Brême, ou Berlin, qui revint dans
sa ville natale en 1803, dérangé mentalement (geistig gestort), comme on dit, et qui
après quelques années d’errance indécise mit fin à sa vie par un suicide. Son biographe
le définit comme un (( idéaliste qui a échoué )) (ou (( un idéaliste qui a sombré )) ein gescheiterter Idealist) 5 . Bref, Bohlendorff est quelque chose comme l’ombre ou le
double étrange de Holderlin et les deux lettres que Holderlin lui adressa auraient
aussi bien pu être adressées à (( lui-même ». Mais celui qui aurait reçu ces lettres celui qui est en train de devenir Scardanelli ou Buonarotti ou quelque chose comme
ça )) (c’est ainsi que Holderlin se nommait lui-même à partir de 1806) - n’est
certainement pas (( lui-même », et celui qui les envoie, le Holderlin qui revient de
son voyage en France et des ruines de l’esprit grec (rien que pour trouver Diotima
morte) ne revient pas non plus à (( lui-même ». La peur de perdre la tête (( en France,
à Paris )) (Icb werde den Kopf ziemlich beisammenhalten müssen, in Frankreich, in Paris)
que Holderlin exprime dans la première lettre à Bohlendorff pourrait certainement
sembler avoir été justifiée; et la seconde lettre à Bohlendorff le confirme :
L’élément puissant, le feu du ciel et le silence des hommes, leur vie dans la nature,
modeste et contente, m’ont saisi constamment, et comme on le prétend des héros,
je puis bien dire qu’Apollon m’a frappé. (Das gewaltige Element, das Feuer des
Himmels und die Stille der Menschen, ihr Leben in der Natur, und ihre Eingescbranktbeit und Zufriedenheit, hat mich bestündig ergriffen, und wie man Helden
nachspricht, kann icb wohl sagen, dass mich Apollo geschiagen) [VI, 4321.
Mais ces détails biographiques sont seulement des symptômes. Avant de décider de
quoi ils sont les symptômes er avant de remettre ces lettres au Bureau des lettres
mortes de la psychopathologie - disons à (( la folie de Holderlin )) - nous ferions
mieux de déterminer en quel sens elles ne peuvent ni être remises à leur destinataire
ni être retournées à l’expéditeur. I1 nous faut examiner la nature d u système postal,
pour ainsi dire, et dans le cas de la première lettre de Holderlin à Bohlendorff cela
veut dire interpréter avec plus de précision la nature de l’articulation textuelle de la
245
Grèce avec 1’Hespérie. Que ce soit bien une question d’articulation problématique,
cela apparaît clairement à une lecture même cursive de la lettre, et il est difficile de
comprendre comment on a jamais pu interpréter cette lettre dans le sens d’un simple
acte de se détourner ou de se tourner vers la Grèce, vers une Grèce ou vers une antiGrèce. Holderlin commence par féliciter son ami pour sa pièce (Fernando) et en prend
prétexte pour proposer une interprétation de la nature grecque et de notre nature
dans la mesure où elle comporte la condition de poète. Cela vaut la peine de citer
les passages cruciaux en entier, autant’pour ce qu’ils ne disent pas que pour ce qu’ils
disent :
Mon cher, tu as beaucoup gagné en précision et en remarquable souplesse, sans
avoir perdu d e chaleur; au contraire, l’élasticité d e ton esprit, comme une bonne
lame, s’est révélée plus vigoureuse à l’école d e la contrainte. C’est d e cela surtout
que je te félicite. Rien n’est pour nous plus difficile à apprendre que de savoir
user librement d u nationel. Et je crois que la clarté de l’exposé nous est à l’origine
aussi naturelle que le feu d u ciel aux Grecs. C’est aussi pour cette raison qu’il
doit être plus facile d e les surpasser par la belle passion, que tu as d’ailleurs su
conserver aussi, que par leur homérique présence d’esprit et leur don d’exposition.
Cela a l’air d’un paradoxe. Mais je le répète, en te laissant libre d’en juger et
d’en user : à travers le progrès d e la culture (Bildung), l’élément proprement
nationel sera toujours le moindre avantage. Voilà pourquoi les Grecs sont moins
maîtres d u pathos sacré, car celui-ci leur était inné, par contre ils excellent à partir
d’Homère dans le don d’exposition, car cet h o m m e extraordinaire avait assez d’âme
pour ravir, au profit d e son royaume apollinien, la sobriété junonienne de l’occident,
et s’approprier ainsi véritablement l’élément étranger.
Chez nous c’est l’inverse. Voilà pourquoi il est si dangereux d e déduite nos lois
esthétiques de la seule et unique perfection grecque. J’ai longuement réfléchi à
cette question, et je sais maintenant qu’en dehors d e ce qui, pour les Grecs comme
pour nous, doit être le plus haut, c’est-à-dire la relation vivante et l’habileté
(Geschick) vivante, nous ne pouvons probablement rien avoir de commun avec eux.
Mais ce qui nous est propre, il faut l’apprendre tout comme ce qui nous est
étranger. C’est en cela que les Grecs nous sont indispensables. Pourtant, c’est
justement en ce qui nous est essentiel, nationel, que nous n’atteindrons jamais leur
niveau, car, répétons-le, le plus difficile c’est le libre usage de ce qui nous est
propre.
(Mein Lieber! Du hast an Prüzision und tüchtiger Gelenksamkeit so sehr gewonnen
und nichts an Würme verloren, im Gegentheil, wie eine gute Klinge, hat sich die
Elastizitüt Deines Geistes in der beugenden Schule nur um so kraftiger emuiesen. Diss
ists wozu ich Dir vorzüglich Glük wünsche. Wir lernen nichts schwerer als das
Nationelle frei gebrauchen. Und wie ich glaube, ist gerade die Klarheit der Darstellung
uns ursprüngiich so natürlich wie den Griechen das Feuer von Himmel. Eben desswegen
werden diese eher in schoner Leidenschaft, die Du Dir auch erhalten hast, ais in
jener homerischen Geistesgegenwart und Darstellungsgaabe zu iibertreffen seyn.
EJ klingt paradox. Aber ich behaupt’ es noch einmal, und stelle es Deiner Prüfung
und Deinem Gebrauchefrei ;das eigentliche nationelle wird im Fortschritt der Bildung
immer der geringere Vorzug werden. Desswegen Sind die Griechen des heiligen Pathos
weniger Meister, Weil es ihnen angeboren war, hingegen Sind S i e vorzüglich in Darstellungsgaabe, von Homer an, Weil dieser ausserordentliche Mensch seelenvoll genug
war, um die abendlündische Junonische Niichternheit für sein Apollonsreich zu
erbeuten, und so wahrhaft das fremde sich anzueignen.
Bei uns ists umgekehrt. Desswegen ists auch so geführlich sich die Kunstregeln einzig
und allein von griechischer Vortreflichkeit zu abstrahiren. Ich babe lange daran
laborirt und Weiss nun dass ausser dem, was bei den Griechen und uns das hochste
seyn muss, nemiich dem lebendigen Verhültniss und Geschick, wir nicht wohl etwas
gleich mit ihnen haben dürfen.
Aber das eigene muss so gut gelernt seyn, wie das Fremde. Desswegen Sind uns die
Griechen unentbehrlich. Nur werden wir ihnen gerade in unserm Eigenen, Nationellen
246
nicht nachkomnen, Weil, wie gesagt, der freie Gebraucb de5 Eigenen da5 scbwer~te
ist.) [VI, 425-4261.
Bien que cette lettre trouve certainement son origine dans la (( querelle des
Anciens et des Modernes H qui se poursuit sous des formes diverses dans la pensée
allemande de la deuxième moitié du XVIII‘ siècle, elle complique de manière radicale
les termes et les enjeux de cette querelle en introduisant une dualité à l’intérieur de
ses adversaires. Tant les Grecs que nous-mêmes sommes divisés selon une distinction
qui pour aller vite peut aussi bien être appelée celle de la (( nature )) et de la (( culture ».
La nature grecque - ce qui est (( naturel », (( nationel », (( original N, (( propre n (das
Eigene) pour les Grecs - c’est (( le feu d u ciel )) et (( le pathos sacré ». La culture
grecque - ce qu’ils avaient à s’approprier, à ravir, parce que cela ne leur était pas
inné mais leur était étranger (das Fremde) - c’est (( la clarté de la représentation n et
(( la sobriété junonienne )),
tandis que notre culture - ce que nous avons à nous
approprier parce que cela ne nous est pas propre mais nous est étranger (das Fremde)
- c’est (( le feu du ciel N et (( le pathos sacré ». En d’autres termes, il y a un renversement
(en forme de chiasme) dans la relation entre la nature et la culture, entre ce qui est
propre et ce qui est étranger, das Eigene et das Fremde, entre les Grecs et nous : ce
qui est das Eigene là est das Fremde ici, et ce qui est das Fremde là est das Eigene
ici. Le caractère double (de das Eigene et de das Fremde) tout comme le renversement
- (( Chez nous c’est l’inverse )) (Bei uns ist’s umgekehrt) - sont explicites. Or c’est
précisément à cause de ce caractère double que notre relation (en tant que poètes)
aux Grecs doit aussi être double. D’un côté, nous ne pouvons pas simplement imiter
les Grecs, car plutôt que d’être leur nature, leur culture est la réaction ou la réponse
à une nature. Cela sonne en effet comme un paradoxe, comme Holderlin le souligne,
mais c’est rigoureusement cohérent : précisément parce que les Grecs - leur culture
- sont notre nature, nous ne pouvons pas les imiter servilement, car notre poésie doit
être la réponse à une nature différente de la leur : nous avons à nous approprier
précisément ce qui est naturel, inné pour les Grecs («le feu du ciel », (( le pathos
sacré N)exactement comme ils ont à s’approprier ce qui (à cause de leur appropriation)
devient naturel, inné pour nous (« la clarté de la représentation », (( la sobriété
junonienne N). Et parce qu’il est plus difficile, en vérité c’est le plus difficile, de
maîtriser ce qui est propre, inné, das Eigene, nous ne surpassons pas les Grecs dans
la clarté de la représentation et la sobriété junonienne qu’ils devaient s’approprier et
qui nous sont innées. Afin d’être comme eux - d u moins en ce qui concerne la relation
vivante (iebendiges Verhaltnis) et le destin (ou (( habileté »,Geschick) - nous ne devrions
pas les imiter ou déduire les lois de la création artistique (Kunstregeln) uniquement
d u modèle de la splendeur grecque, mais plutôt nous approprier ce qui ne nous est
pas propre, ce qui nous est étranger, das Fremde. Mais le rejet de l’imitation - qui
équivaut à un rejet tout à fait explicite d u classicisme de Winckelmann - ne nous
autorise certainement pas à parler d’un délaissement de la Grèce et d’un retour à la
patrie. Les motivations d’une telle (non-) lecture sont claires, car si l’on insiste pour
extraire un (( tournant N de cette lettre, ce serait nécessairement un tournant vers ce
qui ne nous est pas propre, vers ce que nous avons à nous approprier, parce que cela
nous est étranger : das Fremde. Plutôt qu’une quelconque espèce de tournant qui nous
éloignerait de la Grèce, la lettre en question déclare tout à fait explicitement que le
propre - dans notre cas, les Grecs, la culture grecque : (( la clarté de la représentation »,
a la sobriété junonienne D - doit être appris aussi bien que ce qui est étranger, et que
pour cette raison les Grecs nous sont indispensables (Aber das eigene mass so gut gelernt
seyn, wie das Fremde. Desswegen sind us die Giechen unentbehrlich). Bien que non
imités, les Grecs n’en ont pas moins à être appris : nous ne pouvons pas nous passer
d’eux. Mais ce que signifierait apprendre des Grecs sans pourtant les imiter, ce que
signifie pour le poète hespérique d’avoir d’une part à rejeter les Grecs comme modèle
et d’autre part d’être pourtant incapable de s’en passer, voilà ce qui n’est pas aisé à
247
comprendre. Comment sauver les Grecs sans les imiter? L’interprétation de la première
lettre à Bohlendorff à laquelle est consacrée la totalité de l’essai de Peter Szondi
intitulé (( le dépassement du classicisme )) (Überwindang des Klassizismzls) constitue la
réponse la plus rigoureuse à cette question.
Mieux que quiconque avant lui, Szondi reconnaît à la fois la condition dans
laquelle Holderlin a placé le poète hespérique (et le lecteur de la première lettre à
Bohlendorfl) et ses enjeux. Afin d’arracher l’interprétation de Holderlin (en particulier
du dernier Holderlin) à l’emprise de l’interprétation marquée par l’idéologie du
(( George Kreis )) et de ses héritiers (au nombre desquels on peut compter Heidegger
Szondi fait des notions imprécises de abendlandiscbe Wendung et uateriandiscbe Umkehr
les cibles principales de son argumentation approfondie. Cela constitue certainement
une correction salutaire, surtout si on se souvient des tentatives d’enrôler la poésie de
Holderlin (en particulier les soi-disants vateriündiscbe Hymnen comme K Germanien >)
à des fins stupidement nationalistes. En même temps, Szondi comprend pourtant
mieux que quiconque l’originalité radicale de l’anticlassicisme explicite de Holderlin :
en un mot, que les Grecs ne sont pas la nature mais plutôt la réponse à une nature
et que par conséquent nous pouvons nous dispenser de devoir les imiter.
”>,
S’il n’est plus nature, mais réponse à une nature qui n’est pas la nôtre, l’art
classique semble ne plus pouvoir servir d e modèle pour l’époque moderne. (Nicht
inehr Natur, sondern Antwort auf eine Natur, die nicht die unsere ist, scheint die
Klassik die Fahigkeit einzubüssen, der moderne Vorbild zu sein ’.)
La solution de Szondi à ce dilemme - sauver les Grecs sans les imiter - prend la
forme d’une tentative de médiation dialectique entre les Grecs et les Hespériques,
entre ce qui est propre et ce qui est étranger, das Eigene et das Fremde. Cette solution
est énoncée très nettement et rigoureusement dans le résumé qu’en donne Szondi :
I1 s’agit, pour Holderlin, d e parvenir à une vision claire d e cette différence entre
art grec et art hespérique, dont il voit le fondement dans la différence d e deux
natures. Cette distinction achève d e le dispenser de l’imitation d e l’Antiquité, que
lui avait imposée le classicisme d e Winckelmann, et lui fait en même temps
comprendre pourquoi les Grecs lui sont néanmoins indispensables. Holderlin dépasse
le classicisme sans se détourner des classiques. Les idées exprimées dans la première
lettre à Bohlendorff reviennent à sauver l’hellénisme au profit de I’Hespérie, à se
persuader que la littérature des Modernes pourra exceller par d’autres moyens que
celle de l’Actiquité, et à reconnaître que, dans l’art, le propre également requiert
la liberté.
Les Grecs sont indispensables au poète hespérique parce que, dans leur art, il
est confronté à sa propre origine comme à quelque chose d’étranger. Ainsi acquiertil vis-à-vis d u propre une distance qui est liberté.
(Holderlin geht es darum, sich über jenen Unterschied zwischen griechischer und
hesperischer Kunst Klarheit zu verschaffen, ais dessen G u n d er die Verschiedenheit
von griechischer und hesperischer Natur erkennt. Diese Unterscheidung dispensiert
vollends von der Nachahmung der Antike, die ihm der Winckelmannsche Klassizismus
zur Pfiicht gernacht batte, und lüsst ibn zugleich den G u n d einsehen, aus dem die
Giechen ihm dennoch unentbehrlich sind. Holderlin überwindet den Klassizismus,
ohne von der Klassik sich abzuwenden. In dieser Rettung des Griechischen f ü r Hesperien,
in der Einsicht, dass die Dichtung der Moderne durch andere Mittel sich wird
auszeichnen konnen a h die antike, und in der Erkenntnis, dass auch dem Eigenen
gegenüber in der Kunst Freiheit wonnoten sei, besteht der ldeengehalt von Holderlin
erstem Brief an BobLendog
Die Giechen sind dem hesperiden Dichter unentbehrlich, Weil er in ihrer Kunst
dem eigenen Ursprung als einem Fremdem begegnet. So geuiinnt er zu dem Eigenen die
Distanz, die Freiheit ist
248
Szondi sauve les Grecs (tout en les abandonnant en tant que modèles à imiter)
avec élégance : Holderlin ne voudrait pas que nous renoncions à das Eigene au profit
de das Fremde ou vice versa 2 ils sont de rang égal (Gleichrangigkeit), dit Szondi mais voudrait plutôt que nous devenions, nous-mêmes, les Hespériques, en nous
reconnaissant nous-mêmes dans un autre, les Grecs, qui, parce qu’ils représentent
(dans leur art) ce qui nous est propre en tant qu’étranger, nous permettent de prendre
une distance par rapport à lui et par là de nous l’approprier, de le maîtriser, librement.
C’est ainsi que Holderlin dépasse le classicisme (Klassizismus) sans se détourner du
classique (Klassik). I1 est clair que cette solution par médiation dialectique est
rigoureusement hégélienne si l’on considère le terme médiateur invoqué par Stondi :
la représentation. Dans l’art (Kunst) grec, le poète hespérique rencontre (begegnet) sa
propre origine en tant que (als) origine étrangère : le mot (( en tant que )) (als) doit
être ici investi de tout le sens de la Vorstellung de Hegel. Et tout comme l’art
caractérise dans le schéma de Hegel une forme de connaissance (de soi) qui, précisément
parce qu’elle est encore entachée de représentation (Vorstellung) (non réfléchie), a
besoin d’être surmontée ou sursumée (aufgehoben), d’abord par la religion et ensuite
par la philosophie (absolument idéaliste), de même on peut dire que l’art grec
caractérise le moment esthétique de l’histoire occidentale que nous pouvons sursumer
en l’incorporant comme un moment dans ce récit qui est nôtre et qui raconte comment
nous sommes devenus nous-mêmes - (( Hespériques »,(( modernes », l’autre des Grecs.
Avec une totale cohérence dans son argumentation, Szondi, plus loin dans son essai,
formule explicitement ce schéma dans les termes hégéliens du soi et de l’autre quand
il caractérise ces choses qui peuvent avoir un effet destructeur sur le poète - l’art grec
donné, positif, hérité - mais qu’il ne doit cependant pas éviter car N elles sont, selon
la terminologie hégélienne, son autre, sans lequel il n’est pas non plus lui-même ))
(Sie sind, in Hegels Terminologie, sein anderes, ohne das er auch nicht er selber ist y ) .
Ce schéma, qui est capable de sauver l’art grec, l’art mimétique par excellence, en
l’incorporant comme un moment - peu importe selon quel degré d’absence ou de
négativité, car plus la négation est grande plus la synthèse l’est aussi - dans une
histoire de la conscience de soi, est même capable de sauver la pure et simple imitation
des Grecs comme un moment de l’œuvre d’art : le poète hespérique peut même imiter
Homère, ce que Holderlin, dans sa théorie de 1’« alternance des tons n (Wechsel der
Tone) nomme le N ton naïf )) (c’est-à-dire la clarté de la représentation, la sobriété
junonienne), s’il insère ce ton en tant qu’un ton (momentané) dans la structure tonale
totale qui constitue le poème ‘ O . En un mot, Szondi pourrait assimiler même la
poétique des tons de Holderlin - et ailleurs sa poétique du genre ” - à cette
interprétation de sa philosophie de l’histoire en termes dialectiques : cela veut dire
sous la forme d’une opposition entre das Eigene et du.r Fremde médiatisée par une
histoire de la conscience de soi qui contient la représentation esthétique de soi dans
l’art comme un moment essentiel (et sursumable).
Mais cette interprétation éminemment sensée - sa conception du négatif est en
effet assez puissante pour réunir ultimement en un tout la biographie de Holderlin
avec sa poésie, sa poésie avec sa poétique, sa poétique avec sa philosophie de
l’histoire, etc. - fait problème dès que nous regardons les textes de plus près. Si on
peut lui reprocher quelque chose, c’est qu’elle a trop de sens, et on commence à se
demander si Szondi est capable d’échapper à ses propres observations concernant les
premiers lecteurs de la première lettre à Bohlendorff:
O n dirait que les interprètes ne veulent pas admettre cette reflexion de Holderlin,
qu’ils ont peur de la reconnaître comme sienne (Es is, als wollten die Interpreten
die Überlegung Holderlins nicht wahrhaben, als scheuten sie sich, sie ais die seine
anzuerkennen 12).
Car afin de médiatiser les relations entre das Eigene et das Fremde (et par là entre la
Grèce et l’Hespérie), Szondi doit interpréter cette relation comme celle de termes
249
symétriquement opposés dont l’opposition doit être comprise sur le modèle de la
conscience, c’est-à-dire en termes du soi et de l’autre. Szondi parle en effet d’une
symétrie en miroir )) (Spiegelsymmetrie) entre la nature et l’art grecs et hespériques.
Sur la base de cette (( symétrie en miroir )), il peut interpréter ce qui nous est propre
(das Eigene) comme ce que Hegel nomme das Positive (le donné, l’immédiat,
l’abstrait, etc.), la (( liberté N du (( libre usage de ce qui nous est propre D (der freie
Gebrauch des Eigenen) comme signifiant (( avec conscience )) (c’est-à-dire (( avec conscience de soi ») et la tâche du poète comme (( la médiation des opposés )) (Vemzittlung
der Gegensütze). Or bien que le renversement (en forme de chiasme) - dans la relation
de ce qui est propre (das Eigene) et de ce qui est étranger (das Fremde) - entre les
Grecs et nous soit certainement assez explicite dans la lettre, il n’y a rien dans le
texte qui nous permette de transformer ce renversement en une symétrie en miroir
entre des termes opposés. En fait, ce qui caractérise la relation entre les Grecs et les
Hespériens est une asymétrie constitutive - leur nature est notre culture, notre nature
est leur culture - qui peut être comprise comme une symétrie en miroir (décisivement),
négative seulement aussi longtemps que nous ne lisons pas la nature radicale de ce
(( négatif )) dans le chiasme : en un mot, ce qui nous est étranger (das Fremde). Ce
qui veut dire que les Grecs ne peuvent jamais servir d’image en miroir (négative) en
laquelle nous pourrions nous reconnaître nous-mêmes parce qu’ils sont divisés en euxmêmes; ils contiennent une nature dont nous sommes pour toujours séparés et dont
nous ne pouvons jamais faire un objet de la conscience (de soi). Et ce qui nous sépare
de la nature des G e r s - (( le feu du ciel », (( le pathos sacré )) - est précisément notre
nature grecque - (( la clarté de la représentation », la sobriété junonienne ». Les
ramifications de cette asymétrie s’étendent très loin - surtout à partir du moment où
nous reconnaissons que la nature des Grecs était la culture G orientale »,(( égyptienne »,
- et j’ai étudié ces ramifications ailleurs ‘ j . Tout ce qui m’importe ici, c’est la
présupposition chez Szondi d’une identité ou du moins d’une analogie entre la relation
de la nature et de la culture chez les G e r s et la relation de la nature et de la culture
qui est nôtre. Cette présupposition fait question une fois la relation entre les Grecs
et nous vue comme un renversement asymétrique en forme de chiasme entre deux
termes, dont l’un (das Fremde) nous est inaccessible parce qu’il ne peut pas être l’objet
de notre perception, ou de notre connaissance, ni un objet pour un sujet. S’il est
jamais un objet, ce ne peut être que pour quelqu’un d’autre (les Grecs), non pas
pour nous. Le fait que notre relation aux Grecs est structurée non pas comme la
relation d’une conscience à l’objet de sa connaissance, mais comme un trope - le
chiasme est un renversement qui concerne seulement la relation des termes et non
leur constitution - indique déjà le problème, de même que le fait que dans la théorie
holderlinienne des tons, la relation d’un ton à l’autre, de la Gundstimmung au
Kunstcharakter, est exprimée non pas SOUS la forme d’une opposition entre le soi et
l’autre, mais explicitement en termes de signification (Zeicben) et de figuration
(Metapher). S’il le fallait vraiment, il aurait été plus facile d’assimiler la philosophie
de l’histoire de Holderlin à sa poétique que le contraire : par exemple, les renversements
en forme de chiasme comme celui de la Grèce par rapport à 1’Hespérie font intégralement partie de la théorie holderlinienne de l’alternance des tons - en fait, un tel
renversement en forme de chiasme entre le ton fondamental, la signification (Bedeutung),
et le ton du Krrnstcbarakter marque ce que Holderlin nomme la Katastrophe d‘un
poème épique, lyrique ou tragique.
Afin d’interpréter la poétique de Holderlin sur la base d’une philosophie de
l’histoire qui est conçue en termes d’oppositions dialectisables entre le soi et l’autre
- et afin de présupposer une relation identique ou du moins analogue entre ce qui
est propre (das Eigene) et ce qui est étranger (das Fremde) pour nous et pour les
Grecs - Szondi doit invoquer de sa propre autorité ce que nous avons bien en commun
(gleich), selon Holderlin, avec les Grecs : ce qui est le plus haut (das Hochste), (( c’est250
à-dire la relation vivante et l’habileté N (nümlich dem lebendigen Verbültnis und
Geschirk). Comme il faut s’y attendre, Szondi n’a pas de peine à interpréter la
(( relation vivante )) comme l’autre nom de la médiation dialectique des opposés qu’il s’agisse des tons différents d’un poème ou des natures différentes de peuples
historiques - mais son interprétation du Geschirk ne mène pour ainsi dire à rien et
une fois lue, elle menace d’invalider l’argumentation tout entière. Szondi comprend
tout à fait correctement le Gescbick que nous avons en commun avec les Grecs non
pas comme une commune (( destinée )) - car comment pourrions-nous avoir un destin
commun avec les Grecs si leur nature n’est pas la nôtre, etc.? - mais plutôt comme
une (( habileté », (( une capacité )) : en bref, comme la tecbnê grecque. En fait, il ajoute
à la dernière page de son essai : (( La lettre à Bohlendorff tout entière semble se situer
sous le signe de ce mot : c’est une lettre qui sort de l’atelier. )) (Geschick ist, mit dem
griechischen Wort, técbne, Im Zeichen dieses Wort scheint der Bohlendoorff-Brief insgesamt
zu stehen, es ist ein Brief aus der Werkstatt 1 4 . ) L’atelier de qui? pourrait-on demander
à bon droit, et répondre : du poète. La première lettre à Bohlendorff est une lettre
qui vient de l’atelier d’un poète et est destinée à un autre poète et elle porte sut les
conditions (différentes) du métier de poète pour les Grecs et pour (( nous ». En un
mot, cette lettre porte sur la terhnê de la poésie conçue comme le métier bien fait de
poète. A partir de là Szondi est parfaitement autorisé à importer la poétique holderlinienne de l’alternance des tons dans l’interprétation de cette lettre, puisque cette
dernière fait clairement partie des écrits (( poétologiques )) de Holderlin. Mais Szondi
n’est pas autorisé à convertir cette discussion au sujet de la technique, de la poésie
comme métier en un énoncé à propos de l’esthétique, en une déclaration portant sur
l’art. Plutôt qu’une lettre portant sur l’üstbetiscbe Praxis - ce sont les mots de
Szondi - ce texte porte plus proprement sur la poeti.de Praxis. En un mot, c’est le
glissement au moyen du mot grec technê - de l’art comme métier à l’art comme
objet esthétique, d’une catégorie de la poétique à une catégorie de l’esthétique - qui
permet à Szondi de convertir la poésie en art. Et le fait que ce soit un mot grec qui
puisse autoriser ce glissement est aussi peu accidentel que ne l’est l’invention des
Grecs comme constituant le moment esthétique de l’histoire occidentale. La poésie
doit être convertie en art pour que nous ayons le terme médiateur - la possibilité de
nous représenter nous-mêmes dans notre autre - qui peut réconcilier das Eigene et
das Fremde, la Grèce et 1’Hespérie. O n pourrait dire que Szondi doit sauver la poésie
pour l’art afin de sauver les Grecs pour l’Hespérie, mais, évidemment, l’inverse est
aussi vrai : afin de sauver les Grecs pour l’Hespérie, Szondi doit aussi convertir la
poésie en art. L’invention des Grecs comme constituant le moment esthétique de
l’histoire occidentale fait partie du même système qui doit (( esthétiser )) la poésie, la
re-constituer sur la base d’un modèle qui n’est pas linguistique mais (dialectiquement)
représentationnel, c’est-à-dire en fin de compte mimétique. Sans de tels Grecs et sans
une telle poésie, nous pourrions avoir à reconnaître non seulement qu’il n’y eut jamais
de Grecs ni de poésie grecque, mais aussi que la poésie n’est pas un art et que nous
ne sommes pas nous (c’est-à-dire ceux qui se constituent eux-mêmes en narrant le
récit selon lequel (( autrefois )) nous étions grecs et sommes (( maintenant )) (( hespériques », etc.). De sorte que c’est pour (( de bonnes raisons )) que Szondi désire sauver
les Grecs pour nous et la poésie pour l’esthétique : il veut nous sauver pour nousmêmes. Ce qui pourtant n’est pas sauvé dans un tel schéma, c’est le texte de Holderlin
- le texte comme texte, la poésie comme poésie (et non pas comme art). L’un des
symptômes en est le fait que la première lettre à Bohlendorff n’utilise pas une seule
fois le mot (( art )) (Kunst). Là où elle s’en approche le plus, c’est dans le mot
Kunstregeln, mais il est clair à partir d u contexte que ce qui est discuté, ce sont en
fait les règles techniques du faire poétique (tout comme dans la théorie holderlinienne
des tons le terme de Kunstrbarakter a plutôt à voir avec un (( caractère )) - dans le
sens de a lettre )) - artificiel, fabriqué, qu’avec de quelconques considérations esthétiques). En un mot, la lettre demeure une .lettre qui sort de l’atelier du poète, et
25 1
1 ’ art
~ )) en tant que catégorie esthétique est une importation nécessaire au schéma de
médiation dialectique de das Eigene et de das Fremde en termes du soi et de l’autre.
La (nécessaire) esthétisation par Szondi du schéma historique de Holderlin est très
lisible dans la phrase cruciale :
Les Grecs sont indispensables au poète hespérique parce que, dans leur art, il est
confronté à sa propre origine comme à quelque chose d’étranger (Die Griecben
sind dem hesperischen Dichter unentbehrlich weii er in ihrer Kunst dem eigenen
Ursprung ais einem Fremden begegnet).
L’introduction à la fois d’une (( symétrie en miroir )) - dans le mot begegnet, (( est
confronté »,avec son implication d’une opposition (gegen) - et de l’esthétique - en
faisant se confronter le poète hespérique avec l’art grec - dans cette phrase est fort
claire. Mais il est tout aussi clair qu’une médiation dialectique de ce qui nous est
propre et de ce qui nous est étranger, das Eigene et das Fremde - en un mot, une
représentation de das Eigene comme das Fremde (a notre propre origine comme quelque
chose d’étranger ») - n’est possible qu’aussi longtemps que nous ne lisons pas ces
mots dans le sens que Holderlin leur donne, mais les transformons, les traduisons en
quelque sorte en un sens hégélien : ce qui veut dire que, afin de reconnaître notre
origine, das Eigene, comme ce qui nous est propre dans l’art qui la représente comme
étrangère, das Fremde, nous devons traduire le das Fremde de Holderlin en un das
Fremde hégélien, une étrangeté qui n’est pas la nôtre (mais qui est naturelle pour les
Grecs, qui constitue leur propre) en une étrangeté qui nous appartient. Bref, nous
avons à traduire ce qui est radicalement étranger en ce qui est étranger pour nous,
c’est-à-dire en ce qui ne nous est pas réellement étranger, mais constitue notre propre
- das Fremde en das Eigene. Et si nous comprenons la nature grecque («le feu du
ciel », (( le pathos sacré ») comme (( oriental )) ou (( égyptien N - comme d’autres textes
de Holderlin nous autoriseraient à le faire - une telle traduction signifie alors la
transformation de l’Orient (les Egyptiens) - ce qui nous est radicalement étranger
parce que cela ne constitue pas notre étrangeté - en la Grèce - ce qui nous est naturel,
nationel, propre, etc. (Une autre manière de le dire : Szondi hégélianise le Fremde de
Holderlin pour qu’il signifie l’autre, c’est-à-dire l’opposition à un soi, alors que pour
Holderlin ce n’est précisément pas notre autre.) I1 n’est pas étonnant dès lors que
Szondi ait besoin de faire entrer en scène l’art en tant qu’agent médiateur de la
représentation de soi. Mais à partir du moment où nous lisons la phrase de Szondi
en un sens strictement holderlinien - (( notre propre N signifiant notre propre )) (c’està-dire le Grec) et (( étranger )) signifiant (( étranger )) (c’est-à-dire l’oriental) - elle
commence à prendre un sens insolite mais convenablement holderlinien : c’est-à-dire
que se confronter à ce qui nous est propre (das Eigene) en tant qu’étranger (das
Fremde) signifie se confronter à notre nature grecque (« la clarté de la représentation »,
(4 la sobriété junonienne D)en tant qu’orientale (« le feu du ciel »), (( le pathos sacré »,
cela veut dire, en un mot, représenter les Grecs en tant qu’orientaux. Cela a un sens
parfaitement holderlinien (bien que non hégélien) si nous nous souvenons des propres
paroles de Holderlin à propos de ses traductions de Sophocle : il mettrait en avant
ou (( ferait ressortir n l’élément oriental (das Orientaliscbe), ce que les Grecs ont refusé
(verleugnet) ou réprimé dans leur poésie, leur nature orientale. L’ennui avec l’interprétation de Szondi pourtant, c’est qu’une telle représentation de (( la clarté de la
représentation )) ou de (( la sobriété junonienne )) en tant que (( le feu du ciel )) ou (( le
pathos sacré », des Grecs en tant qu’orientaux (ou Egyptiens), n’est pas possible en
tant que représentation, mais ne peut avoir lieu qu’au moyen d’une traduction : c’està-dire au moyen d’une transposition, d’un transfert ou d’une métaphore qui se fonde
sur un modèle linguistique et non sur un modèle représentationnel tiré de l’expérience
de la conscience (c’est-à-dire l’opposition soi/autre, sujet/objet, etc.). Cela n’est possible, encore une fois, que par une traduction orientalisante, allégorisante des Grecs
252
comme celle de Holderlin. Et le récit que fait Szondi de la manière dont nous
inventons les Grecs, l’art grec, afin de nous reconnaître nous-mêmes en un autre, est
lui-même une traduction (des Orientaux en Grecs, des Hespériques en opposés des
Grecs) - c’est-à-dire qu’il a plus à voir avec la manière dont Szondi lit les mots grecs
qu’avec la manière dont il perçoit les représentations grecques - ce récit est lui-même
une allégorie : le récit de l’invention et de la destruction de l’esthétique, de l’art en
tant qu’esthétique, que nous faisons afin de dissimuler le fait que pour commencer
il n’y eut jamais d’art, le fait que (( pour commencer )) il y eut une traduction de soi,
une signification de soi, une allégorisation de soi, etc., qui ne peut jamais être l’activité
d’un soi mais qui est toujours l’opération d’encryptage de quelqu’un ou de quelque
chose d’autre en hiéroglyphes illisibles, en lettres mortes. En un mo;, nous inventons
les Grecs afin de nous distinguer nous-mêmes de l’Orient et des Egyptiens - pour
lesquels, après tout, das Fremde (disons (( la culture ») serait a le feu du ciel », (( le
pathos sacré N (c’est-à-dire la nature des Grecs, das Eigene) et, pour remplir le blanc
restant, pour qui das Eigene, la nature, serait (( la clarté de la représentation », (( la
sobriété junonienne », pour qui, en un mot, la relation de la nature et de la culture
serait exactement la même que la nôtre - ce qui pour la pensée allemande de la fin
du X V I I I ~siècle est synonyme d’« un règne de la mort », comme dirait Hegel -, une
mort dont le caractère terrifiant consiste à n’être pas notre propre, à n’être pas une
négation, mais celle de quelque chose ou de quelqu’un d’autre, d’absolument étranger
Cfremd), une mort sans mort 15.
Mais nous ne devons pas penser que le recours au pathos (pas si sacré que cela)
de l’Asie, de l’Orient et des Egyptiens nous permettra d’échapper à la tyrannie de la
Grèce et de tous ceux qui veulent transformer la poésie en art et les mots en tableaux
(ou, pour utiliser un vocabulaire proprement (( romantique », les allégories en symboles). I1 suffit de rappeler le destin de Holderlin en France : (( Et comme on le
prétend des héros, je puis bien dire qu’Apollon m’a frappé », dit-il dans la seconde
lettre à Bohlendorff, paroles qui acquièrent une résonance particulière lorsque nous
nous souvenons que, selon la première lettre à Bohlendorff, ce fut le mérite principal
d’Homère que de s’être approprié (( la sobriété junonienne occidentale pour son royaume
apollinien N (die abendlündische junonische Nüchternheit für sein Apollonsreich). Le feu
apollinien du ciel (qui correspond au dionysiaque de Nietzsche) n’est pas quelque
chose pour lequel on puisse être - ce qui voudrait dire par exemple qu’on est p o w
la mort sans mort de I’encryptage - tout comme la tyrannie de la sobriété et de la
représentation grecque n’est pas quelque chose contre lequel on peut être.
Un bon exemple de l’élasticité qu’ont les Grecs - et tous les présents qu’ils
apportent avec eux - est donné par le tout récent voyage de Holderlin en France
(rien moins qu’à Strasbourg) dans les deux essais de Philippe Lacoue-Labarthe : (( La
césure du spéculatif n et (( Holderlin et les Grecs )) 16. Dans ces deux essais, LacoueLabarthe n’hésite pas à formuler les vues de Holderlin dans toute leur radicalité.
Bien qu’il reprenne de Szondi la thèse du (( dépassement du classicisme )) chez
Holderlin, Lacoue-Labarthe va néanmoins plus loin et rejette même le rétablissement
dialectique de la Grèce (absente) en inscrivant une dualité en elle (et par conséquent
en nous). Que pouvons-nous déchiffrer des textes difficiles de Holderlin, demandet-il dans (( Holderlin et les Grecs », et il répond :
Derrière une thématique encore largement tributaire d e Winckelmann et,de Schiller
(même si Holderlin construit d e toutes nouvelles catégories), ceci, tout d’abord,
qui dans l’époque est parfaitement i n o u ï : à savoir que lu Grèce, comme telle, la
Grèce elle-même, n’existe pas. Mais qu’elle est au moins double, divisée - à la
limite déchirée. Et que ce que nous en connaissons, qui est peut-être ce qu’elle a
été ou ce qu’elle a manifesté d’elle, n’est pas ce qu’elle était en réalité - qui, en
revanche, n’est peut-être jamais apparu. D e même, corrélativement, l’Occident
moderne - ce que Holderlin n’identifie jamais tout simplement à l’Allemagne,
253
mais nomme, plus généralement, 1’Hespérie - n’existe pas encore, ou n’est encore
que ce qu’il n’est pas
17.
Pas de Grecs, pas de nous, ou du moins pas encore de nous, l’argument ne saurait
être plus clair. Et la Grèce qui n’a jamais existé est (( la Grèce, comme telle, la Grèce
elle-même »,c’est-à-dire la Grèce en tant que représentée et en tant que représentante,
la Grèce en tant que condition de possibilité de la représentation (de soi) (« comme
telle ») et d’identification (à soi) (« elle-même »), le moment esthétique par excellence.
Lacoue-Labarthe se montre aussi parfaitement cohérent dans les conséquences qu’il
tire de la non-existence de cette Grèce; le travail d u poète se révèle être la tâche du
traducteur :
Le propre des Grecs est inimitable parce qu’il n’a jamais eu lieu. Tout au plus estil possible de l’entrevoir ou, à la limite, de le déduire de son contraire - l’art. Et
de l’introduire, après coup, dans cet art. D’où le travail de traduction (et je pense
plus particulièrement à la traduction d’Antigone, conçue comme la plus grecque
des tragédies de Sophocle), qui consiste à faire dire au texte grec ce qu‘il ne cessait
de dire nais Jans jamais le dire. Qui consiste à répéter l’improféré de sa profération
même I ” .
Mais comment dire le non-dit des Grecs, ce qu’ils n’ont jamais cessé de dire sans le
dire? Comment répéter la profération de l’improféré? La tâche de traduire les Grecs
contient - est précisément la tentative de contenir - un a négatif )) dont on ne rend
pas facilement compte par une logique conventionnelle (mimétique ou dialectique)
et on peut lire le projet entier de Lacoue-Labarthe comme une tentative de trouver
les catégories qui seraient susceptibles de formuler la nature radicale de ce négatif ))
particulier à Holderlin sans transiger avec lui. (( La césure d u spéculatif )) formule
aussi le double bind vertigineux du traducteur hespérique de manière aussi intransigeante que possible - (( il faut bel et bien répéter ce qu’il y a de plus grec chez les
Grecs. Recommencer les Grecs. C’est-à-dire ne plus être grec d u tout l 9 )) - et s’il ne
parvient pas tout à fait à produire les catégories )) qui pourraient maîtriser sa
(( négativité )) particulière,
il est néanmoins capable de déployer les termes d’une
stratégie de la lecture qui le rendrait lisible, à savoir celle de Derrida :
Car en somme, il fallait, pour Holderlin, faire dire à l’art grec ce qu’il n’avait pas
dit, non sur le mode d’une sorte d’herméneutique visant l’implicite de son discours,
mais sur un autre mode - pour lequel j’ai bien l’impression qu’il nous manque
une catégorie - par où il s’agissait de faire dire, tout simplement, ce qui était dit
(mais) comme ce qui n’était pas d i t : la même chose, donc, en différance. u En
diaphéron héautô H 21’.
Le fait que (( l’un différencié en lui-même )) d’Héraclite (et sa traduction par Holderlin
dans Hypérion, K Das Eine in sich selbst unterscbiedene #) ne doit pas être compris ici
comme la différence d e l’un ou du même, mais doit être lu comme une différence
avec une différence, pour ainsi dire, cela apparaît clairement dans la formulation
même : (( la même chose... en différance ».
Et pourtant, au moment même où elles formulent rigoureusement la profondeur
de vue de Holderlin, les interprétations de Lacoue-Labarthe voudraient attribuer à
Holderlin une conception mimétique de la traduction et une conception sacrificielle
(dialectique) de la tragédie. Ce faisant, elles voudraient elles aussi réinventer les Grecs
- (( la Grèce comme telle D. La théorie holderlinienne de la traduction et sa théorie
de la tragédie sont en un sens spéculative, dialectique, de part en part, mais en même
temps elles (( désarticulent N, N neutralisent », (( paralysent D le spéculatif et le modèle
sacrificiel de la tragédie qu’il implique. La solution de Lacoue-Labarthe consiste à
formuler cette simultanéité en termes d’« oscillation »,d’« alternance », de (( paralysie ))
2 54
et pour le justifier il invoque la théorie holderlinienne de l’alternance des tons et son
concept de la a césure )) de la tragédie. Holderlin oscillerait )) entre l’articulation et
la désarticulation du spéculatif, sa théorie de la tragédie comme (( catharsis du
spéculatif )) (( césurerait )) le spéculatif - c’est-à-dire le constituerait dans sa déconstitution et vice versa. Mais on pourrait à juste titre se demander si 1 ’ alternance
~
))
holderlinienne autorise une telle N oscillation )) et si son concept de (( césure )) est
aisément assimilable à une catharsis )). Le fait que pour Holderlin l’alternance des
tons est un principe dynamique qui certainement (( anime )) un poème (plutôt qu’il
ne le paralyse) donne une indication, de même que le fait que la césure holderlinienne
a plus à voir avec la signification de soi (on pourrait dire allégorique) d’un texte où (( la représentation apparaît elle-même )) (die Vorstellung selber erscheint), où la
représentation se représente elle-même en tant que représentation - qu’avec aucune
a catharsis )) conçue selon un modèle sacrificiel, rituel, mimétique de la tragédie. (En
fait, ce que Holderlin nomme, dans la théorie de l’alternance des tons, la (( catastrophe ))
du poème - la césure - est explicitement un renversement - en forme de chiasme entre le ton du Kunstcbarakter et le ton de la Bedeutung, entre, pourrait-on dire, le
ton du signifiant et le ton du signifié.) Le problème avec l’interprétation de LacoueLabarthe, pourrions-nous dire, c’est qu’il continue à employer le discours de la mimésis,
a la mimétologie », bien après qu’il a perdu son utilité : c’est-à-dire à rendre compte
de processus textuels et d’un a négatif )) particulier au langage dont ce discours ne
peut par définition pas rendre compte. L’accouplement non problématisé, dans les
essais, de la mimésis et de la traduction, de l’art et de la poésie, est un symptôme,
comme la nécessité où se trouve Lacoue-Labarthe d’utiliser des formulations du type
(( l’écho de cette parole imprononcée N pour caractériser la nature abyssale de la tâche
du traducteur. Comment l’imprononcé peut-il faire écho sans passer de la représentation
à la signijcation (ou figuration), c’est-à-dire à un modèle dans lequel les catégories
mimétiques telles qu’a écho )) ne sont plus pertinentes? L’illustration la plus condensée
du double bind propre à Lacoue-Labarthe est peut-être la phrase finale de (( Holderlin
et les Grecs )) : (( La Grèce aura donc été ce vertige et cette menace : un peuple, une
culture s’indiquant, ne cessant de s’indiquer comme inaccessibles à eux-mêmes. )) Si
les Grecs s’indiquent eux-mêmes, se montrent à eux-mêmes, se signijïent eux-mêmes
en tant qu’inaccessibles à eux-mêmes, comment pouvons-nous alors les répéter ou les
traduire en recourant à un modèle, quel qu’il soit, de représentation cathartique,
sacrificiel, mimétique? Car la discordance, l’absolue incommensurabilité entre l’ordre
du rigne (Ns’indiquer D)et l’ordre de la mimésis (« comme D) est subtilement visible,
subtilement lisible, dans cette phrase. O n pourrait en effet dire que les Grecs se
signifiaient eux-mêmes en tant que (au sens non mimétique) cette discordance : un
peuple se signifiant lui-même en t a n t que ce qu’il n’est pas et voué par conséquent
à narrer (et à narrer sans cesse) le récit qui raconte comment ils ne peuvent lire leur
signification de soi, comment ils ne peuvent se lire eux-mêmes, une allégorie de
l’illisibilité. L’analyse de la raison pour laquelle Lacoue-Labarthe a besoin - du moins
dans (( La césure du spéculatif », qui est l’essai le plus ancien - de forcer les textes
de Holderlin à réintégrer les modèles mimétiques, sacrificiels, rituels, cathartiques de
la tragédie tout en voyant en même temps l’impossibilité d’une telle réintégration
exigerait une longue argumentation. Pour le dire brièvement, c’est en partie parce
qu’il reprend avec trop d’empressement l’interprétation dialectique hégélienne que
Szondi donne des essais théoriques, poétologiques de Holderlin : pour ce faire, il lui
faut, comme Szondi avant lui, ignorer le cadre et les catégories explicitement linguistiques (et même rhétoriques) que Holderlin emploie 2 ’ . Mais cela est dû, plus
encore, au fait qu’il reprend à Bataille une conception du sacrifice - la représentation
de la mort propre - fondée sur une interprétation anthropologique de la mort dans
la Phénoménologie de l’esprit de Hegel 22. L’ennui, c’est que la Phénoménologie n’est pas
une anthropologie - elle porte sur la conscience et non sur l’homme, du moins si elle
porte sur l’homme, c’est sur l’homme en tant qu’aufgehoben 2i - et ce que Hegel
255
nommerait mort de la conscience n’a rien à voir avec son extinction biologique
naturelle. Ce qui fait de la conscience une conscience - c’est-à-dire la condition qui
la rend capable d’être une conscience de soi - c’est précisément qu’elle ne (( meurt N
pas comme un chien ou un chat mais qu’elle peut se représenter sa propre mort à
elle-même; dans les termes mêmes de Bataille :
Pour que l’homme à ia fin se révèle à lui-même il devrait mourir, mais il lui
faudrait le faire en vivant - en se regardant cesser d’être. En d’autres termes, la
mort elle-même devrait devenir conscience (de soi), au moment même où elle
anéantit l’être censcient
24.
Bataille a tout à fait raison de dire que faire de sa propre mort un spectacle pour
soi-même, un (( subterfuge N - un théâtre, une représentation, en un mot, un sacrifice est nécessaire, mais parce qu’il identifie (( l’être conscient )) avec (( l’homme », le sacrifice
auquel il pense ressemble plus à l’extinction de (( l’homme n qu’à la mort de la
conscience, plus à la (( mort N d’un chat ou d’un chien qu’à la mort de la conscience.
Dans la mesure où Lacoue-Labarthe reprend à Bataille cette interprétation anthropologique et mimétique du sacrifice - sans reprendre les conséquences radicales
(nietzschéennes) que Bataille en tirera - sa lecture de Holderlin menace de régresser
en deçà de ce qu’elle a pris en vue et de retomber dans un modèle mimétique. Mais,
c’est évident, le (( subterfuge )) qui autorisera la conscience à se représenter sa propre
mort à elle-même, à survivre à sa propre mort, pour ainsi dire, à s’identifier soimême dans la disparition d’un chat ou d’un chien, par exemple, ne peut pas être
une opération mimétique. Il faut que ce soit une opération linguistique, et même
rhétorique, de signification de soi ou de figuration de soi - mieux même d’inscription
de soi - car la mort propre n’est pas quelque chose (ou un néant de chose) qui puisse
jamais devenir un objet de conscience, tout comme nous ne pouvons faire l’expérience
de la mort, nous pouvons seulement la nommer, lui donner un sens (au moyen disons
de la catachrèse), lui donner un visage, des yeux et un point de vue (au moyen de
la prosopopée, comme le fait Hegel quand il parle de regarder le négatif qu’est la
mort en face (dem Negativen ins Angesicbt scbaut 2 s ) . Et parce que c’est une opération
linguistique, une telle (( représentation )) fait entrer dans le monde encore une autre
mort - ce que Blanchot nomme (( la mort sans mort )) - dont l’existence est (( réelle N
et déterminée mais complètement hors d’atteinte d’un soi ou d’une conscience ou
d’un sujet : quand nous disons (( je meurs », nous subissons la mort de l’impossibilité
de mourir; le (< je N en tant que sujet linguistique, grammatical ne peut jamais mourir
parce qu’il a toujours déjà trépassé, il est toujours déjà mort. Dire (( je meurs 1) c’est
dire (( la mort meurt )) - et la mort n’est pas un soi ou une conscience ou un sujet :
la mort peut seulement mourir et ne peut jamai5 mourir 2 6 . Cette troisième autre mort
- la première étant (( l’extinction biologique »,la seconde (( la mort de la conscience )) nous pourrions l’appeler avec Blanchot (( la mort de l’écriture )) (ou, aussi bien, la
mort de la lecture) : l’inscription matérielle ou la lettre morte qui ne tue pas parce
qu’elle est immédiate, sensuelle, etc. - non parce qu’elle tue l’esprit en étant opposée
à lui - mais plutôt parce qu’elle contient un esprit de mort, la mort de l’esprit en
un sens purement allégorique. C’est cette mort, prétendons-nous, que les interprètes
de Holderlin ne peuvent pas, ne veulent pas lire dans la première lettre à Bohlendorff
- où elle est inscrite en tant que constituant la nature des Grecs ( a le feu du ciel »,
(( le pathos sacré D) qui nous est pour toujours inaccessible et qui est figurée ailleurs
dans l’œuvre de Holderlin comme l’Orient et les Egyptiens - et qui explique pourquoi
cette lettre ne peut jamais être remise ni retournée (sauf au Bureau des lettres mortes,
c’est-à-dire à une Grèce qui n’a jamais existé). Et c’est afin de ne pas lire cette lettre
morte que Szondi comme Lacoue-Labarthe ré-inventent les Grecs - le premier en
esthétisant la poésie et en an-esthétisant la mort des Grecs, le second en l’anthropologisant - tout en sachant que les Grecs n’ont jamais existé. Comme tous les Grecs,
ils ne peuvent lire leur propre récit.
256
Mais de crainte que nous ne prenions avec légèreté ce retour non garanti des
Grecs (qui n’existent pas) dans une (( allégorie de l’illisibilité )) - dans un récit que
nous nous faisons à nous-mêmes afin de nous (dé-)constituer nous-mêmes en tant
que ceux qui ne peuvent (s’empêcher de) lire leur propre récit - comme une aberration
propre aux idéalistes qui ont échoué, prenons comme dernier exemple une interprétation de l’art, des arts dits picturaux ou visuels. Dans Art and Iiiusion, E. H. Gombrich
écrit un chapitre intitulé (( Réflexions à propos de la révolution grecque )) dans lequel
il caractérise le nouveau mimétisme de la sculpture et de la peinture grecque, en le
comparant en particulier à l’art éminemment (( pictographique », (( hiéroglyphique ))
des Egyptiens. II attribue cette (( révolution )) de la représentation à la découverte, par
les sculpteurs et peintres classiques, de la narration grecque, en particulier d’Homère :
Quelles sont en effet les caractéristiques de la narration grecque, telles que nous
les connaissons d’après l’œuvre d’Homère? Nous pourrions les résumer en disant
que le narrateur cherche à décrire, non seulement l’événement lui-même, mais la
façon dont il se produit 27.
Sa reconnaissance de la différence constitutive entre la nature de l’art égyptien et celle
de l’art grec conduit Gombrich à nous adresser cet avertissement :
Nous ne devrions jamais oublier que nous observons tous l’art égyptien avec une
mentalité héritée et formée par l’art de la Grèce. Aussi longtemps que nous
estimerons que les images égyptiennes avaient à leur époque le même sens qu’elles
peuvent avoir aux yeux du monde qui a succédé à la civilisation grecque, elles
pourront nous apparaître quelque peu enfantines et naïves. Ce genre d’erreur, les
observateurs du XIX‘ siècle l’ont fréquemment commis. Ils nous ont décrit les
peintures et les bas-reliefs des tombeaux égyptiens comme une représentation des
scènes de la vie quotidienne N en Egypte. Mais dans un ouvrage récent, Arrest
and Movement, Mrs. Frankfort-Groenewegen a bien fait ressortir que cette interprétation, qui nous est habituelle, provient de notre formation grecque. Nous
sommes accoutumés à regarder n’importe quelles images comme s’il s’agissait
d’illustrations ou de photographies, afin d’y trouver le reflet d’une réalité présente
ou imaginaire *”.
((
Car là où l’Égyptien peut s’occuper seulement du (( contenu n de sa représentation il veut par exemple représenter le Pharaon en tant que Pharaon, dont la position et
le visage peuvent être les mêmes position et visage conventionnels prescrits et codifiés
depuis dix mille ans - l’artiste grec veut (( convaincre D et s’enquiert d u (( comment M
de la représentation :
En effet, du moment où les Grecs ont vu, dans les modèles typiques de l’art
égyptien, des images qui s’efforcent de convaincre N par leur aspect de réalité, ils
devaient inévitablement se demander pourquoi cet aspect paraissait si peu convaincant. Nous avons exactement la même réaction quand nous parlons de leur attitude
figée ». On pourra nous dire encore que cette réaction provient elle-même de
l’influence de la Grèce dans notre formation. Ce sont les Grecs qui nous ont appris
à nous demander : N Comment se tient-il? », ou encore (( Pourquoi a-t-il cette
attitude? )) En face d’une d’œuvre d’une époque antérieure à l’art grec ce genre de
questions risque de n’avoir aucun sens. Une statue égyptienne ne cherche pas à
représenter un homme dans une attitude rigide ou dans une position détendue,
ce qui compte ici ce n’est pas la manière, mais la signification. Demander plus
aurait surpris l’artiste égyptien autant que pourrait nous surprendre quelqu’un qui
nous demanderait quel est l’âge ou le caractère du roi sculpté d’un jeu d’échecs
((
((
257
Mais cet avertissement proprement holderlinien - nous ne devons pas lire les signes
allégoriques comme s’ils étaient des représentations symboliques - et la clarté de sa
distinction entre l’art égyptien et l’art grec commence à vaciller vertigineusement
quand Gombrich met une œuvre d’art égyptienne en regard de sa contrepartie grecque :
Mais nous trouvons dans les œuvres d’art des indications susceptibles de confirmer
que les Grecs de la période archaïque avaient tendance à voir dans les œuvres
pictographiques égyptiennes des représentations d’une réalité imaginaire. Le vase
dit de Busiris », du ve siècle avant Jésus-Christ, que l’on peut voir aujourd’hui
à Vienne, en est un exemple particulièrement frappant et divertissant. I1 n’est pas
douteux que otte scène humoristique et narrative d’un épisode des exploits
d’Héraclès en Egypte ne soit inspirée de quelques représentations égyptiennes de
campagnes victorieuses. Cette forme de chronique picturale, où l’on volt l’image
d’un Pharaon gigantesque attaquant une forteresse ennemie, avec ses minuscules
défenseurs implorant la clémence, nous est en effet familière. Selon les conventions
de l’art égyptien, les différences d’échelle sont significatives des différences de rang
ou de position sociale. Pour l’artiste grec, qui voyait dans une image picturale
l’évocation d’un événement plausible, cette forme de représentation devait évoquer
une scène où un géant se trouve confronté à des Pygmées. Ainsi va-t-il identifier
le personnage du Pharaon à celui d’Héraclès écrasant une troupe de chétifs
Égyptiens. La représentation pictographique d’une cité a pris la forme d’un autel
véritable sur lequel se sont réfugiés deux misérables victimes, mais c’est en vain
qu’elles tendent les bras dans une gesticulation comique et désespérée. Les attitudes
représentées dans cette scène sont comparables par de nombreux détails à celle des
personnages des bas-reliefs égyptiens, et cependant la signification en est changée :
ces hommes ne sont plus d’anonymes représentations d’un peuple vaincu, mais
des individualités réelles - ridicules, certes, dans leur agitation désespérée; mais
le rire qui nous prend à les regarder suppose que nous faisons un effort d’imagination
pour visualiser la scène que l’on nous présente et pour comprendre, non seulement
le sujet de l’épisode, mais la manière dont les choses se passent 30.
((
L’« erreur )) grecque est suffisamment claire : ils ont pris les signes allégoriques égyptiens
comme s’ils étaient les représentations d’une réalité imaginaire 1). Tandis que dans
l’œuvre égyptienne la taille gigantesque d u Pharaon par rapport à ceux qu’il est en
train de vaincre est seulement (( significative d’une différencg de rang »,dans la peinture
grecque la taille plus grande d’Héraclès par rapport aux Egyptiens qu’il est en train
de vaincre est une peinture mimétique de sa taille et de sa force supérieures. Et dans
le cas, d u moins, d u vase de Busiris, cette faute de lecture qui consiste à tout prendre
à la lettre est loin d’être une (( erreur N, car elle permet à l’artiste grec non seulement
de s’approprier l’art égyptien en le prenant pour ce qu’il n’est pas (c’est-à-dire grec),
mais aussi de le retourner contre les Egyptiens (en transformant un Pharaon vainqueur
au milieu d u peuple de Canaan en un Héraclès grec vainqueur des Egyptiens) et par
là de marquer la supériorité de la Grèce sur 1’Egypte. (C’est comme si on voulait
prendre la Charité allégorique de Giotto pour la peinture d’une jeune cannibale offrant
un cœur - une (( erreur N qu’on pourrait faire seulement en oubliant de lire l’inscription
x Karitas 2 que Giotto a heureusement ajoutée.) Mais il n’est pas nécessaire de voir
ces peintures pour remarquer le cercle vicieux que contient l’argumentation de
Gombrich et pour demander : comment pour commencer avons-nous été capables de
dire la différence qu’il y a entre l’art égyptien allégorique et l’art grec symbolique?
I1 est clair que si la peinture grecque a l’air plus réaliste, plus mimétique, plus
préoccupée par le (( comment », en un mot, plus semblable à la représentation d’une
réalité imaginaire, c’est seulement parce que nous la regardons avec les structures
mentales que nous avons toutes héritées des Grecs : en d’autres termes, c’est seulement
parce que nous les regardons avec des yeux grecs - à travers notre métaphysique,
notre ontologie, notre épistémologie, etc., grecques - que nous sommes capables de
distinguer l’art dit égyptien de l’art dit grec. En distinguant l’art grec de l’art égyptien,
((
258
nous re-faisons la faute de lecture des Grecs qui consiste à tout prendre à la lettre :
nous regardons l’art égyptien (et l’art grec) avec des yeux grecs. Si nous pouvions
regarder le vase de Busiris avec en quelque sorte des yeux égyptiens, qui sait ce que
nous y verrions ... qui sait ce que nous y lirions.? Si nous devions nous limiter à la
simple différence de taille des figures dans chaque œuvre respective, nous pourrions
dire que la distinction de Gombrich entre l’art égyptien et l’art grec revient à voir
(( A a )) et (( A a )) et à désigner le premier sous le nom d’« égyptien )) et le second
sous le nom de (( grec )), le premier comme pictogramme, le second comme représentation d’une réalité imaginaire - et, selon une élaboration idéologique (typiquement
propre à l’idéalisme allemand), le premier comme (( primitif », (( infantile », (( préréflexif »,etc., et le second comme c civilisé », (( adulte », (( conscient de soi »,etc. : le
premier comme a pré-art )) (Vorkunst), comme dirait Hegel, et le second comme (( art ))
(Kunst). Bref, pour faire le récit du passage de la signification allégorique à la
signification symbolique, Gombrich, en dépit de sa prudence, doit précisément oublier
qu’il regarde l’art égyptien avec des yeux grecs : même son récit qui voudrait se
souvenir de l’oubli des Grecs répète leur oubli. Le fait est qu’un tel (( regard )) est
une lecture arbitraire et une lecture allégorique (idéologiquement motivée) : nous ne
voyons pas la différence entre les Egyptiens et les Grecs, nous la lisons. I1 se peut que
le seul moyen même pour les peintures de devenir des peintures consiste pour elles
à être transformées en mots : tout comme l’art ne peut devenir art que si nous
oublions qu’il est poésie (égyptienne).
Andrejz Warminski
(Traduit de l’anglais par Françoise Dastur)
NOTES
1. E.M. Bulter, The Tyranny of Greece over Germany, Boston, Beacon Press, 1958, p. 203-204
2. The American Heritage Dictionary of the EngIirh Language.
3. Toutes les références données dans cet article sont celles de la grande édition de Stuttgart des
œuvres de Holderlin publié par Cotta : les chiffres romains indiquent les volumes et les chiffres arabes
les pages. [La traduction de la seconde lettre à Bohlendorff est celle, parfois légèrement modifiée, de
d. T . ) . ]
Denise Naville dans Holderlin, (Euores, Gallimard, (( La Pléiade », 1967, p. 1009-101 1 (N.
4. Pour l’interprétation de cette relation difficile de la poétique et de l’herméneutique, voir (( Introduction n de Paul de Man à Hans Robert Jauss, Toward an Aesthetic of Reception, trad. Timothy Bahti,
Minneapolis : University of Minnesota Press, 1982. La critique de la catégorie de 1 ’ esthétique
~
dans
les travaux récents de Paul de Man nous a aidé à comprendre les enjeux théoriques de notre lecture
en progrès )) de Holderlin : Sign and Symbol in Hegel’s Aesthetics », Critical Inquiry, vol. VIII, no 4,
été 1982, p. 761-765; (( Hypogram and Inscription : Michael Riffaterre’s Poetics of Reading », Diacritics,
vol. II, n<’4,hiver 1981, p. 17-35; Hegel on the Sublime », à paraître.
5. Sur Bohlendorff, voir les notes du vol. VI de la grande édition de Stuttgart (VI : 2, 1074).
6. Un héritier », il n’est pas besoin de le dire, en un sens des plus problématiques. Cf. Andrzej
Warminski, (( Heidegger Reading Holderlin », in Readingr in Znterpretation : Hofderfin, Hegel, Heidegger,
Minneapolis : University of Minnesota Press, 1984.
7. Peter Szondi, (< Ubenvindung des Klassizismus », Hofderfin-Studien, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1970, p. 98. [Traduction française in Peter Szondi, Poérie et Poétique de I’idéaiisme afiemand,
Ed. de Minuit, 1975, p. 229 (N.
d . T.).]
8 . Ibid., p. 109-1 10. [Trad. p. 239-240 (N.
d. T.).]
9. Ibid., p. 116. [Trad. p. 245 (N.
d. T).]
10. Ibid., p. 112-1 13. [Trad. p. 242-243 (N.
d . T.).]C’est même encore plus explicite dans Szondi,
Poetik und Geschichtsphifosophie, Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, 1974, p. 170 : U Sowenig Homer dem
naiven Kunstcharakter Jeiner Epen deren Ausgangspunkt (die Bedeutung), namlich das heroische Gegeneinander grosser Bestrebungen geopfrt hat, rowenig d a d ro betont es der Brief a n Boblendor$ über dem
))
((
((
((
((
2 59
Erlernen des Fremden dus Eigene vergessen werden, dessen freier Gebraurb also nirbt mebr dus Ausgeliefert
rejektierte Verwendung als eines Momentes im Kunstwerk, da5 Scbwerste sein soll. H
1 1. Szondi, U Gattungspoetik und Geschichtsphilosophie », aussi in Holderlin-Studien. [«Poétique des
genres et philosophie de l’histoire », in Poésie et Poétique de I’idéalisme allemand, op. rit., p. 248-289
(N.d. T.).]
12. Szondi, Überwindung », p. 100. [Trad. p. 23 1 (N.
d. T.).]
13. Andrzej Warminski, (( Endpapers : Holderlin’s Textual History », in Readings in interpretation,
op. rit.
14. Szondi, (( Überwindung ... )) p. 118. [Trad. p. 247 (N.
d. T.).]
an ihm, sondern seine
((
15. Dans son essai un peu plus tardif, (( Poétique des genres et philosophie de l’histoire », Szondi
parle d’un changement dans la conception que le dernier Holderlin se fait de la relation de la Grèce et
de 1’Hespérie : il s’agit non plus d’une symétrie en miroir sursumable mais d’un saut qualitatif (zum
qualitariven Sprung). Par là, Szondi ne renonce pas aux Grecs en tant que constituant le moment
esthétique dans l’histoire occidentale; il ne fait que transférer ce motif dans l’histoire du développement
poétique de Holderlin : la première lettre à Bohlendorff marquerait maintenant le moment esthétique
de l’itinéraire holderlinien (du moins le moment d’une médiation dialectique théoriquement réussie
entre la Grèce et I’Hespérie). Dans un tel schéma, l’œuvre antérieure pourrait alors être considérée
comme pré-réflexive »,et la toute dernière œuvre comme une destruction des oppositions médiatisées
dans la première lettre à Bohlendorff - l’une et l’autre étant constituées comme (< pré- n et (< post- D
grâce à l’invention de la synthèse dans cette lettre, grâce, comme toujours, à la ré-invention des Grecs.
L’itinéraire propre de Szondi pourrait également être lu selon les termes d’un tel schéma - l’interprétation
de la lettre à Bohlendorff servant de moment (( grec n - ce qui n’est nullement surprenant dans le cas
d’un lecteur qui s’inscrit lui-même dans le texte de Holderlin comme le destinataire de la première
lettre à Bohlendorff.
16. Philippe Lacoue-Labarthe, La césure du spéculatif », in Holderlin, L’Antigone de Sophocle, trad.
Lacoue-Labarthe, Paris, Christian Bourgois, 1978; (( Holderlin et les Grecs »,Poétique 40, novembre 1979,
p. 465-474. [Ces deux essais sont maintenant rassemblés dans Ph. Lacoue-Labarthe, L’imitation des
Modernes, Galilée, 1986, p. 39-84 (N.
d. T.).]
17. Lacoue-Labarthe, Holderlin et les Grecs », lor. rit., p. 470. [L’imitation des Modernes, p. 78.1
18. ibid., p. 473. [L’imitation des Modernes, p. 83.3
19. Lacoue-Labarthe. (( La césure »,p. 206. [L’imitation des Modernes, p. 55.3
20. ibid., p. 204. [L’imitation des Modernes, p. 53-54.
2 1. Cela est tout à fait visible N dans le fait que Lacoue-Labarthe cite Holderlin de manière non
critique à propos de la tragédie : c’est-à-dire sans se demander jusqu’à quel point des termes tels que
Zeirben, Metapher, Uebertragung, etc., sont assimilables à une conception spéculative de la tragédie. Par
exemple, la définition de la tragédie comme (< la métaphore d’une intuition intellectuelle )) (Es ist die
Metapher einer intellektuellen Anscbauung) n’est pas aisément reprise par le modèle spéculatif.
22. Georges Bataille, Hegel, la mort et le sacrifice », Deucalion 40, octobre 1955. Lacoue-Labarthe
fait allusion à ce texte au début de La césure ».
23. Thérapeutique à cet égard est, comme toujours, Jacques Derrida, Les fins de l’homme »,Marges,
Paris, Minuit, 1972.
24. Bataille, lor. rit., p. 32.
25. G.W.F. Hegel, Phünomenologie des Geistes, Hambourg, Meiner, 1952, p. 30. [Trad. J. Hyppolite,
La Phénoménologie de I’esprit, Aubier Montaigne, p. 29 (N.
d. T.).]
26. Cf. Maurice Blanchot, La littérature et le droit à la mort », in La Part du feu, Paris, Gallimard,
1949.
27. E.H. Gombrich, Art and illusion, Princeton, Princeton University Press, 1969, p. 129. [Trad. par
d. T.).]
G . Durand, L’Art et L’illusion, Gallimard, 1971, p. 17 1 (N.
28. ibid., p. 122-123. [Trad. p. 162.1
29. Ibid., p. 134. [Trad. p. 176.1
30. Ibid., p. 134-136. [Trad. p. 178-179.1
((
((
((
((
((
((
(<
La Grèce,
la tragédie
Holderlin et Sophocle
Wolfgang Binder
Holderlin et Sophocle : deux noms qui appartiennent aujourd’hui à la figure
spirituelle de ce que l’on appelle l’occident. Sophocle : d u temps de Holderlin déjà
on l’envisageait sous ce jour. Holderlin : c’est au xxesiècle seulement qu’on a appris
à le voir ainsi; quant à ses traductions de Sophocle, impossible encore d’affirmer
qu’elles s’inscrivent dans cette perspective. S’interroger sur le rapport entre Holderlin
et Sophocle semble évoquer non seulement un épisode historique de la culture
occidentale, mais une part de la compréhension de l’occident par lui-même.
Toutefois, notre époque s’attache-t-elle à cette culture et à cette auto-compréhension? N e s’emploie-t-elle pas plutôt à se libérer de son lourd passé culturel et à
enterrer à jamais l’Occident déjà souvent prétendu mort? Si oui, notre sujet voudraitil dire plus alors que la tentative de clarifier, à l’aide d’un exemple, ce dont il nous
faut prendre congé?
Cela est dit sans ironie. L’insatisfaction croît à l’égard de l’histoire; on veut un
nouveau commencement sans référence à l’histoire - volonté qu’on ne peut éliminer
en invoquant simplement l’utopie de quelques contemporains dénués de sens historique. O n ne veut plus penser ainsi, par crainte d’être freiné par la conscience historique
ou par manque dans l’histoire des catégories pouvant correspondre à un présent en
mutation constante et incessante. Cela est dit aussi sans résignation. En effet, faut-il
continuer à penser en termes historiques sous prétexte qu’on le fait depuis deux
siècles? Pour quelle raison un avenir où l’occident se sera évaporé dans le merveilleux
de la légende ne serait-il pas à sa manicre plus heureux qu’un présent empêtré dans
des traditions dont il ne vient à bout? Etre pour ou contre la Tradition est l’une des
façons dont s’exprime la crise de l’époque actuelle et la balance semble pencher de
1’«utilité n vers 1’« inconvénient de l’Histoire pour la vie ».
Holderlin connaissait cette situation; il y a répondu à deux reprises. A la ville
d’Agrigente en émoi, aspirant comme un corps malade à sortir de l’ornière de l’ordre
établi, Empédocle conseille :
* Holderlin und Sophokles, in Holderlin Jabrburb, 1969-1970. Repris in W. Binder, Aufsrblüsse.
Srudien zur deutsrben Literatur, Zurich, 1976.
263
Ainsi, osez! votre héritage. votre acquis,
Histoires, leçons de la bouche de vos pères,
Loi et coutume, noms des dieux anciens,
Oubliez-les hardiment, et levez, comme des nouveau-nés,
Les yeux sur la nature divine.
Dans le même sens, et visant l’héritage trop puissant des Anciens, un Essai
déclare : (( I1 semble ne pas y avoir d’autre choix que d’être opprimé par ce qui est
reçu et positif, ou, avec une violente arrogance, de s’opposer, force vive, à tout ce
qui est appris, donné, positif. n Si la tradition est devenue un poids mort - le
(( positif )) étant la loi, qui ne vaut que parce qu’il est -, alors ses valeurs ne mobilisent
plus rien et il ne reste plus qu’à faire surgir, dans l’espace délivré de toute tradition,
un commencement nouveau et singulier.
Malgré cela, Holderlin a traduit Sophocle. O n lit dans les Remarques sur
Antigone que dans la crise, là où (( l’esprit s’éveille au comble de sa puissance »,
l’homme doit (( tenir bon le plus fermement », et l’analogue historique de cette crise,
le (( retournement natal de tous les modes de représentations et de toutes les formes
[...I sans aucune retenue n’est pas permis à l’homme en tant qu’être connaissant ».
Mais à quoi se tenir si ce qui arrive est encore incertain? Manifestement, au produit
du devenir. Pas pour le rendre éternel - seule la crise le deviendrait -, mais pour le
comprendre. Car je ne puis prendre une direction que si je sais d’où je viens. A
l’homme (( connaissant », dit Holderlin, il n’est pas permis de se vouer, dans la crise,
à l’instant et à ses paroles changeantes.
Le Devenir dans la disparition, où Holderlin décrit dans son être un virage
historique et sa présentation par l’art, souligne déjà cette nécessité. Le nouveau, ici,
ne provient pas simplement de l’ancien, mais de l’inépuisable plénitude des possibilités
historiques qui, recouvertes quand domine un état déterminé du monde, s’introduisent
maintenant dans la (( lacune N entre l’ancien en disparition et le nouveau en devenir.
Si le choix de l’unique possibilité qui se réalise - une seule peut devenir réalité ne doit pas être laissé au hasard, à son danger mortel, il faut d’abord préciser que
l’être de l’ancien, la raison de son déclin exigent une compréhension totale. Cette
saisie par récapitulation, Holderlin la nomme le (( souvenir n et la (( dissolution idéale ))
qui résout intellectuellement, c’est-à-dire analyse, ce qui dans l’histoire passe. Cellelà accomplie, s’avancer dans le nouveau ne sera plus, comme au début de la crise,
un (( objet de crainte », mais entièrement 1’« acte infaillible, irrépressible, hardi n qu’il
doit être pour porter l’assentiment de ses contemporains aux temps nouveaux. - I1
serait bon d’y être déjà; mais nous n’en sommes qu’au stade de la crainte.
De tels propos et la conscience souvent proclamée de devoir répondre à une
époque de bouleversement politique et culturel laissent penser que Holderlin a traduit
Sophocle non pour enrichir le domaine littéraire allemand de la traduction ou pour
prouver ses capacités de traducteur, mais pour mieux saisir sa propre provenance et
sa propre destination qui sont en même temps celles de son époque. Car traduire,
c’est franchir, toucher le rivage de l’étranger, de sa langue, de son mode de penser,
de sa culture, et - en retour - par son apport, à son contact, reconnaître le propre.
Même en suivant Holderlin, il nous est permis de comprendre notre tentative,
toutes proportions gardées, comme une contribution à une meilleure saisie de notre
provenance. L’hybris consisterait à parler de destination, d’autant que l’histoire ne
se répète qu’en apparence. Je souhaite procéder de sorte que l’on s’entende d’abord
sur la théorie et la pratique de la traduction chez Holderlin, pour passer ensuite
à ses interprétations d’CEdipe et d’Antigone - il faudra se limiter à quelques points.
Ce que j’ai à dire tient compte à maintes reprises des recherches de Friedrich
Beissner, de Wolfgang Schadewaldt et d’une abondante littérature philologique
classique parmi laquelle il faut nommer en particulier le Sophocle de Karl Reinhardt 2 .
’
264
Que l’on ne s’attende pas à des idées grandioses. Ma tâche consiste à présenter
en l’interprétant aussi simplement que possible une partie complexe de l’œuvre de
Holderlin.
I
Dans un hymne tardif de Holderlin,
((
L’Ister )), on trouve les vers :
Nul sans ailes ne peut
Saisir le Plus-Proche
Directement
Et passer de l’autre côté.
Le a Plus-Proche )) est le propre, 1 ’ hespérique
~
», appelé plus tard le (( natal ».
I1 est N de l’autre côté »; car celui qui prononce ces vers vient de 1’« Indus )) et de
1’«Alphée », il a longuement cherché au-dehors (( ce qui convient )), avant de croire
le trouver, en remontant le Danube, dans le pays natal : (( C’est ici que nous voulons
bâtir. D Les vers retracent le retour de l’Hellade à l’Hespérie, et les traductions de
Sophocle constituent un document sur le retour de Holderlin bien plus que sur son
départ vers la Grèce. Mais il ne s’agit pas d’un retour facile. Le poème parle des
(( ailes )) dont il faut être avant tout OUN NU, et la première lettre à Bohlendorff dit
du (( libre usage de ce qui nous est propre », qu’on ne peut apprendre qu’à l’étranger,
qu’il est le plus difficile, ce qui ne s’atteint qu’en dernier, tout en étant aussi le plus
haut à quoi puisse parvenir un homme ou une nation. Au passage, qu’il me soit
permis de rappeler le chemin que dut parcourir Holderlin jusque-là, et qui était
d’abord le chemin de son époque, pour ensuite s’engager dans une direction inédite,
la sienne propre.
L’enthousiasme du jeune Holderlin pour les Grecs fut, si je puis dire, allégorique.
I1 avait valeur d’idéal auquel les Grecs n’attachaient que leur nom, comme la Nature,
l’Harmonie et d’autres puissances spirituelles. Holderlin regardait vers le haut quand
il se retournait vers l’Hellade. C’est la seule raison pour laquelle il put célébrer en
Diotima un retour de l’élément grec. N e l’assurant que de sa propre position,
l’identification réussit incontestablement.
Vient alors cet essai qui soudain éprouve la supériorité écrasante du modèle
grec. La balance penche de l’autre côté; une étude minutieuse lui a révélé les Grecs
dans leur dimension historique. Au même titre que nous, ils constituent maintenant
une réalité, mais qui l’emporte sur nous quant au résultat culturel. D’où leur poids
sur nous. Si nous ne voulons pas éternellement vivre et produire dans leur ombre, il
faut nous en libérer.
Toutefois, cette dénonciation ne prépare qu’un troisième niveau de compréhension : il existe une voie moyenne entre l’académisme et la rupture avec la tradition.
Ainsi, la tentative de se libérer de l’asservissement à la lettre d u grec pour s’ouvrir
à l’esprit du grec; à son contact, on apprend ce que peut être l’esprit en général,
donc aussi pour une poésie moderne, elle-même reposant sur un autre sol. Holderlin
écrit à Schiller, en 1801, qu’il a longuement étudié la littérature grecque jusqu’à ce
qu’elle lui rende la liberté qu’elle lui avait ravie au début. Maintenant seulement,
ajoute-t-il, il voit que (( la grande précision des auteurs grecs )) doit nécessairement
être issue de (( leur plénitude d’esprit ».
La précision de la poésie grecque, non pas comme expression d’un sens des règles
poétiques, ce qu’a cru le XVIII‘ siècle, mais comme conséquence d’une plénitude
265
d’esprit - que veut dire par là Holderlin? I1 pense, d’autres passages en témoignent,
que l’esprit des Grecs en soi déporté dans l’illimité, s’est imposé la forme la plus
stricte dans ses productions afin, à travers elles, de pouvoir reprendre fermement pied.
Nous sommes proches de la conception de Holderlin selon laquelle Sophocle a
contraint la figure insoutenable du partage (Schicksai),qui mène proprement à la
démence, à tenir, par la structure formelle de la tragédie et par les hommes qui
reçoivent l’insoutenable, dans un cadre supportable. Le texte et l’interprétation des
pièces de Sophocle sont pleins de paroles démentes, de la (( quête démente d’une
conscience »,etc., souvent obtenues en forçant sciemment le sens du grec. Mais il faut
circonscrire un peu plus précisément ce dernier niveau de compréhension des Grecs.
I1 s’agit de l’éternelle question sur la Grèce et 1’Hespérie. Je me contenterai de très
brèves indications, pour relever davantage ce qui jusqu’ici me semble avoir été trop
peu souligné.
Suivant une pensée qui ne se limite pas à l’apparition des choses, mais cherche
le (( fondement )) ou 1’« origine N de cette apparition, Holderlin finira par envisager
aussi cultures et peuples dans la dauble perspective de ce qu’ils montrent et de leur
origine. Quand donc l’art grec montre la mesure et la clarté, celles-ci sont précisément
l’art, et non la nature, comme avait pu auparavant le croire Holderlin sous l’influence
de Winckelmann et de Schiller. La nature grecque est d’un autre type, fait de douleur
et d’extase, qu’il nomme aussi N aorgique )) et (( oriental n - celui qui prononce les
vers cités plus haut ne vient pas seulement de l’Alphée mais de l’Indus-, et ainsi
ce n’est qu’à la clarté de la mesure grecque que l’on évalue le degré d’excentricité
de la douleur maîtrisé par cette mesure. Avec nous, Hespériens, c’est l’inverse. Nous
venons d’un monde de convention où, selon les mots de Holderlin, tout est ordonné
avec une (( belle symétrie )) et réparti en (( disciplines )) et en (( cases N - Hypérion déjà
le stigmatisait. Nous sommes nés (( sans partage »; c’est pourquoi nous lancer en
pleine liberté dans un accomplissement du partage est notre mission. Ce qu’expose
à peu près la première lettre à Bohlendorff. Dans les Remarques stlr Antigone Holderlin
en vient à formuler que le problème des Grecs est de (( pouvoir se saisir », le nôtre
en revanche de (( pouvoir atteindre quelque chose ». Et l’hymne (( La migration N (Die
Wanderung) symbolise ces réflexions par un mythe contant la rencontre des deux
peuples.
La traduction est également une forme de rencontre. Mais pas au sens où l’on
se retrouve à mi-distance; le moyen terme signifie presque toujours la mort de la
traduction. O n n’a, semble-t-il, que le choix entre restituer le grec en termes allemands
- cela demeure une œuvre grecque, mais est illisible - ou l’informer dans une structure
poétique allemande - alors ce n’est plus du grec. Holderlin pense et résout le problème
autrement. D’abord, comment le pense-t-il?
Les Grecs, a-t-on dit, ont inventé la clarté, clarté qui nous est naturelle. Cela
ne veut pas dire que notre clarté, purement schématique, serait comparable à la clarté
accomplie des Grecs. O n jouit de ce que l’on possède, et on sait ce que l’on possède
parce qu’on l’a exigé d’une nature rétive. Ce qui est inné, on n’ira pas le posséder,
parce que l’on se contente d’être ainsi, spontanément. L’idée que l’inné et l’acquis
seraient identiques et interchangeables a provoqué beaucoup de confusion dans le
rapport Hellade-Hespérie. C’est par leur direction, non par leur substance, que les
Grecs ont accédé à l’élément occidental, et dans le même esprit uniquement formel
nous devons chercher l’élément grec. Holderlin affirme que nous n’avons rien en
commun avec les Grecs sinon (( le rapport vivant et le destin », le partage, de devoir
chercher en chemin à l’étranger le propre.
Or, il croit, notons-le, que les Grecs n’ont plus remonté le chemin vers le propre,
qu’ils ont dépéri à l’étranger - ce que Schiller appelle (( le lointain pays de l’art ».
Dans un fragment tardif on trouve ces vers :
266
Leur volonté fut certes d’instituer
Un empire de l’art, mais là
Le natif (le propre) par eux
Fut chômé et, lamentablement,
La Grèce, beauté suprême, sombra
Les Grecs n’ont plus trouvé le chemin du retour dont le résultat aurait dû être,
on l’a dit : mesure et extase, ordre terrestre et (( Feu du ciel », à concilier en une
dialectique les renouvelant sans cesse. En revanche, nous autres Hespériens, nous
n’avons pas une fois encore entrepris de sortir de notre existence conventionnelle pour
accomplir le partage.
Vu l’identité de notre départ, selon la direction, avec le retour des Grecs, une
lumière inattendue est projetée sur le problème de la traduction. D’un coup, s’offre
la double possibilité de reconduire le grec à lui-même et de sortir l’allemand de luimême, et ainsi de mener à bien la mission qui n’est plus réalisée et celle qui ne l’est
pas encore. En d’autres termes : Holderlin traduisant Sophocle tel qu’il eût dû
apparaître si, à un moment favorable du monde, l’auto-accomplissement avait été
permis aux Grecs, ne fait rien d’autre, quant à la direction, que ce que fait aussi sa
poésie ultérieure, qui veut être une poésie natale )), donc hespérique. Cela peut
sembler abstrus. Que Holderlin cependant ait pensé de cette manière, ses lettres à
l’éditeur des traductions l’attestent.
I1 espère, écrit-il, avoir présenté l’art grec, qui nous est étranger par convenance
nationale et par des fautes dont il s’est toujours tant bien que mal arrangé », de
manière plus vivante que d’habitude, en ayant davantage fait ressortir (( l’élément
oriental qu’il a renié », et en ayant corrigé son (( défaut artistique )) - défaut consistant
pour l’art à vouloir être trop artistique; (( car ils voulaient instituer un empire de
l’art ». Dans la deuxième lettre, il pense avoir (( écrit contre l’enthousiasme excentrique,
et ainsi rejoint la simplicité grecque », même si, par là même, il a (( exposé plus
hardiment N l’élément original tel qu’en lui-même. Holderlin a donc orientalisé
Sophocle - c’est clair maintenant -, il a écrit (( contre )) l’enthousiasme excentrique
- c’est-à-dire dans sa direction, comme l’a montré Beissner --, il a ainsi atteint la
simplicité grecque. Songer à l’innocence néo-testamentaire nous égarerait. La simplicité
des Grecs est plutôt leur naturel extatique, leur originelle et native ouverture au (( Feu
du ciel ». Holderlin pense en fait avoir mis le texte de Sophocle en allemand dans
la situation de l’être grec, ce qu’il était interdit à Sophocle d’atteindre.
Dressons le bilan de ces commentaires. Holderlin envisage la tâche du traducteur
sous un triple éclairage. Traduire revêt d’abord le sens courant : transcrire un original
étranger dans sa propre langue. Puis : transposer cet original dans un état d’accomplissement qui ne lui est plus accessible. Enfin : passer de la langue et de la nature
propres dans l’autre, l’érranger, où il faut chercher le point d’Archimède de son
autodécouverte. I1 ne doit pas y avoir un seul traducteur allemand qui ait conçu sa
tâche de manière aussi fondamentale et même aussi spéculative.
Mais ce n’est pas assez. Dans les Remarques sur Anttgone se trouvent les phrases
difficiles à propos du (( Zeus le plus proprement lui-même », sous lequel nous,
Hespériens, nous tenons. Holderlin le nomme ainsi car il nous reconduit dans ce qui
nous est propre. Nous lancer dans la grandeur du partage, chose qui certes est à venir
encore, cache en fait le danger qu’une fois engagés dans cette voie, devenant toujours
plus hardis et extatiques, nous soyons, enfin de l’autre côté, pris de vertige en l’absence
de mesure et de contrôle - une pensée dont nous avons hélas vérifié l’exactitude. La
pureté de l’imagination de Holderlin nous préserve de ce danger. En effet, à la place
où la terre, c’est-à-dire l’espace de l’existence figurable, finit et où commence le
(( désert sauvage », aorgique, il y a Zeus, et il nous impose de nous arrêter. Car il est
le dieu qui (( force plus décisivement vers la terre n tout (( chemin hostile à l’homme
267
et portant vers l’autre monde ». Voilà pourquoi Holderlin le nomme (( Père de la
Terre D ou a Père du Temps », et il s’en explique en particulier. Pour nous, Zeus joue
le rôle du dieu de la limite. Pas pour les Grecs. Ils viennent de cette sphère excentrique
et cherchent la terre, la figure et la clarté. Quand, à l’inverse de nous, ils franchissent
la limite, ils exécutent la volonté de Zeus. Mais plus tard, plus loin, chez nous, là
même où la mesure devient raideur, la figure ((ordre mort », il n’y a pas un seul
dieu pout en quelque sorte les retourner; (( lamentablement, la Grèce, beauté suprême,
sombra ». Les Grecs se tiennent donc sous Zeus improprement lui-même qui, s’il les
libère à l’étranger, ne les ramène pas dans ce qui leur est propre.
Pourtant, à cet endroit, il y a quelqu’un : Holderlin traducteur, dont nous savons
qu’il traduit Sophocle en direction de l’enthousiasme excentrique et de l’origine reniée
dans l’élément oriental, qui donc a remis le texte grec traduit en allemand dans ce
qui lui est propre. Faut41 en conclure que Holderlin a pris pour ainsi dire le rôle
d’un Zeus plus proprement lui-même qui manquait aux Grecs et que sa traduction
est, sur le plan de l’esprit, une correction de l’histoire du monde?
Parler ainsi semble relever de cette hybris la plus extrême que Holderlin aurait
sans doute à peine osé imaginer. En effet, il est inutile de rappeler la distance infinie
qu’il voit, ou plutôt qu’il a appris à voir, entre le poète et le dieu. Mais que, comme
traducteur de Sophocle, il croie exercer une fonction analogue à celle du (( Zeus le
plus proprement lui-même », me semble résulter forcément de ses réflexions. Si l’on
examine dans quelles dimensions se meut aussi sa pensée ultérieure, on admettra sans
difficulté une telle hypothèse.
II
Nous avons essayé de déterminer le lieu que Holderlin attribue à sa traduction.
A présent, il faut voir au moins à l’aide d’un exemple si cela va. La première strophe
de l’un des plus célèbres chœurs de Sophocle donne dans la transcription de Holderlin :
Beaucoup est insoutenable. Pourtant rien
De plus insoutenable que l’homme.
Car lui, sur la nuit
D e la mer, quand à l’approche d e l’hiver souffle
Le vent d u sud, il sort
Sur des palais ailés, sifflants.
Et des Célestes la sublime Terre,
L’impérissable, infatigable,
I1 racle; avec la charrue q u i force,
D’année en année,
I1 s’affaire à la retourner, avec le cheval,
Et le monde des oiseaux rêveurs
11 captive, et le chasse;
Et la bande des bêtes sauvages,
Et d u Pontos la nature vivifiée par le sel
Dans les mailles des filets,
L’homme habile.
Et prend avec art le gibier
Q u i sur des montagnes passe les nuits et rôde.
Et au cheval à la crinière rêche il jette autour
D u col le joug, et au taureau
Errant, indompté, des montagnes.
268
Présenter convenablement l’élément insoutenable de ces vers excède notre tâche.
Restons-en au palpable. Sophocle énumère des occupations humaines quasi traditionnelles : la navigation, l’agriculture, l’élevage, la chasse des oiseaux, des animaux
terrestres et des poissons, c’est-à-dire d u gibier dans toute la nature. Qu’il faille voir
là la grandeur ou la présomption de l’homme reste ouvert; dans la strophe suivante
seulement, qui parle du comportement social de l’homme, retentit le thème de
l’hybris. Holderlin s’en sert comme titre pour le chœur : il traduit 6~ivOv par
(( insoutenable )) - avec l’homme ce n’est pas soutenable. Des années plus tôt, il avait
une fois déjà traduit le chœur. Cela donnait :
Beaucoup de violence il y a. Pourtant rien
N’est plus violent que l’homme.
Et maintenant :
Beaucoup est insoutenable. Pourtant rien
De plus insoutenable que l’homme.
O n remarque combien maintenant il (( expose )) Sophocle (( plus hardiment n. I1
faut cependant décrire son style.
D’abord, on est frappé par une tendance vers l’extrême. De la (( mer blafarde ))
(7rohtoç ~ C O V T O ~il) fait la (< nuit de la mer M. Des (( animaux des champs )) (tiypcruhoç
ûqp), le gibier (( qui sur des montagnes passe les nuits ». Et, à la fin du chœur, il
traduit le (( prodige divin )) (6aipoviov T É ~ Ç par
)
la (( tentation du dieu ». I1 s’agit du
regard d’Antigone que le garde amène prisonnière. La tentation du dieu N exprime
la crainte d u chœur pour sa loyauté envers la cité, si la princesse, qu’il aime pourtant,
est une criminelle.
Ensuite, on trouve une tendance à l’ambiguïté. Sophocle dit que l’homme
(( retourne D la terre avec la charrue ( h o ~ p ~ k ~ a
Holderlin
i),
qu’il la racle. Littéralement :
il la rend âpre en y traçant des sillons, au sens figuré : il tourmente et maltraite la
terre en lui extorquant ce qu’elle refuse de donner. Ou, Sophocle : (( 11 prend dans
ses filets des oiseaux sans méfiance n - ce qui peut signifier aussi : des oiseaux étourdis,
enjoués, sans malice. Holderlin : (( 11 captive le monde des oiseaux rêveurs. )) L’élément
rêveur de la nature, un thème tardif, sonne à l’opposé de la lucidité de l’homme. Et
captiver )) est encore à double sens : des filets qui captivent, mais aussi de la ruse
de l’homme qui prend de rêveuses et innocentes créatures en les appâtant. Avec lui
ce n’est décidément pas soutenable.
Puis, troisième point, une tendance à la concrétion. Avec (( du Pontos la nature
vivifiée par le sel », Holderlin renvoie à la créature qui vit dans l’eau salée. (( Nature ))
au lieu de (( créature n - cpbaiç peut évidemment signifier les deux. Mais dans la
deuxième partie du chœur il traduit les dieux par les (( puissants de la nature », et
dans les Remarqaes sur Edipe il nomme le dieu (( puissance panique de la nature N.
I1 faut chercher la raison objective de telles variations dans le sujet de la strophe, la
maîtrise de l’homme sur la nature. Quand Holderlin rend par (( nature )) les couples
créature-dieu, création-créateur, il indique que l’homme a étendu sans limites sa
domination sur la nature au point de contester celle du dieu. C’est une traduction
qui, en concrétant, dit plus que le texte ne contient.
Enfin, quatrième point, la transposition dans l’objet d’un état subjectif. La
deuxième strophe dit que l’homme a appris à éviter le (( ciel ouvert, mauvais pour
ceux qui habitent les collines », c’est-à-dire à se bâtir des huttes dans des vallées
protégées. Holderlin dit qu’il a appris à fuir (( les collines infectées d’air humide ».
D u mauvais pour ceux qui habitent il fait des collines infectées; il transforme un
effet sur le sujet en une qualité de l’objet. De même, quand il rend (( maladies
267
incurables )) (voooi cip,il~avoi)par (( épidémies sans recours »; la détresse est transposée
de l’homme à la maladie, du sujet à l’objet du secours qui ne vient pas.
Extrémisation, ambiguïté, concrétion et objectivation sont bien les quatre
marques de style les plus importantes. Mais que signifient-elles? Ensemble, elles
vont avec l’intention de traduire non pas littéralement, mais en interprétant.
Interpréter signifie alors : dégager des rapports que le texte original entend ou
semble entendre, mais que recouvre le vocabulaire poétique traditionnel. Au (( prodige divin )) ne répond rien dans l’esprit d u spectateur, à la (( tentation du dieu ))
il dresse l’oreille et s’interroge : qui est tenté ici, pourquoi, et par quel dieu?
Dépaysante traduction aujourd’hui que celle qui prétendrait mettre en éveil la
pensée du spectateur à partir du choc produit par l’inattendu. Dans la langue de
Holderlin et de Hegel, il faudrait parler d’une traduction délivrant du positif ».
Car le (( positif », ce qui est posé, c’est la langue conventionnelle et classique de
l’époque, qui présente le mot attendu, beau et poétique, et empêche ainsi de se
mettre à penser à la suite. Cette barrière est levée par le mot de Holderlin qui,
s’il n’est pas beau, met dans le mille - (( pouvoir atteindre quelque chose )) est
bien la tâche du poète hespérique -, dégage l’originel, la nature de la chose dite.
Holderlin cherche à traduire natura », pas C positio ».
((
Une autre forme de positivité est encore la mythologie, si toutefois elle dogmatise
le mythe en noms, enseignements des dieux, légendes sur la naissance du monde, etc.
En remplaçant les noms des dieux par des caractères de l’être - par exemple, (( Zeus ))
par (( Père du Temps )) -, Holderlin (( atteint )) ce que le nom conventionnel manque.
Les Grecs pouvaient encore savoir ce qu’ils disaient en nommant (( Zeus ». Pour nous
qui ne croyons plus à Zeus, ce nom est devenu un gage de poésie, un mot sans vie
de ta langue artistique, il faut s’en débarrasser. D’où le (( Père du Temps )) que l’on
remarque à la place de (( Zeus )) qui n’est que bruit et fumée. Le détachement de la
mythologie n’est qu’une conséquence du détachement du positif.
Cependant, le préfixe ent signifie que quelque chose est nié, auprès de quoi on
ne peut rester. Mais au lieu de faire comme notre époque, se hâter de murer
idéologiquement l’ouverture obtenue par la négation de ce qui existe, Holderlin
cherche à la maintenir. Cela, en rendant visible dans la chose montrée un absolu qui,
comme condition de la chose, ne reçoit jamais le caractère de la chose, du phénomène
évaluable et disponible. Un exemple : dans l’antistrophe du chœur cité, Holderlin
remplace le a droit juré )) par la (( conscience jurée )) des dieux. Le droit est un statut
positif qui peut prêter à controverse. La conscience est aux yeux de Holderlin une
instance inconditionnelle et indépassable, même celle des dieux. I1 n’y a aucun acte
dont on ne puisse a priori affirmer qu’il n’est pas du ressort de la conscience. Un
autre exemple : (( Zeus )) - (( Père du Temps )). Zeus possède certaines propriétés et
pas d’autres, à ses côtés il y a d’autres dieux, on peut déterminer son être et son
champ d’action. Mais le Père du Temps, lui, est un absolu, qu’il soit pesé en termes
grecs ou chrétiens. En effet, personne n’existe hors du temps, et personne ne peut être
plus âgé que son père. Quiconque est, est en tant que tel un enfant du Père du
Temps.
De cette manière, Holderlin essaie de transformer le connu, ce qui est monnaie
courante, en signe d’un absolu qui n’est rien tant qu’il n’est pas perçu. Sa langue
fait le maximum pour le rendre perceptible. Mais il n’est pas rare qu’elle franchisse
la limite du compréhensible qui, vu l’effort intense du lecteur, reste la condition
humaine à ne pas omettre de la poésie.
Depuis la langue d’un chœur qui représente bien le style de l’ensemble, nous
avons constaté la tendance à remplacer le mot habituel par le mot étrange, c’est-àdire le beau mot par le mot qui atteint sa cible; nous y avons discerné la tentative
de faire éclater la langue littéraire classique, de faire apparaître la chose dont il s’agit
270
et, à travers elle, de diriger le regard vers l’absolu qui porte la chose comme la
langue. Cette démarche, c’est le chemin qui va de la positivité à l’ouverture de l’être,
chemin d’où le poète hespérique doit sortir et que le poète grec aurait dû remonter.
La pratique langagière de Holderlin semble confirmer sa théorie de la traduction.
III
Maintenant, il a aussi interprété Sophocle. L’interprétation contenue dans les
quelques pages des Remarques conçoit à dire vrai des mondes dont l’examen réclamerait
des heures. Je me limiterai donc à certains points choisis en vue d’élargir l’horizon
actuel de nos commentaires. Commençons par l’interprétation d’@dipe - en laissant
de côté ce qui touche à la constitution de la tragédie et la plupart des éclaircissements
particuliers de Holderlin, soit la première et la deuxième partie des Remarques.
Holderlin comprend la tragédie comme le déroulement d’un procès entre le dieu
et l’homme, et même au double sens du procès juridique et du processus historique,
ce qui rend plurivoque le cas juridique. L’histoire - cela commence ainsi - est entrée
dans une phase déterminée, où l’homme et le dieu deviennent étrangers à l’extrême.
La (( mémoire de ceux du ciel )) a (( échappé )) aux hommes, dit Holderlin, ou, pour
reprendre (( Fête de paix )) ( R Friedensfeier »), les hommes ont (( orgueilleusement oublié
le Ciel ». I1 ne s’agit pas là d’un oubli de l’existence des dieux, mais de leur être.
Après comme avant, il y a des cultes, des temples et des oracles. Mais ils sont, comme
on dit aujourd’hui, institutionnalisés; l’homme dispose des dieux.
Vu que le monde peut certes exister en l’absence des Célestes, mais pas dans
l’ignorance complète de ce qu’ils sont, le (( cours du monde )) risque d’avoir une
(( lacune 1). De cette lacune parle déjà le Devenir dans la disparition. La manière de
la combler est traitée par la philosophie de l’histoire; à présent, cela se fondr sur la
théologie de l’histoire : les dieux se choisissent quelqu’un pour démontrer effroydblement qui ils sont et qu’ils sont encore.
Empédocle est déjà un tel individu, mais dans le rôle du réformateur qui annonce
les dieux vivants et expie la tentative du monde faisant du messager ce qu’il annonce,
le dieu - tout au moins dans la dernière version de la pièce. (Edipe n’est pas un
réformateur. I1 s’érige en représentant du dieu qui a ordonné de chercher un criminel
et de punir le crime. I1 s’identifie au dieu et prouve ainsi qu’il reste prisonnier,
comme son monde et autrement qu’Empédocle, de son ignorance du dieu. Mais en
vérité c’est Apollon lui-même qui l’a poussé à agir dans l’ignorance - son aveuglement -, afin que dans la lumière qui démasque le juge comme étant l’accusé, se
montre qui est en propre le dieu, revienne la mémoire des Célestes et commence un
nouvel âge pour le cours du monde. Holderlin nomme ce processus - d’abord du
devenir un, puis de la séparation entre Apollon et CEdipe-, avec une concrétion
extrême, 1’« accouplement )) du dieu et de l’homme et la (( purification », qui n’a rien
d’une catharsis esthétique, mais est exactement l’élimination de l’impur.
Cette conception a pour conséquence d’écarter plusieurs fois et visiblement
Holderlin de Sophocle. Nous pouvons l’affirmer avec détermination, même si selon
nous l’interprétation de ce très grand drame de la littérature mondiale ne sera jamais
définitivement close.
Il n’y a pas un mot de Holderlin sur le fait q u ’ a d i p e a tué son père et épousé
sa mère à leur insu. Si cette faute existe, il ne s’y arrête pas. Partant, il laisse s’échapper
la compréhension humaine liée à cette question. En effet, si CEdipe est pleinement
responsable aussi des actions commises dans l’ignorance, c’est qu’il ne peut être un
sujet au sens moderne. Car un sujet n’est responsable que de ce qui tombe dans la
27 1
sphère subjective, donc de ce qu’il sait ou toutefois pourrait savoir. Mais le cas
d’CEdipe consiste en ce qu’il ne pouvait pas savoir. Ainsi, a d i p e n’est pas identique
à sa conscience de soi. I1 est la totalité d’une personne qui - le sachant ou non -,
par son existence et ses actions, a changé la réalité effective et qui, avec son assentiment
propre et entier, doit rendre raison de ce changement. Ajax aussi n’excuse pas son
acte en prétextant l’avoir commis sous l’empire de la démence; pas plus Déjanire le
sien en prétextant avoir été de bonne foi. Tous deux en tirent les conséquences et se
donnent la mort. Sans établir d’associations modernes, nous pouvons dire que Sophocle
comprend l’homme non comme sujet, mais comme existence, pourvu qu’« exister ))
signifie sortir dans la réalité effective. Est décisif non pas ce que l’homme sait de la
réalité effective, mais comment il existe en elle, non pas sa conscience de celle-ci,
mais son existence en elle.
Ce que je dis ici se rapproche de l’interprétation hégélienne d’CEdipe, qui moins
connue que celle d’Antigone - provient de remarques dispersées dans la Phénoménologie,
l’Esthétique et l’Encyclopédie. Je ne citerai que ces phrases :
La réalité effective tient caché en elle l’autre côté, celui qui est étranger au savoir,
et ne se montre pas à la, conscience telle qu’elle est en soi et pour soi - au fils
elle ne montre pas le père dans son offenseur qu’il tue, la mère dans la reine qu’il
prend pour femme. La conscience d e soi éthique est d e cette manière traquée par
une puissance ténébreuse qui n’éclate qu’une fois le fait arrivé et prend la conscience
d e soi sur le fait.
Nous autres, dit Hegel dans un autre passage, (( ne reconnaîtrions pas davantage
ces crimes comme les actes d’un Moi propre, vu qu’ils ne sont situés ni dans le savoir
propre, ni dans le vouloir propre. Mais le Grec, par son sens plastique, répond de
ce qu’il a accompli en tant qu’individu, et ne se démembre pas dans la subjectivité
formelle de la conscience de soi et dans ce qu’est la chose objective )). Hegel conclut
avec le concept d’« action pure ». Par là il entend une action qui embrasse du regard
l’ensemble de ses moments, c’est-à-dire traverse entièrement du regard ses présupposés,
ses conséquences et elle-même. Seuls les dieux sont capables d’agir ainsi. Le faire de
l’homme est toujours morcelé et sa responsabilité jamais entière, une part de ses
moments lui demeurant sans cesse cachée. Toutefois, l’homme peut exécuter un
analogue de l’action pure s’il répond, au moins une fois le fait accompli, de toutes
ses conséquences, et ainsi corrige ce qu’il devait manquer. CEdipe représente l’exemple
cardinal de cet homme. En ne se corrigeant PUS, il atteste l’honneur de l’homme.
Que de ce fait il honore le dieu caché, ce dont pourtant témoigne la pièce de Sophocle,
Hegel ne le dit plus.
Holderlin, donc, n’évoque rien de tout cela. Son interprétation va seulement de
la question d’CEdipe sur l’oracle jusqu’à son aveuglement; il écarte les événements
qui précèdent et la scène finale. L’extrait restant lui permet de présenter l’histoire
d’une hybris qui commence par le c nefas d’CEdipe, passe par le combat entre la
(( fureur n et la (( conscience N et finit par la victoire de la fureur et l’anéantissement
de celui qui en est atteint. Apollon l’abat. Ou, pour reprendre les termes d’une lettre
sans doute en rapport avec (Edipe : il expie la flamme qu’il n’a pas su maîtriser la flamme du (( feu [grec] du ciel ». Ce N nefas - Holderlin le nomme ainsi parce
qu’il s’enflamme au contact d’un N fas >, d’un oracle divin - consiste en ce qu’CEdipe
interprète l’oracle (( trop infiniment », c’est-à-dire de sa propre autorité. I1 l’interroge
sur un criminel précis au lieu de s’en tenir à une (( souillure du pays )) pioropor ~ w p a ç
qui devrait vouloir dire (( en général n : (( Attachez-vous à ériger une justice sévère et
nette, maintenez un bon ordre civil. )) En fait, c’est inexact. Holderlin omet la deuxième
partie de l’oracle, qui donne dans sa traduction :
))
Nous devons frapper d e bannissement, ou meurtre pour meurtre
Faire payer, un tel sang agitant la cité.
272
I1 s’agit concrètement d’un meurtre. Mais l’oracle ne mentionne ni Laïos ni son
meurtrier. I1 en dit assez pour que l’on se mette à rechercher un meurtrier mais trop
peu pour que l’on ait à attribuer aux hommes seuls le résultat de leur recherche.
Cette ironie qui caractérise aussi les deux autres oracles d’adipe, Holderlin ne
la perçoit pas. C’est que seule l’intéresse l’hybris de l’homme qui veut voir plus qu’il
n’est dû à un mortel, qui a un œil de trop peut-être », comme le dit l’hymne (( En
adorable bleuité ». L’esprit d’CEdipe, son (( excès dans la recherche », son (( excès
d’interprétation », voilà son sujet. Que cela atteigne Sophocle est douteux; mais
restons-en là.
Nous y reconnaissons donc la conception d u (( tragique N dont parle Holderlin.
Elle ne réside pas dans la chute d’un innocent, dans un malheureux concours de
circonstances, dans la tromperie perfide d’une volonté en soi juste. Elle ne réside
surtout pas dans le rapport horizontal entre un individu et son monde, mais dans le
rapport vertical entre une humanité et le dieu. A Thèbes règnent (( la peste, le
dérèglement d u sens et un esprit de divination partout exacerbé », et ceux-ci seraient
les signes d’un temps de (( désœuvrement D. (( Désœuvré », dans la langue tardive de
Holderlin, ne signifiant pas inactif mais inconséquent, et le sérieux se rapportant
toujours à la conscience de ce qui concerne quelqu’un de manière inconditionnelle,
par exemple les Célestes, un temps de désœuvrement est un temps qui oublie
l’inconditionnel.
Ici interviennent les représentants de l’inconditionnel, les dieux. Ils se choisissent
quelqu’un qu’ils élèvent, puis qu’ils laissent tomber - le devenir-un et la séparation!
A présent, le monde est attentif. I1 remarque que les dieux sont encore. (( Car alors
nous aveugles avions besoin du prodige », trouve-t-on déjà dans Empédocle. Mais ici
le prodige ne sauve pas, il anéantit, et sa victime est celui qui a été abusé. Hdderlin
dit expressément qu’CEdipe est (( tenté N en direction du nefas. I1 ne craint même pas
de nommer l’avancée des dieux (( infidélité divine »; elle, en effet, serait (( le mieux à
retenir ». Soit : celui qui fut témoin de la manière dont les dieux poussèrent le roi
bon et juste à prendre leur affaire en main et s’en débarrassèrent comme d’un outil
hors d’usage, celui-là ne l’oublie plus, il a compris que l’homme est manipulé, en
particulier quand il pense lui-même manipuler, et au maximum quand il le fait au
service d’une puissance, on dirait aujourd’hui d’une idéologie.
Toutefois, les dieux ont distingué CEdipe de tous les mortels. I1 ne représente
précisément pas l’homme, comme Hegel le pensait, mais l’exception. Mais une
exception de par la grâce des Célestes qui ne confient qu’à lui les forces nécessaires
à l’aveuglement. Un calculateur comme Créon n’en serait pas capable. En tant que
celui qui est aveuglé cependant, CEdipe devient sujet - encore à l’inverse de l’interprétation hégélienne -, sujet dont la conscience de soi paradoxalement est corrompue
par la méconnaissance de la réalité effective. La reconnaître et s’oublier font donc un;
(( à la limite extrême d u
déchirement, l’homme s’oublie », dit Hdderlin. Ainsi
l’homme n’est pas a priori sujet, mais les dieux peuvent le rendre tel, un moment,
sur le mode de la démence, pour, en l’anéantissant, faire souvenir qu’ils sont les vrais
sujets de l’histoire d u monde. Par conséquent, ce qui est d’abord visé n’est absolument
pas l’homme, ni même l’exception que constitue CEdipe, mais l’apparition des dieux.
Holderlin pense, comme toujours, du haut vers le bas, au contraire de Hegel chez
qui le haut ne prend aucun contour exact. L’interprétation de Holderlin peut s’éloigner
encore plus de Sophocle que celle de Hegel; pourtant elle est d’une conception plus
ample.
273
IV
Tout autre est son interprétation d’Antigone. Nous pouvons ici renoncer à Hegel.
Son principe d’un combat équilibré entre la polis et la famille, Créon et Antigone,
dépasse Sophocle de si loin qu’il ne peut même par la négative contribuer à comprendre
l’interprétation de Holderlin, bien que celle-ci aussi manque Sophocle au plus haut
point. Pour commencer, laissons donc de côté ces deux interprétations et disons
simplement ce que l’on éprouve quand on passe d’ûZdipe à Antigone.
En un mot : une atmosphère plus humaine. La chute d’CEdipe s’enracine dans
la volonté insondable des dieux et s’accomplit avec la froide précision d’une mécanique.
Dans Antigone, l’instigateur de la chute se tient en effigie sur la scène; on peut le
voir nettement et dire : c’est lui. Dans Gdipe, il n’y a, sauf à la fin, aucun acte pur;
tout agissement est démence ou simple réaction, défense ou fuite. Antigone agit
clairement et consciemment quand elle enterre son frère, elle ne doit, jusqu’à la fin,
rien renier. A aucun moment elle n’est le jouet d’une fatalité anonyme. C’est avant
tout une femme, plutôt une jeune fille, sur l’âge de laquelle plane un charme singulier.
Elle a presque entièrement perdu l’inconscience de l’enfance. Son esprit est vif, il a
saisi dans le déchirement l’inconditionnel, et ce, de manière inconditionnelle. Elle
soutient le dfoit de son acte jusqu’au paroxysme. En revanche, elle ne semble pas
touchée par Eros, le désir amoureux, bien qu’elle soit fiancée à Hémon; sinon, elle
devrait instinctivement se protéger en vue d u mariage et ne pourrait mettre sa vie
en jeu sans réfléchir. Ses plaintes, de ce que le tombeau sera sa chambre nuptiale et
qu’elle devra mourir non mariée et sans avoir enfanté, sont des copoi à l’aide desquels
elle essaie de donner la parole à l’insaisissable. Ce qu’est réellement ce à quoi elle
doit renoncer, elle l’ignore encore. I1 faut penser à l’Athéna d u sculpteur Myron;
toute sa fatalité est de se dresser face à un Créon. Nul autre ne pourrait se fermer à
la sévère et intime vérité de cette jeune fille.
Nous ne lisons rien là-dessus chez Holderlin. I1 parle d’Antigone comme d’une
abstraction sans âge et sans sexe; en effet, ce qu’il dit sur le (( travail secret de l’âme N
et le fait de (( prendre une forme spécifique N comme personnage représentatif s’applique
à tout sexe et à tout âge; dans la présence de l’aimable )) et la G naïveté rêvant D il
reconnaît la langue de Sophocle en général, pas la langue particulière d’Antigone; et
ce qu’il dit du (( génie prématuré n se rapporte à Niobé avec laquelle Antigone ne se
compare certainement pas dans cette perspective. Vu qu’il n’a rien perçu de ce qui
vient à peine d’être dit, il faut admettre qu’autre chose lui importe. Cette autre chose
est facile à repérer : il s’agit des réflexions sur une poésie hespérique future, qui
avaient résulté de l’interprétation grecque d’CFdipe. Sous la contrainte systématique
de celle-ci a lieu l’interprétation d’Antigone. Cela implique la mise au jour de ce qui
en fait est le plus extrême, mais perd presque de vue l’individualité du drame
d’Antigone. Pour finir, je ne soulignerai que trois points : la stylisation d’Antigone
en (( Antithéos », la construction d’un (( retournement natal )) et l’affirmation que dans
cette pièce cela passe (( du grec à l’hespérique ». Aucun de ces sujets n’est imposé par
Sophocle, mais chacun d’eux illumine la conception de Holderlin.
(( Antithéos n est quelqu’un qui (( au sens du dieu lui-même, sc comporte comme
contre le dieu, et reconnaît hors statut l’esprit d u Plus-Haut ». a Au sens du dieu
lui-même », parce que celui-ci s’est choisi en Antigone à nouveau la figure par
l’anéantissement de laquelle il se rappelle au souvenir du monde. (( Comme contre
le dieu », parce qu’elle, d’une autre manière qu’une martyre chrétienne, d’abord dans
le devenir-un avec lui, puis en s’insurgeant contre l’obligation de mourir, franchit la
limite impartie. a Hors statut », parce qu’elle connaît le dieu de façon immédiate et
((
274
donc privée. Antigone se targue de sa connaissance personnelle d u dieu, ce que
Holderlin traduit alors (en rapport à l’interdiction d’enterrer) :
CRÉON : Par quelle audace as-tu enfreint une telle loi?
ANTIGONE: Voilà : mon Zeus ne m’en a pas instruite.
Chez Sophocle, cela donne seulement : OU yap ri poi ZEUSfiv - pow moi, ce n’était
pas Zeus qui l’ordonnait. Son Antigone parle simplement d’un Zeus qui vaut aussi
pour Créon et qui ne cautionne pas l’interdiction. L’Antigone de Holderlin, malgré
l’ironie que présente mon Zeus », accentue la nouveauté provocante de sa connaissance
d’un dieu plus vrai et plus humain. I1 faut ce déplacement de l’accent pour qu’ait
lieu le devenir-un avec le dieu, puis la séparation qui avait caractérisé l’interprétation
d’û3dipe.
Ce processus implique un (( retournement natal ». Aucune révolution politique
- les rapports de force subsistent -, mais une révolution de la manière de penser et
de comprendre. Les N modes de représentation N changent, et notamment trois d’entre
eux, les religieux, politiques et moraux ». Les politiques doivent se rapporter à
l’explication entre le père et le fils. Créon ayant déclaré : Thèbes, c’est moi, Hémon
avait répliqué : il n’y a pas de cité qui soit le bien d’un seul. Le prince héritier d’une
monarchie reconnaît à la déviation despotique de celle-ci le sens des principes
républicains. Puis les représentations morales : faire passer le frère avant l’ennemi
signifie remplacer l’archaïque jus talionis », la loi d u talion, par une morale humaniste
où chaque homme a le droit d’accéder au repos dans le royaume des morts. Enfin,
les concepts religieux : en se réclamant des (( lois non écrites )) des dieux, Antigone
fait apparaître sous l’ancienne religion de la loi une religion moderne de la conscience,
au sens non pas d u libre arbitre, mais de la conscientia, de la (( connaissance )) d u
dieu. Créon qui honore le dieu simplement ((comme une loi », quelque chose de
positif, ne le connaît pas, il s’en sert. C’est sur ces trois plans à la fois que Holderlin
voit le retournement natal. I1 a toujours tenu l’idée d’un changement de conscience
purement politique, sans raison suffisante morale et surtout religieuse, pour de
l’aveuglement, et la pure convoitise d u pouvoir pour de la démence anarchiste.
Ce retournement montre donc comment cela (( passe d u grec à l’hespérique ».
Ce qui peut vouloir dire : d’Antigone à Créon, vu qu’elle représente l’extase grecque
et lui le doctrinarisme hespérique qui reste effectivement vainqueur. Mais aussi : de
Créon à Antigone, vu qu’il symbolise la fin des Grecs dans un engourdissement hors
partage et elle l’élan hespérique dans un destin propre, qui vainc par l’esprit et
indique le retour inaccompli des Grecs. Notre manière d’interpréter dépend de notre
position face au système et elle est finalement indifférente. Seul importe que Holderlin
reconnaisse dans û3dipe le drame purement grec, quelqu’un ici expiant la flamme
qu’il n’a pas SU maîtriser, tandis qu’il voit Antigone sur le chemin d u grec à
l’hespérique car elle ne rétablit pas seulement le souvenir des Célestes mais de ce fait
change aussi la figure spirituelle de l’histoire. Selon une remarque, il semble avoir
considéré CEdipe à Colone, où il n’y a plus que le combat entre l’esprit et son contraire,
comme un drame déjà proche d u drame purement hespérique. Les principes de sa
théorie et de sa pratique de la traduction guident aussi son interprétation des pièces.
O n s’aperçoit, plus clairement encore que jamais, que chez Sophocle Holderlin a
cherché à discerner, certes aux dépens de la fidélité historique et philologique, la
provenance et la destination de la poésie propre, natale.
((
Quelle attitude adopter face à ces réflexions d’un métaphysicien Souabe? En
prendre connaissance n’apporte rien. Les écarter comme des bizarreries n’apporte
rien de plus. Mais s’attacher à la lettre, lettre qui (( tue », peut conduire à l’esprit
qui rend les (( esprits vivants n en les contraignant d’une manière ou d’une autre,
275
mais aussi inconditionnellement que lui, a penser leur provenance et leur destination
propres.
W. Binder
(Traduit par Dominique Saatdjian)
NOTES
1. La plupart des traductions des Retnurqzres et des Lettres à Bohlendorff et à Wilmans sont reprises
des Retnurqires sur @dip, et An?igone, Paris, UGE, 1965, traduction de F. Fédier.
2. Traduction française aux Editions de Minuit.
3 . Traduction de Jean Beaufret, Holderlin et Sophocle P, in Retnurqires J Z ~ Y@dip et Antigone, op. r i t .
4. Binder entend la préposition gegen, contre », à l’encontre de », dans un sens rare : en direction
de ». Sur ce point, cf. Holderlin, @:livres, Paris, Gallimard, (< Bibliothèque de la Pléiade », p. 1245,
note 1.
((
((
((
Figures de la dualité :
Holderlin et la tragédie
grecque
Arnaud Villani
Nietzsche écrit dès l’ouverture de la Naissance de la tragédie :
Nous aurons fait en esthétique un progrès décisif quand nous aurons compris, non
comme une vue de la raison, mais avec l’immédiate certitude de l’intuition, que
l’évolution de l’art est liée au dualisme de l’apollinisme et du dionysisme, comme
la génération est liée à la dualité des sexes, à leur lutte continuelle coupée d’accords
provisoires [...I ce conflit des contraires que recouvre, en apparence seulement, le
nom d’art qui leur est commun, jusqu’à ce qu’enfin [...I ils apparaissent unis, et
dans cette union finissent par engendrer l’œuvre d’art, la tragédie attique. (Trad.
Bianquis.)
Je voudrais montrer que cet accord discordant est en effet le fil rouge d’une lecture
conceptuelle d’Eschyle et de Sophocle, et qu’un démontage précis de ce qui nous
apparaît comme une énigmatique intuition, éclaire fortement certaines des délicates
pages des Essais de Holderlin, et au premier chef ses Remarques sur la traduction des
tragédies de Sophocle.
Le K pZus-que-deux N de la tragédie grecque
L’ordre infrangible d’un destin échu ne peut, en son inflexible application,
produire d u tragique. Le destin devient tragique lorsqu’il est transgressé. I1 est alors
lieu de la lutte à mort de l’homme avec ce auquel il lui faut s’égaler *. Silésius
dégage un destin de l’homme lorsqu’il énonce : (( I1 me faut monter plus haut que
Dieu, dans un désert 3 . )) Ce gain en dimension humaine, qui installe l’effraction de
277
la limite dans la violence et la mort, engage l’homme dans une voie inaugurale et
destinale, et en fait un c deinon # : inférieur à tout puisqu’il doit mourir, il est
supérieur à tout puisqu’il ne connaît pas les limites de sa puissance ’. Inférieur aux
dieux, et cependant supérieur sur un point, inférieur au destin pendant qu’il le dépasse
par un biais, en sorte qu’inessentielles soient les fluctuations autour de la ligne
d’équilibre, tandis que l’essentiel devient le passage des deux éléments l’un vers
l’autre, où chacun soit l’impur et l’asymétrique. Manière élégamment efficace de fuir
l’équilibre immobile d’une fausse mesure et le déséquilibre d’un détournement absolu
des dieux (leur transcendance).
Si tel est le destin tragique qu’il inclut sa propre transgression, et l’échange des
opposés, la tragédie grecque serait donc une vaste variation sur la dualité. Cette
hypothèse demande confirmation. Mais nulle impatience ici : nous ne cherchons pas
le deux, mais le deux dans l’un, l’mitas multiplex, le Plus-que-deux, dualité qui
échappe au doublement de l’unité et serait plutôt doublement d’elle-même. D’autre
part, si c’est là une préoccupation centrale d’Eschyle et de Sophocle nous pourrons
nous attendre, de l’un à l’autre, à un approfondissement de ce concept, enjeu d’une
constitution de la philosophie. Pouvons-nous, chez Eschyle, démontrer l’existence d’un
modèle de cette dualité unitive, et chez Sophocle, mesurer le chemin parcouru dans
son concept > ?
Cette présence centrale de la dualité dans la tragédie est d’abord confirmée en
général par sa (( forme ». Hegel écrit :
N e sont véritablement œuvres d’art que celles dont le contenu et la forme sont
parfaitement identiques,
et il ajoute :
[il y a] rapport absolu d u contenu et d e la forme [...I renversement d e l’un dans
l’autre, de sorte que le contenu n’est rien d’autre que le renversement d e la forme
dans le contenu. et la forme le renversement d u contenu dans la forme ‘.
Or la forme structurelle des tragédies telle que la décrit J. de Romilly (la Tragédie
grecque, PUF, 1970) est si manifestement duelle qu’on peut s’étonner que sa recherche
n’ait pas insisté sur la dualité concomitante du contenu, rattachée seulement à une
théorie du (( genre poétique )) (la (( péripétie )) aristotélicienne, les devoirs contrastés
~ # ou (( contrastes serrés et crépitants », comme dit joliment J . de
(p. 82), 1 ’ agôn
Romilly sans en tirer plus de parti). Nantis au contraire de ce principe de réversibilité
de forme et contenu, accordons la plus vive attention aux manifestations d’une dualité
structurelle. Ainsi le partage dithyrambique entre chœur et personnages dégage dans
l’espace théâtral deux lieux, orchestre et scène ’, dans l’espace verbal, deux types de
mètres (mètres lyriques, trimètres iambiques), dans l’espace vocal, deux tons, deux
modulations, dans l’espace chorégraphique, deux maintiens, avec les (( strophes )) et
alternances de l’évolution du chœur. Ce partage si marqué, qui permet affrontement
et (( répons )), n’est pas seulement souvenir de l’affrontement de l’homme et du dieu
(un tel K agôn # avec inversion existe dans les Bacchantes d’Euripide), mais il .semble
devenir le Sens même, le référent, l’origine de la tragédie. Le partage comme
dilacération-rassemblement du corps de Penthée, image du corps tragique, se ressource
dès lors d’une simple allusion à la dualité. Dualité qu’il faut sentir et vivre comme
souffrance, lèvres d’une blessure qu’il faut suturer tout en les écartant jusqu’à la limite
du tolérable. Corps du dieu-et-homme, concept de leur (( machine )) ou œuvre théâtrale,
sont le même, perpétuant le mystère d’un Deux. Cette machine duelle, corps ou
texte, joue de l’un contre l’autre, les excite pour (( monter en puissance )) l’énergie de
leur différence. La force est alliage, la puissance des dieux son dosage comme mise
en tension ». Ainsi est à la fois monté un modèle physique de l’origine de l’énergie R ,
278
dans cette machine qui tâche, comme le montre Nietzsche, de penser e t d’être, de
penser la vie selon les principes de la vie, et découvert un moyen de lutter contre la
montée menaçante des effets secondaires de la positivité : logique dichotomique,
exclusion et dévalorisation d u (( négatif », exaltation de la lumière, déplacement du
centre d’intérêt de la physique vers la métaphysique, (( de mauvaises choses N 9.
Or cette dualité est aussi l’enjeu de la philosophie : le (( philosopha1 n recule,
dans un pas qui rétrocède depuis les formes avalisées d u réel, et prend appui dans
ce recul. Le (( solide )) ‘ O file alors vers 1’« informe n où, dans une vacance de l’étant,
les questions peuvent advenir. Au-delà du divertissement, l’homme jeté entre deux
infinis, I’UnfomzIicbe et I’Allzuflmlicbe holderliniens, le (( choix d u choix n de l’éthique
kierkegaardienne, le Polémos de Volonté et Représentation, Force et Forme chez
Schopenhauer et Nietzsche, Kebre et Scbritt zurick, disent, chacun à sa manière, une
dualité archique. Ces philosophies, abritant un combat incessant d’ouverture maximale
et de naissance des formes, en tant que disciples de la possibilité, sont l’esprit de la
dualité, non pas bien sûr le (( oui-non D ou (( flic-flac )), piège d’une dichotomie qui
semble laisser le choix, mais instance décisive de 1’« indécidable n de toute réelle
dualité. Si le deinon N ou le c tbambos » des Tragiques dégagent eux aussi un lieu
d’où l’essentiel puisse advenir, alors se dégage une connivence d u (( symbole )) grec et
de la philosophie, dans la problématique universelle du doublement transcendantal
de toute question qui touche au fondement : c noesis noeséôs », choix d u choix, je sais
que je ne sais rien, etc. Pout le dire en exemple, soit le couple homme/dieu. De
deux choses l’une : ou bien l’homme a du dieu en lui, et le dieu de l’homme, le
K deinon » étant leur part commune, et leur débat indéfini est, à travers violence,
transgression, fidélité infidèle et amours croisées, la garantie d’un (( rythme )) tragique,
où ce qui s’assaille est forme en danger de se fossiliser dans l’exténuation de la force
et force en danger de se perdre hors des formes qu’elle déborde; ou bien l’homme
et le dieu sont rigoureusement antithétiques, symétriques et inverses dans une dualité
sans (( épaisseur n et seulement (( extrêmes morts et non opposés »,ils laissent s’installer
le cas de figure d’une hespéricité malheureuse ». Car les dieux pourraient bien n’être
pas seulement détournés, comble de l’infidélité, mais radicalement enfuis (Dieu est
mort). Le plus que deux )) du deux semble donc, à travers structure théâtrale,
commémoration dithyrambique, et, comme nous allons le voir, le contenu des
tragédies, constituer un rempart pour une unité de la pensée et de l’être 1 2 .
((
Eschyle ou la dualité doublée
Que la dualité soiv présente dans l’œuvre d’Eschyle est évident à une première
lecture. Mais le type de cette dualité doit être soigneusement dégagé. Les Suppliantes
sont l’histoire d’un dilemme.
I1 faut d e toute nécessité, contre les uns ou les autres (roioiv fi roiç), soutenir une
guerre redoutable, et m a barque reste là clouée, comme si elle y avait été hissée
par des cabestans. Nulle part je ne vois d’issue exempte d e douleurs (v. 439 q.).
Deux lois sont en présence : celle de Zeus, qui soutient la cause d’Io et des suppliantes,
celle des fils d’Aegyptos. Cet affrontement n’admet pas de solution décisive, d’autant
qu’un autre affrontement redouble le premier : celui des mâles et des femelles. Les
Perses sont la conséquence d’un malheureux pontage 1 3 . Xerxès (( a franchi les caps
marins reliés par un pont aux deux continents N (v. 735). Dès lors le songe sera
querelle de deux sœurs (v. 181, 185) accouplées dans le joug d’un bige qu’elles
brisent. Ce joug brisé est l’image de la (( méchané N d u pont, suggéré par une Até
279
aveuglante : (( Son expédition était double et présentait deux fronts )) (&p<po~epa,
GinhoUv,
Guoiv) (v. 720), d’où le sacrilège d’un joug imposé à la mer, traditionnellement (( sans
route N (PXneipov). Pourtant la faute réelle de Xerxès est dans ce pontage de la terre
à la terre, qui néglige doublement les couples agonistiques naturels : terre/mer et
terre/terre. En ce sens le pont de Xerxès a une intention strictement opposée à celui
de Heidegger 14. Le pont heideggerien enrichit chaque rive dans le respect de leur
différence devenue (( sensible N (au sens de Holderlin) tandis que le pont de Xerxès
tient seulement à assimiler la culture grecque à la civilisation perse, en sorte que terre
et mer soient en fait le même Is.
Avec les Sept contre Thèbes se présente le module central. Les thèmes, le lexique
(les (( hébraïsmes )) comme dit Fontanier 16), la syntaxe (oxymores), la structure des
vers (chiasmes), la prosodie (stichomythies), l’architectonique (les deux demi-chœurs
d’un parti opposé), multiplient la signification d’un Deux très particulier : le fratricide
simultané. Catastrophes de l’un et du deux qui basculent chacun dans son contraire :
frères du même sang, ils sont Un. Mais leur Un est encore plus intime, provenant
d’une semence paternelle e t fraternelle. Mais leur différend est total, il est à mort.
Mais il aboutit à la même mort, à un unique destin. Mais ils y sont séparés par le
mode de leur sépulture : nefas >) auquel rien ne s’oppose, demandant un sacrifice
total, annulant la différence dans un calme enfin retrouvé. Blessure/suture à vif.
Multiplication du Deux : (( Double est notre angoisse, double le malheur qui vient
de s’accomplir )) (v. 847 8inhaL.. GiGup&vopccGipoipa). Réduplications (« les malheurs
succèdent aux malheurs ») qui miment le (( module N surgi au vers 509 : (( 6 ~ 0 p o çy&p
&vqp &vGpi T@ & O T ~ O E T ~ »,
I
(( En
ennemi se produira l’affrontement d’homme à
homme. N Asyndète et doublet se conjuguent pour bâtir une (( mimèsis n littérale du
module de l’unité duelle, dans une claire perception de la réversibilité de forme et
contenu. Le creuset du tragique est, comme éclair appariant-déchirant (insoutenable
plaie dans son affect pur) la pure forme de la répétition du même, terriblement
différent de devoir être différent alors qu’il est même : frères ennemis. (( ” A p ~ o v sri ’ & p ~ o v
ri K ~ O L ~ V ~T &
~ T~ ~ iEXBpoç
ç , OUV E&@
», (( Roi contre roi, frère contre frère, ennemi
contre ennemi N (v. 674). Le duel central est aussi mimé par les six autres duels,
parmi lesquels celui d’Hippomédon et d’Hyperbias, dont les boucliers eux-mêmes
sont des divinités en lutte : Typhon vomissant la flamme, dieu chtonien, contre Zeus
l’ouranien. Effets de dualité doublée qui culminent avec les vers 961 sq. :
((
rrcrioûaiç Ënaioaç - frappé tu as frappé
a6 6’Ëûuveq K ~ T C ~ K T U V W
-Vtu es mort en donnant la mort
âopi ~ ‘ Ë K U V E S ,6opi â’Ëûcrveç - au combat tu as tué, au combat tu as été tué.
où les jeux de variation différentielle sont limités à un radical (pcheo~ovoç/p~h~onaBilç),
une lettre (ËKavsç/Ëûaveç) quand ce n’est pas pure reprise du même mot (&il).
La
,
6’bptiv, doublets de spectacle et de parole
conclusion est évidente : Ginhti ~ É Y E L V81nhti
(v. 772).
Le Prométhée enchaîné expose la violence compensatoire d’un dieu’ sensible aux
dangers (est-ce pourquoi il détient un secret des dieux?) d’un déséquilibre du couple
fragile homme/dieu. En accordant aux hommes un savoir, Prométhée s’oppose au
dessein destructeur des dieux (même image dans Exode, 32 17) : (( J’empêchai que les
mortels mis en pièces ne descendissent dans l’Hadès. N Intermédiaire entre les deux
règnes dont il constitue la ((césure », il livre aux hommes le savoir de soi. Mais en
débrouillant les pensées des mortels
puisque avant lui (( ils voyaient sans voir,
écoutaient sans entendre et brouillaient tout au hasard au long de leur vie », il en
fait (( trop )) et se livre à la fureur de Zeus. Un trop d’amour. Mais il détient une
parcelle du dieu dans un secret, et ce secret, inversant les positions redonne l’avantage
à Prométhée : (( I1 aura besoin de moi, il brisera mes chaînes et reviendra faire alliance
2 80
( ~ i çClpepov) et amitié )) (v. 169). Belle illustration d u couple impur et asymétrique,
sans vainqueur, du (( plus-que-deux )) symbolique, où l’épaisseur invisible est (( porte
de sortie »,solution trouvable, évitement des unilatéralités. La ruse (« mêtis ») comme
recul est la perception de l’épaisseur et de la sortie possible (« poros ») du système :
aussi bien, Prométhée est-il tkivoç ~ r j p ~ ?~ v& &pqxBvov
k
icopov (( habile à découvrir,
même dans le sans issue, un chemin )) (v. 59). Et c’est cette ruse secrète qui tient en
échec l’ordre unilatéral de Zeus. Jacques Derrida, reprenant Hegel sur Antigone, avait
bien perçu ce principe :
Ces deux lois ne s’affrontent pas comme deux volumes ou deux surfaces pleines,
identiques à elles-mêmes, homogènes à elles-mêmes. Chacune est entaillée, fissurée
en son dedans et déjà par le travail d e l’autre en elle.
En un sens comparable, Beda Allemann parle de lutte fraternelle entre deux (( principes
communicants )) I V . Paradoxe au sens fort : Prométhée est la figure d u coupableinnocent chère à Kafka, du traître fidèle de Holderlin. Ainsi se confirme le module
central d’un agôn N redoublé, porté à sa puissance maximale, là où métaboles et
catastrophes mettent le monde, non à l’envers, mais dans son juste équilibre. Telle
est la source, tel est le ressourcement du tragique. Et il se pourrait même que l’allusion
au N foudre D de Zeus, (( tresse à double pointe à poignée médiane )) ne soit qu’un
croquis approchk de ce module dont l’importance décisive nous apparaît peu à peu * O .
Avec Agamemnon, retour d u dilemme, mais approfondi, puisque le père doit
sacrifier sa propre fille. La relation sacrificielle double cruellement, comme pour
Abraham, dont l’épisode est significativement quadruplé dans Crainte e t Tremblement,
la relation de parenté : (( Cruel est mon sort si je désobéis. Cruel aussi s’il me faut
déchirer mon enfant ... Des deux côtés il n’y a que malheur D (v. 206). Structure
identique dans les Choéphores. Oreste est pris entre le vœu de venger son père, et la
terreur du matricide : (( N e dois-je pas craindre de tuer ma mère? - Fais-toi des
ennemis de tout le monde plutôt que des dieux n (v. 899 sq.). (( Prends garde aux
chiennes vengeresses de ta mère! - Mais celles de mon père, où les fuir si je renonce? N
(v. 925). Ici encore le combat des hommes est mimé par un combat des dieux en
sorte que les protagonistes sont toujours au moins quatre. Le double fouet d’Arès qui
intervient dans les deux pièces des Choéphores et d'Agamemnon (v. 642 d’Ag. et 375
des Choeph.) rappelle la tresse à double pointe du Prométhée. Les doublets des Choéphores
font écho à ceux des Sept contre Thèbes: (( Arès luttera contre Arès, le droit contre le
droit N ”Apqç “Apei, A i ~ AiKu
q
(v. 46 1 ; la forme grecque est bien plus intense). Enfin
un dilemme, bifurcation ouvrant sur deux abîmes, occupe les Euménides en leur
centre : a Voilà où j’en suis : que je les accueille ou que je les repousse, dans u n cas
comme dans l’autre je ne saurais échapper à l’aporie )> (&;~1q~kvwç)
(y. 480). Doublement par l’intervention des dieux : Athéna contre les chtoniennes Erinyes, Apollon
1 ’ impur
~
», dieu sauvage et lumineux à la fois ‘ I jouant ies intermédiaires. Cette
nouvelle occurrence du module pourrait soutenir une interprétation que nous avanfons
prudemment : l’agôn, qui redouble la dualité et qui se montre l’enjeu du tragique,
ne serait-il pas la lutte de 1’« apeiron (l’informe de la nuit) et d u péras J (les formes
ciselées d u jour) autrement dit déjà le (( trop formel )) (Allzuflvnfiche) et l’« informel n
(Unforinliche) holderliniens ?
Si d’autre part les tragédies d’Eschyle font comme un tour d’horizon de la pensée
grecque archaïque, en faisant défiler la conception de l’équilibre d’un juste milieu
(« de la grande santé la maladie est proche )), Agamemnon), le principe anaximandrien
de la dette d’injustice (« il y a un vieux dicton [...I c’est que le bonheur parfait
devient fécond et ne meurt pas sans enfants », c’est-à-dire sans malheur, ibid., v. 750),
la réciprocité de tinzé (honneur) et de poiné (châtiment) autour de (c tisis
(dette) 2 2 , enfin le refus de i’accumulation ( a si une crainte sage, manœuvrant pru((
))
<{
))
((
)J
))
28 1
demment sait décharger un peu des richesses acquises, la maison ne sombre pas toute
malgré sa charge d’opulence », Cboéph.), n’y aura-t-il pas dans ces principes encore
vifs chez les Sages et les premiers philosophes, le modèle simple d’une dualité
agonistique s’enlevant sur le fond homogène d’un support de (( par derrière », qu’il
soit le sunécbès ,Y parménidien ou le polémos héraclitéen, capables d’accueillir tous
les deux possibles sans les réconcilier dans la fadeur d’une relève n dialectique?
Du dilemme des Suppliantes à la parenté déchirée des ChoéphoreJ, un seul enjeu
eschylien : la dualité doublée.
((
((
))
Sophocle et la machine hyperboliqzle
Avec un peu de sévérité, Sophocle disait d’Eschyle : (( I1 fait ce qu’il faut sans
savoir qu’il le fait. )) C’était bien repérer la distance et la complicité de leur (( brisure ».
Une dualité simple et allusive apparaît bien ici et là chez Sophocle zi. Mais pour
avoir rencontré dans son texte des structures bien montées et autrement subtiles, nous
verrons dans Sophocle le concept d’Eschyle. Et nous étudierons trois de ses (( machines n :
le (re)doublement, l’échange réciproque et asymétrique, l’oxymore symbolique.
Le redoublement, c’est d’abord l’ambiguïté de la parole mantique. Héraclès
croyait bien (( toucher au port », il n’avait pas compris qu’il s’agissait de sa mort (Les
Trachiniennes, v. 1167 à 1170). CEdipe clame sa vindicte contre lui-même, sans le
savoir lorsqu’il annonce : (( Ce n’est pas dans l’intérêt d’amis éloignés, c’est dans mon
propre intérêt que j’abolirai cette souillure )) (avec un r*UsOs aUro6 significatif, v. 138);
((Je me voue moi-même aux châtiments que mes imprécations viennent d’appeler
sur d’autres )) (v. 25 1); ((Je combattrai pour ma cause comme s’il eût été mon père D
(v. 264). Humour tragique! Le moyen après cela que Freud ne se soit pas intéressé
au personnage?
C’est aussi le dédoublement d u système de la parole véridique. On peut en effet
opposer Tirésias, représentant de la tradition d’une c Alétbeia > magico-religieuse,
comme index sui : (( en moi vit la force du vrai N (v. 353 d’CEdipe roi 2 4 ) , Alëtheia
qui a pourtant déjà perdu sa force automatique de conviction, sa Peitbô, puisque ni
Gidipe ni Jocaste n’en sont convaincus ’>,et d’autre part la constitution de 1’Apaté
comme ruse, illusion autonome. Ainsi Clytemnestre, dans Électre, voyait dans la
nouvelle du messager le salut, et non pas une feinte destinée à introduire dans le
palais son fils meurtrier. Ajax et Hector croyaient réellement après un long combat
se faire des cadeaux, mais ils s’offraient mutuellement la mort. Déjanire, trompée par
les paroles de Nessos, (( fait le mal en désirant le bien )) (Trachiniennes, v. 1137).
Polybe et Mérope, parents présumés d’CEdipe, lui dissimulent la véritable nature de
sa parenté. Et cet écran (( supplémentaire )) seul pouvait déclencher la série des
catastrophes.
Quant à la bifurcation, elle rappelle le dilemme eschylien. Deux voies s’ouvrent,
laquelle choisir? Le récit de Laïos comporte deux versions, celle des brigands, celle
des voyageurs. La première abandonnée, reste le choix entre une troupe et un passant
unique 26. Même problème avec Néoptolème à la croisée de la morale : faut-il obéir
aux injonctions d’Ulysse, et respecter les intérêts suprêmes des Achéens, ou bien tout
avouer en préservant du moins son intégrité morale (Philoctète)? L’image elle-même
de la bifurcation, on le verra, aura dans CEdipe à Colone une importance considérable 2 7 .
L’échange réciproque complique ce premier niveau de la dualité sophocléenne.
O n le lira dans les figures croisées : «philia ,Y et rpharmakon Y, 28. La «philia ,Y qui
lie désormais Hector et Ajax s’est rituellement -assurée d’un échange de cadeaux. Mais
ces cadeaux empoisonnés, trace d’un a mana », délivrent la mort.
))
282
C’est avec la ceinture même dont Ajax lui avait fait don qu’Hector, lié à la rampe
d’un char d’une façon qui lui sciait la chair, se vit traîné, déchiré sans merci, alors
que celui qui l’avait reçu en présent de lui a péri, par cette épée même sur laquelle
il a chu d’une chute mortelle (Ajax, v. 1028 à 1033).
Avais-tu prévu qu’un jour, d u fond de son tombeau, Hector serait ton meurtrier!
(v. 1026).
Les cadeaux de philia Y entre ces ennemis (le grec porte significativement le duel,
marque, comme en sanskrit (obha) d’un couple gémellaire indissociable : T ~ tVU ~ q v
GuoivBporolv) les ont tenus en chiasme, chaque objet représentant en l’autre une part
de l’adversaire, le baudrier d’Ajax établissant en Hector, et l’épée d’Hector en Ajax,
une tête de pont des intérêts de l’antagoniste. O n retrouve au passage un principe
oriental : Yin et Yang où les deux opposés s’enclavent et s’incisent impurement et
asymétriquement 2 9 .
Ce cadeau empoisonné peut aussi s’interpréter comme (( persistance du don n.
D’où sa transmission en chaîne. Les parents abandonnent E d i p e ; un serviteur le
recueille qui s’en défait au profit de parents adoptifs; ils s’en désistent par piété, et
retour au départ, avec tous les intérêts accumulés qu’il faudra payer au plus haut
cours. I1 faut que le don du mort soit relayé par une femme amoureuse pour
qu’Héraclès que rien n’abat soit vaincu (Trach., v. 1207). Hector triomphe ((postmortem )) d’Ajax par le relais de son cadeau : il y a là un cas de figure que Hegel a
omis dans sa lutte des consciences, et il se pourrait que le tragique tienne dans l’espace
de cet oubli.
Cette (( contagion )) très primitive de la mort désigne l’objet comme paradoxal :
nclhaiov GWpov (Trach., v. 5 5 5 ) il ne cesse de voyager tout comme le mouchoir fatal
d’Othe110 ou la clé dans Dial M for murder de Hitchcock. Objet trop intense qui
donne tout, mort comprise, il est pharmakon # à deux visages 3”. Cadeau porteur
d’un autre cadeau, inverse du Silène (la Lamie) il redouble le don en l’inversant. Le
mort saisit le vif, l’objet possède le sujet. C’est l’objet qui donne au donateur le sujet
du don, et non seulement le donateur qui confie au sujet l’objet du don 3 ’ . C’est à
la fois ce que Hegel voyait dans un certain type de (( plus 3 2 D et ce que Baudrillard
décèle dans le Code, désirant à la place du sujet dont le désir ne porte plus que sur
des intermédiaires d’intermédiaires, et le mettant en position d’objet (L’Echange
symbolique et la Mort) ou encore dans la (< marchandise inéchangeable )) (Les Stratégies
fatales) dont le lien avec l’insoutenable holderlinien seraient à creuser.
Qu’il s’agisse d’un cpharmakon Y, cela est clair dans le texte : (( Qui fut à Trachis
si expert en poisons? )) demande Héraclès (Trach., v. 1140). Son fils n’est pas dit
(( meurtrier )) mais (( médecin )) (v. 1209). Et c’est un (( philtre magique n que croyait
transmettre Déjanire (v. 575). Seraient alors des phamzaka Y chez Sophocle la paix
et la prospérité qu’CEdipe accorde à Thèbes, les enfants qu’il donne à Jocaste, les
malédictions sur le meurtrier. c Pbarmaka V, ses enfants qu’il lui faudra maudire,
U pharmakon I) lui-même, le plus épouvantable de la Grèce, << enfant indésirable, époux
contre nature, meurtrier contre nature )) (v. 1184-1 185). Mais devenu cpcrppcricoç (bouc
émissaire) il inversera sa mort en secours pour Colone et Athènes. L’amour, l’acte
d’adoption, le geste secourable, la vigueur indomptable, la profonde sagesse, tout a
viré en son contraire, et cette strophe révèle les deux visages du héros tragique, si
clairs dans l’anti-CEdipe, qui possède (( l’œil en trop )) d u secret de son autre, sa part
maudite, sa ligne de fuite, les deux se tenant en j l ~ o d o ç . Ainsi, chez Sophocle,
également, le doublement devient croisement et tend vers une figure quaterne.
Plus loin encore dans la complexité des machines duelles, se présente la figure
textuelle du symbole : l’oxymore. Elle concerne, dans une exagération de son principe,
une relation familiale perturbée dans les cycles d’Oreste et d’CEdipe 3 3 . Que le père
et le fils attachent leur désir au même port, a u même (( sillon N comme dit le grec
((
((
((
283
(« ainsi la chambre nuptiale a vu le fils après le père entrer au même port terrible »,
Edipe roi, v. 12 io) et c’est un (( coup double )) monstrueux, dont le rexte, pour
obtenir le maximum d’effet tragique, n’a qu’à mimer la duplication. Le même pullule,
et c’est alors qu’il est le plus destructeur : profonde intuition. Autrement dit, Sophocle
utilise l’oxymore de manière très différente d’Héraclite, par exemple. Les sens opposés
sont recherchés chez ce dernier (Diels Kranz, Frag. 54 : EV nolvscc; 60 : &vo K&W; 80 :
G ~ K Epiv)
~ v tandis que Sophocle cherche la répétition polyptotique (Fontanier, p. 352) :
(( tiyapov yolpov D ( E d i p e roi, v. 12 14). I1 y a bien chez Héraclite des oxymores fondés
sur des mots de même radical : 54 &<paVqç
< p a v q p ~62
~ , &û&varoiûvqroi. Mais Sophocle
concentre l’effet sur la parentèle : E t &vGpds&&pa (v. 1250 d’Edipe roi, d’une saisissante
portée car la traduction peut aussi bien être : (( Un homme d’un mari n qu’« Un mari
d’un mari ) , nouvel exemple du (( coupable innocent »> et simplifie l’effet par mouvement sur place : (( TÉKV’ EK riicvov T E K O ~)) (ibid.). Cette maxime lapidaire : (( Enfanté
des enfants de mon enfant N résume en trois mots le tragique : avoir subverti par une
surenchère les directions de la parentèle, celle qui va du fils au père, celle du frère
au frère ... Renchérir sur la paternité est le coup de grâce : K & T E ~ U Sh&~h<poU~
ncriGaç
[...I v\ip<puçyuvuiicaç pqsiporq avec un ternaire caractéristique de l’affolement. (( 0 noces,
vous avez amené au jour des pères-fils-frères [...] des filles-femmes-mères. D Et il faut
à tout prix respecter en français ce travail d’écriture par parataxe ou asyndète, comme
on pourrait résoudre le débat engagé par Heidegger sur les vers 360 et 370 du chaeur
d’Antigone en respectant les oxymores par une juxtaposition asyndétique.
Cet affolement général des relations de parenté, qui fait vibrer la langue sur
elle-même, est le revers du possible indéfini de l’homme : il est alors le terrifiant, et
c’est (( dans l’instant )) (ESai<pvqç) qu’CEdipe perd femme, enfants, mère, honneurs,
pouvoir. Tirésias avait vu cet abîme où tombait Edipe, 1 ’ hupsipolis
~
» désormais
apatride, mais comme le saura Holderlin, Tirésias, c’est la césure du temps (le soudain
du dieu) et l’abîme lui-même qu’il ouvre sous les pieds des personnages. Cette
strophe du temps nous fait comprendre que l’oxymore n’est qu’une figure textuelle
de la rapidité absolue, celle des échanges dans l’unité symbolique. Entrons plus
précisément dans cette machine de la tragédie.
Soit une (( lancée )) (Bohq, K physis » pour Heidegger). Elle est extériorisation, pari
sur l’espace, trace aventureuse. Elle se lance vers quelque chose. Posons-le inassimilable.
S’engage une lutte sans fin où s’arriment les deux lancées. Que l’une y défaille et
nous revenons à l’Un exclusif. Le symbolon » dont s’occupe entre autres la tragédie,
est la machine formée par la résistance conjointe des deux lancées qui s’épuisent et
se ressourcent de leurs assauts. Tenue unaire, échange réciproque, impossibilité d’éluder
la faille. En ce sens, le symbolon fonctionne aussi comme diabolé ». Il ponte deux
éléments en (( lançant entre eux )) mais constitue aussi l’obstacle de leur séparation. I1
tient l’espace de l’intervalle d’un pont et d’une faille : pont kafkaïen. La diabolé»
du t symbolon U est qu’il ajointe et déchire, comme le diable sait être le calomniateur
(((diabolos »). Imaginons donc un module pérenne où il soit impossible au K symbolon »
de perdre son équilibre : cela ne se peut qu’à supposer une assise du double symbolique
dans un nouveau double, en sorte que les deux symboles fonctionnent perpendiculairement (le quatriparti) ou en schiasme. Le symbole absolu trouve son point tranquille ,
dans l’hyperbole.
Rien d’abstrait dans ces figures. Elles ont souvent mimées dans des petites
machines, roues d’un char, vases, instruments chinois de divination. Elles sont le
concept universel de la pensée symbolique. Chez Sophocle un modèle de cette pensée
trouve sa perfection : Antigone et Créon. Mais si (Edipe a (( un œil de trop peutêtre )) chez Holderlin, c’est parce qu’il est, malgré lui, la parturition de cette perfection.
Partout, sur le chemin d’CEdipe, on rencontre ces luttes et ces couples, ces bifurcations
et ces strophes caractéristiques. CEdipe est la part commune de Laïos et de Jocaste,
où ils se tiennent unis au sein de leur plus grande différence. Sa monstruosité est de
((
((
284
redoubler cette part, car, semence de Laïos dans la chair de sa femme, il réensemence
cette chair, tout en donnant la mort à son géniteur: (( Ah comment le sillon que
féconda ton père a-t-il jamais pu, misérable, te supporter si longtemps en silence N
(aiy’, trad. Pignarre, G F : (( sans crier »).
Tout se passe alors comme si le lien naturel des groupes humains dans le
K genos », resserré par des luttes symboliques entre clans (potlatch) se pervertissait et
trouvait sa fin dans un surcroît. Dons horribles d’CEdipe, legs de Jocaste ou de Laïos,
K megaloprépeia
négative commémorent dans la tragédie la fin douloureuse du
U genos ». Et précisément parce que la pensée issue d’une constitution peut-être mythique
(voir la discussion chez Moses I. Finley et les spécialistes actuels de la (( cité )) antique)
d’une (( religion de la famille D, mais que l’on est forcé de postuler si l’on veut
comprendre la (< révolution politique n comme fin d’un système antérieur, cette pensée
d u secret, du refus de l’excès linéaire, de l’équilibre compensatoire, est près de céder
la place au grand mouvement des (( positivités n (monnaie, concepts philosophiques
et mathématiques, lois, égalité des citoyens...), elle produit sur son extrême déclin
une floraison de symboles dont la tragédie semble une expression raffinée. Ainsi,
plutôt que de mettre en scène une lutte rituelle dithyrambique dont beaucoup devaient
avoir perdu la clé, la tragédie contera la mort d u système familial, dans les affres des
parricides et fratricides ainsi que la lutte qui était responsable de cette mort : celle
de K genos » et polis », d’Antigone et de Créon.
Or, semble dire Sophocle, ce qui a perdu le (( genos )) est un trop ». Le (( trop N
du vainqueur légendaire de la Sphinge. Son (( trop D d’amour pour sa mère. Si CEdipe,
Antigone, et déjà Oreste, Electre, Clytemnestre, sonnent le (( glas )) 14 de cette famille
ancestrale, c’est par un trop d’amour qui aurait d û donner à penser à la pensée
positive. Voyez CEdipe le trop bon fils qui quitte ses parents pour leur épargner des
désagréments, Jocaste qui aime son fils comme un amant, Clytemnestre folle d’Iphigénie, Electre souvenir vivant de son père, Antigone qui sacrifie tout pour ses frères
et son père. Voyez l’amour trop fidèle de Déjanire. La chance du rgenos U semblait
(peut-être dans l’imaginaire) un renforcement des liens de parenté : en fait c’est ce
qui le perd. Dure leçon d u «pantoporos aporos ». A la limite ou sur la faille les
extrêmes sont un (fragment 130 d’Héraclite). Mais la rpolis », et Créon le montre
déjà, était elle aussi vouée à exagérer dans un seul sens, à linéariser durement ce qui
avait fait son triomphe, et ce qui fait notre souci. Notre âge occidental est la pensée
nécessaire de cet enjeu.
L’hyperbole œdipienne était Ia figure des rapports croisés de ses deux parentés
à son propre être double (ce qui nous fait à la réflexion, bien plus d’un œil en trop).
L’hyperbole antigonienne va plus loin, en pérennisant le principe de r g e n o s » face à
la (( polis )) ou à la loi qui semblent l’écraser. Cela est possible par une mutation de
l’excès dont CEdipe est porteur. Sa transformation (terrifiante pour Thésée dans la fin
d’CEdipe 2 Colone) est préparation de l’excès salvateur d’Antigone. C’est ici qu’il faut
faire un pas de plus pour suivre jusqu’au bout la constitution étonnante de cette
logique symbolique.
En effet le déplacement du problème de l’affrontement rituel d’homme et dieu
à celui de genos » et ((polis» ne biffe pas la lutte précédente tout en redistribuant
la (( donne D du monde grec. Le défaut de dieu (Gottes Fehl) chez Holderlin ou Karl
Reinhardt (la tragédie, dans Sophokiès, est (( signe vers l’énigme qu’est la frontière
entre l’homme et dieu ») ou l’affirmation de Hegel : (( C’est le divin qui constitue le
thème propre de la tragédie primitive )), (Esthétique, Flammarion, t. IV, p. 263),
disent l’importance de ce thème. Mais le dieu a changé. I1 s’est dédoublé pour tenir
l’instance humaine elle-même bipolaire. Au couple d’Antigone et de Créon répond
donc d’une part un dieu de la cité (soutien de la loi humaine et du formalisme
religieux) et un dieu des morts (qui pérennise le «genes» et a la haute main sur les
forces d’en bas, forces excessives toujours à maîtriser). Antigone sera le révélateur de
<(
((
285
leur hyperbole, où l’harmonie d’un point médian est ce respect des lois qui sait se
dépasser en respect du fondement de ces lois 3 5 .
Ce n’est donc pas pour sa piété fraternelle (même si son amour est quasiment
charnel, on le voit par (Edipe 2 Colone, v. 1414) qu’Antigone domine la tragédie de
sa stature, mais pour son juste rapport aux dieux d’en bas. Ce juste rapport s’entend
après coup comme endurance dans laquelle s’est renversée la fougue excessive d’CEdipe,
et comme le ((plus )) que laissait prévoir son ouverture d’homme brisé », élevé
infiniment au-delà de lui-même. Non qu’une hybris nouvelle le pousse à se prendre
pour un dieu, mais il a entendu la leçon du respect conjoint du dieu statutaire (il
obéit aux injonctions pieuses du chœur, (Edipe à Colone, v. 170) et du dieu foudroyant,
maître du r tbauma ». Cette leçon conjoignante et dédoublante se nomme Antigone,
et a permis à Holderlin de concevoir une logique non chronologique de la séquence :
(Edipe Roi/ Antigone.
Ce n’est pas non plus pour avoir méprisé sa parenté (CEdipe à Colone insiste sur
sa violence à l’égard d ’ a d i p e et de ses filles) que Créon est finalement abattu, sans
pour autant, Hegel le sait bien, que son choix politique cesse de représenter un avenir,
et en cela il ne peut être vaincu, mais pour sa négligence des lois éternelles en
lesquelles s’enracinent même les lois qu’il défend. L’enseignement de Sophocle est
peut-être encore plus profond : alors qu’Antigone (comme le note Mazon dans sa
notice : Les Belles Lettres, 1767, p. 65) ne conteste pas les droits de Créon, et les
comprend, Créon a cette naïveté de la bonne conscience du juste, prototype d’une
redoutable attitude politique qui (( ne sait que le Vrai ». La loi d’Antigone dit deux
fois oui, son a oui )) est doublement symbolique, la loi de Créon dit (( oui n pour
l’un, (( non )) pour l’autre sans comprendre plus avant. Et cela, aussi bien Nietzsche
que déjà Holderlin l’ont saisi dans la tragédie.
Bref, l’hybris de Créon est linéarisation indéfinie de la puissance des lois positives,
et le sacrifice d’Antigone est l’instance de transgression requise pour rééquilibrer par
une courbure. Une potentialisation sérieuse ne peut en effet s’obtenir que par un
retour de la force qui a atteint son maximum, et s’offre ainsi un nouveau champ
pour poursuivre son avancée (Nietzsche le dit par le couple de Dionysos et d’Apollon,
Parménide par le fragment 5 du Poème). La courbe mathématique de l’hyperbole, ou
le thème de l’hyperbolique et du retour chez ces philosophes et chez Holderlin disent
cette courbure sans régression qui s’équilibre dans le modèle de deux croisements
inverses à double courbure compensatoire.
La latence entre les deux tragédies où CEdipe est protagoniste, cette lente
maturation par la souffrance joue le rôle de (( tiers D ou de a case vide », de césure
constitutive d’un dépliement du dieu en deux parts, ce qui seul lui permet de ne
pas dépérir. Par là l’homme garde aussi son ouverture, la loi se retient de devenir
un rite sans référent, le positif ne fait pas encore (( croître le désert ». Ainsi devient
claire la nécessité dans la tragédie de dualités doublées, d’une (( épaisseur )) du symbole,
du r kommoJ Y, où se joignent chœur et personnages. Par une machine de plus en plus
complexe, la tragédie monte une pensée stratégique, une sagesse, où le (( plus que
deux )) comme support n’est pas pour autant (( conciliation )).
L’instance de la tragédie grecque dans l’accomplissement poétique holderlinien
Montrer que la structure conceptuelle des tragédies d’Eschyle et de Sophocle
(avec Euripide (( quelque chose change )) j h ) est ce que Holderlin entend comme
N démarche de l’esprit poétique », nous permettra de mesurer le pas accompli par le
286
poète depuis cette extrême avancée de la pensée grecque. Et dans la réflexion sur
l’essence de la poésie, la position holderlinienne est d’autant plus originale qu’elle
admet pour point de départ une conception très comparable à celle de son condisciple
et ami Hegel. Ils se retrouvent sur la définition d u lyrique (l’intérieur, le subjectif)
et de l’épique (l’extérieur, l’objectif, Esth. op. fit., p. 94) et sur l’idée d’une N zone
intermédiaire )) entre forme intérieure et extériorité (ibid., p. 9 1 : Elle participe aux
deux domaines extrêmes ») ou encore dans l’échange croisé des deux : (( Cette objectivité
qui a sa source dans le sujet, et cette subjectivité présentée dans sa réalité et sa
signification objectives, forment la totalité de l’esprit n (ibid., p. 95). O n trouvera
chez Hegel des oxymores : (( coupable-innocent n (ibid., p. 282). Mais si Hegel a bien
vu, notamment pour Antigone, le principe d’avoir en soi la raison de sa destruction
et le gage de sa sauvegarde (ibid., p. 286), reste que la conception centrale chez
Hegel, de la tragédie comme conciliation calme que le (( vrai substantiel 1) produit en
<( relevant N
I’unilatéralité d u conflit, est radicalement inopérante dans la pensée
holderlinienne.
Le détail des Essais et des Remarques nous en convaincra. (( Réflexion )) (SW 4,
p. 243; Pl., p. 605 3’) ajointe d’emblée les contraires de sobriété et enthousiasme :
(( Là où la sobriété t’abandonne, là est la limite de ton enthousiasme. N Et Holderlin
ajoute, en un sens que Nietzsche n’oubliera pas : <( O n peut tomber dans l’altitude
comme dans la profondeur ”. n L’idée est celle dont Sophocle nous a entretenus : la
montée en puissance (Steigerung) ne se fait pas linéairement, mais dans la courbe
qu’implique la tenue de l’équilibre des forces en tension :
Qu’il se garde surtout de croire qu’il ne pourra se surpasser (U’bertreffen)qu’au
moyen d’un crescendo allant du plus faible au plus fort, il n’en résulterait qu’un
manque d’authenticité et un excès de tension [...I un surcroît de légèreté compensera
la perte de profondeur, le calme remplacera fort bien la violence (Pléiade, p. 606).
Comment le dire mieux? Renversement, réciprocité harmonique, excès non linéaire,
le moins qu’on puisse dire est que les choses de la tragédie grecque ne sont pas
étrangères à Holderlin, et dans leur concept même.
Tentons alors d’entrer dans ce texte redoutable qu’est (( La démarche de l’esprit
poétique )) (SW4, p. 251; Pl., p. 610 ’I)). Attachons-nous d’abord à saisir le sens de
cette longue phrase introductive de trois pages : Wenn der Dicbter einmal des
Geistes... Structure étrange : une protase de 69 lignes, une apodose de deux lignes.
Si le principe de réversibilité de forme et contenu se vérifie aussi chez Holderlin, une
si évidente disproportion a un sens. Dans les premières lignes (1 à 8 d u texte français)
le poète doit remplir la condition d’une saisie des principes d’alternance (Werbsel)et
de tension (Fortstreben) harmoniques, de reproduction de soi ri l’extérieur et de progrès
de l’esprit (Folgerungsweise).Mais dès la ligne 9 intervient l’antagonisme (Widerstreit)
qui sépare la synchronie (sirnultanéité des parties, unité de l’esprit) appelée contenu
spirituel (geistig Gebalt) et désignée ici par a, de la diachronie (reproduction de soi
à. l’extérieur, progression, alternance) appelée forme spirituelle (geiJtzg Fovrn) et signalée
ici par b (lignes 9 à 1s). Mais a et b se divisent eux-mêmes en deux : le contenu
spirituel implique, pour être saisi, une différence de degr6 dans le contenu sensible
(Sinnlicb Gebalt, G a d e ) ( = a’), la forme spirituelle, pour la même raison, une
identité de la forme sensible (Sinnlicb Form) ( = b’) (lignes 15 à 29). L’antagonisme
peut alors développer un chiasme que Holderlin, sans reprendre souffle 40 étudie
branche à branche. I1 faut en effet que le poète comprenne que l’antagonisme de a
et de b se résout précisément pat le fait que : 1) la forme sensible identique (b’)
compense l’alternance des parties (h) et satisfait l’exigence d’identité de a; 2) le
contenu sensible différentiel (a’) compense le besoin d’unité (a) et satisfait l’exigence
de progression alternante (b). D’où la première figure chiasmatique : (1. 29 à 46)
(<
))
287
Schème 1
+compense
-satiJfait
La figure du chiasme ne serait pourtant pas complète si le mouvement inverse ne se
vérifiait pas. I1 faut donc que l’antagonisme entre a’ et b’ se résolve par le fait que :
1) le contenu spirituel (a) compense la déperdition d’identité matérielle dans le
contenu sensible (a’) et satisfait l’identité matérielle (b’); 2) la forme spirituelle
alternante (b) compense la déperdition de diversité matérielle due à la progression
vers le point culminant d’identité matérielle (b’) et satisfait le contenu sensible (a’).
Deuxième chiasme inversé (1. 46 à 56) :
Schème 2
d’où
un
double
chiusme :
Schème 3
II reste encore au poète à comprendre, si la tête ne lui tourne pas trop, que c’est
pour autant qu’ils sont inconciliables (muereinbar) que a et b, a’ et b’ peuvent
devenir sensibles Cfühfbar) dans leur antagonisme (1. 56 à 62). Dans cette inconciliabilité, chaque élément peut trouver son point culminant. Mais c’est aussi son (( point
tranquille N (Rahepankten) car la (( progression identique )) (b’) est procès vers le point
culminant, et ce point lui-même est double, satisfaisant à la fois la stabilité et le
procès en tant qu’« akmé U . Ce (( repos culminant )) réalise une (( harmonie )) où les
contraires s’équilibrent et se tiennent. O n peut alors dégager le schème complet :
Schème 4
288
ou, selon
l’hyperbole :
Schème 5
/
WirkungJkreis
Dans cette recherche exceptionnellement rigoureuse, Holderlin veut sans doute
dire que cette démarche écartelée, croisée, recourbée, doit pourtant s’imposer dans
l’évidence d’une seule (( tenue », d’où la phrase d’un seul souffle. La facilité parfaite
de l’esprit poétique apparaît alors au plus haut du difficile : (( Tout proche, mais
difficile à saisir le dieu N... L’essentiel, on le voit, n’est pas dans les éléments mais
dans leur quaternité comme champ d’effectivité (Wirkungskreis). Qu’est-il exactement?
(Pl., p. 613).
Entre (( expression )) (Ausdruck) de la matière poétique, et (( élaboration libre ))
(Behandlung) de l’esprit, il est fondation. Esprit-matière, il est conciliation spirituelle,
et dissociation matérielle, (( ce qui le distingue, c’est qu’il est toujours opposé à luimême ». Principe de change et de stabilité, il inverse les valeurs, sépare l’uni, libère
le fixe et inversement. (( Dès lors la signification concilie même ce qui est absolument
contradictoire, et est en tous points hyperbolique. )) C’est que les contenus, parvenus
à I’inconciliabilité, sont pourtant conciliables par le degré et l’orientation de cette
opposition et sont pris dans 1’« Allgemeinsten 8 de la vie, union contradictoire de tous
les opposés comme U Harmonischent gegengesetzt N. A ce point, l’esprit devient sensible
comme (( infini )) et s’apparaît de la façon (( la plus sensible, la plus hyperbolique )),
dans un (( négatif-positif N qui semble un commentaire de l’épigraphe d’Hypérion (Pl.,
p. 618). Holderlin peut alors écrire :
L’unité infinie qui est point d e
d’unification d e l’unicité en tant
qu’en elle l’opposé harmonique
tant qu’opposé, mais les deux
p. 619).
séparation d e l’unicité en tant qu’unicité, point
qu’opposition, et l’un et l’autre à la fois, d e sorte
n’est ni opposé en tant qu’unicité, ni unifié en
en un seul, unicité-opposé indissociable ... (Pl.,
Infini présent, moment divin, art accompli. Cette définition nous semble le montage
d’une machine simple de mécanologie mystique. Chiasme, renversements, symbole,
excès, hyperbole sont les rouages de cet (( organe en soi n comme le nomme Holderlin.
Quand il faut exprimer cet infini, réapparaissent les réduplications (( hébraïques )) :
(( Monde dans le monde, voix adressée à 1’Eternel par 1’Eternel D (p. 618) où, à la
césure, souffle le divin et devient possible le « kommos 8 .
Holderlin tente cependant d’aller plus loin que les tragiques en déployant un
arsenal conceptuel de définitions : I’opposé harmonique sera l’élément qui échange place
et qualités dans une lutte indéfinie; l’Harmonique opposé sera la (( tenue », l’appovia
grecque, où opposé doit être entendu comme l’&vri~ofiçhéraclitéen (DK, frag. 10);
l’alternance ou change est la réciprocité des mouvements croisés ; l’absolument opposé
est i’inconciiiabilité réelle d’éléments qui ne luttent pas dans une unité molle et
fadasse, mais trouvent au bout de leur inéchangeable la strophe qui les ajointe en
conciliation ; la césure est alors faille irréductible encre les opposés, leur rééquilibration
architectonique, la blessure sans guérison, le yopcpoç parménidien qui fait couple dans
289
le Prologue du Poème avec K E P O V ~: coin qui écarte, cheville qui tient, l’insoutenable
de la blessure de Philoctète.
Même idée en d’autres textes. <( De la religion N donne la recette d’un emboîtement par tenon et mortaise : (( Chaque partie dépassera légèrement la limite nécessaire, d’où leur indivisibilité )) (SW4, p. 287 sq). Les enjambements dans les poèmes
et le U aber U caractéristique sont sans doute de ces dépassements. (( Le devenir dans
le périssable )) (SW4, p. 294; Pl., p. 651) dit le tragique comme chiasme de l’infini
réel et du fini idéal. Le (( Fondement d’Empédocle )) définit le <( plus-que-deux )) :
Lorsque chacun d’eux est entièrement ce qu’il peut être et que l’un s’unit à l’autre
en comblant la lacune de l’autre, lacune inévitable sinon il ne serait pas tout à
fait ce qu’il peut être en tant qu’objet singulier, alors nous sommes en présence
d e la perfection (SW4, p. 155; Pl., p. 656).
Alors naît le sentiment le plus sublime que l’on puisse éprouver, lorsque se
rencontrent deux opposés ! )) Holderlin travaille plus spécialement le concept de
(( retour ». La nature est aorgique (illimitée) et l’homme organique; chacun d’eux part
de son N natal », tend vers son contraire puis revient au natal. Dès lors les deux
mouvements admettent deux points de rencontre symétriques, où la nature est plus
organique et l’homme plus aorgique au même instant. A ce point (Ev pEcrcp), lieu
surdéterminé de la pensée grecque, survient
...le moment où l’organique, devenu aorgique, semble se retrouver lui-même en
se fixant à l’individualité d e l’organique, et où l’objet, l’aorgique, semble se trouver
lui-même en trouvant à l’instant où il revêt son individualité l’organique à la
pointe extrême d e I’aorgique, si bien qu’en ce moment, en cette naissance de
l’hostilité suprême, semble se réaliser la conciliation suprême (Fondement d’Empédocle).
De tels textes sont radicalement inintelligibles dans une logique asymbolique où ni
la tragédie grecque ni un Empédocle, comme emblème vivant de la contradiction
vécue à sa plus haute intensité, ne sont concevables.
Qu’est-ce alors que la tragédie? Tentons de potentialiser les Remarqzles... par
l’acquis précédent.
La présentation d u tragique repose principalement sur ceci que l’insoutenable
(Ungehauer) comment le dieu-et-homme s’accouple (sich paart) et comment toute
limite abolie (grenzenlos) la puissance panique d e la nature (die Naturmacht ) et
le tréfonds (Innerstes) d e l’homme deviennent Un dans la fureur (in Zorn Eins
wird) se conçoit par ceci que le devenir-un illimité (grenzenloses Eineswerden) se
purifie (sich reiniget) par une séparation illimitée (grenzenloses Scheiden).
La (( césure )) (Z2sur) n’est autre que (( le change des représentations à leur sommet N
en un sens désormais intelligible (Pl., p. 952, SW 4, p. 230 4’). Dans le ((statut
calculable D (Gesetz) de l’œuvre, la césure équilibre les deux parts de la tragédie. Elle
est donc champ d’effectivité, suspension des formes, arrachement tragique à la sphère
de la vie (HWB 2, p. 231) faille où l’insoutenable d’une sphère excentrique des
morts survient. Ce U deinon U est aussi l’originel qui surgit quand le signe égale a zéro ))
(SW 4, p. 286) et que se produit dans la vacance des formes la suspension antirythmique. L’homme ne doit pas se faire happer par cette vacance : c’est ce recul de
l’étant dans son ensemble qui révèle le o péras d’une discrimination validante des
formes, qui ainsi peuvent faire, sur fond d’o apeiron U leur (( retour », évitant ainsi un
nouvel enracinement du devenir-forme dans une forme non nécessaire. Ainsi s’entend
la césure comme (( marche sous l’impensable )) des Grecs et des hespériens 42.
))
290
C’est donc de l’intérieur même de l’expérience d u feu aorgique que le recul des
formes vers l’informe valide l’organique des formes ou leur harmonie. Cette harmonie
étant croisement, le concept de tragédie sera l’évitement absolu d’un devenir-forme
unilatéral ou non croisé : ainsi les dieux punissant l’hybris qui consisterait (Empédocle)
à se prendre pour un dieu. L’homme ne doit jamais être sans résidu ce qu’il doit
pourtant viser totalement (le dieu). L’unilatéral doit alors se (( purifier D et payer sa
dette d’injustice (il est clair que la parole d’Anaximandre est une saisie très profonde
du modèle tragique grec et holderlinien). C’est alors plutôt l’olyvoç que le Kkûapoç
d’une conception aristotélicienne que signifierait sich reiniget > : paiement de 1’«injustice ». Dès lors la citation de Suidas deviendrait : (( Le greffier de la nature, laissant
macérer (sens de rino6pÉ~ov)son calame pour qu’il devienne bien disposé n (sens de
~UvoUven cette position). Et elle concernerait, comme le pensent certains commentateurs, Sophocle et à travers lui CEdipe qu’une longue souffrance fait macérer, comme
ont viré de la sauvagerie à la bienveillance les divinités qui l’accueillent (Euménides) 43.
Statut non calculable, mais concevable, la faille demande la confection d’une
machine comportant le (( contre )) (gegenseitig), l’excès (alizukeusche, alizumecbaniscbe),
l’échange (lneinandergreqen) (HWB 2, p. 736) :
((
D’où le dialogue tout en oppositions, le chœur en tant que contraste au dialogue,
l’excès de réserve réciproque, l’intrication machinique excessive... Tout est discours
contre discours, chacun fait place nette de l’autre (HWB 2, p. 736).
Mais que signifie ce trop de pudeur (alizukeusche) 4 4 ?
La figure d’CEdipe, à s’enlever trop brusquement vers le céleste, côtoie le K deinon
d’un devenir-un avec le dieu. Dans le trop d’une logique de l’excès, il ne peut que
faire volte-face (kehret), mépriser Tirésias, figure vivante d u dieu. La potentialisation
des forces n’est préservée qu’au prix du (( détournement catégorique ». Double détournement 4 5 où le dieu et l’homme (( se parlent dans la figure tout oublieuse de
l’infidélité N (HWB 2 , p. 7 3 6 ; PI., p. 968), oxymore d u (( traître pieux ». Mais le
dieu vire car (( à la limite d u déchirement, ne restent que les conditions de l’espace
et du temps )), et la figure toute mathématique de l’hyperbole. Nous savons ce qu’il
faut entendre ici par mathématique. L’essentiel est dans l’antisymétrie ou (( impureté )) :
que début et fin (( ne se laissent plus rimer N et que ni l’un ni l’autre d u dieu et de
l’homme ne peuvent (( s’égaler à la situation initiale ». Dans le Kategorischen Umkehr,
une nostalgie mimétique fascinée par l’identité laisse place à la (( démarche n (Foigerungsweise, avons-nous vu pour le poétique) dans un rapport réciproque où la fidélité
est (( trop grande N fidélité, le respect (( trop grand D respect (hérétique), en sorte que
s’évitent les deux dangers de la relation : le statu quo d’infériorité et de supériorité
où les places d u dieu et de l’homme sont fixes; le détournement définitif dans
l’extériorité oublieuse et radicale (la (( conscience malheureuse », et Dieu est mort).
Opposition réelle et unité, mouvements croisés qui s’inversent (cf. la lettre à
Neuffer du 12 novembre 1778), déplacement du point de croisement, qu’il s’agisse
du rapport des Grecs et des hespériens, de l’aorgique naturel ou de l’organique
humain, de l’homme et d u dieu, toujours se retrouvent ces éléments qui en tant que
principes peuvent être dits catégoriques. Mais la dualité doublée ou le double chiasme
ne suffisent pas encore à rendre raison de ce (( tout vivant aux mille articulations N
(lettre à son frère, 1“ janvier 1799) de la poésie. En effet, à la césure, les points de
croisement sont aussi des points d’hésitation où la route peut virer: l’hésitation
parvenue à son comble, ou la potentialité de virages indéfinie, est le (( désert ».
CEdipe, le c nefas devenu antitbeos 8 est conduit par le détournement catégorique dans une (( atopie N où plus rien (honneurs, famille, pouvoir, temps) ne (( fait
trait ». Ce désert est le lieu des virages, le champ d’effectivité lui-même devenu
sensible. CEdipe y retrouve le respect du dieu statutaire, et de là, saute à sa disparition,
))
((
29 1
qui l’assimile à un dieu. Antigone a le même trajet à ceci près que c’est son
détournement des formes seulement statutaires de la divinité qui déclenche un virage
du dieu, se dédoublant en dieu statutaire et dieu sauvage. Antigone, du désert de sa
tombe, saute plus haut que le dieu du rite, vers la sauvageté des morts. Dans les
deux cas, au point de rencontre des croisements entre dieu et l’homme, s’est produit
l’hésitation ou la latence d’une marche au désert, (( sous l’impensable )), et cette latence
est suivie d’une volte-face où l’homme, au lieu de suivre un retournement natal, se
met à suivre une voie contraire, vers un a plus haut que dieu ». Chaque fois que
Holderlin modifie sciemment (voir sur ce problème F. Beissner, Holderlins Ubersetzungen aus dem Giecbiscben, Stuttgart, 1961, et les (( Notes D de la traduction de
l’Antigone de Holderlin par Lacoue-Labarthe) le texte de Sophocle, il s’agit d’un enjeu
capital, de cette a ouverture à fond ». La semence que Danaé thésaurise ( Z C L ~ L ~ E ~ C T K E ) ,
chez Sophocle (Beaufret, p. 24; Lacoue-Labarthe, p. 109 et 173), devient le devenir
temporel (Vater der Zeit / die Stundenscblüge). La semence devient donc le spermatique
universel des conditions d’espace et temps, dans un temps sans protension ni mémoire.
I1 ne suffit pas, pour que naisse le tragique, que l’homme soit arraché à sa sphère
d’intérêt (nulle part elle n’est aussi attrayante que dans l’attachement d’Hémon et
d’Antigone à la veille des noces), mais il faut aussi qu’une potentialité non dévoilée
de l’homme (son deinon ») prenne le relais 46. Cette épiphanie non métaphysique
débloque aussi une épiphanie du dieu 47. C’est alors s’acheminer vers une définition
du tragique comme (( risque d’un contour ».
La peur, manquant d’élasticité (Pl., p. 689) devient manie des formes fixes et
des a monumenta », elle interdit le (( déploiement multiple des forces ». Au contraire,
tragédie et poésie comme risque sont l’avancée qui déplace le point de suture des
croisements. Saut par-dessus l’abîme comme seuls, et en cela ils connaissent la
proximité du risque et de ce qui sauve, les fils des Alpes savent le faire («Patmos »).
Or que dit Holderlin du risque dans l’œuvre d’art?
((
Le moment le plus risqué dans le cours d’une œuvre d’art, c’est quand l’esprit
d u temps et d e la nature, ce qui est céleste, ce qui saisit l’homme, et l’objet de
son intérêt se dressent face à face au comble d u farouche, parce que l’objet sensible
ne va qu’à mi-chemin, tandis que l’esprit s’éveille au comble de sa puissance, là
où prend feu sa seconde moitié. C’est là que l’homme doit le plus fermement
tenir bon, c’est là qu’il se dresse ouvert à fond, et prend son contour à lui (PI.,
p. 960, HWB 2 , p. 784).
Le contour ( a Fest Y, de l’Origine de l’œuvre d’art chez Heidegger) est le miracle d’une
a dynamis » de la forme, obtenue par son passage dans son contraire absolu, 1 ’ in~
forme n qui (( l’ouvre à fond ». C’est ce qu’ébauche aussi Hémon avec Créon en jouant,
déjà chez Sophocle, sur les sens de &pxq et oÉ6.51~(Sophocle, Antigone, v. 744-745;
Holderlin, H W B 2, p. 762 et Lacoue-Labarthe, p. 87). ”Apxq, c’est commandement
et commencement, oÉ6~1vc’est respecter et être pieux. Au-delà des filigranes du destin
qui veinaient l’intrigue, c’est dans le décalage sémantique qu’est le point décisoire,
et un virage apparemment minime suffit pourtant à ouvrir le personnage. Ainsi le
a Mein » de a Mein Zeus Y, (Antigone, v. 460; Lacoue-Labarthe, p. 53 48) engouffre
Antigone et la tragédie dans 1’« esprit de la sans cesse vivante, la sauvageté non écrite,
l’esprit du monde des morts ». D’où le mépris pour le prêtre dans la première version
de la Mort d’Empédocle, car il interdit ce virage-là.
Si les Remarques sont peut-être le texte le plus prégnant de la littérature, c’est
parce que, dans une forme poétique, elles croisent pour la première fois après les
Grecs le couple d’homme et dieu, ressort du tragique, et celui des Grecs et des
hespériens, ressort du déplacement du tragique. (( Cela vire du Grec à l’hespérique ))
(PI., p. 961) en (( plein centre N (Ev pÉoq). La tragédie nous impose de penser 1’« absence
de rime N parce que quelque chose a changé depuis les principes qui faisaient le fond
292
de l’esprit grec. D’où des paradoxes lorsque le déplacement d u point de suture est
déplacement du barycentre non seulement d’une pensée (grecque) mais aussi de deux
pensées (grecque-occidentale). Par exemple Antigone répète la patience d’Empédocle,
qui pouvait rejoindre dans la joie la Nature et les dieux, et ne l’ayant pas fait à
temps, se condamne à une longue souffrance bénéfique aux hommes 49. Et il y aurait
à dire sur les fosses (KUTZOKM~&Ç) qui, dans le délai d’une mort lente de l’ensevelissement vivant, rappellent plutôt l’empaquetage de notre mort hespérique (voir lettre
du 4 décembre 1801 et la (( Lettre à Bohlendorff », Pl., p. 1004). Et Antigone est
aussi chez Sophocle la ferme détermination d’une conscience de type hespérique, aux
yeux de Holderlin. Pourtant, c’est bien une pièce grecque où la parole tue directement
des corps (« médiation meurtrière ») tandis qu’en CEdipe ou dans le personnage de
Créon parlerait une parole plus hespérique puisque tous deux, épargnés, subissent le
long délai d’une parole (( immédiatement )) (elle touche sans médiation l’esprit)
(( meurtrissante )) (elle ne détruit pas les corps).
I1 faut donc en venir à la conception d’un tout grec-hespérique fonctionnant
(( impurement ». Les deux harmoniques opposés se tiennent par leurs lacunes et leurs
réciproques tirants. Les Grecs, moins maîtres dans le pathétisme sacré parce qu’il est
leur natal, excellent dans l’exposition modérée qui est leur acquis. Chacun vole à
l’autre une part de lui-même et le bat sur son propre terrain. Avec les tragédies de
Sophocle et leur traduction, avec l’Empédocle, un point central se précisait pour
Holderlin : effectivité du (( moment infini », qui a d û l’enivrer au-delà de toute
expression. Mais comment son époque aurait-elle compris (et l’avons-nous nousmêmes bien comprise?) cette évolution de Holderlin depuis une nostalgie de la Grèce
et de l’UN, jusqu’à cette conception toute machinique et conceptuelle, antimétaphysique, où l’essentiel n’est plus un modèle esthétique intemporel, mais l’((habitation
poétique », la (( lumière philosophique », le (( contour D d’un croisement continu des
Grecs et des Modernes? Et que le génie de Holderlin consistait à s’être placé en ce
point et à avoir commencé à l’aménager poétiquement? (( Car c’est poétiquement
toujours que l’homme habite cette terre )) (« En bleu adorable »).
Quel que soit le sens de gegen J (lettres à Wilmans de septembre 1803 et
avril 1804), et que Holderlin ait orientalisé dans les deux cas, ou orientalisé e t
simplifié le texte grec pour en retrouver la pureté, reste que le pas de Holderlin est
de ne pas séparer, préservant à notre sens un enseignement de la tragédie grecque
elle-même, le sort des Grecs et des hespériens, en n’allant pas couper leur symbole
infrangible. Cela veut dire en profondeur que Holderlin savait que les pièces de
Sophocle intéressent la modernité par cette latence d’CEdipe où s’est constitué le savoir
de soi qui se nommera Antigone. N e perdons pas de vue la pièce non écrite d’une
(( marche au désert )) d’CEdipe soutenu par sa fille. C’est là qu’Antigone, en silence,
souffrant de l’horrible secret de sa naissance, impure comme fille et sœur de son père,
niée dans ses désirs de jeune fille, écrasée par la tâche, se forge cette conscience qui
fera virer le temps, le dieu, l’occident post-schopenhauerien en philosophie. Cette
latence, à la fois grecque (savoir de soi) et hespérique (délai) nous apparaît comme
le point indépassable d’un dernier symbole : celui de Sophocle et de Holderlin.
Dans l’espace infini d u déplacement de leurs points de croisements qui se nomme
avenir de l’occident, les enjeux de la modernité restent possibles, en suspens, césurés.
((
Arnaud Villani
NOTES
1. Le couple nietzschéen d’Apollon et Dionysos r e p t dans les recherches récentes de Marcel Detienne
une confirmation : un Apollon meurtrier, avide du sang des sacrifices, patron des bouchers, dieu noir et
293
impur, double l’Apollon du rite de purification, lumineusement rationnel. De la sorte, l’échange des
deux divinités est aisé.
2. Idée mise en relief par Schelling, Lettres sur le dogmatisme et le criticisme, Aubier 1950, lo’ lettre :
(( Un mortel destiné par la fatalité à devenir criminel, luttant contre la fatalité et cependant terriblement
puni pour un crime qui était l’œuvre du destin! [...I Lutte dans laquelle le mortel, lorsque cette puissance
était une surpuissance, devait nécessairement succomber, et pourtant, comme il ne succombait pas sans
lutte, être puni de sa défaite. Voir Lacoue-Labarthe, a La césure du spéculatif », qui suit la traduction
de l’Antigone de Holderlin, Bourgois, 1978.
))
3. Angélus Silésius, Pèlerin chérubinigue, trad. Plard, Aubier 1946, lerlivre, dist. 8 : (< Ainsi Dieu ne
vit pas sans moi, et si je deviens néant, il rend l’âme »; dist. 9 : ((Je suis aussi grand que Dieu, il est
aussi petit que moi »; dist. 22 : Autant tu cèdes à Dieu, autant il peut être pour toi. D
4. Inutile de revenir sur le fameux chœur d’Antigone, commenté notamment par Heidegger, in
Introduction à la tnétaphysique, Gallimard, 1967, p. 153 sq., et dont l’aspect formel est déjà tout le sens,
le (< mode d’emploi ».
5 . La césure du spéculatif )) est en ce sens un texte riche. L’auteur s’appuie sur l’étude programmatique
de Derrida, Glas, Galilée 1974, p. 188 : (( La logique de I’Aufhebung se retourne à chaque instant dans
son autre absolu. L’appropriation absolue est expropriation absolue. L’ontologique peut toujours être
relu comme logique de la perte ou de la dépense sans réserve. )) Hiatus entre Hegel et Bataille, entre
la dépense et la relève ». Plutôt que de supposer une dialectique spéculative N que Holderlin n’aurait
pu que répéter en la parodiant, au cours d’un long travail de sape N qui ne lui offrirait nulle occasion
d’installer une quelconque différence (p. 191). pourquoi ne pas partir d’emblée de la mise en suspens n
où Lacoue-Labarthe voit très justement le ressort de la pensée de Holderlin : Plus c’est proche plus
c’est lointain. [...I le maximum de l’appropriation [...I est maximum de dépropriation n (p. 216-217).
Par l’économie radicale du procès dialectique se dégagerait un espace original de la pensée où l’hésitation,
le suspens, la bascule, la (( pure perte )) deviendraient effectifs : retour d’Héraclite.
((
((
(<
((
((
))
((
6. Hegel, Science de la logique, cité par Peter Szondi, in Théorie d u drame moderne, L’âge d’homme,
1983, Introduction ».
7. L. Marin, Utopiques. Jeux d’espace, Minuit, 1973
8. Un problème comparable se pose avec l’origine de l’information et le débat entre ordre et désordre,
entropie et néguentropie. Voir R. Ruyer, L a Cybernétique et l‘origine de L’information, Flammarion, 1954.
9. Husserl, Méditations cartésiennes, Vrin, 1969. Qu’il soit ici bien évident que n’est en aucun cas
mis en cause le moment crucial de la naissance des positivités )) en Grèce. Mais ces positivités ne
naissent pas sans lutte : secret/promulgation, hiérarchie/égalité, famille/cité ... Comme dit Derrida,
cette guerre n’est pas une guerre parmi d’autres, c’est la guerre )) (Glas, p. 166). Elle oppose (Hegel)
la loi de la singularité, féminine, divine, familiale, naturelle, nocturne, et la loi de l’universel, virile,
humaine, politique, spirituelle, diurne.
((
((
10. Kafka, Description d’un combat », in Prépuratgs de noce à la campagne, Gallimard, 1957, trad.
Marthe Robert.
11. I1 importe de prendre rythme B au sens dégagé par Benveniste, in Problèmes de linguistique
générale, Gallimard, 1966, et Heidegger, Acheminement vers la parole, <( Le mot », Gallimard, 1976,
p. 2 15. ‘Phspoç, c’est la forme stable d’un flux continuellement changeant, ce qui éclaire Héraclite et
rejoint les concepts actuels de turnover ou (( homéorrhèse n en thermodynamique des systèmes ouverts
(Prigogine).
12. Parménide était inspiré par une juste ui6Oç lorsqu’il césurait non entre pensée et être, mais encre
(( pensée/être )) et (( non-être ».
13. La thématique du pont est récurrente, profonde, secrète. De beaux exemples dans l’œuvre
énigmatique de Raymond Roussel, soucieuse d’ajointer les pôles de la dualité. Voir <( De la métagrammatologie, Roussel et la philosophie contemporaine », Mélusine, LAge d’homme, décembre 1984.
<(
))
14. Heidegger, (< Bâtir, habiter, penser », Essais et Confireences, Gallimard, 1958, p. 180 sq.; et
l’entretien avec J . Beaufret dans les Lettres nouvelles, décembre 1974.
15. Figure de la dichotomie et son aboutissement normal : A exclut B pour respecter la tautologie
de A = A ou se l’incorpore. Dans le cas le plus pernicieux, A, sous couvert d’une pseudo-rivalité avec
B, assoit encore plus sa tyrannie de paraître double. Baudrillard a démontré ce mécanisme dans L’Echange
symbolique et lu Mort.
16. P. Fontanier, Les Figures d u diJcours, Flammarion, rééd. 1968 : (< C’est un hébraïsme que ce retour
d’un nom sur lui-même dans ces expressions d’un style sacré: Esclave des esclaves, Cantique des
cantiques, Vanité des vanités ... Et quelle n’en est l’énergie, puisque par là le nom se trouve au plus
haut degré de signification [et dit] tout ce que l’on pourrait imaginer de plus exagéré et de plus
emphatique. N (p. 29 I ) . Voilà une mimésis textuelle des actes, une pipqoiç n p a ( ~ o ç(Aristote, A r t poétique,
chap. VI début). Aristote connaissait ce procédé : Poétiqxe, chap. XIV, 9 &6~h<pbç
b6~kpO~
Rhétorique,
.
III,
294
chap. IX,2 et 3, 9 : Plus la tournure est brève, plus elle est antithétique, plus on la goûte. N Exemple :
rov {ÉVOV {Evou.
17. A travers une suppression seulement jouée des différences - Yahweh transmet (quand même) à
Moïse, dont Aaron supplée (tant bien que mal) la bouche empêchée, le peuple ayant été par la décimation
(grosso modo) assimilé au peuple élu -, l’Exode vise une union paradoxale de Yahweh et du peuple
juif.
18. Parménide, Héraclite et Eschyle font une description analogue des hommes. Chez Héraclite, ils
(( ignorent ce qu’ils font à l’état de veille
(DK, frag. I ) et (( ne savent rien de la vraie nature des dieux
et des héros N (DK, 5 ) , chez Parménide, GiKpctvoi ils errent dans une kpqxstviq totale (DK, VI, v. 5).
19. Derrida, Glas, op. rit., p. 166; B. Allemann, Hdderlin er Heidegger, PUF, 1966, p. 29; Holderlin,
Remarques sur la traduction ... UGE, 1965, note de F. Fédier, p. 167.
20. La tresse est n symbolon U parce qu’elle intersecte deux mouvements contraires. Sur l’importance
du tressage (~rpÉ<p~iv)
dans l’imaginaire grec, voir : Detienne-Vernant, Les Ruses de l’intelligence, Flammarion, 1974, sub fine.
2 1. (( Impureté N est un terme emprunté à B. Pautrat; cf. Versions du soleil, Le Seuil, 197 1 : Le
voile et le pli », Dionysos oblique ».
22. Ces trois termes semblent pensés dans une unité par les Grecs : nombreux échanges entre les
deux radicaux que la phonétique postule pour expliquer K timé U , K tisis U (+ kwei) et c poiné U ( + kwea.
23. La bifurcation est triplicité chez les Grecs : CEdipe roi, v. 1398, Triple chemin, vallée obscure ...
défilé à la fourche de deux routes n et ibid., v. 7 16 rpinhriS. Dans les manuscrits de (( deuxième famille D
un diagramme en marge représente un y : image de la dyade. II faudrait chercher l’origine du
symbolique dans cette adhérence de l’un au deux. La coupure en deux est aussi dans adipe à Colone,
v. 900-901 : GIOTO~OS.Le même adjectif qualifie la grotte de Philoctète à deux ouvertures (Philoctète.
début). Voir aussi Ajax, v. 268 et 277 et Choéphores, v. 1415 pour des exemples de dualité.
24. Trace d’une Aletheia magico-religieuse : voir Detienne, Les Maîtres de vérité en Grèce archaique.
Maspero, 1979, chap. I I I .
25. Les oracles, à cette époque, rusent avec le discours pour rester vrais : ils ne le sont qu’à supposer
deux sens à la fois. La relation de Vérité et Erreur n’est cependant pas encore chez Sophocle aussi
tranchée qu’elle le sera chez Platon : l’illusion est Apaté comme ruse positive, celle d’Oreste et d’Ajax,
autant que négative, celle de Nessos et d’Ulysse.
26. Les dichotomies apparentent le premier roman policier : CEdipe roi, et le dernier possible : Cosmos
de Gombrowicz.
27. La bifurcation est point d’hésitation, possibilité de renversement. Sur l’importance du renversement,
voir la fin de Philoctète, le vers 505 du même, les derniers vers d’CEdtpe roi, Trach., v. 109, Edipe à
Colone, v. 609, Ajax, v. 131. Voir aussi les Sages grecs : DK, t . 1, 10 (73) a.
28. Sur c Philos U voir Benveniste, Le Vocabulaire des institutions indo-européennes, Minuit 1969, t . 1.
La K philia U d’Ajax et d’Hector unit par un pacte des ennemis. Voir iliade, V I , 230 et VII, 303. Sur le
cadeau empoisonné, Gernet, Droit et Institutions en Gère antique, Flammarion, 1982, p. 17, 35, et
Anthropologie de la G è r e ancienne, Flammarion, 1982, p. 36. Voir aussi la Médée d’Euripide, et le
~pharmakon du cadeau de Médée : poison qui mine l’accouplement en faisant fondre les chairs.
29. Équivalence du schème grec du K symbolon a et du symbole chinois du Yin et Yang.
30. A propos de l’étude connue de Derrida, on remarquera que l’écriture est à la fois un K dôron U
et un apharrnakon B .
3 1. Dans Les Figures du discours de Fontanier, c’est une réversion N (p. 38 1, note).
32. Voir Derrida, G/as, op. rit,, p. 79 : Le plus n’est égal ou inégal à aucun objet, il n’est comme
rien. N Contra : Platon Philèbe, 24‘.
33. Trach., v. 734 et 817. Électre (v. 261) : La mère qui m’a enfantée, je la hais plus que tout au
monde. n
34. Les deux colonnes de Glas sont consacrées, l’une à la famille, l’autre au (( gl H du coup
35. On n’a pas la place ici de détailler l’incroyable complexité de la machine symbolique d’Antigone.
Penser par exemple que c’est Antigone qui fait de Créon un héros de tragédie.
))
((
((
((
((
))
*)
((
((
36. Les Héraclides, débutant pourtant comme Les Suppliantes n’accordent pas au dilemme une place
essentielle, Les inversions qui terminent plusieurs pièces d’Euripide sont stéréotypées. En revanche, le
couple des chairs confondues de l’épousée et du père dans Médée, et la dilacération de Penthée dans Les
Bacchantes rappellent la place éminente de la dualité dans la pensée grecque (v. 1127, 1 136).
37. Les Essais de Holderlin sont cités dans l’édition de F. Beissner, Sütntliche Werke, Aufsatze 4,
Kohlhammer Verlag, Stuttgart 1962 (SW 4) et l’édition de La Pléiade, dir. Jaccottet.
38. Ainsi parlait Zarathoustra, 3‘ partie, Le voyageur n
((
295
39. Également une traduction de Martineau dans la revue Po&sie : << Second accomplissement poétique ».
40. Comme pour l’extraordinaire Breathless blues )) de Mezzrow-Bechet.
41. Pour les Reinarques sur les tragédies..., référence allemande : Holderlins Werke und Brieje, Herausgegeben von F. Beissner et Jochen Schmidt, 2, Insel Verlag 1969 ( H W B 2).
42. Les traductions de deinon N ont été pour Holderlin gewaltige puis Ungehauer et chez Heidegger :
unheimlicbe.
43. La lecture aristotélicienne de (( purifier )) n’est pas au niveau exceptionnel de la pensée de Holderlin.
La (( fureur )) n’est pas une passion ».
44. Une aidôs N excessive mais positive se recourbe en infidélité et laisse place à un respect infini
(Empédocle). Une (( aidôs négative comme peur dévalorise l’homme et annule le dieu : elle est le fait
du (( prêtre pourrisseur B (Mort d’Empédocle).
45. Voir le double mouvement intériorisant de la a communication négative N chez Kierkegaard, Post
srripttrm aux miettes philosophiques, 2‘ partie, 1“ section, chap. II, $ 1 .
46. Voir le poème (( La moitié de la vie )) et la note de Fédier, La Pléiade, p. 1233.
47. La sauvageté est un ajout : Sophocle dit (( les fosses des morts », et Holderlin, c Wildniss des
Gestorbnen N. Voir Lacoue-Labarthe. p. 105, 172.
48. Reinhardt et Schadewalt renchérissent encore sur Holderlin dans ces vers.
49. Empédocle, l’être illimité (Pi., p. 471) est entré au désert (p. 475) du jour où il s’est dit égal
aux dieux. Son c deinon N est justement décalage de la latence : Terrible un être l’habite qui tout
métamorphose (p, 468) et : (( J’ai solitaire fleuri du temps que le monde dormait encore. D
(f
((
((
))
Holderlin
entre les Anciens
et les Modernes
Beda Allemann
Avec cette question, celle du champ de tension qui s’établit entre les Anciens
et les Modernes, nous ne pénétrons nullement dans un nouveau monde. Nous nous
mouvons bien plutôt dans le domaine d’un lieu littéraire et artistique qui remonte
quant à lui jusqu’à la fin de l’Antiquité. Peu après la Seconde Guerre mondiale,
E.R. Curtius y a fait brièvement allusion dans l’un des chapitres de son célèbre livre
sur les rapports de la littérature européenne et de la latinité médiévale. Depuis le
temps de la Renaissance, en Europe, la querelle entre les antiqui et les moderni, entre
les (( partisans des Anciens )) et les (( partisans des Modernes n est presque devenue un
thème directeur pour les discussions sur la littérature. Hans Robert Jauss ’ a analysé
plusieurs fois à partir des années soixante l’importance de la querelle qui eut lieu en
France à la fin du X V I I siècle
~
et ses effets sur le X V I I I ~siècle. Et plus récemment,
Manfred Fuhrmann a replacé cette querelle qui avait secoué les salons parisiens dans
un plus ample contexte culturel et politique - en signalant avant tout son rôle dans
la naissance du nationalisme allemand au temps du romantisme ’.
Quant à moi, j’ai pris la liberté, dès le milieu des années cinquante, d’attirer
l’attention, dans ma leçon inaugurale à Zurich, sur l’importance du rôle de cette
querelle, ou plutôt de sa répétition dans le cercle des premiers romantiques allemands;
de ce point de vue donc, il ne me semble pas à av$r à rattraper quoi que ce soit 3 .
Peter Szondi, ensuite, n’a cessé, surtout dans ses Etudes holderliniennes et les cours
qui ont été édités après sa mort, de faire signe en direction de ce vaste contexte de
l’histoire de l’esprit, celui qui va de la naissance de la querelle et s’étend jusqu’au
déploiement d’une pensée spécifiquement spéculative de l’histoire, c’est-à-dire jusqu’à
277
l’idéalisme allemand - et cela aussi bien chez les grands penseurs et critiques que
chez les poètes, et parmi ces derniers, à côté de Schiller, avant tout Holderlin ‘.
De fait, aucun doute que l’esprit de l’époque goethéenne - ou comme on voudra
nommer cette époque étonnante dans l’histoire de la langue et de la littérature
allemande - ne nous est pleinement intelligible (me voilà presque enfonçant des
portes ouvertes) que sur fond d’un champ de tensions adverses que balise l’opposition
polaire entre les deux notions d’antique et de moderne. Ce n’est pas un hasard si la
recherche holderlinienne, et plus généralement tout débat approfondi avec l’œuvre
du poète, n’a plus pu se défaire jusqu’à aujourd’hui de la question décisive : quel
fut le rapport du poète vis-à-vis des Anciens et des Modernes > ? L’indice d’une
discussion déjà au départ mal engagée, et qui ne fit par la suite que s’embrouiller,
nous le trouvons dans le titre en lui-même problématique du livre de W. Michel
(paru en i923), le Virage occidental de Holderlin 6 .
I
(( I1 n’hellénise nulle part, mais il sent, il agit absolument comme un Grec ’. D
Cette phrase de Goethe se trouve dans un jugement sur Raphaël. Elle ne paraît
s’appliquer à aucun poète allemand mieux qu’à Holderlin - même si Goethe luimême, lors de ses rencontres avec le jeune poète souabe à Iéna et Francfort, ne l’a
pas perçu tel, pressentant au contraire. chez lui un certain intérêt étrange pour les
(( époques moyennes n - entendons bien : le Moyen Age - ce qui n’a pas manqué de
plonger les commentateurs dans l‘embarras, vu qu’il n’est guère facile de faire cadrer
cette remarque avec les préoccupations qui agitaient Holderlin à l’époque. L’auteur
de 1’Hypérion aurait-il passé sous silence, devant Goethe, son inclination pour la
Grèce? O u bien - ce qui donne la seule explication raisonnable de la remarque que
rapporte Goethe - Holderlin lui a-t-il parlé du programme de poésie et de rEflexion
sur la poésie qui lui tenait à cœur (« ouvert avec anxiété n - c’est ainsi que Goethe
décrit le comportement de Holderlin), à savoir le projet à la fois modeste et titanesque
de réconcilier l’exercice artistique des Modernes et celui des Grecs? Un programme
qui, de fait, aurait pu le conduire (tout comme son mentor Schiller quelques années
plus tard avec la Fiancée de MesJine, et Goethe lui-même avec le château fort du
second Faust - ce château fort avec sa cour intérieure (( entourée de bâtiments
médiévaux riches et fantastiques ») à déterminer la scène romanesque ou dramatique
comme se déroulant dans les (( époques moyennes », cet espace intermédiaire, cet
intervalle historique entre l’Antique et le Moderne. Nous n’avons, dans l’œuvre de
Holderlin en son ensemble, que peu de passages qui confortent sans équivoque un
tel pressentiment; il n’est cependant pas oiseux; nous aurons encore à y revenir. Dans
1’Hypérion - quoi qu’il en soit du Moyen Age - il y a opposition abrupte entre
l’antique et la moderne Grèce : c’est même le thème fondamental qui est exposé
littérairement ou poétiquement. Le tranchant de cette contradiction entre l’idéal antique
et la réalité politique moderne se trouve même, dans les combats de libération du
X V I I I ~siècle, en rapport immédiat, quoique inverse, avec le ton fondamental élégiaque.
Comme l’opposition demeure insurmontable, la douce nostalgie de la fin du roman
est la seule réponse, grandiose même en son impuissance, qui reste à Hypérion devant
les réalités du siècle. Le voyage chez les Allemands des Lumières dont la bourgeoisie
commence à s’émanciper, n’a guère été capable de rien changer. I1 a plutôt provoqué
la célèbre invective contre les Allemands - qui est en fait un témoignage de douleur
et de désespoir, et non de colère.
298
Goethe lui-même ne s’est exprimé que plus tard au sujet de l’opposition
entre Antique et Moderne telle qu’elle apparaît à son époque. D’abord de manière
plutôt elliptique, vers 1805, dans la contribution intitulée (( Esquisses pour un
portrait de Winckelmann )) qui parut dans le recueil collectif Winckelmann e t son
siècle. Puis de manière plus détaillée et plus systématique, en 1818, dans la revue
qu’il éditait sous le titre Sur l’art e t l’antiquité - je veux parler de l’article
(( Antique et Moderne », dont on vient de lire une citation. Plus tard 8 , il détourne
son humeur à voir la querelle persister en faisant porter son attention sur le thème
explicite de la querelle; il remarque qu’avec vingt ans de retard la voici revenue
d’Italie sous une nouvelle appellation : querelle des Classiques et des Romantiques;
et il souligne à satiété que ce sont bien Schiller et lui qui, les premiers, ont
soulevé, à la fin d u X V I I I ~siècle la question de la querelle entre antique et moderne.
Personne ne s’étonnera de le voir plaider pour un compromis entre les deux termes
de l’opposition. Plus remarquable est le fait qu’il ne développe pas son argumentation en prenant des exemples littéraires, mais en renvoyant à l’un des Grands
dans le domaine des arts plastiques, le plus grand, même, aux yeux des gens du
XIX‘ siècle commençant, à savoir Raphaël. Ici, donc, ce n’est pas un Hypérion qui
est montré en exemple au public, un homme pour qui la lumière poétique ne
commence à poindre qu’après l’échec de son projet politique : restaurer l’ancienne
Grèce. La référence est plutôt à un monument reconnu de l’histoire de l’art, qui
personnifie la synthèse depuis longtemps accomplie :
Q u e chacun soit à sa manière un Grec! Mais qu’il le soit,
I1 en va de même des mkrites d e l’écrivain. Ce qui se peut saisir nous saisira
toujours d’abord pour nous contenter enfin parfaitement,
Et Goethe d’ajouter, pour expliquer ce qu’il entend par (( ce qui se peut saisir )) :
il s’agit de ces œuvres qui (( ressortent comme de libres produits de la nature )).
L’œuvre d’art comme quasi-produit de la nature - telle est, dans sa formulation la
plus brève, la représentation idéale de l’art grec que déjà postulait Winckelmann,
que dès la Renaissance les arts plastiques et l’architecture, mais aussi les poètes,
tentaient de prendre comme exemple à imiter, et que finalement l’ami de Holderlin,
celui qu’il regardait comme un père, l’écrivain Heinse a glorifié dans son roman
Ardi nghelfo.
Une telle exigence programmatique semble correspondre exactement à la nostalgie
de l’ancienne Grèce qui anime Hypérion, mais aussi Holderlin. Tout aussi importante
que la restauration de l’ancienne culture est, pour le héros du roman, la réunion, à
nouveau, avec la Nature et son éternelle jeunesse. C’est elle qu’il recherche dans sa
vie d’ermite. Pour Holderlin, la Nature est davantage que la somme de toutes les
œuvres d’art existantes et à créer. Chez lui, art signifie aussi civilisation, et tout aussi
bien culture. Son idéal serait, comme celui de Goethe, un art à l’état de nature. O n
reconnaît là des idées qui ont gouverné la pensée de Rousseau et de Herder.
Poétiquement, cela se réalise dans des conceptions mythiques où la Nature divine est
réconciliée avec l’art. Cette représentation qui fait l’objet de tous ses souhaits, on peut
la rencontrer chez Holderlin encore au tournant du siècle, par exemple dans l’ode
(( Nature et Art ». La Grèce antique des temps classiques est l’incarnation historique
de la réconciliation globale, dont l’apparition se fait comme présence des dieux. I1 se
trouve que dans cette même ode apparaît déjà un autre thème : la crainte que Zeus,
dans la profusion de son art, ne perde mémoire du règne de Saturne (c’est-à-dire de
la Nature), qu’il a usurpé. Tout cela est bien connu et a même fini par attirer à
Holderlin le renom d’être seulement un nostalgique de la Grèce. Ainsi donc, il n’y
aurait guère de quoi se préoccuper longtemps d u rapport entre l’antique et le moderne
chez lui. L’Antiquité et son expression exemplaire, c’est-à-dire classique, dans le siècle
de Périclès paraît bien être le modèle absolu de tout exercice artistique, même de la
299
poésie - aussi bien du point de vue du contenu que de celui de la forme; l’époque
moderne n’aurait ainsi plus rien d’autre à faire que de sortir au plus vite de sa misère
pour revenir à ces jours anciens et heureux.
II
Dans notre contexte, il faut avant tout garder les yeux fixés sur la portée que
va pouvoir conserver chez Holderlin ce mythe initial; en d’autres termes : où commence
la problématisation de la nature et aussi de l’Antiquité, ou bien (si l’on part de l’idée
qu’elle n’a jamais vraiment pu commencer, vu qu’elle a toujours déjà été là, à l’état
latent dans le ton élégiaque de l’kiypérion) où et en quelle manière elle finit par se
manifester. Si l’œuvre de Holderlin était vraiment cette nostalgie non réfléchie de la
Grèce pour laquelle l’a tenu tout le XIX‘ siècle - si tant est qu’il en a eu connaissance
- elle serait aujourd’hui bien oubliée. Même la sublimation de la nostalgie hellénique
dans le cercle autour de Stefan George n’aurait pas réussi à y changer grand-chose.
Comme il n’en est rien, la question se pose avec d’autant plus d’insistance : où fautil chercher les résistances internes qui ont fait, pour Holderlin, du simple schéma
ancien-moderne un champ de tension productif? Et productif veut dire ici : au-delà
d’une opposition sommaire comme celle du blanc et du noir (quelle que soit par
ailleurs la façon dont on partage le blanc et le noir - sur l’Antiquité ou sur les
Temps modernes).
Holderlin n’a pas écrit de second roman. Pour cette raison, mais aussi pour
d’autres, plus profondes, il est indiqué de passer à la considération de son œuvre
dramatique. Le plan pour le drame Empédocle paraît au premier abord n’apporter rien
d’autre que la confirmation de la vieille nostalgie de réconciliation, celle qui aspire
à se réunir aux dieux et à la Nature, au sens de l’état idéal de la culture grecque.
Mais si l’on y regarde de plus près, là aussi ne tarde pas à se montrer ce qui va à
contresens de cette tendance. Voilà pourquoi a échoué le plan du drame aboutissant
au suicide du héros se jetant dans l’Etna. Mais cet échec a ouvert la voie à la poésie
de la maturité, à la poésie où Holderlin a chanté ses élégies et ses hymnes. A côté
de ses travaux dramatiques, et de même rang qu’eux, sinon de rang supérieur, du
moins pour ce qui nous intéresse ici, il y a les traductions des deux tragédies de
Sophocle, CEdipe-Roi et Antigone. Or le débat moderne avec la tragédie grecque a,
dès le X V I I I ~siècle, une longue histoire derrière lui. I1 remonte à la Renaissance
italienne, et a atteint un sommet au X V I I ~siècle chez Corneille, dans les célèbres Trois
Dixours
O n peut se demander si Holderlin connaissait en détail tout cet ensemble
historique avec ses répercussions. La richesse du débat interdit qu’on en puisse
seulement esquisser les contours dans le cadre d’une simple conférence. Je vais donc
choisir un chemin détourné, et pénétrer dans cette problématique par une porte
dérobée, non sans emprunter, d’un point de vue strictement historique, une direction
tout à fait fausse : je vais en effet partir d’une position qui se situe environ un quart
de siècle aprèJ les efforts déployés par Holderlin pour reconquérir la tragédie grecque,
et la tragédie en général, c’est-à-dire une forme spécifiquement moderne de ce genre
poétique qui est pour lui le plus rigoureux de tous. En l’an 1826 - Holderlin avait
alors cinquante-six ans - Karl Leberecht Immermann publie dans sa ville natale,
Magdebourg, un essai dramaturgique intitulé Sar l’Ajax farieax de Sophocle ‘O. C’est
l’unique texte critique qui sera repris en 1843, trois ans après sa mort, dans l’édition
en quatorze volumes de ses œuvres. Afin de compléter et d’achever ces mentions de
dates : Immermann est né en 1796; il est ainsi d’à peine une génération plus jeune
que Holderlin. Nous pénétrons dans le champ de tensions entre antiqzde et moderne
300
à partir d’une position que l’on peut nommer post-classique, celle du romantisme
tardif et de la toute dernière période de l’idéalisme. Certains diraient presque : à
partir de l’époque de la Restauration, sinon de la bourgeoisie triomphante. Un tel
accès à la problématique holderlinienne pourra paraître peu approprié. Je prends
pourtant le risque.
Ce qui saute aux yeux dans le débat d’Immermann avec Sophocle, c’est le fait
que les obstacles sur le chemin d’une réception vivace des deux tragédies, les difficultés
que Holderlin s’est efforcé de surmonter dans ses propres traductions de Sophocle
sont au fond restées les mêmes. O n pourrait presque dire : la situation s’est seulement
aggravée en devenant plus aiguë. En connaisseur circonspect, Immermann ne se
contente pas de paraphraser l’Ajax; il l’analyse en sa structure, et lui rend hommage
quant à sa singularité historique. Malgré cela, il arrive à un résultat univoque, et
univocément négatif :
La question de savoir si l’imitation des Anciens, au sens véritable, a déjà eu lieu,
et si elle est même possible, doit recevoir une réponse négative. Notre tragédie est
ia.
ce qui est externe, tout ce qui est
d’une autre nature que leur ~ p ~ y ~ 0 6[...]Tout
interne et qui créa chez eux la forme, tout cela manque; et l’indispensable chœur,
si nous le copions, devient une fiction inconsistante; quant à l’idée de destin, qui
est la formule d e l’ancienne manière d e voir et d’exposer, elle ne peut que souffrir
les plus étranges altérations s’il faut qu’en tant que malheureuse ilote, elle porte
parcirnonieusement au poète moderne l’eau par laquelle il va pouvoir faire tourner
son moulin tragique (I, 604).
Alors que Holderlin reste sur la piste du phénomène qu’il nomme le (( transport
tragique )) (V, 196, 1. 7) et qu’il s’efforce de lui faire correspondre un rythme accessible
à l’entente moderne, Immermann s’abandonne à la résignation. A la place du transport,
c’est-à-dire de l’arrachement tragique de la passion ou du mouvement de précipitation,
il ne voit plus, chez les imitateurs modernes des Grecs, que cliquetis de moulin ”.
I1 serait erroné, à partir d’un tel scepticisme, de conclure à une simple manifestation
d’épuisement. Ici ne parle en effet ni un épigone désespéré, ni un moderniste aveugle
qui tiendrait tout ce qui est ancien pour dépassé et, sous des airs de génie puissant,
vouerait aux gémonies le principe de l’imitation parce qu’il ne se sentirait pas de
taille à affronter les modèles et méconnaîtrait en lui-même l’exigence d’émulation.
Celui qui parle, c’est le futur homme de théâtre qui s’est déjà essayé lui-même à
écrire des pièces - des comédies aussi bien que des tragédies. Et il exprime sans
illusion (sur la base d’une connaissance exacte de ce dont il parle) cette vérité
incommode : la tragédie antique, vu ses conditions de production tout autres, ne peut
être répétée pas plus du point de vue formel que du point de vue matériel. (Qu’en
tant qu’auteur il ne soit pas lui-même allé au-delà d’un fade classicisme, cela n’a pas
besoin d’être examiné ici. Comme directeur de théâtre à Düsseldorf il a eu au moins
le mérite de faire représenter Kleist l 2 et d’avoir employé Grabbe comme dramaturge.)
Ici donc, où s’exprime l’abandon radical de l’idée d’imiter les Anciens, et si
nous jetons à rebours le regard sur l’effort de Holderlin pour rendre davantage
accessible à un public contemporain les tragédies de Sophocle, le caractère négatif du
bilan que tire Immermann (pourtant un vrai connaisseur de Sophocle) est un symptôme
qui parle de lui-même. L’ampleur des résistances contre lesquelles Holderlin a dû
lutter en mettant à contribution ses dernières forces créatrices, lorsqu’il a tenté quelques années après l’échec de ses propres projets dramaturgiques - de rendre les
œuvres de Sophocle plus assimilables au mode de représentation moderne, commence
à devenir visible. A partir de là, et à cause de l’absence d’effets qui a suivi, au
XIX‘ siècle, la percée de Holderlin (ainsi par exemple, il est douteux qu’Immermann
ait seulement eu connaissance .des traductions et des Remarques de Holderlin), on
peut mesurer l’intensité des tensions et contradictions qui arment le champ où
Holderlin s’est rendu une dernière fois, pour tenter, en passant par une traduction et
son explication - Holderlin avait le projet, à côté des Remarques d’écrire une << Introduction )) aux deux tragédies de Sophocle; ce projet n’a pas été réalisé - de ménager
une dernière fois une médiation entre le principe de la poésie antique et celui de la
poésie moderne.
Holderlin et Immermann s’accordent sur un point dans leur évaluation de la
situation de départ. Par opposition à la tragédie grecque qui se développe en sortant
du chant lyrique, celui du chœur - Immermann parle de cantate à propos de la
forme tragique chez Eschyle (I, 597) - la tragédie moderne, si tant est qu’il puisse
y en avoir une, a une origine épique 1 3 . L’élément de narration prévaut donc en elle.
C’est cela qui correspond à l’idée de Holderlin, telle qu’elle apparaît dans la célèbre
lettre à Bohlendorff datée du 4 décembre 1801, où l’ami est félicité d’avoir donné à
son idylle dramatique Fernando ou I’lnitiation à l’art une charpente épique 14.
Ce qu’Immermann ne voit pas, ou ne veut pas voir, c’est la possibilité d’un
débat productif avec ce qui met en branle la tragédie grecque, mais nous demeure
étranger. Son entente nationale et organiciste de la littérature lui fait croire que peut
servir de thème uniquement ce qui est issu de notre propre histoire 15.
Le plan pour l’Empédocle, Holderlin ne l’a assurément pas esquissé de façon
moderne en ce sens, c’est-à-dire en référence à sa propre terre natale et au Moyen Age,
donc en visant une époque venant après l’Antiquité. Mais lui aussi montre une
certaine tendance à accentuer les traits structuraux que dégage Immermann pour
caractériser le drame moderne (celui de l’époque post-antique) - à savoir la tendance
à poser durement la finitude positive, figée, celle de la civilisation, face à l’infinitude
de la Nature et du règne des dieux, et à développer à partir de cette opposition un
conflit de destin. Cela, malgré la matière antique et classique, et la scène qui se
déroule en Grande Grèce. Voilà qui ne peut être exposé plus en détail dans le présent
cadre, et doit donc être admis comme connu. Je renonce par conséquent à analyser
la façon dont Holderlin s’explique à lui-même sa propre dramaturgie dans le Fondement
pour Empédocle; je me concentre sur les Remarques aux tragédies de Sophocle qui sont
en tout état de cause plus difficiles parce qu’encore plus denses. Ces textes doivent
être désignés comme des fragments, à cause de l’absence de 1’« Introduction ». Mais
ce sont des fragments en un sens encore plus essentiel que ne le sont, si on les regarde
bien, le Fondement tout-commun et le Fondement pour Empédocle. Le côté abrupt dans
la suite des pensées, l’audace des métaphores et comparaisons, que l’auteur laisse sans
explication, va tout à fait dans ce sens. Mais dans cette particularité, ces textes tardifs
font connaître toute la violence et toute la nécessité du débat avec la tragédie grecque.
III
Tout comme Immermann après lui, Holderlin a exactement reconnu, et déjà
dans le projet d’article qui s’intitule a Le point de vue d’où il nous faut regarder
l’Antiquité )) (et qui a sans doute encore été rédigé durant le premier séjour à
Hombourg), qu’il y a, suivant une perspective déterminée, une opposition décisive
entre notre formation et celle de l’Antiquité. Ainsi, dans la première lettre à Bohlendorff dont nous venons de parler, on peut lire : (( Nous n’avons sans doute pas le
droit d’avoir quelque chose de commun avec eux [les anciens Grecs] (VI, 426,
1. 34 sq.). Revenons un instant au (( Point de vue D, avant de nous tourner définitivement vers les Remarques, Car c’est ici qu’est exposé le concept qui me semble être
indispensable même pour l’entente des Remarques et de la tendance fondamentale qui
anime les traductions de Sophocle, à savoir le concept de Bildungstrieb - d’impulsion
302
formatrice. Ce concept fournit une base fondamentale parce que se laisse montrer
avec lui justement de quelle manière c’est là où Immermann s’arrêtera en pleine
résignation, à savoir là où se constate la diversité absolue de la tragédie antique et
de la tragédie moderne, que Holderlin entreprend avec intrépidité de mettre à nu
quelque chose de commun, même si cette communauté est difficile à caractériser et,
de plus, en elle-même structurée antithétiquement. Pourtant, ce concept de l’impulsion
formatrice ne correspond déjà plus, en tant que tel, à tous ces autres concepts que
les essais de Hombourg forment et transforment dans une sorte d’exercice continu,
afin de les rendre aptes à une conciliation entendue encore au sens de la synthèse
idéaliste.
Au premier abord, le schéma dialectique bien connu semble rester en fonction
dans le (( Point de vue ». Thèse : nous sommes écrasés par l’exemplarité de tout ce
qui est antique, Antithèse: pour nous libérer de ce joug et de ces attaches, il n’y a,
semble-t-il, pour reprendre les mots de Holderlin, qu’à (( s’opposer, dans la violence
de la présemption, à tout ce qui est appris, donné, positif, et le faire en tant que
force vivace H (IV, 221, 1. 9 sq.). Ce qu’il faut souligner d’emblée, c’est qu’ici
l’Antiquité grecque n’apparaît pas comme prototype de l’éternelle jeunesse, pas plus
que son exemplarité ne promet de renaissances. Au contraire, elle apparaît comme ce
qu’elle est en réalité lorsqu’on la considère historiquement, à savoir comme antiquité
au sens littéral du terme, c’est-à-dire comme somme de tout ce qui est devenu positif
et de ce fait pèse sur nous. Mais la simple révolte qui proteste contre ce poids
(Holderlin ne laisse planer sur ce point aucun doute, dès la première phrase), ne nous
serait d’aucun secours ; elle nous ferait seulement nous mettre plus inextricablement
en dépendance par rapport à l’Antiquité. Nous n’avons ainsi qu’un avant-goût du
véritable problème. (( Le plus difficile, continue Holderlin, c’est que l’Antiquité paraît
être entièrement opposée à notre impulsion originale, elle qui va dans le sens de
former ce qui est informe [...I )) (IV, 22 1, 1. 11 sq.). Avec ces mots, mais sans que
l’expression d’impulsion formatrice apparaisse, est déjà défini en toute exactitude ce
que Holderlin va entendre par elle. Former ce qui est informe - conduire ce qui est
brut, ce qui est intact, ce qui est au stade de l’enfance, à prendre une forme et une
figure arrêtées, voilà qui est l’impulsion naturelle de l’homme moderne lui aussi. Or
l’Antiquité n’est plus du tout quelque chose de brut, d’intact ou d’enfantin - en un
sens très vaste mais aussi très précis, elle était de part en part fomée, de sorte qu’elle
ne saurait plus être pour nous en aucune façon une matière brute en vue d’une
formation. On aura déjà compris que le mot de formation ne doit pas être pris au
sens actuel de la pédagogie qui transmet un savoir acquis; mais compris comme
l’activité fondamentalement créatrice de l’être humain. Or il se trouve que c’est
justement à cause de l’excès avec lequel s’est exercée l’impulsion formatrice de
l’Antiquité que cette dernière a fini par sombrer dans le néant: en effet sa propre
Nature vivace a succombé sous le carcan positif résultant de l’impulsion formatrice,
et s’y est finalement figé.
Ce n’est pas mon intention de dérouler ici l’histoire complexe d u concept
aujourd’hui un peu oublié d’« impulsion formatrice n - cette histoire, de son côté,
remonte jusqu’à l’Antiquité “. I1 a été mis à la mode comme terme typique par
l’écrit que le médecin J.F. Blumenbach a publié en 1781 à Gottingen : Sur l’impulsion
formatrice e t l’opération génératrice; Lichtenberg a joué un rôle dans la parution de
cet écrit. Par la suite, le concept d’impulsion formatrice se retrouvera dans la
Philosophie de la Nature du jeune Schelling. Ce terme, forgé pour l’anthropologie
et la physiologie, Holderlin lui donne, il faut le souligner, une inflexion tout à fait
particulière. A l’opération génératrice, dont parle Blumenbach lorsqu’il décrit l’impulsion formatrice (nisus formativzls), Holderlin donne un sens spirituel et artistique.
Son usage de la langue est comparable, sur ce point du moins, à celui des discussions
sur la théorie de l’art que Goethe a menées avec Karl Philipp Moritz, lors de leur
303
commun séjour à Rome, et dont on trouve l’écho dans le livre de Moritz qui s’intitule
Sur l’imitation du Beau dans la forme (1788). Sigmund Freud lui-même a confessé
sans ambages à la fin de sa vie qu’il était hors d’état de définir vraiment le concept
de Trieb qui, comme on sait, joue un rôle central dans sa psychologie de l’inconscient.
Holderlin, donc, présuppose de but en blanc l’existence d’une impulsion (que le texte
qui nous occupe en ce moment va désigner de plus près comme ((impulsion formatrice ») comme élément constitutif fondamental de la nature humaine. La possibilité
de recourir ainsi à une constante supra-historique de la nature humaine, voilà ce qui
est décisif en l’occurrence. Mais plus décisif encore est le fait que si l’on examine de
plus près les choses dans leur contexte historique, l’impulsion formatrice des Grecs
et la nôtre se révèlent être - du moins en ce qui concerne leur orientation originale
- opposées. C’est la première lettre à Bohlendorff qui permet de cerner cette découverte
de Holderlin. Alors que l’impulsion formatrice des Anciens était, au sens propre, une
impulsion à former une figure bien dégagée - au sens d u (( saisissable )) dont parle
Goethe à propos de Raphaël - l’impulsion formatrice moderne vise en sens inverse
à la réunion empédocléenne avec l’Un-Tout, autrement dit le saut dans le cratère de
l’Etna. Pour reprendre une expression chère autant à Holderlin qu’à Schelling, elle
n’est pas organique, c’est-à-dire dirigée vers une forme bien cernée, vers une forme
organisée; elle est au contraire aorgique, c’est-à-dire à tout instant disposée à retourner
vers la (( tout ancienne confusion N (II, 48, v. 22 1), dans le Chaos de la création
originale. C’est ici qu’est atteinte la véritable antithétique qui caractérise pour Holderlin le rapport de l’antique et du moderne. Ce sont d’ailleurs des concepts fondamentaux décisifs pour ceux qui connaissent et aiment l’œuvre de Holderlin. Mais la
dimension canonique et l’horizon singulier où ces concepts fondamentaux sont à leur
place, je ne suis pas sûr qu’ils soient toujours reconnus en toute clarté, même chez
les spécialistes de Holderlin. I1 peut y avoir litige sur beaucoup de détails et beaucoup
de phrases que le poète prononce à ce propos. Mais la question de fond me semble
bien être celle-ci : de quelle manière - en ce point précis de ses réflexions sur l’essence
de la poésie - effectue-t-il une sortie qui l’éloigne à tout jamais des représentations
et intuitions traditionnelles de la (( querelle des Anciens et des Modernes »?
S’opposant d’abord à ses contemporains allemands, Holderlin s’occupe non pas
tant de parvenir à saisir conceptuellement ce que sont les Anciens et les Modernes.
I1 ne cherche pas des couples de concepts opposés, comme l’a fait Schiller en proposant
les notions de naif et de sentimental, ou Schlegel celles de plastique et de progressif
- leur but étant d’arriver à rendre la différence historique aussi constatable qu’une
chose. Chez Holderlin, il ne s’agit pas de proposer comme des concepts pertinents ce
qui lui permettrait d’abord d’étiqueter les phénomènes, quitte ensuite à les modifier
au gré de l’expérience; il s’agit de dégager la dynamique même des courants historiques. Pour user d’une formulation en raccourci : là où Schiller et Schlegel font de
l’opposition entre statique et dynamique la clé de la distinction entre antique et moderne
(l’exercice antique de l’art ayant pour but ce qiii est clos en soi-même, le parfaitement
achevé, la forme parvenue à son expression ultime, la structure idéale et typique, et
ayant pour principe la nature avant toute réflexion; l’exercice moderne de l’art visant
une perfection toujours à dépasser, une approximation progressive de l’idéal impossible
à atteindre, cela dans une dissociation, voire même une aliénation de la conscience
dans la disparité du réel et de l’idéal), Holderlin voit au contraire l’art grec luimême déjà, et la culture qui lui correspond, comme un processus, et même, au sens
strict d u terme, comme un processus révolutionnaire - ce qui lui fait forger dans les
Remarques le concept de retotlrnement natal (vaterlündische Umkehr). Inutile de souligner que dans le contexte précis des Remarques, (( natal )) désigne le natal des Grecs.
Ainsi, chez Holderlin, il n’y a pas, comme c’est au contraire courant à l’époque du
classicisme, du romantisme et de la philosophie idéaliste, opposition entre un monde
hellénique statique et un monde moderne progressiste (et cherchant dans sa progression
304
à atteindre un but qui se dérobe sans cesse). Au contraire, les mouvements caractéristiques des impulsions formatrices (celle de l’Antiquité comme celle des Temps
modernes) sont mis face à face, et c’est seulement dans la différence secondaire de
ces voies qu’est aperçu ce qu’il y a de relativement opposé dans ces deux époques
du monde.
L’enseignement que les Modernes ont à tirer de cette comparaison, c’est, pour
Holderlin, ni l’absolutisation du modèle antique, ni le modernisme qui ne pense
devenir lui-même qu’en surenchérissant par rapport au dit modèle. Ce n’est pas
davantage la tentative de s’installer dans une actualité dont l’Antiquité serait par
définition coupée. Holderlin ne veut être en aucun cas un partisan au sens de
l’engagement dans un camp - quel qu’il soit. I1 ne l’a d’ailleurs jamais été (faisons
abstraction de ce qui s’est passé bien après lui, et où il a été recruté bien à son insu
pour servir de caution idéologique à des combats douteux). Holderlin lui-même est
à ce point lucide et réceptif qu’il endure à plein la surpuissance de l’Antiquité - et
pas seulement au moment où, lors de son séjour dans le sud de la France, il est
(( frappé par Apollon N (VI, 432, 1. 10); cela a lieu dès son premier contact avec les
dieux de la Grèce. Mais l’Antiquité, pour lui, n’est jamais devenue une réalité
monumentale abstraite. I1 ne connaît même pas ce concept, tel qu’il nous est familier.
(( Les Antiques », ce sont pour lui, conformément à l’usage de l’époque, les œuvres
d’art de l’Antiquité - c’est-à-dire quelque chose qui ne peut foncièrement pas être
d’ordre antiquaire ».
IV
L’Antiquité, chez Holderlin, est donc à la fois jeunesse et ancienneté, tout comme
l’est aussi le monde moderne. Elle est jeune comme elle l’était pour Goethe, c’est-àdire à titre de promesse - celle que soit toujours à nouveau possible à partir d’elle,
peut-être même sur notre sol, l’apparition de quelque chose de grand. Elle est ancienne
dans la surpuissance de son caractère exemplaire. Or le même rapport, à condition
de seulement l’inverser, vaut pour le monde moderne : il est ancien en tant qu’il est
l’héritier et donc l’épigone (le mot, ici, sans aucune nuance péjorative) de l’Antiquité.
Mais il est jeune de par toutes les possibilités qui lui sont offertes, alors qu’elles se
refusèrent à l’Antiquité sur la pente de son anéantissement. Pour prendre en main
ces possibilités, le monde moderne doit impérativement tirer les leçons de la disparition
du monde antique. Une telle leçon (le texte du (( Point de vue N ne laisse déjà à ce
propos aucun doute) consiste à porter toute l’attention qu’il faut sur les éventuels
égarements de l’impulsion formatrice, dans le but de parvenir à contrôler avec art
cette dernière (que l’on me pardonne cette formulation trop actuelle). C’est là seulement
que ressort le véritable caractère de modèle que recèle l’Antiquité, à savoir qu’elle
est la première forme, et par conséquent qu’elle peut devenir l’objet d’une réflexion
productive, et le modèie d’une expérience poétique dont les suites heureuses sont à
prendre à cœur - et les impasses à méditer.
Le soupçon de nostalgie envers la Grèce, en ce qui concerne le Holderlin tardif,
est tout simplement absurde. I1 ne partage même plus l’idée dominante de ses
contemporains, celle qui voudrait que l’art grec soit pour ainsi dire un art naturel ”.
Certes, dans les Remarques, Holderlin attribue aux héros de l’Iliade une sensualité
qui ne peut que nous sembler paradoxale, ce qu’il nomme aussi une a vertu athlétique n
(V, 270, 1. 5 ) . Mais voilà qui déjà est à sa place dans le contexte de cette opposition
secondaire, et nullement absolue, entre antique et moderne. Alors qu’Immermann
continue de voir dans les Grecs (( un peupie dans sa prime jeunesse »,et qu’il conclut
de cette juvénilité des Grecs à leur polythéisme olympien (I, 563), Holderlin, dans
305
une ébauche tardive d’hymne voit les Grecs comme se trouvant déjà sur une voie
exclusivement déterminée par l’impulsion formatrice - ce qui a même fini par leur
devenir fatal :
...nommément ils voulaient instaurer
Un règne de l’art. Par là pourtant
Le natal par eux
Etait chômé et pitoyablement alla
Le pays grec, le plus beau, à sa perte
(II, 228, v. 3 q.)
L’impulsion formatrice s’éloigne, chez tout peuple, de son origine. Ce qui est à
proprement parler national ne cesse alors de passer toujours plus à l’arrière-plan; chez
les Grecs, c’est donc la nature qui se perd, c’est-à-dire leur origine orientale. C’est
ainsi qu’on peut arriver à entendre l’importante phrase de la lettre à Bohlendorff, où
est dit qu’à la fin le propre doit tout aussi bien ((être appris )) (VI, 426, 1. 36) que
l’étranger. Contre la disparition du monde grec - ainsi l’attestent aussi bien la lettre
à Bohlendorff que les Remarqaes - il y aurait eu un moyen de lutter, assez radical
pour briser le tropisme exclusif qui les portait vers un règne de l’art, c’est-à-dire vers
la sclérose dans la positivité : à savoir le retournement natal. Dans les RemavqaeJ, on
peut lire en toute clarté la définition holderlinienne d’un retournement natal :
Le genre d u cours tragique dans l’Antigone est celui d’une révolte [entendons
bien : ce n’est pas le cours tragique qui est révolte; jamais cela n’en vient jusquelà dans cette tragédie, mais seulement jusqu’au différend entre Antigone et le
détenteur d u pouvoir; c’est le différend qui a le genre de la révolte], là où, dans
la mesure où il s’agit d u natal, tout revient à ceci que chacun, en tant qu’emporté
par un retournement infini, et secoué, se sent en une forme infinie, en laquelle il
est secoué. [Et voici la phrase décisive, celle qui résume tout :] Car un retournement
natal est le retournement d e tous les genres et d e toutes les formes de représentation
(V, 271, 1. 1 sq.).
Impossible d’être plus radical. Ici, ce n’est plus telle ou telle institution - fûtce l’organisation même de 1’Etat - qui est renversée, ou la structure de la société qui
est changée; il ne s’agir pas non plus d’une pure et simple révolution artistique. C e
qui a lieu ici, c’est un changement au principe même des genres de représentation
en vigueur dans une nation, un changement donc aussi des formes dans lesquelles
ces derniers peuvent s’exprimer. Sont par conséquent révolutionnées les bases de toute
connaissance,et celles de toute communication pour la vie des êtres humains dans le
cadre d’un Etat et d’une société. A la façon dont est esquissé ici le retournement
natal correspond, donc, à la fin du paragraphe, la restriction selon laquelle le genre
de procédure, lors d’une révolte c est an genre seulement de retournement natal Y, (V,
271, 1. 19 sq.). Inutile de souligner une nouvelle fois qu’un tel retournement n’a
rigoureusement plus rien à voir avec le fait de se détourner de quelque chose pour
se tourner vers quelque autre (rien à voir donc avec ce qu’on a nommé (( le virage
occidental )) de Holderlin I R ) .
L’autre restriction résulte peut-être encore plus immédiatement du caractère
fondamental du retournement, caractère qui concerne les genres de représentation et
les formes, et pas seulement leurs effets et leurs types :
Mais un retournement complet en ceux-ci, tout comme en général un retournement
complet, sans aucun point d’appui, pour l’homme, en tant qu’être connaissant,
est interdit (V, 271, 1. 5 sq.).
306
Voilà qui se comprend relativement sans peine : vu que tout retournement
concerne essentiellement le pouvoir humain de connaître, un retournement total, où
tout serait pour ainsi dire sens dessus dessous, ne pourrait qu’entraîner la destruction
même d u pouvoir de connaître. Pour le dire positivement : au retournement natal
doit aussi prendre part une autre instance que l’instance humaine - une instance
divine, qu’elle paraisse dans le monde artistique antique sous la forme du souverain
de l’Olympe, comme Zeus grec; ou bien, chez nous, comme Zeus plus proprement
nôtre. La radicalité d u retournement n’en est pas atténuée; bien au contraire, elle est
accentuée. Car de façon tout à fait cohérente (et là, les Remarques sur Antigone aussi
bien que les Remarques sur @dipe ne laissent planer aucun doute), dans la forme
tragique d u retournement au moins, même le Dieu ne peut assurer aucun soutien.
Le conflit tragique est quant à lui si fondamental que la participation réciproque des
deux natures, divine et humaine, l’une à l’autre, ne peut plus se manifester que dans
leur séparation et sous la forme la plus aiguë, celle de la trahison :
L’exposé du tragique repose surtout sur ceci que l’énormité, comment le Dieu et
homme s’accouple, et sans limite la puissance de la Nature et le plus intime de
l’homme devient Un dans la fureur, se comprend par ceci que le devenir-Un sans
limite se purifie par une séparation sans limite (V, 201, 1. 18 sq.).
Le fait que par une telle séparation, à quoi s’ajoute un doute quant à sa propre
raison, l’être humain soit poussé au bord de la folie, Holderlin peut le montrer
naturellement en premier lieu à l’exemple d’adipe-Roi. Je pense que cela reste évident
avec cette tragédie, même pour le spectateur d’aujourd’hui. Mais d u même coup,
voilà qui donne la dernière occasion de mettre à l’épreuve la solidité de l’appartenance
réciproque des dieux et des hommes :
Le Dieu et l’homme, afin que le cours du monde n’ait aucune lacune, et la
mémoire de ceux du ciel ne s’éteigne pas, se communique dans la forme tout
oublieuse de l’infidélité, car l’infidélité divine, voilà ce qui se garde le mieux.
Dans un tel moment, l’homme s’oublie soi-même et oublie le Dieu, et, certes de
manière sainte, comme un traître il se retourne (V, 202, 1. 3 sq.).
Nous sommes partis de l’idée que le retournement natal aurait été l’unique
moyen pour faire obstacle à la ruine d u monde grec antique. Après ce que nous
venons de voir, on peut se demander : à quel prix? La réponse est aussi claire que
sont rigoureuses les présuppositions de Holderlin : au prix de l’abandon des dieux
de l’Olympe et d u retour aux origines orientales de la culture grecque - au prix, par
conséquent, d’une totale révolution culturelle. Ou bien, aurait-il suffi seulement de
se remémorer l’origine, comme l’avait demandé à Zeus l’ode a Nature et art ou
Saturne et Jupiter )) (mais à sa façon idéaliste, c’est-à-dire dans le schéma de la
conciliation)? La question reste ouverte. Holderlin ne donne aucune réponse explicite.
Mais il faut méditer ceci : en ce qui concerne au moins la tragédie grecque, la mémoire
des dieux ne peut être gardée chez les hommes que par le moyen d’une infidélité
réciproque, et non par des exhortations au souverain de l’Olympe de ne pas oublier
son père (exhortations qui ne peuvent plus paraître, vues depuis la période ultime
où parvient Holderlin, que comme naïves).
V
Mais la tragédie n’est pas toute la poésie, même si elle représente sa forme la
plus radicale. En ce qui concerne le poète, comme dit la fin des Remarques (V, 272,
307
1. 9 sq.), il U expose le monde à une échelle moindre ». C’est pourquoi il est important
de se rendre compte que le retournement - au sens où Holderlin entend ce mot est un événement dont la signification fondamentale s’étend bien au-delà du domaine
des arts, de la littérature et de la poésie, puisqu’il en constitue le principe a priori.
L’exigence d’avoir à se retourner est par ailleurs davantage qu’une indication de
contenu. Elle ne se laisse pas non plus ramener à la simple injonction biblique
metanoeite 2 0 !
Au sens holderlinien, le retournement est bien - ainsi que cela ressort des
Remarques, avec leurs phrases poussées à l’extrême et écrites en toute conscience au
bord (à l’extrême bord!) de l’inintelligible - un renversement formel non seulement
du mode de pensée, mais aussi des procédés de pensée; cela vaut tout autant pour
la manière de ressentir, que Holderlin mentionne expressément au début des Remarques
sur Edipe, quand il caractérise l’être humain comme c système qui sent et qui ((se
développe sous l’injuence de l’élément » (V, 196, 1. 1 sq.). La sûreté de la règle qui
règne sur ce développement, et que Holderlin nomme le statut calculable, cette sûreté
qui, comme celle de tout statut, ne concerne que le général et ne peut décider de
l’interprétation à donner du cours particulier au sein d’une tragédie déterminée (cf. V,
195, 1. 20 sq.), voilà ce qui permet d’apercevoir dans la catastrophe tragique la
K U T X O T ~ Oau
~ ~ sens
~ ~ littéral du terme, celle du retournement natal.
S’il y a, dans l’histoire de la pensée, un point de référence pour le concept
holderlinien de retournement natal - et son homologue divin, le retournement
catégorique - il me semble se trouver dans la notion heideggerienne de tournant; le
tournant, toutefois, ne se situe pas dans la dimension des réflexions théoriques sur la
poésie mais dans celle de l’ontologie. (A ce propos, il faudrait peut-être dire ceci :
les deux dimensions, marquées toutes deux par un indice sans pareil de profondeur,
tendent à se réunir en une seule et unique dimension, mais cette fois à peine accessible,
et surtout extrêmement difficile à aborder par le discours, sans que jamais pourtant,
même au sein de cette réunion, les deux dimensions n’abandonnent l’altérité qui les
fait s’opposer l’une à l’autre.) I1 y a trente ans, dans ma thèse intitulée Holderlin e t
Heidegger, j’ai présupposé, avec l’inconscience de la jeunesse, cette connexion intime
- et je l’ai même utilisée comme une sorte de cadre pour la comparaison
Mais je
ne me risquerais pas à soutenir qu’entre-temps la philologie heideggerienne a mieux
réussi à définir le concept de tournant.
I1 en va de même avec la philologie holderlinienne et son traitement du concept
de retournement dans les Remarques. Pour parler net : les tentatives qui ont eu lieu
chez les spécialistes des études holderliniennes pour domestiquer ce concept, ou tout
simplement pour l’évacuer (alors qu’il occupe à l’évidence une place centrale dans
les réflexions théoriques ultimes du poète), me font la plus affligeante des impressions.
La première des manœuvres d’esquive demeure justement cette idée du N virage
occidental », qui fut l’invention de Wilhelm Michel.
Malgré toute son imperfection, mon propre essai d’autrefois pour saisir et
interpréter dans toute son ampleur et jusqu’à ses plus extrêmes conséquences le concept
de retournement chez Holderlin, me paraît autoriser qu’on garde au moins l’une de
ses hypothèses de travail. I1 s’agit de celle qui concerne l’étroite connexion entre d’une
part le concept d’impulsion formatrice (en tant qu’elle détermine fondamentalement
la culture et la spiritualité d’une nation), tel qu’il se trouve dans l’essai (( Le point
de vue d’où il nous faut regarder l’Antiquité )) et dans la première lettre à Bohlendorff,
et d’autre part les concepts de retournement natal et de retournement catégorique
qu’exposent les Remarques.
Loin de moi l’idée de passer sous silence que Holderlin n’a jamais établi luimême cette connexion dans les ultimes textes où la formulation atteint un comble
de densité. N e lui tenons pas rigueur de ce manque d’égards pour la philologie. Mais
308
de ce passage que nous avons cité, et qui se trouve au début des Remarques sur
CEdipe, où il est question d’un système qui sent - par quoi Holderlin désigne l’être
humain en entier - système qui se développe sous l’influence de l’élément (injuxus,
au sens exact de l’ancienne mystique et de l’ancienne cosmologie; et développement,
au sens de la métaphore organique ou organologique, tout comme l’était, au départ,
le concept de l’impulsion formatrice), la connexion intime dont je parle, et qui est
celle de ce dont il s’agit essentiellement, me paraît ressortir avec une particulière
évidence. D’autant plus que dans la suite de cette phrase il est question à satiété des
diverses séries dans lesquelles K représentation e t sensation e t raisonnement [...I selon une
règle sire sortent successivement les uns des autres )) (V, 196, 1. 3 sq,).
Ce statut, assurément, K est dans le tragique plzltôt équilibre que pure succession
(V, 196, 1. 5 $9.). Cela ne signifie pas autre chose que ceci : les diverses orientations
de l’impulsion formatrice, qui (je reviendrai là-dessus) vont d’abord du national à
l’antinational, puis - à supposer que la culture ne se laisse pas aller à sa perte, comme
ce fut le cas autrefois pour K le pays grec, le plus benu (II, 228, v. 7) - doivent être
recourbées en sens inverse, vers ce qui est originalement national et correspond à la
nature la plus propre, bien que cela ait été négligé avec le progrès de la civilisation
(vu que l’étranger est plus aisé à apprendre que ce qui est propre) - tous ces
mouvements, donc, qui sont en soi successifs, la tragédie les expose l’un face à l’autre
à égalité de poids. Savoir quelle peut être en chaque cas la complexion de cet équilibre
qui détermine le rythme dans le déroulement d’une tragédie, voilà bien ce qui
constitue le contenu concret et chaque fois particulier des démonstrations qu’entreprennent les Remarques sur Gdipe et les Remarques sur Antigone. Et le fait que le
monde s’expose dans l’œuvre du poète K à une échelle moindre s a pour conséquence
parmi bien d’autres que des événements historiques fondamentaux - qui prennent
tout leur sens si on les caractérise à partir de l’orientation que présente en eux
l’impulsion formatrice qui les anime - peuvent bien évidemment se dérouler en
couvrant un grand nombre de siècles, alors que dans un poème tragique particulier
ils sont susceptibles de se montrer, dans l’équilibre de leur opposition dialectique,
au sein d’un dialogue, ou entre le dialogue et le chœur, et finalement entre les sousparties les plus grandes du drame, que Holderlin nomme, en tenant compte de
l’absence de découpage de la tragédie grecque en actes, les ((grandes parties ou
dramates s (V, 201, 1. 28 sq.). En ce sens assurément pas simple, mais tout à fait
précis, statut calculable de la tragédie, destin d’un exercice artistique véritablement
natal, et cours du monde déterminé par l’histoire des hommes - lequel à son tour est
lui aussi déterminé par l’impulsion formatrice (au sens métaphorique précis qu’a ce
terme chez Holderlin) sont en intime connexion.
La structure qui fait l’unité de cette connexion n’est pas une chose simple.
D’abord parce que Holderlin, à l’époque ultime de son travail, a renoncé (comme
nous l’avons souligné), à ce qui était habituel chez ses contemporains, et qu’il avait
lui-même professé dans ses premières tentatives, à savoir regarder l’Antiquité comme
l’époque de la juvénilité de l’humanité civilisée en général (une humanité considérée
à peu près universellement à partir d’un centre qui n’est autre que l’Europe), et
corrélativement saisir l’époque contemporaine comme la vieillesse de plus en plus
prosaïque de ce qui avait été la juvénilité même. Mais ce renoncement a aussitôt
pour conséquence une nouvelle complication : la dialectique de la nature et de l’art,
telle qu’elle se produit en chaque (( pays natal )) (la Grèce aussi bien que l’occident),
subit un décalage. Elle peut se manifester, puisqu’elle est une polarité de thèse et
d’antithèse, de manière antithétique : comme conscience de l’opposition entre nature
et art. C’est ainsi que cette conscience correspond à l’impulsion formatrice de 1’Antiquité (je prie le lecteur de ne pas se laisser prévenir par le caractère non conventionnel
de cette conception holderlinienne de la Grèce), laquelle tendait à établir son règne
309
de l’art sur cette Terre-ci, contre la Nature et contre l’origine orientale de l’hellénité
qui se trouve bien être le Feu d u ciel.
Cette même dialectique de la nature et de l’art peut toutefois aussi se manifester
comme tentative de synthèse, c’est-à-dire comme nostalgie, dans l’impulsion formatrice, d’une réunification de la nature et de l’art. Voilà qui correspond à la variante
moderne primaire. En effet, comme le monde moderne découvre devant lui un règne
de l’art tout constitué - ne serait-ce que sous la forme de la transmission historique
du souvenir de l’ancienne Grèce, et de son exercice artistique exemplaire - la première
tentative de synthèse s’effectue d’abord, au niveau de développement auquel se trouve
I’Hypérion, comme retour à la Nature, au sens strict qu’a cette expression chez Rousseau
(il faut voir dans le retournement holderlinien la transposition d u retour rousseauiste) ;
et si l’on veut parler de manière plus différenciée : comme l’articulation de la double
louange qui célèbre aussi bien la Nature éternellement juvénile que la culture grecque
antique. Telle est la position d’Hypérion lui-même, qui est certes un Grec, mais un
Grec de notre temps, tout comme le roman par lettres qui porte son nom est un
roman moderne.
C’est exactement là que s’amorce l’autre enseignement, l’enseignement inverse
que Holderlin cherche à tirer (dans la lettre à Bohlendorff et dans les Remarques) de
l’effondrement du monde grec antique. Cette leçon va résolument au-delà de toute
nostalgie élégiaque qui se contenterait de pleurer l’ancienne constitution de la Grèce,
comme elle va au-delà du retrait final d’Hypérion au sein de la Nature, au-delà de
l’éclat mélancolique que représente le souvenir de l’aimée après qu’elle est morte, et
au-delà de la promesse qui fait miroiter des jours poétiques à venir. Cela ne doit
toutefois pas laisser croire que le moment élégiaque va cesser de constituer un élément
déterminant de la réflexion et de la pratique poétique de Holderlin.
VI
J’y ai déjà fait allusion, et j’aimerais le souligner de nouveau : l’impulsion
formatrice, telle que l’entend Holderlin, est un principe dynamique. La véritable
thèse de Holderlin au sujet de l’impulsion formatrice pourrait se formuler comme
suit : son orientation, il est possible de la modifier, et même il est nécessaire de la
modifier si l’on veut prévenir un effondrement comme celui qui a atteint l’ancienne
Grèce d’une manière irrévocable.
Aussi est-il indispensable d’envisager de plus près la modification d’orientation
de l’impulsion formatrice qui commande la littérature et la poésie moderne, celles
qui font suite à la littérature et à la poésie de l’Antiquité. Mais avant de le faire,
jetons encore un coup d’œil sur ce qui, en tant qu’exigence fondamentale, demeure
toujours identique aussi bien pour la poésie antique que pour la poésie moderne, et
qui vaut donc indifféremment pour les deux. Dans la lettre A Bohlendorff du
4 décembre 1801, Holderlin le nomme (( vivace rapport et adresse N (das lebendige
Verhaltnis und Gescbick .) (VI, 426, 1. 34). Comme souvent chez le Holderlin tardif,
et particulièrement dans les Remarques, une telle expression n’est simple qu’en
apparence. Elle n’est liée que par la plus simple des conjonctions (« et »),.qui semble
s’effacer pour lier la formulation. Or cette expression doit être lue comme une formule
antithétique. Il s’y abrite en effet ce que Holderlin aurait sans doute nommé, lors de
son premier séjour à Hombourg, une a opposition harmonique ». (( Adresse v e t (( vivace
rapport )) visent au même : l’exigence inéluctable de poésie en général. Mais ils
formulent chacun cette exigence à partir d’orientations différentes. L’adjectif (( vivace )),
référé à des textes poétiques, est de nouveau, au sens strict du terme, une métaphore
((
3 10
organologique. Des rapports sont vivaces s’ils sont naturels, c’est-à-dire nullement pris
dans l’étau d’institutions positives, s’ils sont par conséquent libres de toute sclérose
dans la positivité (comme dirait le jeune Hegel). (( Adresse )) au contraire, désigne la
part qu’ont pris le statut calculable et l’habileté artistique dans l’achèvement d’un
poème en tant qu’œuvre. Cette opposition, au cœur de la formule vivace rapport
e t adresse », peut être dégagée si l’on se livre à une soigneuse analyse de l’usage des
mots chez Holderlin. I1 ne faut pas se laisser égarer par l’aspect de locution toute
faite que présente cette formule au premier abord. En d’autres termes : l’opposition
entre la nature et l’art et sa synthèse - opposition et synthèse qui viennent se condenser
ici sous la forme d’un jeu à l’unisson aussi bien de la liberté naturelle que d u calcul
artistique, pour donner l’inaltérable exigence ultime de tout exercice artistique, en
quelque époque qu’il ait lieu - cette opposition ne devient pas le symptôme d’un
déchirement et d’une aliénation proprement modernes, ou mutatis mutandis celui d’un
espoir en une conciliation idéaliste qui la résoudrait dans le sens d’une poésie
sentimentale ou d’une poésie progressive, comme cela peut être le cas chez Schiller ou
chez Schlegel; il n’y a pas chez Holderlin une telle historicisation de la poésie, mais
tout au contraire - c’est même ce qui fait l’extrême simplicité de sa formulation il énonce la condition absolue de toute poésie, l’antique aussi bien que la moderne,
dans une incise où elle est pour ainsi dire présupposée comme allant de soi. Ce qui
pour Schiller, mais aussi pour Schlegel et pour tous les théoriciens d u premier
romantisme, constitue le but ultime de la littérature moderne (un but par ailleurs
qu’il n’est possible d’atteindre que grâce à une approximation infinie, et par conséquent
qui n’est plus du tout atteignable de facto), pour Holderlin est le point de départ de
ses réflexions sur la théorie d u poétique. Telle est la raison de leur singularité, et
aussi de la difficulté extrême que présente leur compréhension.
((
Holderlin mythologise l’opposition de la nature et de l’art - par exemple dans
l’ode dont nous avons déjà fait mention plusieurs fois : (( Nature et art ou Saturne
et Jupiter. )) Mais il n’en fait jamais une clé de l’histoire. Assurément, dans sa période
idéaliste, Holderlin part, exactement comme ses contemporains, d u fait que lors de
la culture grecque classique n’était encore nullement entrée en jeu la séparation entre
nature et art, elle qui va au contraire donner sa marque à l’époque moderne (celle
que caractérise le christianisme ”). Mais Zeus/Jupiter, que le poète exhorte à ne pas
oublier l’origine, reste néanmoins un dieu de provenance grecque, à savoir le souverain
de l’Olympe, même si dans l’ode il paraît sous son nom latin - ce qui ne peut être
un hasard (sur la question d u (( Zeus plus proprement nôtre »,je reviendrai plus tard).
Le germe de la séparation devrait-il être cherché déjà en Grèce, dans le mythe
de la lutte des Titans, et de l’usurpation du trône olympien par Zeus? L’idée est
inutilisable tant que le classicisme hellénique est considéré à la manière de Winckelmann et des autres (( partisans des Anciens )) comme l’exemple absolu et indépassable de tout exercice artistique pensable et possible. Or c’est le cas encore pour la
Grèce allégorique de Schiller et aussi - mais avec certaines réserves - pour le sol
classique dont Goethe a fait l’expérience à Rome et en Sicile, et dont il fait dire
dans l’acte d’Hélène de la seconde partie du Faust que sur lui ce qui est grand peut
toujours à nouveau voir le jour.
C’est seulement Immermann qui va oser attribuer au dernier Goethe (il pense
en l’occurrence au poète d u Divan occidental-orientai) la pensée d’une insuffisance de
l’art grec (cf. I, 558, rem. 1). Connaissant le texte d u second Faust, qu’Immermann
ne pouvait pas encore connaître en entier à l’époque où il a fait cette remarque, nous
dirions plutôt que le dernier Goethe a découvert le soubassement oriental de la culture
grecque, ce soubassement resté invisible pour la majorité de ses contemporains. Encore
dans la troisième décennie d u X I X ~siècle, Hegel part, pour exposer son Esthétique,
du vieux schéma selon lequel l’art oriental et l’art grec - dans son vocabulaire : l’art
311
symbolique et l’art classique - constituent des époques clairement distinctes dans
l’histoire d’un Esprit sortant d’abord de lui-même pour ensuite revenir à soi.
I1 y a une différence entre d’une part la construction de l’histoire qu’effectue en
toute précision Hegel avec la plus grande énergie dialectique et d’autre part l’idée
de l’histoire que se fait le dernier Holderlin; cette idée n’est plus un schéma de
l’histoire, mais ce que j’ai cherché à caractériser à l’aide d’un terme qui prête assurément
à confusion et que je n’emploie qu’à défaut d’un meilleur, celui de dynamique.
L’allure du langage chez le Holderlin de la maturité est souvent à ce point
proche, surtout lorsqu’il s’agit de dialectique, de celle de Hegel qu’on peut même
parfois les confondre. Mais ce n’est pas une raison pour se laisser induire en erreur,
et construire des associations précipitées. Le début de l’ode <( Métier de poète », qui
date de la maturité de Holderlin, obéit encore à la conception conventionnelle qui
veut que l’Esprit suive un certain cours dans son histoire - l’ode évoque le dieu du
vin venant de l’Inde et transportant la culture en direction de l’occident :
Les rives du Gange entendirent le triomphe
Du dieu de la joie alors que, conquérant tout depuis l’Indus
Le jeune Bacchus s’en venait, avec le vin
Sacré éveillant du sommeil les peuples.
(II, 46, v. 1 sq.)
Dans l’hymne tardif (( L’unique », le cheminement de la conquête semble s’être
inversé. A présent il est dit de 1’Euïos qu’il a
Aux chars attelé
Les tigres et, vers là-bas en bas
Commandant un service de joie,
Instauré le vignoble et
Dompté la colère des peuples.
(II, 154, v. 54 sq.)
Or c’est justement un tel mouvement qui permet de présumer le sens profond
du dynamisme )) par lequel Holderlin pense mythiquement l’histoire. Cela dépasse
l’interprétation dialectique d’un cours de l’histoire que l’on se représenterait malgré
tout de manière linéaire, et s’annonce dans la formulation pour ainsi dire ultradialectique qu’en donne le vers suivant, tiré de l’élégie (( Pain et vin », où il s’agit encore
de Dionysos dans son rapport à la terre natale :
De là-bas il vient, et en arrière il fait signe, le dieu qui vient.
(II, 91, v. 54)
Entre-temps il s’est aussi approché de la terre natale souabe du poète, comme
en témoigne assez l’élégie (( Stutgard », même si c’est allusivement, dans la mesure
où le nom du dieu est passé sous silence.
Le leitmotiv dionysiaque, dans l’œuvre de Holderlin, n’est pas bien connu
seulement pour la recherche holderlinienne; il l’est aussi de tous les amateurs et
connaisseurs de sa poésie. Mon propos vise ainsi à faire ressortir une connexion peutêtre pas toujours assez soulignée, malgré toute la familiarité possible avec ce motif celle qui relie la figure mythique de Dionysos à la tension harmonique entre Antiquité
et époque moderne au sein même de l’œuvre d u poète 23.
3 12
VI1
I1 sera devenu un peu plus clair que l’impulsion formatrice, du moins dans la
façon dont Holderlin utilise ce concept, ne doit pas être entendue seulement d’une
manière quasi dynamique, de sorte que cette impulsion tout à fait propre puisse être
dirigée dans une direction autre, ou même puisse être retournée; en tant que métaphore
issue des sciences naturelles, elle a été à nouveau métaphorisée par Holderlin. Elle
atteint ainsi un degré de généralité qu’elle ne retrouvera que chez Krug, un disciple
de Kant, dans son lexique de 1832, sous la rubrique nisusformatiuus vel plasticus 2 4 .
Dans ce livre, elle devient le concept suprême pour saisir ce que Kant nommait
encore imagination. Inutile de préciser l’importance et la signification de ce concept,
ne serait-ce qu’en ce qui concerne la réflexion sur la poésie.
Qu’on me permette cependant de signaler que le concept de l’impulsion formatrice, dans l’œuvre de jeunesse de Schelling - où il joue un rôle éminent - demeure
quant à l’essentiel restreint à une signification biologique et anthropologique. I1 relie,
dans la (( philosophie de la nature N du jeune Schelling, la nature anorganique à la
nature organique et ainsi joue à peu près le rôle des esprits animaux dans la physiologie
cartésienne. Goethe lui aussi reconnaît dans ce concept d’impulsion formatrice la
dénomination << anthropomorphisée )) d’une force naturelle 2 5 . En ce qui concerne
Holderlin, ce qui est important ici, c’est que chez Goethe aussi le concept en vient
à se situer au cœur du champ de tension qui s’établit entre nature et art. En tant
que c’est une impulsion, l’impulsion formatrice est aussi pour Goethe, du point de
vue de son origine, une impulsion naturelle. Dans sa direction première, elle correspond
ainsi à ce que Holderlin nomme dans les Remarques le (( cours de la Nature ». Mais
ce qu’il y a de tout à fait surprenant (et cela a été bien trop peu remarqué dans les
recherches holderliniennes, parce c’était trop étranger à l’image que l’on se fait du
poète), c’est que ce <( cours de la Nature )) est à présent nommé hostile à I’homme Y.
En 1804, Holderlin parle du (( cours de la Nature éternellement hostile à l’homme ))
(V, 261, 1. 26 sq.). C’est lui qu’il s’agit - pardonnez-moi la banalité de l’expression
- de corriger. Or ce cours est hostile à l’homme manifestement parce qu’il le pousse
toujours plus loin dans une direction qui débouche en fin de compte sur la ruine,
précisément parce qu’il conduit à une position toujours plus exclusive. Mais comme
il s’agit d’un cours de la Nature, et que l’impulsion formatrice en sa direction initiale
est bien une impulsion naturelle, elle ne peut aucunement être orientée en sens inverse
par l’homme seul, à l’aide de sa seule force ou de la plénitude de sa propre puissance.
Nous avons déjà rencontré cette idée : un retournement complet, sans aucun point
d’appui, n’est pas permis à l’homme. C’est là que devient visible la fonction du
(( Zeus plus proprement nôtre N (V, 269, 1. 25), et la nécessité de son intervention.
En tant que nôtre, il lui faut diriger le cours de la Nature éternellement hostile à
l’homme vers la Terre.
(< Nous sommes dans une Mission. Nous sommes appelés à donner forme à la
Terre. )) C’est ainsi que parlait Novalis, quelques années auparavant, dans les fragments
intitulés Pollen 2 6 . Or il s’agit là exactement du point où Holderlin, dans les Remarques,
et plus précisément dans les Remarques sur Antigone, articule la question << comment
cela passe-t-il du grec à l’hespérique N (V, 267, 1. 8 sq.) avec celle de l’irruption par
laquelle (( le céleste, ce qui saisit l’être humain )) (V, 266, 1. 9) intervient. Dans ce
contexte, le céleste apparaît comme esprit du Temps - comme Zeitgeist. C’est le
a moment le plus téméraire dans le cours d’une journée ou d’une œuvre d’art [...I là
où l’esprit du Temps et de .la Nature, le céleste, ce qui saisit l’être humain, et l’objet
pour lequel il s’intéresse, se dressent le plus sauvagement l’un contre l’autre )) (V,
((
3 13
266, 1. 8 sq.). I1 pourrait être licite, avec toute la prudence requise, de compléter la
formule a le moment le plus téméraire dans le cours d’une journée ou d’une œuvre
d’art )) en ajoutant (( le moment le plus téméraire d u cours de l’histoire ». Mais pour
cela, il faudrait pouvoir comprendre l’histoire autrement qu’à la façon d’un déroulement linéaire. Dans le milieu du temps, le temps vire. Cela nous remet en mémoire
les (( époques moyennes N dont, au témoignage de Goethe, Holderlin l’aurait entretenu
lors de leur conversation d’août 1797 à Francfort. Que les papiers posthumes ne
permettent pas de documenter le contenu de cette conversation se comprend si l’on
songe à l’histoire de leur transmission.
Toujours est-il qu’il me semble possible de faire avancer l’interprétation des
Remarqtles en prenant appui sur ce point central, celui d u virage ou d u retournement
- là où le dieu le plus haut, dans sa figure moderne de ((Zeus plus proprement
nôtre », fait lui-même irruption dans le cours historique d u jour et (( contraint vers
la Terre )) (V, 269, 1. 28) le cours original de la Nature. I1 faudrait avant tout pouvoir
rendre compte de la subtile analyse au cours de laquelle Holderlin, à l’aide de phrases
au premier abord oraculaires, mais en réalité tout animées par le seul souci d’une
acribie allant jusqu’au plus infime détail, explore l’opposition entre Grèce et Hespérie,
précisément non plus comme une simple opposition, mais comme différence signifiante
au sein d’un même horizon du tragique.
Voilà à quoi il me faut ici renoncer. Permettez-moi cependant de donner encore
une indication. J’ai pris comme point de départ et domaine de comparaison l’analyse
par Immermann de 1’Ajdx de Sophocle. Or la phrase la plus clairvoyante de ce texte
porte sur la différence entre tragédie antique et tragédie moderne. La voici :
C’est pourquoi nos tragédies peinent à travers quatre actes pour arriver jusqu’au
point où, chez les Grecs, la tragédie commençait (I, 590).
Si l’on n’y regarde pas de près, Immermann veut simplement dire que le drame grec
est principalement bâti de manière analytique, et que par conséquent l’action y est
présupposée comme histoire déjà accomplie, ce qui a pour effet que les dialogues et
les chœurs reviennent pour ainsi dire sur cette histoire; alors que la tragédie moderne
emploie la plupart de ses actes à présenter de manière épique l’action elle-même sur
la scène. Ce point de vue est encore étranger à Holderlin. Mais plus profondément,
ce que découvre ici obscurément Immermann, et qui se trouve être ainsi en contradiction avec sa thèse finale (celle de l’impossibilité de répéter la tragédie grecque),
c’est qu’il n’y a entre la tragédie antique et la tragédie moderne qu’une différence de
degré.
Or c’est bien là l’idée de Holderlin et, si l’on veut, son dernier mot quant à la
(( querelle des Anciens et des Modernes ». Comment, sinon, aurait-il pu penser traduire
Edipe roi et Antigone et, en les traduisant, intervenir en toute connaissance de cause
pour corriger l’orientation fondamentale des deux tragédies, dans !e but de les rendre
plus facilement intelligibles au mode de représentation moderne?
En vérité, Holderlin vise tout autre chose que reprendre une nouvelle fois la
querelle, même pour une bonne fois la vider.
Revenons encore sur la formulation apparemment si paradoxale de la lettre à
Bohlendorff, selon laquelle les Grecs nous sont indispensables pour apprendre ce qui
nous est propre et national, c’est-à-dire ce que Holderlin nomme l’hespirique - alors
même que serait pour nous suprêmement périlleux (( d’abstraire les règles de l’art
uniquement de la seule excellence grecque )) (VI, 426, 1. 3 1 sq.). Après tout ce qui a
été dit sur les diverses orientations de l’impulsion formatrice, l’entente de ce paradoxe
ne présente plus aucune véritable difficulté. L’hespérique que nous sommes en état
d’apprendre des Grecs, c’est ce qui est étranger à l’origine grecque, vu que leur
impulsion formatrice (exactement comme la nôtre, mais seulement en une orientation
3 14
inverse) s’éloigne de ce qui leur était propre, et tendait vers ce qui leur était étranger.
Bref: ce qui nous est propre et que nous pouvons apprendre des Grecs, c’est ce qui
leur était étranger, mais qu’ils ont, en suivant leur impulsion formatrice, fini par
conquérir. Comme on sait, Holderlin résume cette conquête par le concept moitié
mythique et moitié abstrait de sobriété junonienne J (VI, 426, 1. 27 sq.). Si l’on
regarde en partant de l’autre bord : les Grecs peuvent nous être de grand secours avec
leur impulsion formatrice unilatérale, pour que nous puissions retourner la nôtre, qui
est originalement opposée à l’impulsion formatrice grecque. A côté d u Zeus plus
proprement nôtre (lui qui nous ((contraint vers la Terre )) de façon encore plus
caractérisée qu’autrefois les Grecs), viennent apporter leur secours les Grecs euxmêmes, lesquels par nature ont gardé, suivant l’orientation spécifique de leur impulsion
formatrice, la direction de la Terre - et cela même jusqu’à la démesure qui occasionna
leur perte. O r ce genre de ruine ne nous menace pas si nous suivons leur exercice
artistique; pour nous en effet, est correctif générateur d’équilibre ce qui pour les Grecs
était presque une obsession, à savoir l’impulsion à toujours aller vers la configuration
terrestre, dont les contours soient fermement délimités - ce qui se manifeste pour
nous dans ce qui nous semble être un paradoxe : la vertu athlétique des héros de
l’Iliade. Sur ce point, Holderlin est de nouveau en parfaite concordance avec la
représentation que se faisait le X V I I I ~siècle finissant de l’art grec, laquelle se rksume
volontiers sous la rubrique de la plasticité. Est-ce d’ailleurs un pur hasard si, quelques
décennies plus tard, le lexique de Krug nomme le nisus formativus de Blumenbach,
de Goethe et de Holderlin r nisas plasticus » ?
Ainsi donc, la sobriété junonienne des Grecs, dont il nous faut encore nous
acquitter en l’acquérant comme ce qui nous est originalement propre - cette sobriété
junonienne nous aide à remplir cette mission dont parle Novalis, la mission de
configurer la Terre. Là, comme d’ailleurs dans la locution même de (( sobriété
junonienne N, il y a une manière de s’exprimer qui est à la fois abstraite et mythique.
Que désigne-t-elle quand on la transpose dans la terminologie rigoureuse de la
réflexion sur la poésie? Rien d’autre que cette adresse dont parle Holderlin dans la
première lettre à Bohlendorff, lorsqu’il en fait l’une des conditions préalables de tout
exercice artistique. Et ce mot d’« adresse », qui par ailleurs veut aussi dire ce qui
s’adresse, à savoir le destin, doit être pris tout à fait au sens d u métier, comme la
dextérité capable d’atteindre de nouveau, suivant des règles sûres et un statut calculable,
la mêcbanê des Anciens.
Mais autant Holderlin est en concordance avec ses contemporains en ce qui
concerne la manière de comprendre ce qui fait l’excellence de l’exercice artistique des
Grecs, autant la conclusion qu’il en tire est inhabituelle, absolument originale et
exemplaire dans la dialectique de sa réflexion sur la poésie. Que l’excellence grecque
ne doive en aucun cas être imitée aveuglément, cela avait fini par devenir bien
commun depuis l’époque de la querelle en France, et malgré Winckelmann. Déjà
Klopstock avait trouvé la formule et l’avait énoncée sous forme de paradoxe dans
son épigramme (( Solution du doute n :
((
Imiter m’est interdit, et pourtant m e nomme
Ta sonore louange toujours et encore la Grèce.
Si le Génie en ton â m e est ardent
Alors imite le Grec. Le Grec inventait 2 i .
Tel est aussi le sens de la citation que nous avons rappelée plus haut, où Goethe
parle de Raphaël qui n’hellénise jamais, mais travaille comme un Grec. A la fin du
siècle, donc, malgré le culte de Winckelmann, la situation s’était klaircie. Mais
Holderlin reste le seul, dans cette époque d u classicisme, du romantisme et de
l’idéalisme, à tirer les conséquences de cette évolution et à formuler une exigence
poétique aussi nette. C’est ce qu’il fait dans la lettre à Bohlendorff et dans les
315
Remarques. Mais ce qu’il y a de singulier dans la façon dont il procède, c’est que le
déclin du modèle que restent les Grecs, déclin qu’il est impossible de nier d’un point
de vue historique, est intégré dans une argumentation qui vise à instaurer une nouvelle
exemplarité de l’exercice artistique grec. Ce coup de génie dans la réflexion poétique
permet à Holderlin de tirer en un seul trait de plume les conséquences de l’unilatéralité
fatale de l’exercice artistique grec, et du même coup de sauver leur exemplarité pour
les Modernes. Les Grecs, même au moment où ils sont pris dans leur propre déclin,
nous aident en ce qui concerne la mission de devenir les habitants de cette Terre; et
la devise de cette mission porte à juste titre le nom romain de l’épouse grecque de
Zeus : sobriété junonienne. C’est elle en effet qui, au contraire de la situation grecque,
nous sauvegarde précisément de l’unilatéralité. Car l’impulsion junonienne est l’opposée
de la direction originale que prend notre impulsion formatrice. Elle est ainsi l’antidote
de notre tendance innée à nous élancer, en un mouvement d’exaltation idéaliste, hors
de nos coquilles d‘escargots nordiques, c’est-à-dire hors d’une vie étriquée et casanière,
pour nous envoler dans l’élément aorgique du Feu du ciel. Elle nous aide à entreprendre
le retournement.
VI11
Je ne résisterai pas à la tentation de revenir, après ce qui a été dit plus haut
des cheminements du dieu Dionysos, sur le fameux vers qui date de l’époque où
Holderlin remanie l’élégie (( Pain et vin ». C’est ce vers qui a servi de point d’appui
lors des explications qu’on a cherché à donner sur le rapport qu’entretiennent chez
Holderlin la Grèce et 1’Hespérie. Voici ce vers :
Colonie(s) il aime, et vaillant oubli, l’esprit
(II, 608, v. 6 ) .
Les interprètes qui ont spécialement été attentifs à ce texte - à côté de Friedrich
Beissner, il faut citer Martin Heidegger - sont tous longtemps partis d’une évidence
pour eux indubitable, à savoir que l’esprit dont il est question ici est bien une sorte
d’Esprit du monde. De même, pour ce qui est des vers qui précèdent immédiatement
dans la version tardive :
en effet chez lui n’est l’esprit
Pas au commencement, pas à la source. Lui, la patrie
le consume
l’horizon de compréhension était fourni par un cheminement de l’Esprit du monde,
entendu à la façon du cours de l’histoire chez Hegel. I1 y a trente ans, j’ai signalé
un état de fait incontestable du point de vue philologique : dans l’usage que fait
Holderlin de la langue à l’époque tardive où il remanie ses poèmes de la maturité,
eJprit est la dénomination du dieu du vin, donc de Dionysos lui-même. Lorsque
Holderlin, vers 1800-1801, a calligraphié l’élégie (( Pain et vin », il n’aurait jamais
nommé simplement esprit le demi-dieu. Mais à partir du moment où commence la
phase de l’œuvre tardive (à laquelle appartient le travail sur (( Pain et vin )) qui nous
occupe) une telle nomination n’est plus du tout inhabituelle chez Holderlin. Ce que
j’ai indiqué alors n’a guère suscité la sympathie, bien que ce n’ait jamais été
formellement contredit. I1 y a quelques années encore, Hans Joachim Kreutzer a
déclaré qu’avec cette indication a un acquis décisif, qui semblait avoir été assuré avec
les travaux de Gadamer et de Pyritz - à savoir celui d’une migration comme un tout
3 16
dans le cadre d’un cheminement historique - devait pour ainsi dire être abandonné 2n ».
Est-ce là véritablement la conséquence à tirer de mon travail? Je n’en suis pas tout
à fait sûr. Car c’est un fait - et rien n’est plus inflexible qu’un fait : Holderlin, dans
tous les manuscrits de la dernière période, remplace systématiquement (( Dionysos N
ou (( le dieu d u vin N par l’esprit. Pourquoi donc continuer à s’en tenir à une
interprétation devenue douteuse, celle de l’esprit comme Esprit du monde, uniquement
pour ne pas mettre en doute un (( acquis )) de la recherche? Je confesse volontiers mon
faible pour les erreurs fécondes, même en science. Et l’on pourrait penser que recourir
à l’Esprit du monde facilite la compréhension de ce passage - du moins pour
quelqu’un qui part d’un point de vue hégélien. Mais je crois néanmoins plus fécond,
en l’occurrence, de suivre, à la place d’un cours historique de l’Esprit absolu, les
cheminements complexes de Dionysos dans la pensée poétique de Holderlin. Ils
reflètent une tout autre conception de l’histoire et ainsi ne peuvent en aucun cas être
mis en rapport immédiat avec le mouvement dialectique de l’Esprit du peuple ou
de l’Esprit du monde. C’est uniquement pour marquer cette différence que j’ai voulu
revenir sur ce passage très discuté L9. Il s’agit en effet de la différence entre poésie et
pensée.
Mais ce qui rend si difficile une entente exacte de Holderlin et ne cesse de placer
en porte à faux la recherche officielle dans sa manière de procéder, c’est l’usage de la
langue que fait Holderlin, tel qu’il se montre dans ses ultimes réflexions sur la poésie,
et se reflète exemplairement dans le vers que nous venons de citer, celui où il est
question de la colonie. A propos de locutions décisives qui se trouvent dans les
Remarques, je viens d’utiliser - et, croyez-moi, c’est une approximation, sinon même
un pis-aller - l’expression de tournures à moitié abstraites et à moitié mythologiques.
Or lorsqu’il parle d’«esprit )) en désignant par Dionysos - et non pas, comme le
présume presque nécessairement un cerveau passé par l’école de Hegel, un (( Esprit
du monde )) comparable à Napoléon, que Hegel a aperçu, (( âme du monde à cheval »,
un matin à Iéna vJ - Holderlin cherche à dire cette dimension caractéristique de son
œuvre et de sa pensée tardives, dimension qu’il nous est presque impossible de saisir
à l’aide des modes de représentation usuels. L’« esprit )) est-il alors l’Esprit du monde?
Est-il légitime d’entendre le mot esprit, dans la dernière poésie de Holderlin, au
moins aussi dans le sens de cette abstraction philosophique (dont Hegel aurait assurément démontré qu’elle est en fait l’unique concret réel)! Ou bien ce mot dit-il
concrètement, mais dans un sens poétique, le demi-dieu Dionysos? Poser la question
en ces termes ne peut aboutir qu’à une impasse.
Impasse comparable aux apparences de discussion qu’a soulevées la plupart du
temps ce qu’on a appelé la dispute autour de l’hymne (( Fête de la Paix ». Avec
Napoléon, Holderlin élève au rang de mythe une figure historique de son temps. O u
plutôt, pour le dire de manière plus appropriée : à une figure mythique, qu’il nomme
le prince de la Paix, et qui se trouve être une figure indispensable dans le cadre des
présuppositions qui sont les siennes (et que je ne puis exposer ici plus avant), pour
que ceux d u ciel, au soir d u temps, puissent faire leur entrée dans notre demeure, il
octroie d’incontestables traits de celui qu’il avait déjà invoqué dans un essai d’ode
antérieur, à savoir (( Buonaparte 1). Cette remarque qui est en fait une constatation ne
peut en aucun cas être comprise comme la mise en place d’une (( thèse napoléonienne ))
- comme s’il s’agissait de décoder une dénomination chiffrée, et comme si (( Fête de
la Paix N était un hymne à clé, C’est de toute autre chose qu’il s’agit. La difficulté
capitale qu’il y a aujourd’hui à entendre Holderlin vient bien - s’il est permis
d’étendre aussi vite la portée de deux exemples à peine esquissés - de la difficulté
qu’il y a à saisir correctement ce qu’est ce règne intermédiaire (le terme est de Paul
Klee), dans lequel Dionysos devenu esprit (à entendre donc comme dainzôn ou demidieu), ou bien un prince de la Paix portant les traits d’une figure de l’époque,
prennent en charge une fonction rion seulement poétique, mais impliquant la réflexion
317
sur la poésie. Cette fonction ne peut être remplacée par rien d’autre, et certainement
pas par une opération de déchiffrement ou de traduction métaphysique. Cette fonction,
bien au contraire, fait irruption au beau milieu d u poème de telle sorte qu’elle en
assure l’organisation. Une telle figure, prise en vue avec des yeux éduqués par les
modes de représentation usuels, ne peut que présenter l’allure d’un très étrange
hybride, difficile à identifier, et pour cette raison exposé à l’incohérence de toutes les
tentatives imaginables d’identification.
Ce que je viens d’appeler un hybride est en vérité un centaure, comme Chiron
- en tout cas une figure mythique ayant sa propre loyauté. Et la colonie, qu’aime
Dionysos, n’est autre que la Terre, depuis l’Indus jusqu’à Stuttgart - c’est-à-dire
jusqu’à 1’Hespérie. La rendre habitable est donc aussi et surtout sa tâche. c Esprit
communautaire (II, 751, v. 20), tel peut être le nom typique de Bacchus dans les
développements d’esquisses du poème (( L’unique », car il est le demi-dieu commun
aussi bien aux Grecs qu’aux Occidentaux, celui qui préside à cette mission, et qui
de plus dompte les bêtes les plus sauvages. Le vaillant oubli est sa part, comme c’est
la part de tout un chacun, qu’il soit demi-dieu ou simplement homme, au point
suprême de la conscience, à l’instant d u retournement.
Dans la Fête de la Paix, cette opération d’élever au rang de mythe a-t-elle déjà
été réussie? O n peut en douter. La question de l’interprétation de ce poème peut se
résumer ainsi : est-ce que ce grand hymne, chanté au comble de l’attente millénariste
de Holderlin, il faut le lire en anticipant dans la direction de l’œuvre tardive et de
sa qualité mythique, ou bien au contraire faut-il le lire en sens inverse, c’est-à-dire
régressivement vers la phase idéaliste de l’œuvre, où le prince de la Paix, alors,
demeure une sorte d’Esprit du monde - mais toutefois simplement constaté de façon
a purement )) visionnaire, et non développé à l’aide d’une dialectique du type de celle
de Hegel? Dans les hymnes de jeunesse écrites à Tübingen, il y a déjà à foison des
dieux et des demi-dieux. Mais ils n’accèdent que peu à peu au rang d’une nouvelle
mythologie digne de ce nom. La Venus Urania, et toutes les autres figures analogues,
ne deviennent réellement mythiques, et elles perdent leur valeur de simples références
rhétoriques, seulement dans la mesure où, quittant le statut d’élément allégorique au
sein d’un registre aisément disponible, elles passent à celui d’entité dont la stature
est désormais autonome, et en tout cas difficile, voire impossible à ramener au concept.
Dionysos ici en est un exemple particulièrement frappant. Chez Holderlin, il ne
correspond pas si facilement à l’image reçue d u dionysiaque. Ce n’est d’ailleurs pas
le moindre mérite du poète qu’il en soit ainsi. Tous les traits qu’il reprend de
l’ancienne tradition mythologique, il les interprète d’une manière qui n’est qu’à lui.
Ce qui est en point de mire avec le concept holderlinien de retournement, c’est
une dialectique plus dure que celle dont fait montre l’idéalisme allemand. Est-ce
même encore quelque chose de tel qu’une dialectique? En tout cas Holderlin a
contribué de façon décisive à ce que la dialectique - dans les dernières années d u
X V I I I ~siècle - puisse faire sa percée définitive sur la scène philosophique. Sans doute
y a-t-il même contribué largement plus que ne veulent bien le reconnaître les historiens
de la philosophie (lorsqu’ils mentionnent le plus ancien programme systématique de
l’idéalisme allemand). Mais dès cette époque, Holderlin était passé au-delà de ce
stade, ou plus exactement, il en était revenu. I1 s’était placé sous la loyauté d u Zeus
plus proprement nôtre.
Une modestie toute nouvelle est liée à ce retrait. Holderlin écrit le 12 mars
1804 à Leo von Seckendorf :
))
La fable, manière poétique de regarder l’histoire et l’architectonique du ciel me
préoccupe présentement surtout, partiçulièrement le national, dans la mesure où
il est différent de l’hellénique (VI, 437, 1. 2 3 sq.).
3 18
Et il enchaîne aussitôt :
Les diverses destinées des héros, chevaliers et princes, comment ils servent le destin,
ou de façon plus douteuse se comportent au sein de ce dernier, je l’ai saisi en
général (VI, 438, 1. 154.).
Nous voilà de nouveau dans les parages des (( époques moyennes ». Et à proprement parler, toutes les époques sont moyennes, tendues qu’elles sont entre avenir
et passé. La querelle des Anciens e t des Modernes est bien, au sens précis du terme, un
thème à n’en plus finir (la longueur de cet exposé n’en est que le pâle reflet).
Qu’au moins ceci soit bien fixé : Holderlin ne pense pas historiquement. I1 écrit
la fable, le mythe, la (( manière poétique de regarder l’histoire ». Voilà qui n’a rien
à voir avec l’historisme qui pousse Immermann à se résigner.
Holderlin ne pense pas historiquement ; il pense historialement, c’est-à-dire : sa
pensée est d’une seule traite à la fois historique, logique, poétique et mythique.
(Traduit par François Fédier)
NOTES
N.B. : Les citations de Holderlin suivent la Grande Édition de Stuttgart, publiée sous la direction
de Friedrich Beissner. D’après le tome, la page et la ligne (ou le vers). Karl Immermann est cité en
suivant l’édition de ses Euvres complètes en 5 volumes, éd. par Benno von Wiese, Francfort-sur-le-Main,
177 1. (On cite d’après le tome et la page.)
1. Ernst Robert Curtius, La Littérature européenne e t le Latin médiéval. Berne-Munich, 1948, p. 256 sq.
Hans Robert Jauss, Normes esthétiques et Répexion historique dans la querelle des Anciens et des Modernes H ,
in le parallèle des Anciens e t des Modernes de Charles Perrault, Munich, 1964, p. 8-64. Du même : La
réponse de Schiller et celle de Schlegel à la “ querelle des Anciens et des Modernes ” in L’Histoire
littéraire comme provocation, Francfort-sur-le-Main, 1770, p. 60- 106 ; et Antiqui/Moderni », in Vocabulaire
historique de la philosophie, éd. J. Ritter, t. I, Darmstadt, 1971, col. 410-414.
2. Manfred Fuhrmann, La “ querelle des Anciens et des Modernes, le nationalisme et le classicisme
allemand ” », in : Le Développement culturel de l’Allemagne. La nouvelle destination de l’être humain,
éd. B. Fabian, etc., Munich, 1980, p. 47-67. Cet aspect spécial n’aura pas à nous occuper aujourd’hui;
il n’y a pas le moindre indice qui permette de regarder Holderlin et son œuvre comme ayant préfiguré
l’idée nationale telle qu’elle s’est manifestée DU XIX‘siècle. Le terme de national est central dans la
réflexion holderlinienne pour l’opposition entre ancien et moderne; mais il a un sens absolument singulier,
et ne va nullement en direction de l’idée nationaliste.
3. Beda Allemann, Le concept d’une science de la littérature dans le premier romantisme », in Sur
l e poétique, Pfullingen, 1757, p. 53-7 1.
4. Peter Szondi, Études holderliniennes. Aver un truité sur la connaissance philologique, Francfort-surle-Main, 1767. Du même : Poétique et Philosophie de l’histoire, I “ partie, édition des cours, t. II, publié
par Senta Metz et Hans Hagen Hildebrandt, Francfort-sur-le-Main, 1974 (cf. particulièrement : Antiquité et Temps modernes dans l’esthétique de l’époque goethéenne », p. 11-265).
5 . On ne peut indiquer ici qu’en gros le matériel abondant des recherches sur le rapport de Holderlin
à la Grèce, sur sa mythologie, etc. En ce qui concerne le problème spécifique du champ de tension entre
Anciens et Modernes, voir, parmi les travaux les plus récents : Adolf Beck, Holderlin et son chemin vers
l’Allemagne, Fragments e t thèses, avec une réponse au c Friedrich Holderlin v, de Pierre Bertaux, Stuttgart,
1782. Hans Joachim Kreutzer, (( Colonie et pays natal dans l’œuvre lyrique tardive de Holderlin », in
Annuaire Holderlin, 1980-1981, p. 18-46.
6. Wilhelm Michel, Le Virage occidental de Holderlin, Iéna, 1723.
7. Goethe à Schiller, Francfort, le 23 août 1777.
8. Entretiens avec Eckermann, le 21 mars 1830.
9. Max Kommerell a rassemblé tout ce qu’il faut savoir sur cette question dans Lessing et Aristote,
Francfort-sur-le-Main, 1940.
io. I, p. 554 sq, immermann l’appelle en sous-titre Un traité d’esthétique.
((
((
((
((
((
3 19
11. Assurément, il pense aussi, mais sans les nommer, à ce qu’on appelait alors les tragédies du
destin ; elles étaient devenues une vraie mode (cf. Zacharias Werner, Müllner, Houwald, Grillparzer).
Elles sont une parodie de l’idée antique de destin. August von Platen les parodie à son tour avec sa
comédie La Fourchette fatale (1826).
12. Catherine de Heilbronn, et Le Prince de Hombourg, cette dernière pièce dans sa propre adaptation.
13. Cf. Immermann I, 598. Cette pensée a peu à voir avec ce que nous connaissons à notre époque
sous le nom de théâtre épique )) (une locution qui n’est d’ailleurs pas tout à fait adéquate, et que
Brecht lui-même finira par modifier). Ce à quoi pense Immermann, c’est au drame moderne en tant
qu’il provient des mystères médiévaux.
14. (( [...I que tu aies traité le drame de manière plus épique )) (VI, 426, 1. 40 54.).
15. Qu’il n’y ait chez lui encore aucune réduction nationaliste, voilà qui ressort du fait que ses
références, lorsqu’il parle des mystères, sont surtout françaises (I, 599 54.). En ce qui concerne ce type
de théâtre, ce qui lui semble essentiel c’est : la grande richesse en personnages, la longue durée de
représentation (plusieurs jours) et la thématique axée sur l’histoire par excellence, l’histoire du Salut,
avec sa tension entre éternité et temporalité. Ce sont là des points de vue parfaitement étrangers à
l’hellénisme.
16. Cf. l’article U Nisus )) de R. Specht, in Vocabulaire hi~toriquede la philorophie, éd. Joachim Ritter
et Karlfried Gründer, t. VI, Bâle 1984, col. 857-866.
17. Ainsi Friedrich Schlegel, dans ce qui s’appelle le Studirrm-Aufsatz (le mémoire concernant les
études); il nomme l’art grec un art Rat’exochen, (( dont l’histoire particulière serait du même coup
l’histoire naturelle généraie de l’art )) (édition critique, de Schlegel, par Ernst Behler, Munich-PaderbornVienne, 1958 sq., t. I, p. 273; souligné dans l’original.
18. Toutefois, Peter Szondi lui-même n’a pas voulu reconnaître cet état de fait. Dads sa critique du
concept de retournement natal (critique trop unilatéralement appuyée sur la première lettre à Bohlendorff,
et non rééquilibrée par une étude des remarque^), il a trop vite confondu le concept holderlinien de
retournement natal et le concept de (( virage occidental )) qui vient de W. Michel. Peter Szondi, (< Lettre
à Bohlendorff du 4-décembre 1804; commentaire et critique de la recherche », in Euphorion 58, p. 260275. Repris dans EtudeJ holderliniennes (op. rit., note 4), p. 95-1 18.
19. Voilà du même coup l’interprétation la plus profonde, à vrai dire une véritable surinterprétation
du concept aristotélicien de catharsis.
20. Cette exigence contient et même dépasse ses conséquences purement poétiques - cf. les célèbres
vers de Rilke : (( Là en effet aucun endroit / Qui ne te voies. I1 faut que tu changes de vie »; R.M. Rilke,
CEuures CompiéteJ, éd. Ernst Zinn, t. I, Francfort-sur-le-Main, 1955, p. 557.
2 1. Beda Allemann, Holderlin e t Heidegger, Zurich, 1954 (2’ édition augmentée, 1956).
22. Et aujourd’hui - si la digression est possible - aboutit aux problèmes de la pollution
de l’environnement, du mauvais usage des sources d’énergie, et menace même de destruction notre
planète.
23. Cf. les ttavaux récents de Bernhardt Bochenstein, Les Bacchantes d’Euripide dans leur transposition chez Holderlin et Kleist », in AJpectJ de I‘époque goethéenne, Gottingen, 1977, p. 240-254, et
la conférence de Turin sur la figure de Dionysos chez Holderlin, pour paraître dans les Annales aknander
((
))
((
((
trimertrielleJ.
24. W.T. Krug, Lexique général pour la Jcience phdoJophique, 1832- 1834, article Force formatrice
et impulsion formatrice )) t. I, p. 360 54,
25. Cf. l’article de Goethe (( L’impulsion formatrice dans l’édition de Hambourg, t. X I I , p. 3234; et aussi dans I’Edition complète de Cotta, t. XIX, Stuttgart, 1969, p. 145.
26. Édition historique et critique de Novalis, éd. Paul Kluckhohn et Richard Samuel, t. II, Stuttgart,
1960, p. 426, n<’32.
27. Friedrich Gottlieb Klopstock, û3uureJ rhoisie~,éd. Karl August Schleiden, Darmstadt, 1969,
p . 180.
28. Cf. note 5, la conférence de Kreutzer, p. 23 sq.
29. Dans l’interprétation méticuleuse et fondamentale de l’élégie par Jochen Schmidt (L’élégie de
Holderlin n Pain ct Vin P, le déoeloppement du style hymnique dans la poésie élégiaque, Berlin, 1968), la
lecture de (( esprit )) comme Dionysos est admise : (( Le mythe de Dionysos détermine la matrice du
poème, jusque dans les dbtails. D Malgré cela, l’auteur cherche à conserver la signification (( générale ))
d’esprit. II déclare ainsi : Plusieurs traits repris à la légende caractérisent I’eJprit (qu’il faut bien
comprendre au sens général comme le divin dans l’acceptation la plus englobante) dans un sens plus
particulier comme Dionysos. I1 faudrait s’entendre! Faut-il lire (( esprit )) dans un sens général, celui
qui passait pour aller de soi, ou faut-il le lire comme une nomination de Dionysos? Ou bien s’agiraitil de l’entendre dans les deux sens? Mais dans ce cas, qui est responsable de l’ambiguïté, ou mieux de
((
))
((
))
320
la contamination? Est-ce Hdderlin, ou ses interprètes? Ou bien n’est-elle que la suite de cette fausse
évidence dans laquelle le passage a longtemps été compris?
Momme Mommsen se prononce quant à lui sans ambiguïté pour une interprétation d’* esprit comme
désignant uniquement Dionysos. Cf. Dionysos duns lu poésie de Holderitn (1963).
30. A Niethammer, le 13 novembre 1806.
))
Holderlin,
disciple de Dionysos
Situation et portée d’une relation exemplaire
Bernard Boschenstein
(( Tu l’as capté, tu as compris le langage des étrangers, interprété leur âme ’! ))
Rousseau, le traducteur d u message des dieux à qui Holderlin s’adresse ainsi comprend
l’étrangeté seulement parce qu’il est lui-même (( étrange )) et (( étranger ». (« Comment
désigner l’étranger? », est-il dit dans l’hymne (( Le Rhin )) à son propos ’.) Cette double
qualification de traducteur et d’étranger prend appui sur le (( dieu du vin )) qui produit
lui aussi une traduction du (( langage des plus purs )), des dieux, en exprimant leur
((plénitude sacrée )) par une création qui ne se soumet pas à des lois (métriques et
politiques) déjà établies, mais qui reflète une innocence première 3 . Ce langage de
Dionysos (( frappe )) en revanche (( de cécité )) ceux qui ne prêtent pas leur attention
aux dieux. I1 est fait allusion ici à la foudre qui a engendré le dieu du vin en tuant
Sémélé, sa mère. Le langage de Dionysos est donc à la fois éclairant et destructeur,
selon l’attitude de ceux qui sont appelés à le recevoir. Holderlin écoute Rousseau
afin de comprendre comment son modèle a pu s’ouvrir à ce langage de la totalité
non encore organisée sans se perdre, sans ployer sous ce fardeau. I1 y a une certaine
polarité entre la fermeté, la sûreté de l’écoute de Rousseau et l’absence de (( lois ))
dans la parole qu’il crée afin de transmettre cette écoute. Holderlin se sert ici,de deux
médiateurs, de Rousseau d’abord, puis, à travers lui, de Dionysos. L’un et l’autre
sont porteurs d’un langage de la médiation qui a un rapport immédiat avec l’origine
de la vie. Ils restent tous deux en contact permanent avec un état premier qui
comprend, mais sous une forme encore diffuse, la plénitude qui précède tout état
différencié. Le terme de (( sans loi )) appliqué à Rousseau et à Dionysos est aussi
invoqué, par Holderlin traducteur de Sophocle, pour Antigone 5 , lorsque l’opposition
qu’elle exprime face à Créon est rapprochée des a lois non écrites )) auxquelles elle se
réfère, (( lois appartenant au ciel », dans la traduction de Holderlin. Antigone et
Rousseau sont unis dans leur conception (( originelle 1) des lois. Les deux font opposition
322
à un état figé qu’ils rencontrent et qu’ils aimeraient voir s’écrouler. Les deux font
œuvre de législateur sur la base d’une origine qui précède toute légalité. Cette origine
se confond avec le pouvoir dionysiaque. Sa propriété est la force d’éveil qui s’empare
des peuples et de leurs maîtres. Les prophètes de l’Ancien Testament, les poètes grecs
et les événements guerriers déclenchés par la Révolution française ont cette faculté
d’ébranler un monde menacé de manque d’inspiration et de créativité ’. La révolution
ressemble dans ses conséquences, aux yeux de Holderlin, au langage des prophètes
juifs et des poètes grecs. Comment Holderlin en vient-il à unir ces trois moments de
l’histoire qui, tous les trois, lui servent à présent de modèle? Dans ces trois cas, une
volonté divine se fait entendre que n’entrave pas une institution arbitraire. Le langage
des prophètes est une traduction authentique d u message divin, comme le sont les
drames de Sophocle ou les odes de Pindare. Ces poètes sont un modèle par la force
de leur réception d u vrai sens des mythes et par leur faculté de créer un langage qui
correspond à ce qu’ils ont capté. Ce langage reflète une totalité indistincte, mais aussi
sa négation. A travers cette dernière, la totalité se fait comprendre. Antigone a besoin
de Créon pour que sa position puisse s’articuler, comme Rousseau répond à ses
contestataires et cerne ainsi sa pensée, comme Holderlin se confronte à une thématique
que lui offre la tradition antique ou biblique ou médiévale ou plus récente afin de
la structurer, dans un deuxième temps, selon l’opposition entre (( nature )) (Natur) et
(( culture n (Kunst), entre 1 ’ aorgique
~
)) et 1’«organique ». Les prophètes, en dénonçant
le mal qui agit sur le peuple d’Israël, font entendre la parole de Jéhovah. Et les
guerres issues de la Révolution française expriment, selon Holderlin, une volonté de
liberté et de fraternité qui ne peut s’affirmer qu’à travers les résistances des anciens
régimes. L’histoire se fait alors le théâtre d’un dialogue violent que semble inspirer
un nouveau sens de l’unité et du progrès qui parle à travers les combats idéologiques
les plus récents. Holderlin veut se faire l’écho de ce langage de la totalité différenciée
en deux pôles, en créant une méthode poétique qui sert le langage de l’Un à travers
sa division cohérente.
Cette division est préfigurée, aux yeux de Holderlin, par la tragédie grecque
dont l’exemple le plus rigoureux nous a été donné par Sophocle. Un distique de
Holderlin résume l’essentiel de ce que Sophocle constitue pour lui :
Nombreux sont ceux qui, en vain, se sont essayés à dire la plus grande joie par la joie.
Ici, enfin, elle se révèle à moi, dans le deuil.
Viele versucbten umsonst das Freudigste freudig zu sagen,
Hier spricbt endlicb es mir, bier in der Trauer sich aus ’.
Cette joie démesurée, c’est celle qui s’apparente à (( ce triomphant délire qui
saisit les chanteurs soudain dans la nuit sainte )) (« Pain et Vin »). Elle s’exprime au
milieu du plus grand deuil dans Antigone, au début du cinquième acte (selon la
division adoptée par Holderlin), lorsque, après le départ d u devin Tirésias et avant
que soit annoncée la nouvelle de la mort des deux fiancés, Antigone et Hémon, le
chœur chante Dionysos en exaltant sa nature de dieu de la joie », c Freudengott ‘ O ».
Comment le sacrifice de ces deux jeunes morts peut-il être rapproché de la joie
suprême? L’un et l’autre, Antigone et Hémon, meurent en restant fidèles à leur dieu :
Antigone à (( son Zeus ” N qui garantit (( les lois d u ciel )) et qui exige la fidélité aux
morts envers et contre les lois édictées par le pouvoir temporel; Hémon en rappelant
à son père l’honneur d û aux dieux souterrains, dans un dialogue conflictuel qui met
en cause le pouvoir solitaire de ce père, séparé des citoyens. Exactement au milieu
de la stichomythie qui oppose le père au fils (les vers 773 et 774 de Holderlin) se
trouve la confrontation entre la conception que Créon se fait de son pouvoir qu’il
croit incontesté et celle d u respect des dieux souterrains exprimée par Hémon. Or,
ces vers du milieu sont considérés par Holderlin comme la transition d’une constellation
323
appelée (( grecque )) vers une nouvelle constellation dite (( hespérique )) 1 2 . Cette transition acquiert son véritable sens à la lumière de la mort des deux jeunes protagonistes.
L’événement de cette mort est significatif du passage d’un monde où la mort est
physiquement subie vers un autre monde où elle est intériorisée. Or, cette intériorisation
est rendue par le traducteur sous la forme d’une modification importante : l’honneur
dû aux dieux devient la (( sanctification du nom de Dieu D. Cette sanctification est
liée à l’acte même de la compréhension de la nature de Dieu qui se fait par la
fondation du nom approprié. Or cet acte de fondation correspond à la réflexion
moderne de celui qui traduit le nom antique en un nom actuel. Cet acte de la
traduction passe des dieux à Dieu, de l’honneur qu’on leur rend à l’esprit qui pense
le sacré, Cette réflexion se fait ici dans la communauté avec des êtres fraternellement
aimés. Pour cette sanctification de la fraternité, Holderlin use ailleurs du terme de
c Gemeingeist », esprit communautaire, en ajoutant que celui-ci s’appelle Bacchus 1 3 .
Bacchus, joie suprême sur un fond de deuil, préside au passage de l’état grec à l’état
hespérique. I1 est le dieu qui incarne ce passage. Ainsi, lorsque Holderlin explique
1’u insurrection 1) qui caractérise l’action d’Antigone, en l’interprétant comme un
(( retournement de tous les modes de représentation et de toutes les formes l 4 », il cite
l’invocation de Dionysos dans le dernier chœur de la tragédie : (( .rcpo<pctvq0i(û&ooç) ))
(( Sois manifeste (dieu)! », afin de bien marquer le lien étroit entre la nature de ce
dieu et la révolution qui détermine la pièce de Sophocle, mais bien plus encore
l’éclairage sous lequel il la comprend. Antigone, c’est pour lui le grand exemple de
sa vision de la révolution qu’il définit ailleurs comme ((une future révolution des
conceptions et des manières de voir ». Dionysos serait ainsi le moment où le vent
de l’histoire tourne : où ce qui fut pouvoir autoritaire et honneurs archaïques offerts
aux dieux de la cité se transforme en adhésion en profondeur à la communauté
d’amour qui unit les morts aux vivants et ceux-ci aux générations futures. En se
souvenant de Polynice mort, au moment même où ils mourront eux aussi, Antigone
et Hémon libéreront la voie de l’avenir au profit du nom le plus sacré qui garantisse
l’expérience de l’essentiel, celui du Dieu commun à tous ceux qui obéissent aux lois
(( non écrites et fermement établies dans le ciel ». Dionysos est le dieu qui donne une
forme et un sens à ce tournant. I1 est celui qui va profondément en arrière - en se
souvenant de la mort de sa mère qui lui a donné naissance - et en même temps
profondément en avant, vers la fête de l’unité finale qui sera le banquet des dieux
dans la maison des hommes 16.
Ainsi il est le dieu qui est invoqué lorsqu’il s’agit de donner de nouveaux noms
aux divinités. Sophocle l’appelle nohuhvupe, (( dieu aux multiples noms ». Holderlin
change cette appellation en (( créateur de noms ». Dionysos serait alors, une fois de
plus, le principe générateur d’une nouvelle compréhension des forces et formes
essentielles qui doivent aboutir à un nouveau langage. Cette génération du langage
fait de lui le dieu des poètes tel qu’il est célébré dans la première tentative hymnique
de Holderlin, (( Comme au jour du repos l ’ . . . ». La comparaison de sa naissance avec
la naissance du chant signifie qu’il est particulièrement proche de l’acte de l’engendrement et de la naissance - qui, chez lui, ne font qu’un. Mais il rachètera, dans la
vision de Holderlin, la mort de sa mère qui précède cette naissance par la conjuration
du péril d’une telle présence de l’élémentaire qui ruine toute protection. Ce rachat,
c’est, dans la poétique de Holderlin, le corps du texte qui renferme le feu venu d’en
haut. I1 y a dans cet aspect protecteur et limitatif une élucidation de ce qui se donne
à voir dans l’épiphanie concrète invoquée par le chœur : (( Sois manifeste, dieu! ))
Le chœur d’Antigone, d’où ce vers est tiré et interprété à la lumière de la
Révolution française et de ses conséquences pour l’Allemagne de Holderlin et de ses
contemporains, est riche de traces d’une lecture très spécifique que Holderlin traducteur
a faite du texte grec : au lieu de nommer Dionysos (( l’orgueil de la jeune femme qui
est la fille de Cadmos », le traducteur en fait (( l’orgueil des eaux aimées par Cad-
mos )). Dans la seconde strophe, les nymphes coryciennes deviennent les eaux
bacchiques d u Cocyte, et les coteaux ornés de lierre se transforment en (( fontaines
qui écoutent au loin ». Trois fois, donc, l’eau remplace, soit une fille ou des nymphes,
soit une pente. L’eau étant désignée comme celle d u Cocyte, d u fleuve des enfers,
Dionysos est, beaucoup plus que chez Sophocle, situé ici dans la sphère souterraine
des morts. A cette sphère s’allie (( 1’I.mpénétrable)) que Holderlin ajoute aux motifs
éleusiniens propres à Sophocle. I1 s’agit de l’intérieur de la terre que le Dionysos
holderlinien domine également. Ces modifications du texte original renforcent considérablement la relation de Dionysos au domaine des morts qui dicte, dans l’interprétation des Anmerkungen zur Antigonae, le cours de l’action d’Antigone.
Ce rapport privilégié avec le monde qui habite sous la terre constitue aussi une
relation étroite avec le souvenir. Ce dieu reste fidèle à sa ville natale. Lorsqu’il la
quitte, c’est pour y revenir : (( Dorther kommt und zurtlck deutet der kommende Gott 19. N
(C’est là d’où vient et c’est là ce qu’indique, en se retournant, le dieu à venir.) Ce
dieu est donc fixé par sa naissance tout en s’appelant le dieu qui advient. Mémoire
et avent, regard en arrière et annonce d’un avenir imminent se confondent en lui.
C’est peut-être là ce qui lui assigne, dans la perspective holderlinienne, le lieu d’élection
à l’intérieur des tragédies : le sens d’Antigone est pour Holderlin la simultanéité de
la fidélité au mort et de l’avènement d’un état de fraternité universelle. Le passé et
l’avenir qui se rejoignent ici appartiennent ensemble à ce qui fait le propre de cette
divinité qui pr yi e nt et advient en même temps, dieu de sa propre origine et de son
propre avenir. Etre simultanément le souvenir de la dimension du feu céleste et de
la terre impénétrable et l’annonce d’une fête universalisée qui signifiera l’union durable
de ces deux composantes, c’est obéir à la fois à la structure du renvoi et à celle de
la prophétie.
Pourquoi cet attachement permanent de Holderlin à Dionysos? En lui, il pouvait
être à la fois proche d u Christ et de l’Antiquité grecque, proche de ces deux
constellations, chacune porteuse d’un passé et annonciatrice d’un avenir. Les penser
ensemble, c’est inventer cette troisième incarnation provenant des deux et s’accomplissant dans ce que les poètes (( fondent )) : le (( durable 20 ». Fonder (stl‘iften),c’est le
mot que Dionysos utilise lui-même dans le prologue des Bacchantes, lorsqu’il révèle
son intention de (( fonder mon mystère, afin d’apparaître un dieu aux hommes *’ ».
(( Ici, à Thèbes, j’ai institué mon chœur n : le fondateur est le modèle pour le poète
qui se demandera : (( Pourquoi des poètes 2 2 ? »,en répondant à Sophocle qui dit, dans
D (dans la traduction de Holderlin) ou plus exacCEdipe roi : (( Pourquoi chanter
tement : (( Pourquoi danser dans un chœur? n Parce qu’il faut voyager à travers (( la
nuit sainte )) : à travers l’avent, à travers Noël, en se situant à cette limite qui s’inscrit
au milieu du temps qui doit se retourner pour porter fruit.
Ce voyage dans l’espace du souvenir qui se retourne en avenir, c’est une structureclé des poèmes de Holderlin. On la découvre entre autres dans (( Pain et Vin », dans
a Patmos »,comme dans (( Souvenir ». Ce dernier hymne de Holderlin combine une
grande partie des éléments interprétés ici comme étant essentiels à l’image du Dionysos
de Holderlin. La description d’un grand voyage en mer rappelle le voyage de Dionysos
aux Indes. Mais cette fois, les Indes se transforment en Amérique. Le tournant de
l’Orient vers l’occident résume le changement d’orientation exigé par la nouvelle
constellation hespérique. Ce changement est, comme dans la tragédie de Sophocle,
lié au tournant qui s’inscrit dans la thématique du deuil : en s’identifiant, au cœur
du poème, un instant avec Diotima, la défunte, et en s’imaginant appartenir déjà,
comme elle-même, aux ombres souterraines, le poète se ressaisit pourtant en tirant
de ce souvenir la force qui émane (( des journées de l’amour / Et des grands faits
accomplis 24 ». Le dialogue authentique avec Diotima et les Grecs se distingue des
pensées éphémères qui ne dégagent pas le sens profond du deuil, concrétisé en fidélité
à l’essence indestructible de l’amour. C’est cette dernière qui appelle le poète à charger
325
le vent du nord-est de messages pour les marins. Ce vent apporte a l’esprit de feu ))
qui est celui de Dionysos. Il conduit la pensée qui active les souvenirs vers (( un
figuier qui croît au milieu d’une cour 2 5 ». Ce figuier rappelle celui que, dans la
traduction erronée de Holderlin, le Dionysos des Bacchantes d’Euripide situe au lieu
du tombeau de sa mère 2h, arbre donc qui évoque la mémoire d’une rencontre entre
le feu d u ciel et la terre et qui, dans l’univers holderlinien, est éminemment chargé
de la dimension du souvenir. Car l’hymne (( Mnémosyne N a pour point de départ le
vers : Sous le figuier, mon Achille est mort 27. ))
Dans l’Évangile, nous rencontrons les deux figuiers : celui dont les branches sont
pleines de sève et dont les feuilles annoncent l’avènement de l’été 28 et celui qui ne
porte pas de fruits et que Jésus condamne au dépérissement 29. Le premier appartient
au monde dionysiaque, tel que Holderlin le conçoit. Le second indique une menace
de stérilité qui pèse sur l’hymne (( Mnémosyne n, si le souvenir, qui se nourrit d u
deuil, ne réussit pas à obtenir de nous que le regard tourné en arrière, celui qui nous
a presque privés du langage authentique, parce que nous dépendons si fortement du
passé glorieux, mais entravant, de l’Antiquité, change d’orientation et accueille l’événement d’une nouvelle prise en charge de la temporalité authentique : (( Le temps est
long, mais voici paraître le vrai ?‘I. N Cette épiphanie serait le fruit d’un deuil qui ne
se fige pas en (( absence de douleur », mais qui travaille en profondeur, là où (( les
mortels 1) atteignent l’abîme avant les dieux, parce qu’ils sont seuls à faire l’expérience
de la privation du sens qui précède celle de l’avènement d’un tournant.
Même dans ce texte hermétique - et dont la forme définitive est controversée 12
- les références discrètes à Dionysos indiquent le chemin d’une productivité qui se
nourrit d u deuil, centré autour des héros antiques, afin de surmonter la fatalité
périlleuse de la mort de Mnémosyne, mère des Muses, pour l’ère hespérique.
Dionysos est toujours présent là où le destin du poète et du poème est en jeu,
qui dépend d’un tournant dans les rapports entre le divin - le donneur de sens - et
les hommes. L’événement de la naissance périlleuse de Dionysos, les réponses qu’il a
lui-même données à son propre destin élémentaire, l’énergie rétrospective et prospective
contenues dans le mouvement qui le conduit selon Holderlin de l’Antiquité à
l’Hespérie, sa prise en charge de la mort sacrificielle qui ouvre la voie à une nouvelle
communauté que la fraternité rendra cohérente - ce sont là des thèmes qui ne sont
pas simplement évoqués, mais véritablement transformés par Holderlin en un drame
structurant la succession des vers qui en sont le théâtre. Avec Dionysos, Holderlin
repense les conditions de la préparation de l’épiphanie d’une vérité toujours médiatisée
par une forme de poésie qui, tout en donnant la réplique à Sophocle et à Pindare,
agit en pleine conscience d’une ouverture non encore traduisible en paroles fixées.
Dionysos reste ainsi l’avent de la parole à trouver, de celle qui sera, un jour, révélée
aux jeunes et aux vieux, lorsque la joie aura rencontré les vrais résonances, celles qui
pourront en témoigner dans l’authenticité 3 3 .
Bernard Boschenstein
NOTES
1. (( Rousseau »,vers 29 54: Grosse Stuttgarter Ausgabe (=StA), II, p. 13.
Les citations données en français, si elles ont souvent été traduites par moi-même, doivent pourtant
beaucoup à l’édition de la Pléiade ainsi qu’à la traduction d’Antigone par Philippe Lacoue-Labarthe
(Paris, 1978).
2. Der Rhein », v. 149. SrA, II, p. 146.
3. Cf. à ce propos mon article (( La transfiguration de Rousseau dans la poésie allemande à l’orée d u
x ~ x ~ s i è c:l eHolderlin - Jean Paul - Kleist », in Annales de la société Jean-Jarques Rousseau 36, 1966,
((
326
p. 153- 17 1, qui accentue davantage une thématique déjà traitée dans mon étude préliminaire HoiderIinr
Rheinhymne, Zurich et Fribourg-en-Brisgau, 1959; 2' éd. 1968.
4.
5.
6.
7.
8.
((Der Rhein », v. 146. StA, II, p. 146.
Anmerkungen zur Antigonae, StA, V, p. 268, 28.
Antigonae, v. 471 sq. StA, V, p. 223.
Cf. l'ode Dichterberuf »,StA, II, p. 46-48, en particulier les v. 34-36.
Sophokles », StA, I , p. 305.
9. StA, II, p. 91, v. 47sq.
IO. Antigonae, v. 1169. StA, V, p. 253.
I I . Ibid., v. 467, et l'interprétation que Holderlin fournit dans les Anmerkungen zur Antigonae. StA,
V, p. 223 et 226.
12. Anmerkungen zur Antigonae, StA, V, p. 267, 1-10.
1.3. Der Einzige v (variante), StA, II, p. 75 1, 20.
14. Anmerkungen zur Antigonae, StA, V, p. 271, 5 .
15. Lettre à Johann Gottfried Ebel du 10 janvier 1797. StA, VI, p. 229, 45 rq.
16. Cf. l'hymne (( Friedensfeier v , StA, III, p. 533-538.
17. Wie wenn am Feiertage ... », StA, II, p. 118-120. L'importance de Dionysos pour cet hymne
est mise en relief dans mon article à caractère introductif, N Geschehen und Gedachtnis », in Le Pauvre
Holterling 7, 1984, p. 7-16.
18. Antigonae, v. 1162 rq. StA, V, p. 253.
19. (( Brot und Wein », v. 54. StA, II, p. 91. Cf. l'étude de Manfred Frank, Der kommende Gott.
Vorlesungen über die Neue Mythologie, Francfort, 1982.
20. (( Andenken », v. 59. StA, II, p. 189.
2 1. Die Barchantinnen der Euripides, v. 2 1 rq. StA, V, p. 4 1.
22. Brot und Wein », v. 122. StA, II, p. 94.
23. ,<War sol1 irh singen? >, @dipus der Tyrann, v. 914. StA, V, p. 163.
24. (( Andenken », v. 35 et 36. StA, II, p. 189. Je renvoie, pour ce poème aussi, a l'article cité a la
note 17.
25. Ibid., v. 16. StA, II, p. 188.
26. Cf. à ce propos mon article Die Bakchen des Euripides in der Umgestahung Holderlins und
Kleists », in Arpekte der Goethezeit, Gottingen, 1977, p. 240-254.
27. Mnemosyne »,v. 36 rq. StA, II, p. 194.
28. Mt. 24,32; Mr 13,28; Lr21,29.
; 13,6-9.
29. Mt. 21,19-21; MC 1 1 , 1 3 ~ q .LC
30. Mnemosyne 1' et 2'versions, v. 16-18. StA, II, p. I93 et 195.
3 1, Ibid., 2'-version, v. 2. StA, II, p. 195.
3 2 . Friedrich Beissner a proposé une 3' version, en combinant une nouvelle première strophe avec les
deux autres, ce qui n'a pas entraîné un consensus de tous les interprètes. Cette question reste pour moi,
également, entièrement ouverte.
33. L'aspect contraire d'un Dionysos garantissant l'ordre, l'habitation sûre, l'attachement ferme a la
terre, la résistance à la tentation de la mort, tel qu'il se dégage de l'hymne Der Einzige », mériterait
une recherche autonome. II ne peut être question ici de l'intégrer aux éléments centraux dont notre
étude a traité.
((
((
((
((
((
((
((
)),
((
Souvenir d’CEdipe
Renate Boschenstein
Pour Peter Horst Neumann
(( N e m’oblige pas à combler ce désir funeste ... )) : telles sont les paroles d u dieu
soleil à Phaéton, lorsque celui-ci exprime le désir de conduire son char de feu ’.
Holderlin n’a jamais oublié le récit d’Ovide relatant la rencontre, placée sous le signe
de la mort, entre le fils mortel et le père divin, récit qu’il traduisit en 1795 sous
l’impulsion de Schiller. Bien plus tard, il emploie encore c Katastrophe Phaethon #,
formule qu’il a choisie pour un texte projeté qui aurait eu pour titre (( Gesang der
Musen am Mittag )) (StA, II, p. 317). O n comprend aisément que, cette figure ait,été
à nouveau présente à son esprit, au moment où sa lecture approfondie de l’edipe de
Sophocle avait pris un caractère identificatoire : comme CEdipe, Phaéton est tourmenté
quant à son origine; comme lui, ses doutes le poussent vers Apollon; comme lui, ce
chemin le conduit à sa perte. Ainsi le grand poème que Holderlin consacre à CEdipe,
(( In lieblicher Blaue », n’a pas été altéré en devenant le testament poétique fictif du
héros d’un roman, Phaethon, décrivant la catastrophe subie par un artiste: Une situation
de texte qui n’a pas son pareil : un poème inséré, d’un éclat et d’une profondeur
incomparables, qui se donne à lire comme faisant partie d’un roman dans lequel un
très jeune poète enthousiaste s’efforce d’imiter une tout autre ceuvre du même auteur,
l’Hypérion. Cette situation est devenue un (( schibboleth )) de l’approche de Holderlin
et de la poésie en général. Tandis que des chercheurs marquants venus d’autres
horizons (Heidegger, Schadewaldt, André Green n’ont pas hésité à considérer (( In
lieblicher Blaue )) comme un texte capital de Holderlin, servant de point de départ
ou de référence pour leur réflexion, et tandis qu’André du Bouchet lui a consacré
non seulement une traduction admirable mais aussi une évocation presque magique 3,
’>
328
l’incertitude quant à l’origine réelle d u texte, en revanche, a maintenu un tabou sur
ce poème chez la critique philologique proprement dite.
I1 est certes indubitable que Waiblinger [...I restitue à travers les notes d u héros
celles de Holderlin malade. I1 est pourtant difficile de savoir s’il recopie à la lettre
l’muvre de Holderlin, s’il n’apporte pas par endroits quelques enjolivures, s’il ne
mélange pas certains poèmes entre eux. En outre, on ne peut pas établir avec
certitude s’il s’agit à l’origine d’un seul poème composé d e trois parties - ceci
malgré l’unité apparente suggérée par les motifs d u Maass a [...] et d e la Grèce [...].
Ce lien pourrait justement être l’ajout de Waiblinger dans un souci d’équilibre et
de perfectionnement [...] I1 ne peut donc pas être question d e gesezlicher Kalkul a
(II, 2, p. 991 sy.).
((
((
En conséquence de ce verdict de Beissner, le texte manque dans certaines éditions;
ce même verdict a aussi empêché, dans une large mesure, l’apparition de commentaires
et d’interprétations de ce poème. Pour autant qu’on puisse en juger, on trouvera
parmi les exégèses consacrées à Holderlin à peine une qui se voue à ce texte, à
l’exception de celle de W. Kudszus qui place le poème dans un rapport de réciprocité
avec le fragment hymnique (( Griechenland N ’. L’interprétation la plus pénétrante de
l’ensemble du texte est d’inspiration théologique. Dans son livre L’ldole e t la Distance
(1977), J.-L. Marion examine les manifestations d u dieu absent chez Nietzsche,
Holderlin et Denys l’Aréopagite. La forme d’approche de cette étude approfondie
(laquelle est un interlocuteur ici d’autant plus important que la perspective théologique
est déterminante pour ma propre compréhension de Holderlin) s’inscrit dans ce
courant contemporain de la philosophie française qui se réclame de Heidegger et de
Lévinas. Il est inutile de souligner combien l’accent mis sur un éloignement de Dieu,
signifiant un ménagement de l’homme, rencontre la conception que Holderlin se fait
d u rapport entre le divin et l’humain. Or cet éloignement est appréhendé par Marion
à partir d’une conception donnée d u divin qui laisserait derrière elle toutes les
(( idoles », c’est-à-dire toutes représentations restreintes de Dieu. En regard de la nature
supratemporelle de celui-ci, l’expérience de l’inaccessibilité de Dieu, objet de foi, se
confond avec la souffrance du sentiment d’un manque qui a pris sa place pour la
subjectivitt moderne en proie au doute. I1 y a ici, à mon avis, une distinction
catégorielle que l’on peut repérer dans les textes qui nous occupent. C’est pourquoi
je partirai de la problématique d’un sujet qui interroge, pas seulement pour une
question de méthode, mais aussi parce que Holderlin lui-même ne s’est jamais écarté
de cette problématique malgré toutes les tentations d’une interpénétration d u sujet
et de l’objet en général, et d u sujet et d u divin en particulier et que, même à la fin
de sa vie, il s’en est réclamé avec force et lucidité. I1 faut bien souligner ce lieu
spécifique d u texte qui concerne à la fois les alentours des derniers fragments hymniques
d’une part et les poèmes désignés comme (( tardifs N d’autre part, c’est-à-dire des vers
d’une construction formelle généralement simple, datant de l’époque de la maladie
présumée, ainsi que l’effort constant soutenu jusqu’à la fin pour distinguer entre elles
les représentations diverses de Dieu, malgré une quête constante de la divinité dans
son unité. A la différence de cette exégèse synthétisante, qui en même temps accepte
mais neutralise la polysémie du langage poétique en tant qu’expression de l’éloignement indicible du Père, l’interprétation qui suit se fixe le but beaucoup plus modeste
de comprendre le texte en partant d’un contexte spécifiquement holderlinien. Je
voudrais montrer qu’il répond bien à un t gesezlicher Kalkzil », de telle manière qu’il
ne faudrait plus l’appréhender comme un fragment, mais comme un poème.
Ce faisant il ne faut pas trop rapidement écarter le problème délicat de la
transmission d u texte. L’argument le plus convaincant en faveur de la paternité
authentique de Holderlin reste le fait que le jeune Waiblinger, au regard de ce qu’il
nous a laissé par ailleurs, n’a nulle part prouvé qu’il aurait pu élaborer un poème
329
aussi saisissant, même stimulé par l’impulsion de textes ou de paroles de Holderlin,
même en composant à partir de tels éléments. Ce que Waiblinger a été capable
d’imiter avec plus ou moins de bonheur, c’est la prose lyrique de Hypérion. En
revanche, l’imbrication particulière entre ce qui est tout à fait concret et qui se
présente en apparence comme simple, et la pensée la plus dense et la plus substantielle,
imbrication qui caractérise le Holderlin de la dernière époque, Waiblinger n’a pas
été en mesure de l’imiter. I1 est difficile de croire que celui qui a écrit : (( Lutter avec
Dieu, n’était-ce pas depuis toujours fâcheux (misdich) 5 ? )) puisse être le même que
celui qui écrit : (( Lutter, comme Hercule, avec Dieu, c’est là une douleur. n Et la
disposition originale en vers pindarisants, expressément signalée dans le roman par le
narrateur fictif, témoigne plutôt dans le sens de la loyauté d’un jeune admirateur
envers l’œuvre de Holderlin, car de tels vers se seraient bien accordés avec le style
du roman et il faut supposer que Waiblinger n’a pas voulu modifier de sa propre
initiative la version en prose dans laquelle il avait peut-être transcrit le texte en le
copiant. Cependant, l’interconnexion entre le texte et le roman dans son ensemble
n’en demeure pas moins étrange. La mesure (Maass) et la pureté (Reinheit) sont les
leitmotive de l’histoire du jeune sculpteur Phaéton qui court à son malheur, par la
démesure de sa quête du sens et suite à la perte de sa pureté sexuelle, d’une manière
très trouble, qui invite à la lecture psychanalytique. Presque tous les éléments du
texte (( In lieblicher Blaue N apparaissent aussi dans le roman, parfois en revêtant une
fonction structurante : la vierge, les trois colonnes, la Beur, les myrtes et les roses, la
Grèce, la Voie lactée, la révolution gigantesque des mondes, les comètes, l’œil de
Dieu et, bien évidemment, le soleil.
La vertu la plus sublime d e cette beauté est la pureté. Sa forme est comme celle
d’une flamme d e lumière blanche incandescente. Aussi est-elle mesurée tout en
étant plénitude
‘.
L’éditeur de l’édition critique de Waiblinger suppose que ce jeune auteur (( a sélectionné
quelques parties à partir de feuillets autographes de Holderlin selon des critères
esthétiques et thématiques, se rapportant à la problématique du P H )). I1 me semble
plutôt que Waiblinger, sous le coup des impressions que sa rencontre avec Holderlin
lui avait laissées et saisi d’une contrainte psychique qui le poussait à composer un
roman sur un personnage frappé de folie, entreprit le plan de son œuvre à partir des
papiers reçus de Holderlin le 3 juillet 1822, c’est-à-dire de ceux que nous connaissons
et peut-être d’autres qui nous sont inconnus. Waiblinger vécut sans doute un certain
temps dans une très grande intimité spirituelle, proche d’un véritable échange osmotique, avec ce poète qui l’a si profondément bouleversé. Dans l’hypothèse où cette
osmose eût suffi pour réunir les éléments du texte conformément à l’esprit holderiinien,
il faudrait alors admettre que l’esprit de Holderlin serait resté authentiquement luimême à travers ce médium avec lequel il était uni sous le signe de Phaéton et de la
lutte avec le dieu Apollon.
’
Le texte
Le reflet et l’image
Le dieu apparaît en premier lieu comme celui qui préside à ces tableaux du
pays natal, tels ceux que nous connaissons par les poèmes (( Mnemosyne )), (( Griechenland », (( Und mitzufühlen das Leben N. (Je réduirai les renvois à des poèmes
voisins au strict nécessaire pour la compréhension et ne m’en servirai pas comme
330
preuves pour établir l’authenticité d u texte ni pour construire un réseau se référant à
la totalité de l’œuvre.) A l’intérieur de la sphère de la patrie (Heimat) tout est
correspondances; le clocher resplendit de sa couleur bleue pour être en harmonie avec
le bleu du ciel, de la même manière que dans (( Griechenland )) la terre s’habille de
violettes bleues en signe d’amour du ciel. Le métal du toit confère à ce paysage
idyllique une tonalité héroïque toute caractéristique de Holderlin, de même que les
hirondelles, oiseaux migrateurs, ouvrent l’horizon sur le lointain. A la douceur de ce
bleu si adorable (lieblicb) et si touchant (rubrend) s’oppose par contraste le cri des
oiseaux. Mais si ce bleu (( touche »,il faut le noter, la présence d’un sujet de perception
est déjà impliquée. En outre, la couleur du toit métallique apparaît comme miroir
réfléchissant, comme manifestation de ce dieu dont la présence ne sera désignée dans
tout le poème par aucun autre nom que le plus simple. (( Le soleil au-dessus va très
haut ... )) : il est donc midi, l’heure des Muses, l’heure de la méditation dans la patrie,
l’heure où Empédocle se prépare à mourir. C’est dans le décor de la vie bourgeoise
la plus simple que se rencontrent ici deux divinités. La girouette crie (krzbt) au
sommet du clocher, car elle représente ici le coq, annonciateur du Christ. Elle crie
dans le souffle spiritualisé du vent, silencieusement (stille), ce qui n’est un paradoxe
qu’en apparence : ce silence, célébré jadis par le jeune Holderlin comme un ami, est
cet état de profonde concentration intérieure qui n’a jamais renié son origine piétiste,
état dans lequel l’intensité des représentations sensuelles est toujours déjà intériorisée.
Le silence de la girouette se reflète dans la (( vie calme )) (stilles Leben) de celui qui
descend ces marches au-dessous de la cloche D. Celui-ci n’est pas ici (encore) le sujet
de la perception du texte; il n’en est encore que l’objet. I1 introduit le motif central
de la figure (Gestalt) et par là même la dimension platonicienne du texte. Par la
figure - physique - qui apparaît sur l’escalier ouvert de la tour, décrit ici comme
une sorte de campanile, le personnage indéfini (einer) devient représentatif pour
l’ensemble du genre humain. Mais cette manière de comprendre la phrase, qui paraît
aller de soi, se heurte assurément à une difficulté. U Bildsamkeit U (figure), concept
favori de l’humanisme à l’époque de Goethe, n’est attesté ni chez Holderlin ni chez
les auteurs contemporains dans le sens de (( structure du corps )) (tandis que Bildnng U
s’emploie couramment dans le double sens de développement intellectuel et physique
Mais on peut attribuer sans problème à Holderlin (à cette époque où il avait
coutume, en particulier dans son œuvre de traducteur, de faire éclater l’opacité des
mots) la re-concrétisation individuelle de ce mot : U Bildsamkeit U , c’est-à-dire K Bildbaftigkeit Y . Le passage de la figure (Gestalt) à l’image (Bild) sera justifié par les
réflexions qui suivent. Tout d’abord, la dualité entre l’extérieur et l’intérieur, qui
n’était jusqu’alors qu’implicite, se déploie comme une relation de la beauté et de la
pureté, dont la polarisation n’est suggérée que d’une façon expérimentale avant d’être
aussitôt dépassée et résorbée dans un mouvement d’harmonisation.
Dans l’une des digressions que Holderlin a apprises auprès des poètes de
l’Antiquité, les fenêtres sont comparées, à cause de leur forme arquée, à des arcades
d’arbres. La formulation selon laquelle elles seraient encore (( à l’image de la nature ))
(der Natur nacb, KUTÙ cpUoiv) ramène cette analogie à une généralité. La beauté
physique trouve son analogie dans la pureté : (( Du départ, au-dedans, naît un esprit
sévère. )) (Innen aus Verscbiedenem entstebet ein ernster Geist.) Ce dedans peut signifier
soit l’intérieur de l’église, soit celui de l’homme. Pureté, esprit sévère, simplicité,
sainteté sont des valeurs intériorisées équivalentes à la beauté apparente. L’esprit sévère
(( naît )) U ans Verscbiedenem U ; malgré l’insistance marquée chez Holderlin sur la
diversité dans la vie et dans l’esprit, précisément dans les poèmes tardifs, il semble
plus justifié ici de comprendre U a u Verscbiedenem U comme ans Totem, Vergangenem U
(versrheiden = décéder), ce que semble également suggérer la tournure du (( départ ))
chez du Bouchet. Le passé apparaît en images, lesquelles englobent toutefois également
les images présentes évoquées au début du texte, qui, mythiques, conservent ce passé.
((
”>.
((
33 1
Ce concept de l’image est essentiel, parce qu’il relie entre eux les choses et le sujet
qui perçoit et se souvient. Lequel, dans cette même phrase, s’affirme aussi comme
sujet du texte : U man ». Le sujet sait qu’il est tributaire d u contact avec les images
et qu’il n’est pas dans un rapport immédiat avec l’univers; il se soumet avec humilité
à ces images, parce qu’elles ne sont pas son propre produit, mais lui parviennent
comme parole d’une instance divine. Celle-ci se manifeste à présent à son tour dans
le texte, à l’intérieur d’un faisceau de désignations dont la variété est mûrement
réfléchie : (( Les Célestes, le Divin, Dieu. )) (( Mais les Célestes, qui sont toujours
bons ... 1) comprennent parmi eux les dieux de l’Antiquité, assurant ainsi la continuité
de l’apparition du dieu du soleil, à propos desquels le problème de la théodicée se
pose de façon plus brûlante que pour le dieu chrétien. L’assurance de leur bonté
présuppose non seulement les doutes jamais apaisés de Holderlin, mais aussi toute
l’inquiétude de l’époque pour laquelle les doutes de l’Iphigénie d’Euripide, réactualisés
au travers de l’Iphigénie de Goethe, sont représentatifs. C’est dans l’espoir désespéré
qu’ils soient toujours bons que débouche une série continue d’affirmations analogues : (( Car tout est bien », reconnaît le Christ mourant (II, p. 167); (( Ce n’est
rien, le mal )) - formulation qui apparaît dans l’hymne à la Madone (II, p. 213). Les
dieux sont aussi nommés ici les Célestes, car le ciel - dans une image (( simple et
sainte )) - révèle sa richesse à travers des floraisons argentées ou à travers une couleur
d’airain et de marbre (II, p. 209) : ce qui justifie la comparaison des Célestes avec
des (( riches N qui possèdent tout à la fois : (( vertu et joie )) (Tugend und Freude). En
fonction du calcul )) qui lui est propre, le texte intègre à nouveau ici cette opposition
qu’il avait exclue auparavant entre 1’« Esprit sévère N et la (( beauté apparente ». I1
annonce du même coup l’harmonisation finale de la deuxième partie :
L’allégresse de telle vertu mérite elle aussi d’être louée par l’Esprit sévère, qui,
entre les trois colonnes, souffle, du jardin.
A la différence de du Bouchet, je ne comprends pas ici t Tugend Y au sens de retenue :
c Tugend », de tout temps un terme clé chez Holderlin, l’obséda particulièrement
dans les dernières années comme un motif majeur des chants pindariques qu’il avait
traduits. L’hpsni de Pindare connote la performance, la capacité, le mérite, et pas
seulement avec le sens tout proche de ((mérite des athlètes )) (Athletentagend) des
chants de victoires. Mais lorsqu’on attribue explicitement les vertus de U Tugend Y et
de U Freude > aux Célestes, une des figures principales d u poème se profile déjà en
arrière-plan : Héraclès. Dans le récit célèbre de Xénophon, le demi-dieu n’avait pu
choisir que l’un des deux principes de vie qui s’offraient à lui, à savoir la vertu 9.
Lorsque l’autre principe, dont le nom oscille entre les significations de béatitude et
de jouissance, se trouve désigné par le terme de Freude Y, il gagne une nouvelle
signification qui rend possible sa conjonction avec la vertu : la (( joie )) pleine de force
de Holderlin, principe dionysiaque, n’est pas en contradiction avec une &p& qui se
manifeste dans l’action et dans l’art.
Le retrait du rôle de la révélation messianique dans l’énonciation poétique au
profit de la conscience de son subjectivisme et de la spécificité de sa perspective, si
caractéristique de l’époque tardive chez Holderlin, entraîne à cet endroit un raisonnement au cours duquel le sujet se regarde lui-même explicitement en train de
questionner et de réjîécbir; a Je le croirais plutôt. N I1 faut examiner en détail
l’affirmation selon laquelle l’homme serait capable d’imiter cette unité entre vertu et
joie accordée aux Célestes. A l’encontre de cette idée, il y a le poids de la N fatigue ))
(Miihe, Herculeus labor) qui se trouve cependant contrebalancé par la (( bienveillance ))
(Freundiichkeit) qui forme un tout avec la pureté. Que faut-il entendre par cette
(( bienveillance )) qui apparaît aux côtés de l’instance du cœur qui unit en elle nature
et intériorité? En vertu du rapport de Holderlin à la langue, il faut relever ici
l’importance de la racine de ce mot cher au poète, t Freund », au même degré que
((
332
sa parenté phonétique avec U Freude ( U ...und es sahn ihn [...I den Freudigsten die
Freunde noch zuletzt N II, p. 167). La bienveillance dci cœur réside dans sa disponibilité
en éveil qui sauvegarde le contact avec les Célestes, lesquels (( reposent n volontiers
en lui (II, p. loo), de même qu’avec la nature et avec les compagnons. Le danger
résiderait en un endurcissement obstiné et en la trahison de la relation d’amitié avec
les dieux, à l’exemple de celle de Tantale. Ainsi légitimé, l’acte de se mesurer (sich
messen) au divin signifie en premier lieu, non pas compétition, mais orientation et
direction à suivre. L’aide, que livrent à cet égard les signes du Ciel, trouve une
expression plus claire dans un fragment apparenté : (( Qu’est-ce que Dieu [...I / Plein
d’attributs est le visage / Du ciel, de lui ... )) (II, p. 210). Cette sémantique céleste
est la première version du U Es U de la deuxième partie ( K des Menschen Mass ist’s U )
qui désigne la mesure de l’homme. Ce qui s’exprime avec particulièrement d’intensité
dans ce texte, c’est l’effort de pensée spécifiquement holderlinien qui cherche à suggérer
le signifié en transcendant tout langage verbal au moyen d’une succession de concepts
et d’images qui ne sont valables que de manière approximative. La phrase : (( Riche
en mérites, mais poétiquement toujours, sur terre habite l’homme )) reprend la tension
entre vertu et joie, dans une nouvelle opposition harmonisatrice. Ce qui se trouve
thématisé ici, c’est la tension si virulente depuis l’Antiquité entre otium et negotium,
qui est réactualisée tout d’abord à l’époque de la Réforme avec la valorisation
théologique du travail considéré comme devoir sacré et ensuite au X V I I I ~siècle avec
la naissance de l’idéologie de la performance. Ce n’est pas sans raison que, souvent
dans la littérature allemande, la (( Muse )) et la K Muse U (oisiveté) ont aussi été
rapprochées sur un plan sémantique. Déjà le jeune Holderlin avait dénommé (( oisiveté )) l’état poétique dans lequel lui apparaissaient des visions de l’univers et de
l’histoire, alors que lui-même était transformé en orme ou en aigle. Cet état qui
trouve son point culminant dans l’acte de lire, il l’appelle (( habiter la vie du monde N
(I, p. 236 sq.). Dans les évocations tardives de cet état, la lecture s’oriente vers les
signes du monde physique. II est important que ce soit cet acte de (( lecture )) - et
non pas l’acte de parole propre au sujet - qui soit la marque manifeste même du
(( poétique )) (des U Dichterischen U ) et devienne ainsi un bien propre à tous les hommes.
Envisagé à partir de la problématique de la théodicée, il y a quelque chose de
poignant dans la manière dont le (( je », amoureusement soumis à la divinité, renverse
la situation de telle sotte qu’il doive se justifier de ne pas pouvoir vivre (( sans efforts n
(mühelos), en harmonie, à l’égal des dieux. Cet humble sujet, plein de retenue lotsqu’il
s’exprime, trouve malgré tout un soutien dans la certitude d’être à l’égal de cette
image de Dieu à laquelle aboutit le raisonnement dans le poème. C’est la nuit,
étrangère sainte - présente seulement, elle aussi, par le reflet, par l’ombre - qui
confère à l’homme sa mesure sublime. Pourtant cette dignité de l’homme ne semble
pas aller de soi, (( ...qu’on appelle une image de Dieu N (der heisset ein Bild der
Gottheit) ; cette tournure implique une condition : (( S’il est légitime de l’appeler une
image de la Divinité. )) I1 faut tenir compte du caractère médiatisé de l’existence
humaine et, sous l’aspect de la cohérence du texte, de la correspondance avec le début
du poème : la figure (Bildsamkeit) qui apparaissait au début dans la plasticité, se
découvre à présent comme image (Ebenbildlichkeit). De même que le toit est le reflet
du Ciel, au nom du soleil dispensateur de couleurs, de même l’homme est à l’image
de Dieu, au nom de I’Ecriture qui l’a ainsi nommé.
La figure et l’idée
Ce serait une erreur de chercher à retrouver ici le schéma naïf-héroïque-idéal,
comme la structure tripartite du texte pourrait nous y inviter. L’enjeu de la seconde
partie du poème paraît être bien plutôt de renforcer et d’éclairer avec plus de précision
le système de correspondances développé dans la première partie. Par là même, le
333
sujet qui lutte pour la connaissance fait dériver de plus en plus de soi un cfictas
interlocator Y vis-à-vis duquel il justifie ses vues. Un questionnement insistant apparaît
ainsi, qui rapproche la manière d u texte de celle de son héros, le roi (Edipe. Le
jugement selon lequel l’homme peut et doit se mesurer à la divinité est confirmé par
la conscience du fait qu’il manque (( une mesure sur la terre )), car rien n’est stable à
l’intérieur du monde physique. La formulation, emphatique à la manière de Klopstock,
et ressentie ici comme un corps étranger : ((Jamais monde d u Créateur n’a suspendu
le cours du tonnerre N s’explique chez le Holderlin tardif comme la reprise fréquente
d’éléments anciens ayant appartenu aux poèmes de jeunesse lesquels avaient déjà
voulu réduire au silence le (( tonnerre du cours des Pléiades )) (I, p. 119). La loi du
mouvement perpétuel de la nature condamne également la beauté de la fleur à
l’éphémère. (. Weil Y a encore le sens ancien de (( solange », sens courant dans l’usage
poétique vers 1800 lo.) A travers le (( soleil )) et (( l’œil », la divinité et le sujet sont
contigus et, par cette métonymie, ce dernier se caractérise de manière plus nette encore
comme sujet de la perception. Mais en même temps, celui-ci exprime par une nouvelle
digression la violence déchirante de son sentiment, de manière incomparablement
simple :
Souvent, l’œil trouve en cette vie des créatures qu’il faudrait appeler encore
beaucoup plus belles que les fleurs. Oh! comme je le sais! Car à saigner de sa
figure (Gestalt), et au cœur même, de n’être plus entier, Dieu a-t-il plaisir?
C’est sans aucun doute à Diotima qu’il est fait ici allusion, ainsi qu’à sa disparition.
Le moi ne peut exprimer cette douleur extrême que sous la forme d’une question
qui, ici, n’est pas rhétorique, mais remet en cause l’affirmation courageuse qui postulait
la bonté des Célestes. Dans sa souffrance brûlante, le moi se confond avec cet autre
paradigme important, celui d’une douleur extrême qui est celle d u Christ. Mais il se
confond aussi avec (Edipe, qui, après s’être crevé les yeux, saignant (( de sa figure, et
au cœur même )), n’est plus tout à fait entier. A la suite de la figure (Gestalt), de
l’esprit et du cœur surgit avec l’âme une autre instance de l’homme qui s’affirme
comme instrument de la communication avec le divin. C’est parce que (( divinement
dolente en l’âme forte )) la Madone a supporté la douleur de la perte du fils qu’elle
a mérité d’être adorée - tandis que (( Mnemosyne N rappelle le triste destin d’Ajax à
qui une force semblable a manqué. Pour que cet instrument reste pur, il ne doit
entrer en contact ni avec la douleur, ni avec le divin - comme ce fut le cas avec
CEdipe. (( L’immédiat, pris en toute rigueur, est pour les mortels impossible, comme
pour les immortels ... N (v. 285). Cette conception, toujours présente chez Holderlin,
s’exprime ici à travers l’image de l’aigle qui menace d’accéder à la (( toute-puissance ))
(dar Machtige). I1 s’agit en effet d’une menace, car si l’aigle, prince des oiseaux, est
depuis l’Antiquité attribué à Zeus, il lui est autant interdit d’atteindre le Père puissant
- l’Éther, auquel est substituée ici, à la manière des Hespériens, la qualité catactéristique -, qu’au poète, dont il est la figure et qui transforme le cri d’oiseau en chant
poétique. Le Es Y dans la phrase suivante ne se rapporte pas à la toute-puissance
mais, en vertu d u (( calcul )) générateur du poème, il se réfère à nouveau à la mesure.
Ici apparaît le noyau platonicien du texte : on ne peut trouver la mesure que dans
l’immobilité supratemporelle de l’Idée. C’est l’essence, c’est la figure. )) c Es ist die
Wesenheit, die Gestalt ist’s. Le concept de (( figure )) s’est déplacé de la structure
physique à la traduction schillérienne de l’d60ç. Par cet enracinement du concept de
(( mesure )) dans le monde des idées, la question générale de la mesure obtient une
première solution. I1 est nécessaire d’ancrer la (( mesure )) dans le concept platonicien
de l’idée, puisque la sémantique du Ciel, mesure première, est également soumise
au changement en tant que phénomène naturel, et pourrait par conséquent prêter à
une interprétation erronée.
<(
334
La troisième partie évoquera, par des exemples empruntés à la mythologie, les
conséquences néfastes d’un manque de mesure. Une partie intermédiaire précède cette
troisième partie et décrit le combat d’un sujet qui, face aux déchirements de la
souffrance, cherche à sauvegarder la pureté. Il réfléchit sur un ruisseau qui, malgré
sa connotation idyllique, annonce déjà les ruisseaux déchaînés de la troisième partie.
La juxtaposition du petit ruisseau et de la Voie lactée a beau témoigner de la naitreté
nouvelle du style tardif, elle n’en était pas moins déjà présente dans les poèmes de
jeunesse : (( Ruisseaux, soleils entrent dans leur voie )) (I, p. 131). Le ruisselet, signe
de la nature, est dans un rapport d’analogie avec l’œil de la divinité. Par là même,
l’ambivalence de c srbeinen (à la fois f u e r e v, et uideri # > déplace l’action extérieure
du regard à l’intérieur d u processus de la réflexion. La Voie lactée, de son côté, fait
partie de ces signes qui annoncent l’arrivée du cortège des héros dans le poème : son
origine remonte à cet épisode au cours duquel Héra, ayant découvert l’enfant Héraclès
qu’elle détestait contre son sein, s’en débarrassa avec violence tandis que le reste de
son lait jaillissait vers les étoiles ”. Le moi en proie à la souffrance reconnaît dans la
clarté d u ruisseau et de l’œil divin un avertissement, mais il ne peut pas réprimer sa
douleur : a ...des larmes, pourtant, sourdent de l’œil. D Ainsi Ménon se plaignait,
tandis que son âme se figeait : (( A peine, si je pleure encore de froides larmes N (II,
p. 77). Ainsi le moi se trouve séparé (( des figures (Gestalten) même de la création N
et s’aperçoit d u paradoxe de leur (( vie allègre »,ce qu’il exprime par la comparaison
étrange avec (( ces colombes seules parmi les tombes ». (Le t Weil semble revêtir ici
une signification adversative : Wahrend icb docb. #) Le thème (( de ce qui est décédé D
resurgit manifestement. Les colombes vivent sur un terrain chargé de passé. Elles sont
seules, parce que leur existence est coupée de cette origine, de la même façon que
les hommes sont seuls par la coupure avec le monde harmonieusement unifié de
l’Antiquité, et de la même façon encore que Diotima fut seule en tant qu’Athénienne
exilée dans le monde froid de la modernité. Mais celui qui a conscience de cette
solitude, celui-là est voué au sarcasme. Si la réaction spécifique du moi face à ce
sarcasme ne s’exprime que sous la forme d’une supposition - (( Le rire, pcartant,
semble m’affliger, des hommes, car j’ai un cœur ... n -, alors l’importance de l’activité
maîtrisée de la réflexion devient plus sensible, par laquelle ce moi se prend lui-même
pour objet.
Cependant, une inclination identificatoire vient s’opposer à cette perception aiguë
des différences. Le moi est capable, même si ce n’est que sur le mode velléitaire du
fantasme, de s’identifier à la comète, c’est-à-dire à un phénomène naturel, parce qu’il
ne différencie pas ses propriétés (vitesse, feu, pureté) de celles qui sont semblablement
désignées dans le registre humain. La première partie d u poème a suffisamment montré
que l’homme a le droit de se comparer aux étoiles. Mais pourquoi justement à une
comète? Les étoiles principales sont des divinités : seuls les héros et les demi-dieux
sont métamorphosés en coristellations astrales, telle celle des Dioscures. Le désir d’une
transfiguration analogue relèverait pour l’homme de la démesure. S’il est comète
semblable à l’oiseau, le moi reste apparenté à l’aigle, avec lequel il s’était auparavant
identifié en tant que poète, mais à un aigle privé de chant, mis à l’abri de l’hybris,
qui ne parle plus en son propre nom, mais comme signe médiateur de la parole de
Dieu. (I1 serait peut-être audacieux, mais non pas contraire à l’esprit de Holderlin,
de penser ici à la signification étymologique de Haarstern
la locution K O ~ ~
u i p c t v désigne souvent l’activité de (( défaire les boucles n - t die Locken losen », II,
p. 198 - comme geste de sacrifice rendu en hommage aux morts : le moi-comète
serait dans ce cas lui-même le sacrifice funéraire pour Diotirna.) (( La nature de
l’homme n réalise le lien entre la nature organique-objectale de la première partie et
le (( naturel N de la troisième. Par un subtil examen, l’opposition est cependant
maintenue entre les traits spécifiques de l’humain et ceux de la comète.
))
((
((
((
));
335
V
L’allégresse de telle vertu mérite elle aussi d’être louée par l’Esprit sévère, qui,
entre les trois colonnes, souffle, du jardin.
Quant à savoir s’il s’agit d’un jardin particulier, cela reste indéterminé. La vierge
en tant qu’être humain qui observe la mesure, renvoie à ces (( créatures qu’il faudrait
appeler encore beaucoup plus belles que les fleurs ». Le motif des myrtes fait le lien
entre la deuxième et la troisième partie. Le myrte, qui dans la Grèce antique n’était
pas un ornement nuptial, mais un ornement de fête et de victoire, nous emmène
dans le monde des héros grecs. (( J’aimerais orner le glaive avec les sarments du
myrte ... D : ainsi est-il dit dans l’ode d’Alcée traduite par Holderlin, ode qui célèbre
les deux Dioscures Harmodios et Aristogeiton, les meurtriers du tyran qui cachèrent
leur glaive dans le feuillage des myrtes. Mais Diotima rejoint dès lors aussi le cortège
des héros : (( Vers vous, dieux de la mort/Là Diotima .............. héros D (II, p. 3 19).
Réflexion
Les héros, dont Holderlin a si souvent admiré la vigueur et les exploits,
apparaissent sous le signe de la connaissance (Erkenntnis) et de la souffrance. Celui
qui descendait l’escalier dans la première partie du poème (. einer #) et présentait à
un sujet invisible la structure de la représentation imagée de l’homme est à présent
lui-même sujet et devient représentation imagée (Bild) pour lui-même. De façon
incomparablement pénétrante, le texte concrétise le thème central de la philosophie
idéaliste. I1 démontre l’inéluctable, la possibilité et l’effet de la réflexion sur soi.
L’ensemble des éléments de la partie introductive qui conditionne ce qui va suivre
(et dont la phrase principale renonce à l’inversion habituelle) présente une structure
apparemment archaïsante qui a sa raison d’être. Une tension est ainsi créée, dans la
phrase qui thématise le reflet, qui ne permet pas à la phrase principale (« elle (l’image)
ressemble à cet homme D - K es gleirbt dem Manne #) de confirmer l’évidence, mais
fait de celle-ci la réponse positive à une question. Le fait que ce (( quelqu’un )) (ein)
se concrétise explicitement en un homme (Mann) autorise la réalisation du jeu de
reflets dans les deux membres de la phrase. C’est l’autoréflexion qui permet véritablement la connaissance (Erkenntnis) de soi : cette certitude est rendue possible grâce
à l’analogie relevée dans la première partie entre l’homme et cette divinité qui se
manifeste dans les signes du ciel. La faculté à se reconnaître que l’homme découvre
dans son propre reflet, liée à l’organe de la vue, correspond à cette lumière que
l’ordonnateur du poème, le dieu de la lumière, attribue à la lune. Cela signifie que
la faculté à reconnaître doit rester mesurée, au même titre que la lumière lunaire, et
non pas égaler la violence du feu du regard d’Apollon. Par les Remarques sur Edipe,
nous connaissons l’identification effrayante de Holderlin entre lui-même et ce roi
douloureusement engagé dans une quête de la vérité sur soi et sur son origine :
...l’étonnante curiosité d’CEdipe, et sa colère, tandis que, une fois ses limites
rompues, le savoir, comme ivre [...I s’excite d’abord lui-même, à savoir davantage,
qu’il ne peut supporter ou contenir (p. 198).
Ainsi la phrase célèbre : (( Le roi (Edipe a un œil en trop, peut-être )), semble
condamner à l’illégitimité la quête absolue de l’homme poursuivant son identité.
Pourtant, si cette quête apparaît dans les Remarqaes... comme (( la recherche extravagante et fiévreuse d’une conscience », voire comme (( la quête démente d’une
conscience », il ne faut pas comprendre cela comme une condamnation du questionnement pour lui-même. (Edipe n’est pas tant engagé dans la recherche de faits
dissimulés que dans la tentative de s’approprier une conscience, d’accéder à la
connaissance, aussi douloureuse soit-elle, pour sortir de son état de folie, c’est-à-dire
d’incertitude totale. Seule la vérité entière sur sa’ personne peut receler une nouvelle
336
forme d’existence. Le (( peut-être )) de la phrase ménage une ouverture à cette nécessité
paradoxale d’une quête démesurée qui doit être expiée par la souffrance. Cette
expression profondément émouvante selon laquelle ces souffrances sont (( indescriptibles, inexprimables, indicibles )) met en rapport direct le poème d’CEdipe avec le
drame de Sophocle : c’est au (( nuage nocturne )) de sa souffrance qu’CEdipe s’adresse
en le qualifiant d’«indicible, indompté, invaincu )) (V, p. 185, v. 1336 sq.). A nouveau, la formulation (( avoir l’air )) (scbeinen) vient donc relativiser ce qui par ailleurs
saisit avec violence le spectateur de façon irrésistible. I1 en est ainsi dans l’immédiateté
de la présence, lorsque la souffrance survient sur la scène (daberkommt). La souffrance
présente un autre visage en relation avec l’éloignement inhérent au souvenir dans
l’esprit du sujet, qui lui-même se met à présent à analyser sa propre perception du
drame, dans le mouvement d’une réflexion qui s’amplifie, conforme à la nécessité du
jeu spéculaire. Cette analyse progressive commence par une émotion de nature identificatoire : (( Comme des ruisseaux m’emporte la fin de quelque chose, là, et qui se
déploie telle l’Asie. )) CEdipe chez Sophocle s’interroge de même : (( Io, démon / Où
m’emportes-tu? )) et le chœur de répondre : (( Vers une immensité, inouïe, invisible. ))
Cette immensité a pour nom l’Asie. I1 ne s’agit pas ici de la (( mère Asie », origine
de la culture, mais de valeurs (( orientales )) (das Orientaliscbe) que Holderlin voulait
faire resurgir de par-dessous l’hellénisme, en l’occurrence la démesure, à laquelle
CEdipe se trouve confronté de l’intérieur et de l’extérieur comme à son identité
inquiétante et à un destin préparé pour lui par le dieu.
L’acte de se mesurer (sich messen) à la divinité devient dès lors pour l’homme,
à ce stade où il a perdu sa pureté, un combat par lequel se manifeste I’hybris. En se
crevant les yeux, CEdipe se rend compte que cette néantisation sanglante de l’organe
surmené de la connaissance permet à l’action du dieu de coïncider avec la sienne :
C’était Apollon, Apollon, ô mes amis... )) Mais parce que la réflexion sur soi revêt
ici la forme extrême de l’action physique, elle acquiert du même coup une valeur
cognitive toute nouvelle. Le ruisseau touchant se transforme en ruisseaux qui emportent, qui paraissent moins remplis d’eau que de feu, à l’image de ces ruisseaux
d’Héphaïstos, dévalant les pentes de l’Etna qui apparaissent dans la première (( Ode
pythique )) chez Pindare (V, p. 64), et comme ceux que le char solaire de Phaéton a
enflammés lors de sa chute. Le sujet oppose sa réflexion à cet effet dévastateur par
lequel le souvenir même menaçait la pureté de l’âme : (( Naturelle est cette souffrance
dont souffre CEdipe )) (Nattlrlicb dieses Leiden, das bat CEdiptls). En vertu de l’emploi
particulier de la syntaxe pindarisante, cette phrase se donne à lire comme suit : (( Cette
douleur, qui afflige CEdipe, est en conformité avec la nature )), K ~ T &c p h i v . Nature
qu’il faut comprendre ici comme nature sublimée de l’homme.
La conformité entre la souffrance et la nature humaine est illustrée par les phrases
suivantes qui, obéissant à un schéma tout particulier, se meuvent entre les différents
héros en proie à la souffrance : CEdipe - Hercule - les Dioscures - Hercule - CEdipe.
Hercule a souffert : car lui aussi est entré en conflit avec Apollon, lorsqu’il mit à sac
le temple du dieu, dans sa fureur, à cause de l’oracle qui lui était refusé 1 2 . Mais le
thème de la (( lutte avec Dieu )) ne se limite pas dans le cas d’Hercule à ce simple
épisode, il caractérise le destin entier de ce héros poursuivi depuis sa naissance par
la colère de Héra. Quant aux Dioscures, présents dès le début dans l’œuvre de
Holderlin, ils connaissent une souffrance plus subtile face à la divinité. Si Zeus a
accepté de faire don de l’immortalité à Castor, pour répondre à la prière de son
demi-frère immortel, Pollux, il ne le fait que SOUS la condition qu’ils partagent
alternativement cette immortalité, de sorte que leur existence oscille entre la vie et
la mort. Peut-être Holderlin interprète-t-il les récits d’Homère et de Pindare l 3 de
telle manière que les Dioscures ne partagent pas simultanément la vie et la mort
mais que, un seul étant vivant à la fois, ils demeurent éternellement séparés. C’est
en tant que constellation qui préside à l’amour pour Diotima que les Dioscures
337
témoignent de la douleur vivante et cruelle de la séparation amoureuse. La cause de
cette immortalité imparfaite est la jalousie (Neid dieses Lebens) des dieux à l’endroit
de la vie humaine. L’injustice divine (gottliches Unrecht) trouve sa plus haute manifestation dans le destin d’CEdipe. C’est par une concrétisation extrême que son destin
devient exemplaire pour la condition humaine, conformément à la pensée holderlinienne tardive où il ne distingue plus entre le sublime et l’humble. Que le roi CEdipe
soit souillé sur le plan religieux par le parricide et l’inceste, que le peuple de Thèbes
soit maculé par les taches de la peste par lesquelles le dieu punit la cité pour la mort
non vengée de Laïos, c’est la preuve que chacun peut être frappé par des taches. La
problématique de la théodicée de la première partie réapparaît et trouve une réponse
dans des affirmations forcées : (( Tel est le travail d u beau soleil; car il appelle toute
chose à sa destination )) (f Das tut die schone Sonne : namlich die ziehet alles auf N). Le
dieu dont les rayons dispensent la mort est en même temps celui qui prodigue la
vie. Ainsi, comme pédagogue, il attire les adolescents sur la (( voie )) héroïque, sur
cette c Bahn U , terme privilégié chez Holderlin, parce qu’il permet de mettre en
parallèle la trajectoire des astres et le destin des hommes. Phaéton, Hercule, les
Dioscures, CEdipe ont été tour à tour poussés par cet aiguillon. Mais CEdipe semble
s’être engagé sur une mauvaise voie.
Telles douleurs, elles paraissent, qu’adipe a supportées, d’un homme, le pauvre,
qui se plaint de quelque chose (Die Leiden scheinen JO, die @dipas getragen, wie
wenn ein amer Mann kiagt, dass ihm etwas fehle)
O n remarque à nouveau la prudence de ce scbeinen U . Grâce au poème (( Mnemosyne ))
nous connaissons la double interprétation possible du verbe t fehlen U chez Holderlin.
I1 revêt ici les deux significations. CEdipe (( échoue )) d’une part, c’est-à-dire que son
chemin héroïque le conduit à l’échec; d’autre part, la vertu et la joie lui (( font
défaut », à l’inverse des Célestes qui, (( riches », sont dans l’abondance. De plus, une
troisième interprétation est possible : il (( est malade ». Un être semblablement misérable est celui qui s’exprime par cette plainte : (( Et ils m’ont pris/Mon œil )) (II,
p. 72). Selon une correspondance mystérieuse, cet œil perdu répond à l’œil en trop
d’CEdipe. Mais cet être misérable est en même temps celui qui (( désire s’aveugler »,
parce que, comme Holderlin l’écrit à Susette Gontard, a nous nous manquons l 4 ». A
cet endroit, le sujet poétique s’adresse directement à (Edipe - précisément ici, à la
fin du poème, il regarde dans son texte comme dans un miroir qui lui désigne CEdipe
comme un autre lui-même : (( Elle [son image] ressemble à cet homme. ))
((
L’essence du destin d’CEdipe réside dans son état d’étranger. (( Fils de Laius,
pauvre étranger en Grèce! )) Rejeté par ses parents, troublé par le soupçon de ne pas
être né de ses parents adoptifs, CEdipe a souffert de la solitude douloureuse de celui
qui n’a pas ses racines dans une culture relevant d’une tradition et d’un héritage
biologique. En dépit de toute sa gloire, CEdipe reste un étranger, même à Thèbes où
il a obtenu, par sa seule adresse intellectuelle, la royauté et une épouse. C’est encore
comme étranger, comme mendiant aveugle et hirsute qu’il at:eint finalement les
portes d’Athènes : (( Sur le sol blanc de Colone / Tu es arrivé / O toi qui es étranger
dans ces lieux ... 1) (V, p. 32). Mais ici, la qualité du statut d’« étranger )) se trouve
modifiée.
La leçon sur le destin d’CEdipe, au terme du poème, n’est compréhensible qu’en
fonction de la pièce tardive de Sophocle consacrée à ce héros, qui éclaire elle-même
la première pièce d’CEdipe, en la réinterprétant. Ce qui implique aussi que la voix
capable d’énoncer une telle leçon en de tels termes : (( Vivre est une mort, et la mort
elle aussi est une vie )) ((( Leben ist Tod, und Tod ist auch ein Leben ,), n’est pas
seulement la voix de quelqu’un qui s’identifie à la défaite d’une souffrance semblable.
Cette voix est aussi celle de quelqu’un qu’un destin pareil a mené à une position
338
supérieure, à partir de laquelle il est à même de comprendre et de diriger les choses.
Dans la pièce CEdipe 2 Colone cette voix est celle de Thésée qui, après avoir grandi
lui-même en exil, prête assistance à tout étranger. C’est comme un mort qu’CEdipe
apparaît ici, (( ...ceci n’est plus son ancien corps I s ». Cette mort n’est cependant
qu’extérieure. Ce qui constituait une mort véritable, c’était le moment où, parricide
et époux incestueux, (Edipe avait gagné une fausse gloire et n’avait pas encore aperçu
son propre reflet dans le miroir. Le regard jeté dans le miroir, dans la pièce a d i p e
roi, est signifié par l’acte concret de se crever les yeux, moment de la réunion
douloureuse avec le dieu qui régit la vue, acte par lequel CEdipe, renonçant à la
lumière extérieure, entrevoit sa vérité. Mais ce regard jeté dans le miroir ne saisit pas
tout. A l’effet destructeur de la réflexion sur soi se substitue, dans CEdipe à Colone,
un effet salvateur. De même, (Edipe se rend compte à présent combien le fait d’avoir
agi dans la non-conscience atténue la portée de ses crimes 16. De cette façon, il assure
aux habitants de Colone qu’il s’approche d’eux (( pur »,plein de piété et leur apportant
la bénédiction 17. Cet état est celui d’une mort intérieurement pleine de vie. L’inversion
entre mort et vie se manifeste cependant de manière plus significative encore par les
paroles d’Apollon invitant (Edipe à s’interroger : ((Je ne serais donc un homme valable
qu’après ma mort lS? )) Conformément à l’oracle, c’est le cadavre d ’ a d i p e qui apportera
le salut dans le pays où il sera enterré. La nouvelle vie d’(Edipe se déploie avec
majesté dans l’acte transfiguré de sa mort. CEdipe est rendu à la pureté, parce qu’il
lit dans les signes célestes : appelé par le tonnerre et les éclairs, CEdipe aveugle conduit
le roi Thésée au lieu secret de sa sépulture, qui agira désormais comme un (( bouclier ))
protecteur pour Athènes. La tragédie antique et le poème se trouvent étroitement
enchevêtrés, en particulier avec le motif des yeux et d u regard à la fois intérieur et
extérieur qui, chez Sophocle, connaît de subtiles variations.
Le ((gesezlicber KalkzLl» de ce grand poème de Holderlin apparaît encore une
fois dans le jeu des correspondances. La structure réflexive de la dernière phrase
transpose le regard reflété d u début de la troisième partie en une figure syntaxique,
permettant ainsi de formuler le stade final de la réflexion sur soi. En même temps
s’établit aussi le lien avec le reflet du ciel sur le toit qui avait engagé l’ensemble de
cette problématique.
Mais le processus de la connaissance ne vaut pas seulement pour (Edipe. Les
mythes antiques concernant Hercule et les Dioscures ne rapportent rien d’une recherche
des héros sur eux-mêmes, mais, chez Holderlin, la (( force de réflexion )) (RefEexionskraf)
présente aussi un côté physique : la définition donnée dans la deuxième lettre à
Bohlendorff des valeurs de (( sauvage )) et de a guerrier )) (((des Wtlden, Kriegerid e n ») aboutit à la certitude que le héros (( étanche dans le sentiment de la mort
[...I sa soif de connaître ». Ceux que Holderlin vénère se rassemblent dans le moment
de la mort considéré comme acte d’accomplissement et de connaissance : Hercule et
les Dioscures d’une part, qui, dans sa vision, s’élèvent tous les trois vers la présence
du Père divin - comme le décrit le fragment (( Lorsque pourtant ceux du ciel... N et, d’autre part, le Christ. En vertu d u principe d’analogie, ils garantissent à la fois
au (( pauvre homme D et au sujet du texte en train de souffrir le même renversement
de la mort dans la vie. Mais la figure invoquée d u Christ n’est pas seulement présente,
dans le poème, par des remarques allusives. (( Vivre est une mort, et la mort elle
aussi est une vie )) : cette phrase s’inscrit dans une tradition fondée par le Christ 20.
A partir de Jean et de Paul s’est développée une théologie (que je n’exposerai
pas ici) selon laquelle la véritable vie réside dans la mort d u Christ. Développée par
Luther et Ignace, cette conception théologique était certainement familière à Holderlin.
Les mystiques baroques l’ont à leur tour formulée suivant des variations multiples :
Vivere cum Christo est nobis vita : sine ilIo
vivere non vita est : est moriendo rnori *’.
339
C’est à partir de cette tradition que différents concepts de la vie et de la mort
ont pénétré le chiasme holderlinien, avant tout la différenciation entre mort charnelle
et mort spirituelle. Cette dialectique se trouve interprétée dans notre texte en fonction
du destin d ’ a d i p e . Mais la phrase finale tend également à se détacher du reste du
poème et à devenir le point de départ pour une réflexion et une méditation indépendantes. Ainsi il est certainement pertinent de la lire selon la conception héraclitéenne
du monde en mouvement, qui englobe la vie et la mort comme deux moments se
succédant dans le temps, bien que cette conception ne devait vraisemblablement plus
être aussi présente chez Holderlin, dans son époque tardive, qu’elle l’avait été au
temps de Hypérion. La structure particulière du texte cache sous l’aspect du discontinu
une profonde cohérence qui, dévoilée, libère pourtant à nouveau la formulation isolée.
Cette structure se fonde sur le glissement continuel du particulier au général. Ainsi,
ce texte prouve avec évidence que l’existence d’un sens formant son noyau ne signifie
pas que les différents éléments de ce même texte lui soient subordonnés. Bien au
contraire, ce noyau confère à ces divers éléments une telle intensité qu’ils acquièrent
finalement une autonomie. Ce noyau est constitué ici par la réflexion de l’homme sur
soi-même. Celle-ci se déploie dans trois perspectives : dans le langage des signes
célestes; dans l’idée qui donne la mesure; dans le reflet.
Ce qui, dans ce texte, semble incohérence et obscurité, n’est que le résultat de
sa force et de sa subtilité. Néanmoins, cette impression n’est pas tout à fait erronée.
Dans le plus profond de son essence, ce poème, comme les autres grands textes
holderliniens, est le reflet d’un autre texte, visé par le poète, mais qui ne s’incarne
jamais dans le langage. Est-il blasphématoire de dire qu’il habite une (( lumière
inaccessible »?
R e n a t e Boschenstein
NOTES
1. Ovide, Méta»lorpbores, I, 750-11 400. La traduction de Holderlin : Grosse Stuttgarter Ausgabe, V,
313-316. Toutes les citations de Holderlin se réfèrent à cette édition (StA) dont l’orthographe est
pourtant modernisée. Le texte du poème suit la traduction de du Bouchet à l’exception de quelques
passages où elle ne correspond pas à mon interprétation. Dans la mesure du possible, les versions
françaises des autres citations holderliniennes ont été puisées dans l’édition de la Pléiade (Paris, 1967).
2. M. Heidegger, Eriüuterungen zu Hoidedinr Dicbtung, Francfort, 195 1 ; (( ... Dichterisch wohnet der
Mensch ... », in Vortrüge und Aufiütze, Pfullingen, 1954; W. Schadewaldt, (( Introduction P à son édition
de Sophocle, @dipur und Antigone, Deutrrb von F. Hoideriin, Francfort, 1957; A. Green, Un œil en trop,
Paris, 1969.
3. Holderlin, @ u v m (Pléiade) ; Holderlin aujourd’hui », in Hoiderlin-Jubrburb, 16, 1969- 1970,
p. 70-91.
4. Sprarbveriurt und Sinnwandel, Stuttgart, 1969, p. 132-19. Le survol de la recherche s’appuie sur
la bibliographie de M. Kohler, Stuttgart, Bad Cannstatt, 1985.
5 . Pbaetbon, in Werke und Briefi, II, hg. v. H. Koniger, Stuttgart, 1981. Cf. p. 126. Sur le rapport
de Waiblinger à Holderlin les documents rassemblés dans le vol. VII, 3 de la StA nous instruisent. La
paternité de Holderlin a été réclamée avec la plus grande insistance par L.v. Pigenot (Sdrntiirbe Werke,
t. VI, Berlin, 1923, p. 490-492) et par E. Lachmann (« In lieblicher Blaue ... », Dirbtung und Voikrturn
(Euphorion), 38, 1937, p. 356-361). Tous deux ont tenté de reconstruire la forme métrique de ce texte.
E. Bach (« In lieblicher Blaue : Holderlin or Waiblinger? », The Germanic Review, 36, 1961, p. 27-34)
plaide pour Waiblinger comme auteur du poème. Les résultats de sa méthode linguistique et statistique
ne me convainquent pas.
6. Op. rit., p. 103.
7. Op. r i t . , p. 763.
8. Cf. l’article du dictionnaire des Grimm
((
340
9. Le récit qui nous est transmis dans les Mémorables de Xénophon (II, I , 21-34) se trouve résumé
de manière détaillée dans le Mythologisches Lexicon de Hederich, Leipzig, p. 1770.
10. Cf. l'article chez les Grimm.
1 1. Ce mythe qui nous est parvenu dans un contexte astronomique est également résumé par Hederich.
12. Hederich suit ici Apollodore.
13. Odyssée, XI, p. 300-305 ; Pindare, (( Ode pythique », 11.
14. StA VI, p. 370 (no. 198).
15. V. 110.
16. V. 446 sq.; 265 sq.; 960 sq.
17. V. 287 rq.
18. v. 393.
19. StA VI, p. 432.
20. Cf. les articles Leben n et ewiges Leben in Historisches Worterbuch der Phiiorophie, éd. J. Ritter
et K. Gründer, vol. V, Bâle, 1980. P. Meinhold : (( Leben und Tod im Urteil des Chrisrentums », in
Leben und Tod in den Religionen, Darmstadt, 1980, p. 144-146 (avec bibliographie).
2 1. J. Th. v . Tschech ; Vitae ruin Christo epigraminatorum sacrorurn centuriae, XII. 1644.
((
((
))
Je tiens à remercier vivement Jacques Berchtold et Stefan Schoettke des corrections qu'ils ont apportées
à ce texte.
Le Divin, les dieux
L’Image de la Grèce
chez Holderlin
et Heinse
Jean-Louis Vieillard-Baron
O n sait que la fameuse élégie de Holderlin, (< Brot und Wein )), est dédiée à
Heinse, ami de la famille Gontard, et grand redécouvreur de l’Antiquité classique,
en particulier dans son roman baroque intitulé Ardinghello ou les îles bienheureuses
(1787). O n sait aussi que Heinse écrivit une vie romancée du Tasse et que Holderlin
fut assimilé au poète de la Jérusalem délivrée I . Et cependant les raisons de cette
exaltation de la Grèce comme patrie d’autant plus vraie qu’elle est mythique ne sont
toujours pas éclaircies. O n s’est souvent contenté d’y projeter la prestigieuse conception
de la Grèce qu’on trouve chez Heidegger, et ce, d’autant plus facilement que Heidegger
a lui-même commenté Holderlin. I1 ne paraît pas souhaitable de reprendre ces traces,
fort éculées de nos jours. O n se contentera de quelques remarques, centrées sur
Ardinghello et sur Hypérion, pour dégager la signification spirituelle de cette Grèce
idéale 2 ,
Deux pages de Georg Simmel aident à situer la nostalgie de la Grèce dans
l’esprit allemand et chez Holderlin en particulier. Elles se trouvent au début d’un
bref article sur (( La dialectique de l’esprit allemand n écrit pendant la Première Guerre
mondiale et publié dans un recueil d’une admirable objectivité et d’une rare perspicacité sur la Guerre e t les Décisions s$iritzlelles 3 . Simmel part de l’idée que (( l’idéal
de l’Allemand est l’Allemand parfait - et en même temps son contraire, son autre,
son complément ». O n peut ainsi comprendre la traditionnelle nostalgie des Allemands
à l’égard de la vie italienne, non comme une renonciation à la germanité, mais comme
une façon d’assumer l’être allemand comme n’étant lui-même que s’il est capable de
s’assimiler son contraire. Et l’idéal type de cette tension de l’être allemand par rapport
à son autre auquel il s’identifie sans se dénaturer, c’est précisément Holderlin. D’où
l’erreur magistrale de ceux qui le considèrent comme un Grec de l’Antiquité égaré
dans la période moderne. Simmel écrit :
En lui vivait le désir allemand pour son contraire - pas seulement le contraire de
ce qui lui est donné, mais le contraire de l’idéal de perfection concernant ce donné
- du simple fait que son imagination poétique considérait ce contraire comme un
345
être immédiat, présent pour ainsi dire. I1 me paraît être la configuration la plus
achevée de cette dialectique de l’esprit allemand, parce que son amour allait, en
une proportion remarquable, à la germanité et à ce qui lui parut son autre total.
C’est pourquoi sa nostalgie n’était pas une nostalgie romantique ou sentimentale.
Car cette dernière signifie toujours que le dualisme n’exprime plus l’unité de l’être
allemand, mais est au contraire distendu en vue de la manifestation tout à fait
autre d’une hésitation problématique.
Ainsi, la patrie allemande chantée par Holderlin ne peut être elle-même dans sa
vérité que par le passage dans son autre, qui est la Grèce rêvée au-delà d u temps, à
la fois passée et présente. Simmel met Holderlin en rapport avec Hegel au sujet de
cette dialectique d u même et de l’autre :
Holderlin était l’ami de jeunesse de Hegel, dont le thème métaphysique fondamental ne pouvait absolument croître que sur le sol allemand : à savoir que chaque
objet désire son contraire et ne parvient à sa propre perfection qu’en passant en
celui-ci. I1 ne s’agit pas simplement de l’insatisfaction à l’égard de ce que nous
sommes, ce qui désigne en général tout idéalisme, mais au contraire du fait que
notre idéal ne fait pas progresser cet être seulement dans sa propre direction mais
plutôt accepte en soi son propre contraire et ne s’achève lui-même qu’en lui. Notre
joie de voyager, notre sens historique, notre capacité et notre désir de nous approprier
les créations spirituelles de tous les peuples ne sont que des configurations de cette
forme fondamentale de notre être, et la formule hégélienne, qu’elle soit ou non
suffisante face à l’être objectif du monde, n’aurait jamais eu sa puissance de
fascination dans l’esprit allemand si Hegel n’avait pas ressenti en elle la vérité de
son propre être.
Qu’on se garde bien de considérer comme réductrice une telle analyse. Elle n’explique
pas toute la dialectique hégélienne, ni toute la relation entre la Grèce et la patrie
chez Holderlin. Mais elle éclaire d’une très vive lumière leur enracinement commun
dans l’esprit allemand sans lequel ils ne seraient rien. L’universalité de Holderlin ou
de Hegel, comme celle de Descartes et de Bergson, ne s’oppose en rien à leur
enracinement dans leur esprit national respectif; leur particularité n’a qu’à s’approfondir pour être universelle.
Je ne m’étendrai pas sur l’ambivalence des textes de Holderlin à l’égard de
l’Allemagne. Celui même qui célèbre le (( chant allemand n dans <( Patmos », qui en
appelle aux (( Anges de la patrie N dans (< Stuttgard )) est celui qui lance à son pays
les injures les plus graves :
Pays du génie haut et grave!
Pays de l’amour! Quoique je sois bien à toi,
Souvent j’ai pleuré de rage de ce que, toujours,
Tu renies stupidement ton âme propre ‘.
Le rapport passionné de l’écrivain allemand à l’égard de son pays se traduit
dans ces cris de haine ou ces sarcasmes, qui sont une constante de la littérature
allemande au X I X ~et au XX‘ siècle, c’est-à-dire depuis que la conscience d’être allemand
existe vraiment. C’est que Holderlin juge sa patrie à partir de son idéal moral; ce
faisant il se juge lui-même, et pratique l’examen de conscience luthérien. Les critiques
sont faites au nom de la pensée. Mais, il nous l’a dit : l’homme qui pense est un
mendiant, l’homme qui rêve est un dieu. La Grèce est ce rêve, et singulièrement
dans les diverses écritures du roman épistolaire Hypérion.
Le rêve grec de Holderlin, comme, dix ans plus tôt, celui de Heinse, n’est pas
une rêverie poétique inconsistante. Le ton élégiaque et la pureté d u style ne doivent
pas masquer la position vigoureuse d’un idéal où beauté et vérité sont pleinement
346
unifiées. C’est la réalisation littéraire d’un des éléments fondamentaux du Plus Ancien
Écrit-programme de l’idéalisme allemand :
Je suis convaincu que l’acte suprême de la raison est un acte esthétique, et que
la vérité et la bonté ne s’allient que dans la beauté. - Le philosophe doit avoir
autant de force esthétique que le poète. Les hommes dépourvus de sens esthétique
pratiquent une philosophie de la lettre uniquement >.
Sans s’identifier l’une à l’autre, philosophie et poésie vont de pair. La lecture d’fiypérion
permet de mesurer, sans nulle peine, quelle place importante joue la réflexion
philosophique dans la conception de la nature, de l’idéal, de l’art, et de toutes les
formes de l’existence. A tel point qu’un biographe de Hegel a pu soutenir récemment
qu’aucune différence n’était faite entre philosophie et poésie chez les (( compagnons
de Tübingen », Hegel, Holderlin et Schelling, avant 1800 6 . La seconde composante
du rêve sacré de la Grèce holderlinienne est le lien très fort entre le poète et le héros :
il y a une sorte de réversibilité des deux fonctions, et le héros libérateur (manqué)
de la Grèce opprimée par la (( turcodoulie )) représente aussi bien le poète zventureux
(foudroyé) dans l’Allemagne agitée par la Révolution française. Cette conception
héroïque du poète, qui se retourne en conception poétique du héros, avait été posée
par Heinse dans son Ardinghello, d’une façon presque implicite, mais très explicitement,
et dans une lumière beaucoup plus apaisée et classique, par Goethe dans son Torqtlato
TaJso: si le poète n’est pas l’homme du pouvoir, si la société le subordonne aux
princes, néanmoins, c’est lui le véritable héros, et la gloire du Tasse dépasse la
réputation de son maître :
C’est grand avantage que d’accueillir le génie :
le présent que tu fais à cet hôte
est moins beau que celui qu’il te laisse au départ.
L’héroïsme du poète n’est pas seulement dans l’attachement forcené à une œuvre;
il est aussi dans le sacrifice de l’homme à l’œuvre. La passion de Tasso pour la
princesse la revêt de toutes les qualités idéales, et il se voit à la fin pareil au
mendiant qu’on repousse et qu’on chasse ». Supérieur aux princes par le génie, il n’a
pourtant pas le pouvoir de s’égaler à eux par les sentiments. De sorte que Goethe se
refuse à admettre une réciprocité de fonction entre le héros et le poète; ce sont deux
aventures parallèles, dont la plus belle est celle de la poésie. Deux ans après
l’Ardinghello, en 1789, la pièce de Goethe ne pouvait manquer de faire réfléchir
Holderlin, et de lui permettre de penser en des termes voisins sa fonction de poète
et son amour éperdu pour Suzette Gontard.
*
Ardinghello est un héros libre amoureux de la beauté. C’est un homme du
siècle italien. Mais l’Italie n’est pas plus réelle au sens géo-historique que la
Grèce de Holderlin. Heinse utilise seulement des notes de son voyage en Italie pour
présenter les chefs-d’œuvre de la peinture, en particulier Raphaël ’. Mais c’est toujours
en les référant à un modèle grec : Praxitèle, etc. La référence à Platon est constante,
par exemple le rapprochement fait dans le Cratyle entre fipÉpa IFLEPOÇ,
signifiant que
c’est dans la nuit et l’obscurité qu’on aspire à la lumière et au lever du soleil (p. 35).
Bien sûr la référence idéale est toujours celle de la Répzlbiiqzle. Ardinghello invoque
le divin Platon pour qu’il chasse toute législation barbare et installe sa république
(( où au moins homme et femme sont sains et libres avec leur amour )) (p. 106).
L’idée de la liberté dans l’amour est un thème fondamental sur lequel Heinse pense
fonder la société des îles bienheureuses. I1 y a un élément d’individualisme prénietzschéen chez ce héros, mais dans les limites d’une exégèse originale et téméraire de
XVI‘
347
Platon, volontiers teintée d’ésotérisme hermétiste, A la fin du roman, Ardinghello
quitte tout pour fonder sur une île de la mer Egée une société du bonheur: les
principes sont la liberté dans l’amour, l’égalité et la communauté des biens. Mais la
part utopique du roman se réduit à la dernière lettre et même à ses dernières lignes
(ainsi qu’au titre, inspiré du livre de Wilhelm Zacharias, Tayti Oder die ghcklicbe
Insel de 1777).
Cependant une lecture attentive d u détail du texte montre la constitution d’un
mécanisme utopique. Au niveau de l’espérance, d’abord, elle est celle de l’amour
libre lié à la beauté. Le rapport du passé au présent et à l’avenir se fait par la beauté
éternelle, en particulier la beauté cosmique. Dès le début du livre, c’est la nostalgie
de la Grèce antique qui conduit à valoriser la Grèce moderne : Ardinghello désire
s’entretenir en grec moderne, (( élément vivant de cette langue des dieux, afin que
bientôt je puisse commencer un pèlerinage vers l’authentique sol classique avec le
plus de confort, d’utilité et de plaisir N (p. 22). Ce désir de se rendre en Grèce était,
dans la réalité, un rêve impossible en raison de la domination turque (et c’est pourquoi
on s’arrêtait à Rome - ce que Heinse a fait). Mais le héros Ardinghello réalise ce
rêve dans le roman. Il-n’y a aucune tendance chez lui à aimer le passé pour le passé.
A propos de l’âme, Heinse dit très bien que (( son désir le plus fort est la nouveauté,
la connaissance, la perfection. Elle crée et agit )) (p. 170). C’est donc d’une façon tout
à fait orientée vers l’avenir que le passé est envisagé. Cette tendance dynamique se
retrouve dans le personnage de Fiordimona, la bien-aimée d’Ardinghello, qui apprend
à celui-ci le véritable amour libre. (( Si l’on supprime la joie orgastique (Wollust) de
la vie, il ne reste rien que la mort )) (p. 223). Si la froide raison peut être tournée
vers le passé, le cœur est tourné vers l’avenir (p. 231) : c’est lui qui permet à la
nostalgie de vivre dans une ancienne République, de devenir constructive.
La beauté est en fait le sujet central de I’Ardingbello : c’est elle qui fait l’unité
des thèmes divers et un peu chaotiques de l’ensemble. En particulier la beauté a la
place dominante dans l’art, d’abord, évidemment, et puis dans l’univers er dans la
société. Sur l’art, Heinse dit qu’aucun artiste (( ne peut créer quelque chose de bon
en accomplissant ses œuvres sans un concept explicite et une conscience claire de la
beauté )) (p. 178). I1 se réfère à Platon (Phèdre) : la beauté est l’Idée originelle des
choses en Dieu; les âmes qui connurent ces Idées frémissent si en cette vie elles
aperçoivent les images de la beauté de leurs yeux. L’infériorité de l’artiste par rapport
au Dieu de Platon, c’est de ne pouvoir représenter tout ce qu’un homme a de
particulier sans l’avoir vu. ((Tout ce que le peintre peut trouver, c’est l’idéal de la
Forme de telle ou telle classe d’êtres humains )) (p. 172). L’élément moderne intervient
lorsque, bien avant Hegel, Heinse montre que la musique et la poésie sont les arts
les plus hauts parce qu’ils ont plus d’intériorité, plus d’âme, donc plus d’immortalité,
que les arts plastiques (p. 173).
La beauté va servir de ferment à la pensée utopique de Heinse car elle est
principe d’harmonie et d’unité. K Harmonie mit der Weltall ist das hocbste Gut
(p. 277); et du point de vue de l’univers, Heinse, comme tant d’autres, dit : c Eins
ist Alles, und Alles Eins (En kai pan) (p. 281). Ce qui, au niveau personnel, devient :
U Eins zu sein und Alles zu werden U (p. 309). Cette belle unitotalité qui est à la base
de la pensée de Heinse, nous cherchons d’abord à la réaliser entre êtres humains : la
nature conduit l’homme à la femme, et la femme à l’homme. Mais ‘les deux ne
trouvent pourtant pas cette unitotalité en eux seulement; ils cherchent leur tout chez
plusieurs de leur espèce. Là où cette tendance agit le plus fort, c’est la plus heureuse
des Républiques (p. 268). La cité d u bonheur est donc le résultat de la tendance à
la belle unitotalité.
I1 va y avoir correspondance entre l’âme, la cité et le cosmos, comme chez Platon.
La beauté fait écarter du cosmos un Dieu qui ne serait que pensée de la pensée et
qui est complètement inutile. C’est la nature dans son ensemble qui est Dieu. L’univers
))
))
348
est dans la (( belle vie )) par l’action et la réaction; l’éternité d u monde fonde notre
immortalité (p. 308). De là résultent trois conceptions d u monde divin : la pure
aristocratie cosmique où chaque élément est aussi divin que l’autre (c’est le polythéisme
grec); la monarchie aristocratique d u monde, où un élément règne sur les autres (le
soleil par exemple); enfin la monarchie cosmique qui est à la fois démocratique et
aristocratique, et accepte les bêtes et les plantes comme éternelles (p. 310). La société
heureuse est une (( composition mystique de monarchie, d’aristocratie et de démocratie
cosmiques )) (p. 3 15).
*
Le rêve d’unité dans la beauté et la liberté se retrouve chez Holderlin dans
Hypérion, mais d’une façon plus concentrée L’élément utopique est dans le croisement
d u passé et de l’avenir. Holderlin célèbre (( l’éblouissante jeunesse d’Athènes )) (et il
renvoie à Platon - Politique 268 E-274 E - pour montrer la relativité de la vieillesse
qui peut être rajeunissement). Le héros dit : ((Je prends joie à l’avenir )) (p. 156).
C’est l’héroïsme individuel, appris en partie de Heinse, en partie de Fichte, qui peut
manifester cette foi dans l’avenir.
Ici l’avenir n’a pas de dimension historique, mais hiérohistorique. L’espérance
est fondée dans la verticalité de la transcendance. La fin d u fragment (( Thalia )) (qui
est la première version de Hypévion) montre une expérience indiscutablement mystique :
c’est le thème de l’éblouissement mortel, que Platon avait indiqué dans la République
à propos du soleil.
II y a peu, je vis un enfant couché au bord du chemin. La mère qui le veillait
avait pris soin d’étendre une toile au-dessus de sa tête pour qu’il pût sommeiller
doucement dans l’ombre et que le soleil ne l’éblouît point. L’enfant qui n’en
voulait rien savoir arracha la toile, et je le vis qui essayait de fixer l’amicale
lumière, qui essayait encore, jusqu’à tant que les yeux lui brûlent; alors, en
pleurant, il tourna son visage contre terre.
Le pauvre enfant! pensai-je, il n’est pas le premier... Et j’étais prêt à renoncer
à ces curiosités téméraires. Mais comment le pourrais-je? Je n’en ai pas le droit.
Car le mystère considérable dont j’attends la vie, ou la mort, doit être un jour
révélé (p. 133).
Cette attirance mystique donne à Hypérion sa dimension d’absolu. Elle ôte au
héros cet appétit désordonné de la vie qu’on trouvait dans Ardinghello. Hegel s’est
encore plus inspiré de Holderlin que de Heinse pour cette raison même. L’utopie ici
s’enracine dans une appréciation négative d u présent et dans l’espoir d’une métamorphose radicale, d’une conversion d u mal en bien, qui échoue finalement. (( Heureux
ceux qui ne te comprennent pas! écrit Diotima à Hypérion. Q u i te comprend ne
peut que partager ta grandeur, et ton désespoir )) (p. 245). Et cette lettre exprime la
métamorphoJe opérée par le héros : c’est la projection du désir de plénitude dans
l’amour et la beauté; mais elle a la tonalité religieuse d’une conversion immédiate
et mystérieuse : l’amour règne entre les hommes, entre les générations, entre les enfants
et les amants.
Ils s’abreuvaient à tes sources, ô Nature! aux joies sacrées qui sourdent mystérieusement de tes profondeurs et rajeunissent le cœur; les dieux réjouissaient à nouveau
l’âme fanée des hommes [...] Car tu avais guéri les yeux des Grecs, Hypérion! et
ils recommegaient à voir ce qui vit; tu avais rallumé l’enthousiasme qui donnait
en eux comme le feu dans les bois, et ils avaient retrouvé la ferveur silencieuse et
constante de la Nature et de ses purs enfants (p. 246).
349
La restauration de l’amour suppose le lien filial des hommes à l’égard de la mèrenature. Chaque action humaine redevient une fête, car elle exprime l’éternelle jeunesse
des dieux. Le monde humain prend tout son poids de divinité, d’absolu.
L’échec historique de l’action libératrice d’Hypérion est l’échec de toute action
historique. L’amour pourrait sembler une issue à l’âme assoiffée d’absolu. Et il est
vrai que, dans l’amour, l’être humain trouve sa dimension d’âme. Hypérion écrit à
Bellarmin, au sujet de Diotima :
Où est celui, mieux que moi, qui l’eût reconnue? En quel miroir eussent convergé
mieux qu’en moi les rayons de sa lumière? N’a-t-elle pas tremblé de bonheur
devant son propre éclat, la première fois qu’elle se découvrit dans ma joie.
Et inversement :
Dans sa merveilleuse clairvoyance, elle me dévoilait dès son apparition, avant
même que je l’eusse deviné, chacun de mes accords et de mes discordes profondes...
(p. 185).
Mais il y a quelque chose de destructeur dans la quête de l’Absolu, en lutte contre
la Némésis : Alabanda, l’ami d’Hypérion, représente cette liberté sans frein qui se
détruit elle-même. I1 faut comprendre l’élément négatif qui est présent dans la phrase :
(( Rends une seule fois hommage au génie, il culbutera tous les obstacles terrestres,
il déchirera tous les liens de ta vie )) (p. 254). La mort est toujours proche de l’absolu
dans l’amitié et dans l’amour. Diotima meurt de son amour pour Hypérion :
Par l’Esprit qui nous unit, par l’Esprit divin qui est propre à chacun et commun
à tous, dans l’alliance de la Nature, la fidélité n’est pas un rêve [...I Nous mourrons
pour revivre (p. 262).
L’utopie d u monde meilleur est ici vaincue d’avance. Elle est cependant le rêve
partagé d’Hypérion et de Diotima : (( L’amour engendra le monde, l’amitié le réengendrera )) (p. 187). La (( symphonie de l’Histoire )) peut retrouver des accents aussi
grands, voire plus grands que dans la Grèce antique. C’est l’attachement de Holderlin
aux idées de Fichte qui se traduit ici, mais sous la forme d’un rêve, alors que chez
Fichte c’était une incitation à l’action. I1 y avait, au départ, pour Holderlin, une
(( harmonie de l’enfance »;
elle sera remplacée à la fin par une autre harmonie,
(( l’harmonie des esprits ». Actuellement nous sommes dans le chaos.
Mais la Beauté, chassée de la vie, trouve refuge dans les hauteurs de l’Esprit.
L’Idéal s’apprête à relayer la Nature ... (p. 187).
*
Toute la fin d u premier volume d’Hypérion nous montre que cet idéal est, de
toute part, un idéal de poète; et c’est là la différence capitale avec la pensée de Fichte
dont le centre est la réflexion juridique, qui se substitue habilement à l’intersubjectivité
esthétique analysée par Kant dans sa Critique de la faculté de juger en 1790. Le héros
de Holderlin se déclare artiste : (( Artiste, je manque de métier. L’esprit forme et la
main tâtonne. )) La création, l’action au sens fort d u mot, se situe pour Holderlin
dans la sphère esthétique : c’est la poésie qui est capable de faire jaillir (( un nouveau
monde des racines de l’humain », de faire régner (( une nouvelle divinité sui les
hommes », d’ouvrir à ceux-ci (( un nouvel avenir )). C’est la poésie qui sacralise le
monde, parce qu’elle procède d’une intériorité divine, l’âme d u poète :
350
Nature sacrée! tu es en moi et hors d e moi la même. Peut-être n’est-il pas si
difficile d’unir ce qui est hors d e moi au divin qui est en moi.
On voit ici, comme on le verra aussi chez Novalis 9 , une interprétation du
rapport entre Moi et Non-Moi (que Fichte avait analysée dans sa Gandiage der
Wissenscbafcsiebre de 1794), en termes de correspondance et d’harmonie du microcosme
et du macrocosme. C’est la mission du poète que d’être (( l’éducateur de notre peuple »,
très exactement de la même façon que Fichte considérait le philosophe comme
(( l’éducateur du genre humain », dans la quatrième des Conférences szrr la destination
dzr savant de 1794 ‘ O . Toute distance entre la réalité et l’idéal s’abolit dans la poésie.
C’est Diotima qui le dit à Hypérion, et elle lui révèle là le sens de la Grèce comme
patrie spirituelle, et la fonction théurgique de l’acte poétique, transcendant alors toute
déchirure inhérente à l’esprit allemand, en une réconciliation finale des contraires :
I1 y a le repos d u héros. I1 y a des décisions qui sont à la fois, comme les paroles
divines, ordre et exécution, et la tienne est d e celles-là I l .
Jean-Louis Vieillard-Baron
NOTES
1. Cf. la conférence de Gérard Maillat, prononcée le 28 mai 1976, et publiée dans la
(ittérature comparée, 1977, p. 232-240, sous le titre
Revue de
Holderlin et Le Tasse ».
2. Cf. ma communication au 6‘Symposium international d’Études humanistes, organisé par la Société
grecque d’études humanistes à Athènes et Portaria, 16-20 septembre 1984 : La vérité de l’utopie :
l’image de la Grèce dans l’idéalisme et le romantisme allemands », in Utopia, Athènes, 1986, p. 293298. Texte repris in J.-L. Vieillard-Baron, Platonisme e t interprétation de Platon, Paris, Vrin, 1988,
p. 149-154.
3 . Der Krieg und die geistigen Entscheidungen, Munich et Leipzig, Duncker und Humblot, 1917,
p. 33-34. Sur cet opuscule, voir ma conférence au colloque de Coëtquidan sur La guerre », 12-14 mai
1986 : (( Georg Simmel et la guerre de 1914-1918 : une théorie du conflit »,in La Guewe, publications
du Centre de philosophie politique et juridique de l’université de Caen, 1986, p. 215-223. Les textes
de Simmel sont traduits dans la seconde partie de G. Simmel, Philosophie de la modernité, t. II, Payor,
1990.
4. Holderlin, Samtlicbe Werke, II, 1, Gedichte nach 1800, Ode Gesang des Deutschen », Y. 9 à 12 :
U Du Land des hoben ernsteren Genius! / Du Land der Liebe! Bin ich der deine schon, / Oft zürnt’ich
weinend, dass du immer / Blode die eigene Seele Ieugnest. 8
5 , Das aiterie Sysiemprogramm des deutsrben idealismus
6. Cf. H.S. Harris, Le Développement de Hegel, I, Vers le soleil, 1780-1801, mad. française, Lausanne,
L’Age d’Homme, 198 1.
7. Les citations et indications de pages entre parenthèses renvoient à l’édition Baumer, parue chez
Reclam en I978 et digne de tous les éloges.
8 . Pour les emprunts textuels de Holderlin à Heinse, voir la dissertation (qui ne propose pas le
moindre élément d’interprétation) de Theodor Reuss, Heinse und Holderlin, Stuttgart, 1906, p. 45-62
en particulier. Plus récentes sont les études de Pierre Grappin, Ardinghello et Hypérion », in Etudes
germaniques, 1955, p. 200-2 13, et les études essentielles de Max Baumer, Heinse-Studien, Stuttgart,
1966. Je cite directement la traduction, excellente, de Hypérion par Philippe Jaccottet dans le volume
de la Pléiade, CEuvres de Holderlin, Paris, Gallimard, 1967, p. 113-273.
9. Cf. mon article, (( Microcosme et macrocosme chez Novalis », in Études philosophiques, 1983, nu 2,
p. 195-208.
IO. Trad. française : Paris, Vrin, 1980, p. 76.
11. Dernière lettre de la 1“ partie, in fine; trad., p. 2 10-2 11.
((
((
((
((
((
Structure
de la mythologie
noicteriinienne
Jean-François Marquet
A la mémoire de Swantie et Bernard Gorceix
Un des plus singuliers documents de l’histoire de la philosophie tient dans les
quelques feuillets publiés en 1917 par Franz Rosenzweig sous le titre un peu excessif
de Plus ancien programme systématique de l’idéalisme allemand ». De ces pages
écrites de la main de Hegel, mais vraisemblablement conçues à Stuttgart par Schelling
et Holderlin I , nous retiendrons seulement deux brefs paragraphes où se dégage de
manière particulièrement nette la tâche actuelle de la pensée :
...on entend souvent dire que la grande masse doit avoir une religion qui parle
aux sens (Jinnliche). Ce n’est pas seulement la grande masse, c’est aussi le philosophe
qui en a besoin. Monothéisme d e la raison et d u cœur, polythéisme d e l’imagination
et de l’art, voilà ce qu’il nous faut! Je parlerai ici d’une idée qui, pour autant
que je sache, n’est encore venue à l’esprit d’aucun homme : nous devons avoir une
nouvelle mythologie, mais cette mythologie doit être au service des idées, elle doit
devenir une mythologie d e la raison
’.
Cette mythologie de l’avenir, c’est naturellement du poète qu’il faut en attendre
l’instauration, de même que, selon une formule d’Hérodote fréquemment citée par
Schelling ce sont Homère et Hésiode qui ont donné aux Grecs leur théogonie,
l’histoire et la généalogie de leurs dieux. Durant ses années triomphantes d‘Iéna,
Schelling rêvera un temps d’être lui-même ce poète et de produire (( l’épopée spéculative )) qui (( implanterait dans la nature les divinités idéalistes du christianisme,
comme les Grecs avaient implanté leurs divinités réalistes dans l’histoire ». Mais le
352
projet n’aura pas de suite, et, des trois conjurés de Tübingen, c’est tout naturellement
Holderlin qui assumera seul la tâche écrasante d’ouvrir aux dieux futurs le chemin
de la parole - non pas dans le ((poème didactique absolu )) qu’évoquait Schelling,
mais dans une œuvre (( en archipel )) dont le paysage écroulé semble avoir été
simultanément construit et ruiné par le même insoutenable coup de foudre. Les pages
qui suivent tenteront de retrouver dans ces ruines les traces d’un plan, le plan de la
(< nouvelle mythologie », de la Fable de la modernité que projetait le programme de
1776; elles le feront en gardant en mémoire la définition que donne de la Fable une
des dernières lettres à Seckendorf, où Holderlin interprète ce terme comme signifiant
a vision poétique de l’histoire et architectonique d u ciel N - autrement dit en
examinant tour à tour la dimension naturelle et la dimension historique d’une structure
à la fois très simple et ramifiée à l’infini, mais dont nous voudrions surtout faire
apparaître, d’un bout à l’autre du destin poétique de Holderlin, l’absolue cohérence.
*
A la considérer tout d’abord dans l’élément de la Nature, rien de plus facile à
dégager, semble-t-il, que l’articulation du polythéisme holderlinien : plus d’une
douzaine de textes, allant des premières ébauches d’Hypérion à l’ultime poème
Giechenland, nous offrent ,en effet la même structure à trois termes (l’un se trouvant
dédoublé) avec en haut l’Ether, en bas la Terre, et, dans l’entre-deux, la Lumière soit patente dans la paisible clarté solaire, soit latente, mais réservée à un éclat d’autant
plus violent, dans la nuée d’orage. Ainsi dans Der Wanderer:
... Mais toi, au-dessus des nuages,
Père de la patrie! Puissant Ether! et toi
Terre et Lumière! Vous trois en un (einigen drei) qui régnez et aimez,
Dieux éternels! avec vous mes liens ne se briseront jamais ’
L’Éther, pour Holderlin comme pour Euripide, c’est évidemment Zeus; la
lumière, non moins évidemment Apollon; seule la Terre, comme l’indique le poème
Germanien reste encore à nommer : pour l’instant, elle est seulement 1’Undurchdringliches, l’Impénétrable - épithète que la traduction d’Antigone substitue symptomatiquement au nom divin de Déméter 9. Mais, si nous voulons remonter jusqu’à
la source la plus vraisemblable de ce panthéon, nous devrons le prendre à sa première
apparition, dans l’ébauche romanesque Hyperions Jugend ( 1795) où, comme objet du
culte de la cité future, on ne trouve encore aucune personne divine, mais seulement
des puissances élémentaires, au nombre, cette fois, de quatre : l’éther, le soleil, la
terre, l’eau ‘ O . En effet, ce schéma quaternaire apparaît comme directement issu d’un
autre roman néo-grec qu’Holderlin a beaucoup pratiqué, Ardingheiio et les îles bienheureuses, de Wilhelm Heinse. Dans la quatrième partie de ce récit, un certain Demitri
trace le tableau de la religion de l’avenir, une religion où les dieux s’identifient aux
éléments simples et bienheureux, en contraste avec la condition souffrante et périssable
des mixtes hétérogènes dont nous faisons partie ‘ I ; ces dieux sont au nombre de
quatre - Zeus ( = l’air, l’éther de Holderlin), Apollon (= le feu solaire), Neptune
(= l’eau) et Pluton (= la terre) - et constituent une (( aristocratie cosmique... au sein
de laquelle, selon Homère, Junon, Neptune et Apollon pouvaient lier Zeus l 2 ». Cette
phrase, que Holderlin a certainement méditée, appelle un certain nombre de remarques
dont aucune ne nous éloigne de notre poète :
1) O n voit tout d’abord que Junon peut se substituer à Pluton comme nom
de l’élément Terre 1 3 . Ce sera aussi le cas chez Holderlin, où le caractère (< junonien ))
de l’Occident est avant tout un caractère plutonien et terrestre.
2) Dans le passage cité d’Homère, si Junon et Neptune sont bien présents, il
n’est pas question d’Apollon, mais d’Athéna 14. I1 est possible que, dans un fragment
353
dont l’interprétation est malheureusement difficile, Holderlin ait rétabli la figure de
(( la droite fille d u Tonnant I s ».
3) Le schéma de Heinse se retrouve, par-delà Holderlin, dans les dernières lignes
du Bruno (1802), où Schelling résume mythologiquement sa vision de l’absolu :
Alors nous comprendrons l’âme royale de Jupiter; la puissance est à lui; mais en
dessous de lui sont le principe formateur [= Apollon] et le principe informe
[= Neptune] qu’un Dieu souterrain [= Pluton] renoue dans les profondeurs de
l’abîme; mais lui-même habite dans un éther inapprochable 16.
4) Chez Holderlin même, le quatrième terme de cette structure, Neptune, semble
manquer; mais il faut se souvenir que le Poséidon grec est avant tout le dieu d u
tremblement de terre, 1’u orage souterrain )) qu’évoque Der Archipelagus 17. De fait,
la puissance poséidonienne se retrouve dans la mythologie de notre poète comme
puissance de l’orage, de la (( flamme de nuit », faisant pendant, entre ciel et terre, à
la lumière apaisée d’Apollon. Cette place est aussi, nous venons de le voir, celle que
Schelling, dans Bruno, attribue à Neptune, et Hegel, dans sa Philosophie de la Nature,
au principe cométaire, lui aussi lié à l’eau et à l’orage (ainsi qu’au vin, rapport dont
l’importance nous apparaîtra plus tard)
Zeus
(Ciel, Ether)
Apollon
(soleil)
[Neptune]
(nuage, orage)
1
1
Terre
Si nous reprenons maintenant un par un chaque élément de cette structure, nous
trouvons donc, en haut, l’Ether, identifié, ici, à l’Océan du feu céleste, et non, comme
chez Heinse, à l’air. Pour Holderlin, l’air, cette (( âme du monde l8 )), n’est en effet
que la (( sœur )) et la subordonnée de 1’« esprit », i.e. de (( la puissance ignée qui vit
et règne en nous 17,»; c’est par sa médiation que nous est transmise, adoucie, la
vigueur du feu de l’Ether, source de toute vie, de toute guérison et de toute inspiration,
que nous ne supporterions pas à l’état pur 2”. Considéré en lui-même, et pour reprendre,
avec Holderlin, les termes d’un célèbre mythe platonicien, 1’Ether est nopoç, la
surabondance de la plénitude 2 1 , le lieu où ça jouit 22 - l’inconscient 2 3 , donc, car la
conscience suppose toujours distance, différence de soi à soi et dès lors manque. I1
baigne de ses flots les astres, qui sont comme les fleurs du jardin céleste 24, et dispense
vers le bas (vers la terre) les étincelles de la vie 2 5 , dans les pluies, les vents, les
orages, la rosée où il faut voir autant de modes de descente de la semence céleste.
C’est lui le Père 26 que nous cherchons obscurément à retrouver, comme tout fleuve
cherche à se perdre dans l’Océan, et par l’effet du même désir de mort (Todesiust) 27
- car, en tant qu’inconscient, cet élément par excellence de la vie revêt paradoxalement
pour nous l’aspect de la mort 28; et, parce que la vie nous est ainsi dispensée d’en
haut, elle est ressentie par nous comme une dispensation, un destin (Schicksal) au
lieu d’être, comme pour l’astre, ce dans quoi, démesurément comblés, nous flotterions
librement 29.
La Terre, pour conserver les termes d u même mythe, est, quant à elle, nwiu,
la disette, le manque, la finitude de la conscience et de la détermination, la (( sobriété
junonienne !). D’elle-même stérile, elle n’existe que dans son rapport au déferlement
continu de l’Ether, auquel elle s’ouvre et se ferme par une alternance qui correspond
au rythme des saisons (l’été marquant l’ouverture de la terre au feu céleste et l’hiver
354
sa clôture sur soi). La terre par excellence est la montagne 3 1 , domaine de Cybèle,
avec ses deux formes contrastées du volcan, voué à la hiérogamie dure )) de la foudre,
et du glacier, où, dans une hiérogamie plus tendre, (( le tact léger de la lumière [...I
fait fondre la glace cristalline 32 N (toujours Poséidon et Apollon, les deux visages
opposés du médiateur). Dans le mythe holderlinien, la Terre apparaît comme (( la
moitié toujours plus fidèlement aimante du Dieu soleil, à l’origine peut-être plus
étroitement unie à lui, puis séparée de lui par un décret du destin afin qu’elle le
cherche, s’en rapproche, s’en éloigne et, à travers plaisir et peine, mûrisse à la plus
haute beauté 33 - le soleil, ici, occupant en fait la place de l’Ether, comme le montre
un passage de la troisième version d’Empédocle :
...au souvenir
De l’antique union, la mère ténébreuse
Déploie vers I’Ether ses bras de feu 34
La Terre, jadis fondue dans l’Éther, ne s’en est séparée que pour que celui-ci
ait un miroir 3 5 et une conscience pour se reconnaître, et la tâche qui s’impose à elle
est donc de maintenir une bonne distance par rapport à son père-amant (son Pygmalion,
dit aussi Holderlin 36) : si cette distance est trop brève, comme pour l’Afrique du
Wanderer, ou si elle est trop longue, comme pour la terre (( veuve )) des régions
polaires, on n’obtient dans les deux cas qu’un désert, auquel Holderlin oppose le
vert et le bienfaisant clair-obscur de la patrie, fondé sur une proximité tempérée.
Mais il est cependant nécessaire que cette distance, parfois, se trouve complètement
abolie et que, par un contact direct et fécondant, mais instantané, le Dieu pose la
base de tout habiter futur et, (( fendant la montagne de ses rayons, construise hauteurs
et profondeurs 37 N dans cet (( atelier N chaotique dont les Alpes d’lieimkunft sont
l’exemple par excellence. De même, dans l’ordre humain, on trouve aussi des moments
hivernaux où l’homme vit sur lui-même, loin de Dieu et sans Dieu, on trouve aussi
des moments heureux où la lumière du divin vient jusqu’à l’individu tempérée par
la médiation d’une communauté juste; mais à l’origine de ce bonheur il doit y avoir
à chaque fois un moment où le Dieu saisit directement un individu (poète, voyant,
prophète), un moment où se trouve posée la base inspirée (la (( Loi pure ») dont la
postérité fera l’exégèse :
Comme le roc fut en premier et forgées dans les ombres de la forge les fondations de
bronze de la Terre
Avant même que les torrents coulent des montagnes
Et que bosquets et villes fleurissent au bord des fleuves
Ainsi a-t-il dans un coup de tonnerre
Créé une loi pure et de purs sons fondé w
Moment de possession immédiate 39 qui fonde, mais en détruisant celui sur lequel il
s’abat (Rousseau, ou Holderlin lui-même), et en laissant sa ruine foudroyée en marge
du paysage paisible et ordonné ainsi ouvert 40.
Comme l’Éther avait ses enfants (astres et météores), la Terre aura aussi les
siens, ou plutôt ceux que l’éther aura engendrés en elle. Tout d’abord les Titans,
enfants gavés qui, comme Tantale, ont pris sans dire merci (( plus qu’ils ne pouvaient
digérer 4 ’ )) - poussant ainsi à l’extrême l’un des aspects de la Terre qui, elle, ne
prend que pour rendre; ils dorment depuis leur sommeil de brutes, enfouis dans les
entrailles du sol 4 2 . Puis les Fleuves, eux aussi enfouis (ainsi le Rhin), mais éveillés,
furieux, cherchant à revenir au Père-Océan et le trouvant toujours, en demi-dieux
qu’ils sont. Enfin, les hommes, eux aussi fils de la Terre et du Ciel, eux aussi
originellement endormis (comme le diamant dans la mine, ou l’étincelle dans le
silex 43), mais capables d’être rappelés à 1’Ether paternel, de s’arracher à la Mère,
355
d’être plus grands qu’elle, ce qui du reste correspond à son désir. A la différence
cependant des demi-dieux fluviaux, l’homme ne peut trouver seul son chemin: il
risque donc de se perdre dans l’errance, mais il peut également ainsi s’élever à ce qui
est plus haut que l’Éther lui-même en tant que simple opposé de la Terre - à
l’englobant absolu qu’on peut appeler être, immédiat ou nature 44 et qui, relevant du
(( monothéisme de la raison »,ne nous concerne pas ici ‘>.
En troisième lieu, après le Ciel et la Terre, nous trouvons entre eux un écart,
une béance qu’on peut considérer de deux façons (d’où la structure tantôt ternaire,
tantôt quaternaire de la mythologie holderlinienne). Cet entre-deux, en effet, apparaît
d’abord comme un espace (( aorgique 46 », un lieu de non-organisation où f a pleut et
ou Ca saigne - car toute séparation implique un élément de peur, de haine et
d’informité («Avec des nuages, l’orage t’abreuve / O sombre sol, mais l’homme,
lui, t’abreuve de son sang 47 »). Considéré sous cet angle, l’entre-deux constitue le
domaine poséidonien de l’orage et surtout du nuage, du lourd nuage noir où Holderlin
voit l’épiphanie de N l’esprit du temps N ou du (( dieu du temps 4R ». Ce lien du nuage
et du temps n’est pas si arbitraire qu’il pourrait sembler. D’une part, en effet, le
nuage dispense la pluie et la foudre, il est ainsi l’organe de la dispensation - donc
du destin; d’autre part (et surtout), comme le montre le poème Der Archipelagus,
toute la carrière du nuage se résume dans l’effectuation d’un retournement (Kehre) il monte de la terre (ou de la mer) jusqu’à l’Éther pour en redescendre porteur des
(( dons des dieux 45, )) (= du rayon de foudre), réalisant ainsi une trajectoire qui est
celle-là même de l’Histoire, voire de toute vie humaine en général, avec à son début
un élan vers l’infini d’en haut qu’amour et douleur recourbent ensuite vers la terre.
Image du temps, le nuage signifie donc un affrontement différé de la présence divine >”
- différé, mais pour cela même d’autant plus violent quand il se réalise dans l’orage,
cet a être-là >’ N insoutenable de Dieu où nous recevons d’un coup ce qui nous a été
longtemps destiné : au point que vivre sous un destin (celui, par exemple, de la
Révolution française) est synonyme de vivre sous un nuage (a et longtemps un orage
divin / A passé sur nos têtes 52 D), 1’Ether d’en haut apparaissant comme le lieu d’où
ce destin provient (« les jours naissent du ciel ») et où inversement le temps revient
se rafraîchir comme dans son berceau 53. Mais, d’une manière générale, ce premier
visage de l’entre-deux présente un côté négatif prononcé : le divin présent dans le
nuage est un divin non reconnu, non nommé, plus tremendzlm que fascinans, et, dans
les ultimes Remarques sur CEdipe, Holderlin insistera sur ce caractère nettement sinistre
et déracinant du Zeitgeist 54.
Mais on peut aussi considérer l’entre-deux d’une autre façon, c’est-à-dire en tant
qu’intervalle franchi, donc organisé, et présentant, dans la lumière, le bon équilibre
de la terre vis-à-vis du ciel 5 5 ». Le nuage désignait une communication différée,
masquée, explosant soudain violemment ; la lumière, au contraire, traduira une
communication, une descente continue, douce et à visage offert, à laquelle Empédocle
souhaitera correspondre en se vouant (( comme la lumière )) à la Terre a sérieuse et
fatidique 56 N. Néanmoins, Apollon présente lui aussi un côté noir, car trop de lumière
dessèche, stérilise, pétrifie, comme il arriva à Niobé, figure, pour Holderlin, du désert,
N (« Dans les zones chaudes, près du soleil, les
i.e. de (( l’excessivement organisé >’
oiseaux ne chantent pas 58 »). Le danger, ici, est donc exactement inverse de celui
présenté par le nuage orageux: il est dans la menace d’une fixation, et non d’un
transport. Reste qu’en définitive l’aspect positif l’emporte largement : si le nuage
poséidonien véhiculait le temps (« l’ange de l’année ») ou 1’« esprit d’inquiétude », la
lumière apollinienne (« ange de la maison N)dé&it au contraire l’espace apaisé, (( l’esprit
de repos H qui se trouve au principe de tout être-chez-soi - le devoir de l’homme lui
imposant seulement de ne pas refouler abusivement l’inquiétant (( esprit d’inquiétude »,
car (( celui-ci aussi est ton fils, ô Nature / N é du même sein que l’esprit de repos 59 D.
3 56
En partant de l’élément de la nature, nous parvenons donc, au terme de cette
première analyse, à une structure à trois (ou quatre) termes qui nous semble fondamentale pour la mythologie holderlinienne telle qu’elle procède - mais avec quel
approfondissement - du schéma fourni par Heinse. Avant de passer sur un autre
plan, qui sera celui de l’histoire, pour vérifier si elle s’y retrouve, nous voudrions
présenter deux brèves remarques indiquant des prolongements possibles.
En ce qui concerne tout d’abord la poétique, il serait tentant, en suivant les
analyses d’Ulrich Gayer
de, faire correspondre les trois puissances divines aux trois
tons de l’œuvre poétique - 1’Ether à l’idéal, la Terre au na$ la lumière (patente ou
voilée) à l’héroique, car l’entre-deux est par excellence le lieu où quelque chose se
passe. D’autre part, et pour reprendre la terminologie de la Démarche de i‘esprit
poétique
1’Ether signifierait l’idée ou 1’« esprit )) du poème, la Terre sa matière
(Stofl, l’entre-deux sa signification (Bedeutung), Cette dernière équivalence semble
d’autant mieux fondée que dès le Metrische Fassung d’Hypérion, Holderlin yoit dans
les nuages un signe (Zeichen) enfermant et transmettant simultanément (( 1’Ether du
royaume de la pensée 62 ». En bref, l’entre-deux apollinien et poséidonien de la lumière
et de l’orage apparaît comme l’espace héroïque de la production du signifiant - ce
qui n’est pas forcément favorable, car, comme le dit non sans mélancolie une lettre
au frère, dans une vie, si bienheureusement (( insignifiante )) soit-elle, il y a toujours
trop de signification 63.
Sur le plan philosophique, maintenant, nous avons vu Holderlin reprendre le
mythe hésiodique de la rupture originelle de l’union ciel-terre - rupture dont l’agent,
chez Hésiode, est Kronos, assez facilement identifiable au Zeitgeist, à la puissance du
nuage orageux qui hante la dimension sinistre de l’intervalle. Cette rupture, Holderlin
l’interprète (avec Plotin) comme signifiant la naissance de la conscience ou (avec
Heinse) comme traduisant le passage de 1’«essence N dans la (( forme )) ou la c limite n
où elle parvient à la connaissance $’elle-même. Pour Holderlin, comme pour ses
compagnons Hegel et Schelling, l’Etre, dans son immédiateté, n’est pensable que
comme (( indifférence 64 )) identité absolue, plénitude de jouissance et d’autosuffisance
où aucune conscience n’est possible; mais cette identité, justement parce que absolue,
est instable, car, sous peine de retomber à l’identité relative, elle doit inclure son
opposé, être identité de l’identité et de la non-identiré, (( lien du lien et du nonlien ». D’où un inévitable éclatement en deux pôles qu’évoque un passage célèbre
des remarques sur Pindare :
L’immédiat, pris en toute rigueur, est pour les mortels impossible comme pour
les immortels; le dieu doit distinguer des mondes différents, conformément à sa
nature, parce que la bonté céleste, de par elle-même, doit être sainte, non mêlée.
L’homme, comme être connaissant, doit aussi distinguer des mondes différents,
parce que la connaissance n’est possible que par l’opposition ‘>.
Comme on le voit, l’identité absolue de l’identité et de la non-identité se brise
inévitablement en identité simple (= le dieu) et en non-identité ( = l’homme, la
conscience) - l’origine de la rupture pouvant être attribuée à l’un aussi bien qu’à
l’autre, mais reposant, en fait, dans l’immédiat lui-même, dans la Wilikfir des Zeus ”.
Mais si l’homme tient le lieu terrestre de la non-identité, de la conscience, c’est, nous
l’avons dit, pour que le divin vienne s’y refléter : d’où, en lui, deux pulsions (rentrer
dans l’identité, maintenir la finitude) qui, comme chez Platon et surtout comme chez
Schiller, se résolvent dans l’amour dont le versant objectif est la beauté h 7 , considérée,
dans l’optique kantienne, comme synthèse phénoménale de l’idéal et du réel, du
céleste et du terrestre - comme identité, donc, mais identité reconstituée, et pour cela
même susceptible d’être appréhendée. Cette ide.ntité re-produite dans la beauté, c’est
précisément ce que Holderlin appelle un Dieu ;
357
L’homme est un Dieu en tant qu’il est beau [...I Mais l’homme divin veut se
sentir lui-même, et pour cela il s’oppose [= s’objective] sa beauté. Ainsi l’homme
se donne ses dieux 68.
L’art, la religion, la philosophie69 - la culture en général - sont les moments de
cette objectivation par laquelle vient au jour un polythéisme historique. C’est lui qu’il
nous faut examiner maintenant.
*
Dire que l’homme est le lieu de la conscience, c’est dire que les dieux ont besoin
de l’homme pour s’éprouver eux-mêmes : comme le dit l’hymne au Rhin :
...parce que
Les Bienheureux ne peuvent rien éprouver Vt/hlen) d’eux-mêmes,
Un autre, s’il est permis
De parler ainsi doit, au nom des dieux,
Eprouver en prenant part
- ou,
dans une variante encore plus précise :
Les Bienheureux n’ont aucun sentiment d’eux-mêmes,
Mais leur joie est
La parole et le discours des hommes 7”.
Mais la conscience humaine ne peut soutenir le poids d’un contenu divin, et
l’exprimer en paroles, que si elle est assez forte pour cela, c’est-à-dire si elle a atteint
son âge adulte; sinon, comme ces enfants goulus que sont les Titans, elle reste accablée
par son fardeau. Puisque donc (( le Dieu qui médite hait / Une croissance prématurée 7 ’ »,force sera aux célestes de laisser la conscience humaine croître indépendamment d’eux, voire contre eux : d’où l’image, fréquente chez Holderlin, de l’aigle qui
jette ses petits du nid pour qu’ils puissent voler seuls
A partir de là, nous obtenons
une structure historique à cinq moments, qui apparaît très tôt chez Holderlin et qui
se décompose de la manière suivante : 1) Un moment d’enfance, individuelle ou
collective, où les dieux sont là de manière immédiate (« j’ai grandi dans les bras des
Dieux 7 3 P - i.e. au nid de l’aigle), où le divin apparaît donc comme élément ou
comme nature, sans qu’il y ait encore de religion au sens propre d u terme. 2) Un
moment de séparation où les dieux se retirent dans la nuit de l’inconscient - sur nos
têtes 74, ou sous nos pieds - et cessent donc de nous être présents. 3) Un moment
de retour, mais dans un éclat éblouissant, qui provoque 4) une nouvelle cécité 7 5 ,
due cette fois non à un retrait, mais à un excès de présence, et qui dure autant que
le travail d’appropriation de ce contenu dans 5 ) une forme qui le fixe définitivement,
et où la semence reçue au moment (3) donne son fruit le plus haut 76
’*.
Asie (1)
Grèce
Hespérie (5)
Mais il ne suffit pas de parler, comme nous l’avons fait jusqu’à présent, des
dieux )) en général. En fait, nous l’avons vu, il &existe deux puissances divines
fondamentales, le Ciel (= l’Éther) et la Terre - car l’Eue, l’Immédiat veut et ne veut
pas d u nom de Dieu, aurait dit Héraclite, et, quant aux puissances de l’entre-deux,
la lumière et l’orage, nous les retrouverons plus tard. Par conséquent, nous aurons
((
358
affaire, semble-t-il, à deux processus religieux indépendants, l’un voué au feu céleste
(la Grèce 7 7 ) , l’autre à la Terre (1’Hespérie ou l’occident). Mais en fait, ces deux
processus vont s’articuler comme les deux moments successifs d’une histoire unique,
dans la mesure où le feu céleste et la Terre se rapportent l’un à l’autre comme le
contenu à recevoir et la forme (ou la fixation) à opére:. La conscience grecque naît
au sein du flamboiement oriental (ou asiatique) de l’Ether, dans un état extatique
dont elle se détache pour se donner une culture propre; au terme de ce processus
culturel, avec Empédocle, elle se retourne vers sa source ignée et s’y consume, mais
non sans en avoir reçu, telle Sémélé, une semence qu’elle transmet en l’enfouissant
dans la terre de la conscience occidentale; celle-ci, d’abord désorientée (ou rendue excentrique) par ce contenu étranger 78, finira par revenir vers soi en lui donnant une
forme définitive. Les deux consciences - la grecque et l’hespérique - seront donc
contraintes d’agir chacune contre son (( élément )), sa nature, i.e. son Dieu encore non
reconnu. Le Grec, dont l’élément est le feu du ciel, 1’Ether indifférencié, devra, pour
accéder à une conscience adulte, distinguer, différencier, organiser, élaborant ainsi un
polythéisme simultané où les dieux correspondent aux différentes sphères d’activité
dans lesquelles l’individu est inscrit au sein de la cité 7 9 ; à la fin seulement, avec
Empédocle, (( chant du cygne )) de la Grèce authentique, on trouvera un retour à
l’unité, mais effectué sous une forme catastrophi,que, puisque le héros finit par se jeter
dans l’Etna, lieu privilégié de la descente de 1’Ether dans le sein de la Terre-Mère lieu, donc, de leur fusion, où se résorbe tout dualisme. L’Occidental, quant à lui,
dont l’élément est la Terre, la différence, le repli sur soi, devra s’élever jusqu’à la
saisie du Dieu Un, sa culture sera monothéiste, jusqu’à ce qu’intervienne, là aussi,
un retournement, une Kehre faisant surgir - peut-être, nous le verrons, dans l’œuvre
même de Holderlin - son polythéisme naturel. Pour l’instant, nous nous bornerons
à deux remarques générales qui valent pour les deux évolutions.
Tout d’abord, chaque époque se construit sur le refoulement de ce qui constitue,
pour la nation considérée, son élément divin ou naturel, auquel est substitué un
univers culturel, artificiel : opposition que Holderlin illustre par celle de Saturne (qui
règne sur l’âge d’or de la nature) et de Jupiter (qui possède (( l’art de la souveraineté n). Mais au sommet - au milieu - de la trajectoire se produit une Kehre par
laquelle Jupiter doit redescendre vers le Saturne dont il est sorti. Si ce retournement
est manqué, il y a danger que le divin refoulé et asservi revienne de lui-même de
manière catastrophique et sauvage, entraînant la ruine pure et simple de la culture.
Tel fut peut-être le destin de la Grèce :
Ils voulaient fonder
Un empire d e l’art. Ce faisant pourtant était le natal (das Vaterlandisrhe)
Par eux manqué, et lamentablement
La Grèce, le Plus Beau, sombraX2.
Certes, un héros (( jupitérien 83 )) tel qu’Empédocle opère bien le retour à l’indifférencié, en proclamant lui-même que (( le temps des rois n’est plus 84 », mais il le
fait en (( suicidé de la société », de manière expiatoire 8 5 et purement négative, par
une abolition de la pesanteur, i.e. de la sobriété qui empêche de (( tomber vers le
haut x6 )) (a La pesanteur tombe ,/ La vie éthérique fleurit par-dessus 87 D). Pouvait-il
d’ailleurs en aller autrement? Un retour au feu du ciel )) n’est-il pas obligatoirement
destructeur? Les Grecs, comme Sémélé, ont du moins eu le temps de recevoir une
semence divine et de la transmettre à l’occident : c’est pour nous qu’ils se sont sinon
suicidés, du moins réduits à l’état de ruines, comme l’indique l’admirable poème
(( Lebensalter », qu’on nous permettra de citer ici intégralement (en lisant au vers 10,
avec F. Beissner, darein plutôt que deren) :
O cités d e l’Euphrate!
O rues d e Palmyre!
359
Vous, forêts de colonnes aux plaines du désert!
Qu’est-ce donc que vous êtes?
Vos couronnes
Parce que vous avez transgressé les limites
Des êtres qui respirent
Par les vapeurs fumantes et le feu
Des divins vous furent ôtées.
Mais maintenant je suis assis sous des nuages (dans lesquels
Chaque chose a son repos propre) sous
Les chênes en belle ordonnance, sur les
Bruyères de chevreuil, et m’apparaissent
Etrangers, morts
Les esprits des bienheureux ss
-
Le nuage - l’esprit du temps apporte donc en Occident la semence de la Grèce
pour qu’ici semée, elle porte fruit - comme si I’Hespérie, et plus particulièrement
l’Allemagne, était en quelque sorte l’automne du printemps hellène :
Ô vous joies d’Athènes, ô vous exploits de Sparte
Précieux printemps grec! Quand mtre
Automne vient, quand vous avez mûri, esprits de l’Antiquité,
Revenez et voyez! L’accomplissement de l’année est proche
Mais - et ce sera là notre seconde remarque - il est impossible d’éviter la
question suivante : qu’est-ce donc qui arrache l’homme, dans chaque évolution, à son
élément naturel et natal, le forçant à quitter la source où il se (( consumerait )) pour
aller vers la (( colonie )), l’étranger de la Bildang? C’est ici que nous allons voir
ressurgir les dieux de l’entre-deux, les lumineux (apolliniens) et les orageux (que
nous avons appelés poséidoniens) : ce sont eux, en effet, qui vont assurer la médiation
historique nature-culture, comme ils assuraient déjà la médiation naturelle Ciel-Terre,
et la dédicace d’Hypérion souligne d’ailleurs l’homologie structurelle de ces couples,
en opposant le (( Ciel de l’enfance )) ou de l’état de nature au Land der Kaltar 9’. En
Grèce, cette médiation sera opérée par les dieux de type apollinien, essentiellement
Dionysos et Hercule. O n sera sans doute surpris de trouver ici Dionysos défini comme
apollinien, mais, pour Holderlin comme pour Schelling, il faut rappeler que ce Dieu
n’est nullement un dieu de l’ivresse, mais un dieu civilisateur, conquérant et agriculteur
qui éveille les peuples de leur sommeil naturel et (( contient leur Todestzlst 92 )) - la
pulsion mortelle qui les ramènerait à la source. Quant à (( Hercule le purificateur 93 )),
il apparaît, dès un hymne de 1796, comme celui qui libère l’enfant (= la conscience)
de (( la table et de la maison maternelle 94 )) - il est celui qui détruit les monstres,
refoule l’informe, établit un monde organisé et habitable, en association avec les
Dioscures dont Holderlin dira qu’ils ont, comme Hercule, (( lutté avec Dieu 9 5 ». En
ce qui concerne maintenant l’occident, le rôle du médiateur y sera naturellement
assumé par le Christ, mais, pour Holderlin, le Christ est avant tout der Gewittertragende, le (( porteur d’orages 96 »,le nuage lourd et fatal dont la Pentecôte fut le premier
éclat - ce en quoi il s’oppose radicalement à Hercule dont Holderlin nous dit qu’il
(( a craint cela )) (à savoir le signe céleste, la foudre 97). Nous obtenons donc ainsi une
structure du polythéisme historique qui recouvre exactement celle dégagée plus haut
(p. 336) d u polythéisme naturel :
Nature
Hercule
(Dionysos)
Jésus-Christ
.1
1
Culture
360
Ce schéma se retrouve encore (avec réduction à l’unité des deux figures de la
médiation) si on envisage maintenant le processus historique dans sa totalité : l’Asie
correspond alors à l’Ether, la Grèce à la lumière médiatrice, l’occident à la Terre.
L’Asie, comme l’Éther, est commencement absolu, verbe brut
qui déferle vers
l’extérieur (i.e. vers l’ouest), révélation opaque qui ne se comprend pas elle-même
et attend donc l’écho occidental - cet écho que lui ramène le Danube, d’ouest en
est. En contraste à cette Parole exubérante, la Terre occidentale apparaît, dans Germunien, sous les traits d’une jeune vierge muette et passive, recevant, telle Marie,
l’annonciation que lui apporte l’aigle venu de l’Indus, et qui est précisément une
invitation à parler, à (( nommer la Mère 99 ». Enfin, entre le K O ~ oriental
O ~
et la nevicr
occidentale, la Grèce, comme dans le mythe du Banquet, occupe la place médiatrice
de la lumière, de la beauté et de l’amour. C’est ce que traduit à sa manière l’étrange
mythe ethnique de Die Wunderung, qui fait naître la race grecque, (( la plus belle
race humaine à jamais iOo », de la rencontre, près de la mer Noire, d’une tribu
germanique émigrant vers l’est lumineux et d’orientaux du Caucase qui, au contraire,
(( cherchaient l’ombre )) : deux éléments qu’à la conclusion d’iiypérion, lorsque tout
est fini pour la Grèce, nous voyons se séparer à nouveau - Alabanda et Adamas
gagnant l’Asie, et Hypérion lui-même l’Allemagne ‘O1.
Mais, dans cette onde de la culture, dans ce jeu de cache-cache entre le Ciel et
la Terre, le divin et la conscience humaine, il existe des nœuds où se résout le conflit
des éléments, des points d’égalisation où surgit la figure de l’Homme-Dieu (Guttmensch) que tout ce processus, rappelons-le, a précisément pour seule fin de produire.
Ce sont ces figures qu’il nous faut maintenant examiner pour conclure.
*
On trouve, chez Holderlin, différents symboles pour l’égalisation d u Ciel et de
la Terre. Un des plus immédiats est la couleur verte, où la Furbenlehre de Goethe
voit également la synthèse du jaune (première couleur de la série positive) et du bleu
(première couleur de la série négative) et la seule couleur qui donne à notre œil
pleine satisfaction : de même, pour Holderlin, le feu du ciel est jaune, la terre bleue
(veilchenbluu
et le vert surgit lorsque Ciel et Terre s’égalisent et se tempèrent
sans que l’un élimine l’autre (comme au désert d’Afrique ou aux glaces polaires) couleur de la patrie, nous l’avons dit, et des (( prairies humides de la Charente ‘O3 ».
Le pain et le vin sont d’autres symboles de la même union, mais sur un plan
(( sentimental )) et commémoratif, et non plus naïf, comme pour la couleur des (( verts
paradis D; le pain, (( fruit de la terre ... béni par la lumière », se rattache d’ailleurs à
la médiation apollinienne, alors que (( la joie du vin vient d u Dieu tonnant ‘O4 )>
lorsqu’il s’enferme dans le sol pour y donner fruit. Enfin, nous avons déjà rencontré
un ultime symbole dans la figure de l’Amour, fils (donc égalisation) de Poros et de
Penia, (( plante céleste N nourrie des (( forces du nectar éthérique », et qui jaillit même
du <( sol farouche )) de l’Occident : comme l’indique le poème Vulkun IO6, il n’est
certes vraiment chez lui qu’en Grèce, mais jusque dans notre hiver hespérique il reste
toujours là, retourné seulement vers l’intérieur, tel un foyer chaud dans la cabane
exposée aux blizzards...
Néanmoins, ces différents symboles ne trouvent leur vérité que dans leur rapport
à la véritable égalisation, celle qui s’opère dans l’Homme-Dieu, et dont Holderlin
nous offre trois figures qu’on peut situer respectivement à l’origine, au terme du
moment grec et au terme final de l’histoire : Diotima I”’, Empédocle et Jésus-Christ.
On peut parler, à ce propos, d’une égalisation s’opérant successivement selon trois
modes - naïf, héroïque, idéal - et cette application des catégories de la poétique
n’aura rien de déplacé ici : Diotima, en effet, est une pure fiction, Empédocle agit
comme représentant par excellence de tous les héros tragiques grecs, et quant au
Christ, il nous faut l’envisager ici comme dépouillé de sa réalité historique concrète
(son vêtement de travail) et dans sa forme dominicale de Prince de la Paix, plus
accessible au poète qu’au croyant. C’est bien, en définitive, l’hymne poétique qui
constitue le vrai lieu de l’égalisation du Dieu et de l’homme :
Car les dieux comme les hommes, gibier solitaire,
Et les dieux mêmes, au ralliement (Einkehr) les conduit
Le chant
ion
Diotima, tout d’abord, est (( une fleur parmi les fleurs )) où (( les forces de la
Terre et du Ciel se conjuguent amicalement
)). Pour cela, elle n’a besoin de nul
effort et de nulle Bildung ; il lui suffit d’être elle-même («si nous pouvions créer ce
que tu es i i O ! », soupire son amant) et, par sa seule présence, telle Vénus Urania, elle
ordonne autour d’elle le déchiré et l’aorgique I I I . A la conscience tourmentée d’Hypérion, elle apparaît comme une plénitude à la fois accablante et fragile qui remplace
pour lui (( tous les dieux du ciel et tous les hommes divins de la terre
», comme
une île de perfection primitive dans un monde d’autant plus chaotique qu’il est plus
cultivé. Mais l’un des éléments de ce divin alliage - l’élément terrestre, la pesanteur
- est trop faible, faute d’avoir pu s’affirmer à part, et c’est ce qui dès le début
condamne l’héroïne. Sa mort sera une chute vers le haut, une autoconsumation par
la (( flamme amoureuse I l 3 )) de 1’Ether qui en elle était déjà prédominante et que son
amant, en lui servant de miroir réflecteur, a imprudemment exaltée : elle finira
», comme la (( belle âme n hégélienne dont elle est peut-être
littéralement (( fanée
un des modèles.
Pour Empédocle, il sert d’exemple, nous dit Holderlin, pour (( tous les personnages tragiques qui, dans leurs caractères et leurs expressions, ne sont que des tentatives
N - i.e. les problèmes
plus ou moins réussies pour résoudre les problèmes du destin
posés par l’égalisation Dieu-homme. Empédocle est le (( chant du cygne )) de la Grèce,
d’un monde où l’élément divin et naturel (le (4 feu du ciel ») a été (( chômé », refoulé,
prenant ainsi une coloration maléfique et à la limite mortelle, alors que la conscience
humaine atteignait, dans la culture, un développement unilatéral. Unir cette conscience
hyperformée et cette nature aorgique pour que naisse, dans leur milieu (Mitte I l 6 ) le
divin proprement dit, telle est la tâche du héros, de l’homme capable de (( suspendre
sa subjectivité », de (( s’arracher à son centre et à soi ‘ I 7 n pour se laisser pénétrer par
la Chose même, la Nature, si bien que par lui (( l’esprit de l’élément, sous forme
1) - nature et culture s’unissant dans la
humaine, habite parmi les hommes
souveraineté d’une thaumaturgie permanente. Mais le héros n’occupe cette place de
Dieu présent qu’à condition de se maintenir à l’état de plaque tournante, de lieu
neutre où l’humain conscient et l’élémentaire divin échangent leur détermination : si
la subjectivité revient, si le héros ose proclamer ((Je suis Dieu
N (il l’est, en effet,
mais à condition de ne pas le dire et de ne pas même s’en apercevoir), il en résulte
pour lui un rejet immédiat, et la nécessité d’expier en se jetant tout entier dans
l’informité divine - ici, le cratère de l’Etna. Tel sera aussi le sort d ’ w i p e , dont le
péché est la curiosité démesurée, la volonté de savoir, l’œil en trop 12” »; tel également
celui de Créon, représentant excessif du pouvoir royal, de la loi du jour, de la puissance
d’organiser, alors que (( le temps des rois est passé N (Antigone, de son côté, éprouve
une fascination non moins excessive pour l’au-delà, le monde des dieux et des morts).
Précisons du reste qu’il ne s’agit pas ici de défaillances morales simplement individuelles : en fait, il est impossible que le divin, la conjonction de l’élémentaire et de
l’humain, se maintienne indéfiniment dans un individu sensible et matériel. Une telle
unité, en effet, serait trop intime et trop singulière (einzig) », et, de plus, en
faisant de l’absolu - l’identité de l’idéal et du réel, de l’essence et de la forme quelque chose de U positif 1) (au sens hégélien du terme), elle déboucherait sur la
362
superstition. D’où, pour le héros, même non-transgresseur, la nécessité de mourir,
s’effaçant ainsi devant ce qu’il manifeste :
Pour n’être pas, quand il s’est manifesté, le fils
Plus grand que les pères, pour que l’Esprit
Sacré de la vie ne reste plus enchaîné,
Oublié à cause de lui, l’unique,
I1 se jette, l’idole de son temps, à l’kart,
De lui-même, afin que nécessité sur lui,
Le pur, soit accomplie d’une main pure,
Il brise son propre bonheur, son excès de bonheur,
Et à l’Élément qui le magnifiait
Il rend, mais plus pur, ce qu’il a possédé 122.
- destin où se vérifie la célèbre définition du tragique proposée par les Remarques sur
Antigone : (( Un devenir-un illimité purifié par une séparation illimitée
qu’Holderlin explicite ainsi dans une lettre à Schütz :
123
», et
Le dieu et l’homme semblent un, puis un destin vient susciter toute l’humilité et
tout l’orgueil de l’homme, et si d’une part il aboutit à la vénération due aux
Dieux, de l’autre il laisse l’homme en possession d’une âme purifiée ‘24.
Union du Dieu et de l’homme, inflation de la conscience qui s’approprie la divinité,
séparation purificatrice : telle est la trajectoire tragique, au terme de laquelle nous
retrouvons d’un côté une conscience humaine rappelée à la mesure, et de l’autre un
Dieu retourné à sa transcendance, donc à son inconscience - double échec, qui est
finalement, pour Holderlin, celui du monde grec lui-même.
C’est avec le Christ que nous allons rencontrer la plus haute et la plus authentique
figure de l’Homme-Dieu. Certes, pour Holderlin comme pour Schelling, le Christ
est d’abord le dernier des dieux grecs IZS, le (( frère ‘ 2 6 )) d’Hercule et de BacchusDionysos avec qui il compose un même trèfle à trois feuilles. Néanmoins, il existe
entre eux une différence fondamentale : Bacchus et Hercule sont des dieux de la
Bifdung et du pouvoir, un (( cultivateur )) et un (( chasseur )) - le Christ, lui, est un
(( mendiant »; ou encore, (( Hercule est tel un prince, et Bacchus l’esprit commun
[tyrannie et démocratie, les deux pouvoirs grecs par excellence], mais le Christ est la
fin IZ7. )) La fin de quoi? demandera-t-on. Le grand poème inachevé Patmos nous
fournit peut-être une indication de réponse, en rapportant que le jour où le Christ
disparut de la terre
Le jour du soleil s’éteignit,
Le jour royal, et divinement souffrant
De lui-même il brisa
Le sceptre aux rigides rayons de flamme I**,
le sceptre, précise une variante, (( avec lequel il avait régné à partir de l’Asie, depuis
des temps insondables 129 ». Tout se passe donc comme si, sous la forme du Christ,
une même puissance divine brisait le sceptre du pouvoir qu’elle avait exercé sur la
conscience humaine en tant qu’Hercule et Dionysos - scénario assez proche de celui
de la beaucoup plus tardive Philosophie de f a Réuéfation de Schelling, dans laquelle
une puissance illégitime (Kronos) s’empare de la conscience humaine à la place du
vrai Dieu et se trouve ensuite refoulée par la deuxième personne divine sous la forme
d’Hercule et surtout de Dionysos, jusqu’au moment où celle-ci, ayant triomphé,
abdique son pouvoir devant le Père en s’incarnant et mourant. Hercule et Dionysos,
objectera-t-on, sont aussi des dieux qui meurent et ressuscitent. Sans doute, mais leur
363
mort se situe sur un plan purement mythique et a imaginal », alors que celle du
Christ est effective; en cela, précise Holderlin, a il est d’une autre nature et accomplit
», et il représente a l’action
ce qui a manqué encore en présence aux autres Dieux
la plus extrême de Dieu
)) dans son approche de l’homme. D’autre part, la mort
des dieux grecs (songeons à Hercule) signifie leur disparition dans l’au-delà et la fin
de leur action sur l’homme; la mort du Christ est au contraire pour lui un moyen
de communiquer, de semer plus efficacement sa divinité dans l’homme, en voilant sa
lumière non seulement dans l’ombre d’un enseignement indirect, mais dans l’a ombre
plus noire 1 3 * )) de la mort. La mort d u Christ, en effet, trouve lieu sous le règne du
a Zeus le plus propre »,du Zeus occidental dont le caractère est de (( retourner (kehren)
le désir de quitter ce monde pour l’autre en un désir de quitter l’autre monde pour
celui-ci 1 3 3 »; en même temps, elle marque le passage du médiateur lumineux (patent)
au médiateur caché dans le nuage - le Christ étant lui-même cette nuée d’orage
planant sur tout le cours de l’histoire occidentale et arrosant la Terre d’une pluie de
sang sacrificiel. Telle sera l’ambiguïté foncière du christianisme : son Dieu est un
Dieu caché, inconnu, mais à ce monothéisme nocturne, sans point commun avec le
monothéisme immanentiste de l’Asie, se juxtapose le souvenir incontournable d’une
personnalité concrète à jamais disparue - formule qui sera, pour Hegel, celle de la
conscience malheureuse. Dans cette optique, l’ère chrétienne est une période proprement sans Dieux, faite de souvenir et de pressentiment sous un ciel lourd d’orage,
où seule la Madone tient la place du divin disparu 134.
Néanmoins, dès les années de Tübingen, on trouve chez Holderlin l’idée d’un
retournement possible du christianisme, débouchant sur ce qu’il appelle énigmatiquemen; a nouvelle Eglise 1 3 5 P; (( royaume de Dieu 136», a venue du Seigneur 13’ »,
voire (( Eglise esthétique 138 )) - ce qui a permis au P. de Lubac de l’enrôler dans la
postérité bigarrée de Joachim de Flore. En fait, ce que signifie cette nouvelle Eglise,
c’est fondamentalement le retour du polythéisme, que Diotima annonçait déjà à
Hypérion :
Nous fêterons les fêtes des saints (Heiligen) de tous lieux et de tous temps, des
héros de l’Orient et de l’occident; alors, chacun de nous en choisira un. .. l 3 9 .
La Grèce, monothéiste par nature, avait élaboré une culture polythéiste, puis tenté,
et manqué, un retour à l’Unique; l’occident, polythéiste par nature, a reçu l’éducation
du monothéisme, et doit maintenant réussir son retour au multiple. Mais alors que
le polythéisme grec était, nous l’avons dit, un polythéisme simultané, fondé sur la
coexistence de dieux fonctionnels, le polythéisme hespérique sera, comme aurait dit
Schelling, un polythéisme successif, et pour cela même non contradictoire au monothéisme : il reconnaîtra le retour, au fil de l’histoire, d’une même puissance divine
qui s’est appelée Hercule, Dionysos, Apollon - Jésus-Christ.
Donnez-nous, qui sommes fils de la Terre adorante
En tel nombre qu’ait grandi
Les fêtes, de les fêter, toutes, de ne pas tenir
Le compte des Dieux, un pour tous est à jamais 14”.
Cette reconnaissance implique, néanmoins, un changement radical d’attitude ii
l’égard de la figure d u Christ, en qui l’homme devra cesser de voir un Dieu exclusif
qui interdirait démesurément d’honorer tous les autres. Nulle part cette mutation n’est
mieux décrite que dans l’ébauche en prose de Frieden.rjieier, la (( Fête de la paix », où
il faut voir non certes la glorification du traité de Lunéville, mais plutôt l’évocation
de cette Toussaint spéculative déjà rêvée dans Hypérion et que domine la figure du
prince de la Paix - i.e. du Christ en tant qu’il n’est plus posé à part des autres
Dieux :
364
Nous sommes un chœur. C’est pourquoi tout le divin qui fut nommé, un
nombre [maintenant] clos, doit, sacré, sortir pur de notre boucle.
Car vois! c’est le soir du temps, l’heure où les voyageurs se dirigent vers le lieu
de repos. Bientôt entre un Dieu après l’autre, mais [afin] que leur Plus-aimé, à
qui ils sont tous suspendus, ne manque, et que tous soient un en toi, et tous les
mortels que nous connaissons jusqu’ici.
C’est pourquoi sois présent, Adolescent. Nul, comme toi, ne vaut pour tous les
autres. C’est pourquoi ceux à qui tu l’as accordé ont parlé toutes les langues et
toi-même l’as dit, qu’en vérité nous adorerons sur les hauteurs et spirituellement
dans les temples. Tu étais bienheureux alors, mais plus encore maintenant qu’au
soir nous te nommons avec les amis et chantons ceux d’en haut et que tous les
tiens sont autour de toi. Le vêtement est dépouillé maintenant. Bientôt autre chose
encore deviendra clair, et nous ne le craignons point 14’.
Sur ce texte extraordinaire, le plus parfait résumé, sans doute, de la a théologie ))
de Holderlin, quelques remarques pour conclure :
1) La Fête se situe au soir du temps. Le soir est le moment du souvenir, de
l’Er-innerung, de la récapitulation qui est reprise et intériorisation. Comme le savoir
absolu de Hegel, le polythéisme hespérique sera donc une Er-innerang, un temps
retrouvé rendu possible par le fait que le chiffre des Dieux est désormais fermé et
complet (gescbiossen). Le soir (de l’année), c’est aussi l’automne, temps du fruit, c’està-dire du poème (« donnez-moi un automne »,dit une prière aux Parques 14*), et cela
nous laisse pressentir que la réminiscence sera l’œuvre des poètes, et la nouvelle
religion, donc, une religion de la Lettre, sinon de la Littérature, vouée au service de
(( la lettre solide N 143 - conformément, d’ailleurs, au génie propre de l’Occident.
2) Tous les dieux (tous les voyageurs) viennent se reposer, en ce soir du monde,
dans l’a auberge 144 )) de la conscience humaine, mais tous restent (( suspendus )) au
(( Plus-aimé 1) - au Christ. I1 n’est pas question, donc de renoncer à celui-ci - il suffit
de faire disparaître son état de tension avec les autres Dieux, a de concilier le
conciliateur 1 4 5 »,en quelque sorte. Comme dernière figure, le Christ (( vaut pour tous
les autres )), à condition seulement qu’on le a dépouille de son vêtement )) (de son
N manteau 146 )), dit ailleurs Holderlin), c’est-à-dire qu’on cesse de l’identifier exclusivement à Jésus de Nazareth : à la Fête de Paix des Dieux, le Christ ne vient pas
en vêtements de travail, mais en (( habit de fête 14’ )) - il se révèle comme (( plus
grand que son champ [d’action] », comme (( le Dieu des Dieux 14H »,comme l’archétype
de l’envoyé, du conciliateur en qui s’accomplit la conjonction Ciel-Terre. Ce changement d’habit, Holderlin le traduira aussi, dans le poème An eine Fzlrstin uon Dessau
par la transition glorifiante du nuage à l’arc-en-ciel 149 : la lumière, qui s’était éteinte
quand le Christ avait quitté la terre, revient, mais N plus spirituelle (geistiger) Is” )) et
comme signe d’une alliance désormais établie non seulement entre Ciel et Terre, mais
entre les différents visages du médiateur qui s’égalisent à celui du Christ au fur et à
mesure que celui-ci se spiritualise
3) Cette égalisation des conciliateurs en une figure unique - celle du Christ qui les signifie tous, laisse néanmoins subsister l’énigme, déjà évoquée plus haut, du
divorce originel entre Poros et Penia, le Ciel et la Terre. Pour résoudre ce dualisme,
le procédé le plus facile, qu’Holderlin lui-même ne repoussera pas toujours, ,consistera
à le traduire en termes philosophiques, à l’exprimer comme opposition de 1’Etre et
de la conscience, de l’idéal et du réel, de l’essence et de la forme, voire de la substance
et du mode : on aboutit alors sinon à l’idéal (( monothéisme de la raison », du moins
à un monisme spéculatif. Inversement, le plan du (ou des) médiateur(s) apparaît,
dans le cours de l’œuvre de Holderlin, comme de plus en plus irréductible à la
philosophie - chaque figure divine de l’entre-deux (Héraclès, Dionysos, Apollon,
Jésus-Christ) acquérant une réalité dont le caractère positif va croissant. Si on abandonne
donc Pyas et Penia au langage commun des penseurs, il ne reste plus qu’à dire ceci :
dans l’Eue, il y a à la fois une jouissance sans limites et une souffrance, une déchirure
365
permanente; quelqu’un (le Dieu) franchit cette faille, et cela d’une manière multiple,
mais systématisable. Entre ce qui jouit et ce qui souffre, les Dieux sont un pont, qui
pour Holderlin, s’effondrera en 1805, le projetant dans l’univers tout autre, radicalement démythologisé, des derniers poèmes, où, dans le cours des saisons, ciel et terre
se regardent à travers un espace devenu - enfin - insignijant.
Jean-François Marquet
NOTES
1. Pour la discussion de ce point, nous nous permettons de renvoyer à notre étude Liberté et Exirtence,
Paris, 1973, p. 73 54.
2. Holderlin, Siimtiiche Werke, Grorre Stuttgarter Ausgabe, I V , p. 298-299. Toutes nos citations
renvoient à cette édition.
3. Schelling, Sirmtliche Warke, éd. Cotta, X I , p. 15.
4. lbid., V, p. 664.
5. lbid., p. 445.
6. GSEA, V I , p. 437.
7. Der Wanderer (2c version), ibid., II, p. 83. Pour d’autres exemples de cette triade, cf. (entre autres)
Arbill (ibid., I, p. 271), Gtter wandeiten einrt (ibid., I I , p. 274), Griecbeniand (3‘ version, ibid., II,
p. 257), Hyperionr Jugend (ibid., III, p. 224), Hypérion (ibid., III, p. 147), Der Tod der Empedokier
(versions I et II, ibid., I V , p. 18, 53, 106).
8. Germanien, I I , p. 152.
9. Sophnkier. Antigone, V, p. 253. Dans Emiiie uor ibrem Brauttag ( I , p. 284), on retrouve la même
trinité sous des noms de divinités germaniques : Walhalla (l’éther), Hertha (la terre) et Braga (dieu de
la poésie qui tient la place d’Apollon).
10. Hyperions Jugend, III, p. 224.
11. Cf. Ardingheiio, éd. Baeumer, Stuttgart (Reclam), 1975, p. 269-272.
12. Ibid., p. 271 et 310.
13. Sur ce côté terrestre et plutonien de Junon, cf. par exemple Creuzer, Symboiik (Yéd.), réed.
Hildesheim, 1973, III, p. 2 13, avec références à Plutarque et Eusèbe (cf. Eusèbe, Préparation évangélique,
III, 1, 4).
14. Homère, Iiiade, I, v. 400.
15. Cf. Wenn aber die Himmiirchen, I I , p. 222 ( a ...da den Donnerer bieit
Unzürtiirh die gerude
...
Tacher.. . v )
1
16. Schelling, SW, I V , p. 329.
17. Der Archipelagus, II, p. 103. Sur cet aspect de Poséidon, cf. Homère, Iizade, XIII, v. 10 et les
références classiques résumées par Creuzer, op. rit., III, p. 260.
18. Hypérion, III, p. 112.
19. lbid., III, p. 50. Rappelons que le mot allemand Lufr est du genre féminin.
20. Une même idée est à ta base de l’ouvrage de Schelling Die Weitreeie (1797).
21. Cf. Hyperion Metrisrhe Farmng, III, p. 193.
22: Sur cette a jouissance )) (Genusr) de l’absolu, cf. le bref essai de Tubingen sur Jacobi, I V , p. 208.
23. Cf. Hyperions Jugend, III, p. 204. (U Er irt ummoglirh fur uns, da5 mangellose in5 Bewurstrein
aufzunehmen. v ) .
24. Cf. Hypérion, III, p. 54, et Emilie vor ibrem Brauttag, I , p. 278.
25. U Lebensfunken rate / Befrurbtend... der Ather Y (Der Tod der Empedokies, 2‘ version, I V , p. 102).
26. Vater Ather (An den Ather, I , p. 204, et parrim).
27. Stimme des Voiker (2c version), II, p. 5 1. Cf. aussi Hyperionr Jugend, III, p. 206.
28. Cf. Hyperion Metrirrbe Farsung, I I I , p. 195.
29. C’est le thème du poème Hyperions Schicksalslied, I, p. 229.
366
30.
3 1.
32.
33.
34.
fumée
35.
36.
37.
38.
Lettre du 4.12.1801 à Bohlendorff, VI, p. 426.
Dar Gebirge... / Dar Mutterlicbe Y ( A n Eduard, 2' version, II, p. 42).
Die Wanderung, II, p. 138.
Hypérion, III, p. 54.
Der Tod des Empedokles, 3=version, IV, p. 139. Les U bras de feu N désignent ici la colonne de
U
de l'Etna.
Cf. Hypérion, III, p. 140, sur la terre comme U Folie (= tain) des leucbtenden Himmeis ».
Der Wanderer ( V O ~ ~ J JI , Up.~206.
~ ) ,Der Rhein (variante au v. 178), II, p. 728.
Der Wanderer, II, p. 80.
Heimkunft, II, p. 96.
39. Der Mutter Erde, I I , p. 123-124 (trad. Ph. Jaccottet). Cf. aussi le début du fragment Wenn aber
die Himmliscben, I I , p. 222.
40. Ainsi celui de Heidelberg (cf. le poème de ce titre, II, p. 14).
41. Lettre à Bohlendorff du 4.12.1801, VI, p. 247. Sur l'oubli du U remerciement w (Dank), cf.
Emilie vor ihrem Brauttag, I, p. 295-296.
42. Cf. par exemple Menom Klagen, II, p. 77.
43. Hypérion, III, p. 52.
44. Cf. Der Mensch, I, p. 263; Wie wenn am Feiertage..., I I , p. 118; Hyperion, Vorletzte Fassung, I I I ,
p. 236.
45. Les chênes sont aussi des enfants de la Terre (= de la montagne) et du Ciel, chacun d'eux étant
un monde U comme les étoiles du Ciel w (Die Eicbbaürne, I , p. 201).
46. Lettre à Schelling de juillet 1799, VI, p. 347 et passim.
47. An Zduard (2'version), II, p. 41.
48. Der Zeitgeist, I, p. 300.
49. Der Arcbipelagus, II, p. 104.
50. Cf. Lebenslauf, I, p. 247; et II, p. 22.
5 1. Giecbenland (3' version), I I , p. 257.
52. An eine Fürstin von Dessau, I , p. 309.
53. Heimkunft, II, p. 28.
54. Anmerkungen zur Antigonae, V, p. 266.
55. Lettre à Seckendorf, 12.3.1804, VI, p. 437.
56. Der Tod des Empedokles (2'version), IV, p. 18.
57. Anmerkungen zur Antigonae, V, p. 267.
58. Hypérion, III, p. 30. Ce thème est d'ailleurs constant dans Hypérion.
59. Die Musse, I, p. 237. La référence aux U anges n, vient bien entendu d'Heimkunfr.
60. Der gesetziiche Kalkül. Holderlins Dicbtungslebre, Tübingen, 1967. Mais la dette d'Holderlin
envers CEtinger nous semble très exagérée dans le livre d'U. Gayer.
61. IV, p. 244.
62. III, p. 195.
63. Lettre d'août 1797, VI, p. 247.
64. Tbeoretische Versucbe, IV, p. 237.
65. Pindar-Fragmente, V, p. 285 (trad. F. Fédier).
66. Uber den Unterscbicd der Dichtarten, IV, p. 269.
67. Cf. Hyperion Metrircbe Fassung, I I I , p. 195.
68. Hypérion, III, p. 79.
69. Cf. lettre au frère du 4.6.1799, VI, p. 329.
70. II, p. 145.
71. Wenn aber die Himmliscben, I I , p. 225.
72. Cf. par exemple Stimme des Voiks (2=version), I I , p. 50; et Der Tod des Empedokles (1" version),
IV, p. 62-63.
73. Da icb ein Knabe war, I , p. 267.
367
74. Cf. par exemple Brot und Wein, II, p. 93.
75. Ibid., p. 92.
76. Cf., à la fin du Thalia-Fragment d’Hypérion, l’image de l’enfant endormi dans son berceau
( = Asie), puis ébloui par la lumière du jour ( = Grèce) et retournant son visage vers la Terre (= Occident)
(III, p. 184).
77. Nous reprenons ici le célèbre exposé de la lettre du 4.12.1801 à Bohlendorff, VI, p. 425 sq.
78. On retrouvera une idée analogue chez Hegel. Cf. notre communication sur Le destin de i‘histoire
chez Hegel e t Schelling, Congrès Hegel de Lille, 1968.
79. Cf. l’essai Uber Religion, notamment IV, p. 278.
80. Der Tod des Empedokles, 3‘version, IV, p. 138.
81. Nature und Kunst oder Saturn und Jupiter, II, p. 37.
82. Meinest du es solle gehen, II, p. 228 (trad. F. Fédier). Rappelons que les traductions de Sophocle
par Holderlin tentent précisément de faire ressortir cet élément oriental refoulé (cf. la lettre à Wilmans
du 28.9.1803, V I , p. 434).
83. Der Tod des Empedokles, 2‘ version, I V , p. 104.
84. ibid., 1“ version, IV, p. 62.
85. Sur cet aspect expiatoire, cf. ibid., p. 24 et G u n d zum Empedokles, p. 157.
86. Theoretisrhe Versuche, IV, p. 233.
87. Der Tod des Empedokles, 3‘version, IV, p. 132.
88. Lebensalter, II, p. 115 (et la glose de F. Beissner p. 661) (trad. G. Roud, modifiée).
89. Der Archipelagus, II, p. 1 1 1. Cf. aussi Gesang der Deutschen (II, p. 4) sur la << migration du génie
de pays en pays ». L’idée, là encore, vient de Schiller : (< Chassés par des hordes barbares / Vous ravîtes
le dernier feu du sacrifice / Aux autels profanés de l’Orient / Et l’apportâtes à l’Occident. / Ainsi le
beau fugitif de l’Est, / Le jour nouveau, surgit à l’Ouest, / Et sur les champs d’Hespérie s’épanouirent
/ Les fleurs rajeunies de l’Ionie. )) (Die Kunstler, v. 363-370. Trad. R. d’Harcourt).
90. Variante de Brot und Wein, II, p. 608.
91. III, p. 575.
92. Der Einzige, 2‘version, II, p. 158.
93. Wenn aber die Hitnmlisrhen... II, p. 224.
94. An Herkules, I, p. 199.
95. In lieblicher Blaue, II, p. 373.
96. Pafmor, II, p. 167 (cf. p. 168 sur la Pentecôte).
97. Einst hab ich die Muse gefragt, II, p. 220.
98. Cf. Am Quell der Donau, II, p. 126 sq.
99. Germanien, II, p. 152. Cf. aussi l’esquisse en prose de Der Mutter Erde, II, p. 683, qui développe
le thème du règne de la Mère fondé sur l’éloignement du Père.
100. Die Wanderung, II, p. 139.
101. Hypérion, III, p. 152.
102. Griechenland, 3‘version, II, p. 257.
103. Cf. Der Wanderer, II, p. 81 et Das ndchste Beste, 3‘version, II, p. 237-238.
104. Brot und Wein, II, p. 94.
105. Die Liebe, II, p. 20.
106. II, p. 60-61.
107. Diotima est certes une Grecque moderne. Mais Holderlin la présente expressément comme une
île de perfection primitive au sein du monde actuel.
108. Blodigkeit, II, p. 66; et la glose de F. Beissner, p. 530.
109. Hypérion, III, p. 145.
110. Ibid., p. 114.
111. Cf. ibid., p. 59.
112. Ibid., p, 87.
113. Ibid., p. 146.
114. Ibid., p. 144. Sur Hypérion miroir, cf. ibid., p. 61. Sur la << belle âme », ibid., p. 97.
115. Grund zum Empedokles, IV, p. 157.
116. Ibid., p. 152.
117. Ibid., p. 159. Hegel développera les thèmes analogues dans la préface de la Phénoménologie de
l'esprit. Cf. notre étude Système et sujet chez Hegel et Schelling, Revue de métaphysique et de morale, 1968.
118. Grund zum Empedokles, IV, p. 157.
version, IV, p. 10
119. Tel sera en effet le blasphème d'Empédocle. Cf. Der Tod des Empedokles, Ire
et 11.
120. Anmerkungen zum @dipus, V, p. 198 et In lieblicher Blaue, II, p. 373.
12 1. Grund zutn Empedokles, IV, p. 154.
122. Der Tad des Empedokles, 3'version, IV, p. I36 (trad. R. Rovini).
123. Anmerkungen zum @dipus, V, p. 20 1.
124. Lettre à C.G. Schütz, hiver 1799-1800, VI, p. 382.
125. Cf. Bror und Wein, II, p. 94 : Pour finir apparut un paisible génie, un consolateur / Céleste,
qui annonça la fin du jour et disparut », et la glose de F. Beissner, p. 618.
126. Der Einzige, 1" version, II, p. 158. Sur le trèfle, cf. ibid., 3'version, p. 163.
127. Variante à la 3'version de Der Einzige, II, p. 752-753.
128. Patmos, II, p. 168.
127. Ibid., p. 773.
130. Varianie à la 3' version de Der Einzige, II, p. 753.
13 1. Der Einzige, lre version, II, p. 156. Cf. la lettre du frère du 28.1 1.1798 : (( O h mon cher!
Quand reconnaîtra-t-on que dans son expression la force suprême est en même temps la plus modeste
et que le divin, quand il se manifeste, ne peut aller sans une certaine tristesse, une certaine humilité? ))
(VI, p. 294).
132. Verrohnender... (2*version), II, p. 134.
133. Anmerkungen zur Antigonae, V, p. 269 (cf. aussi p. 268).
134. Cf. An die Madonna, II, p. 844 (la Madone comme Hinterhalt der Himmlischen) et la glose de
F. Beissner, p. 846.
135. Hypérion, III, p. 32.
136. Lettre à Hegel du 10.7.1794, VI, p. 126.
137. Lettre à J.F. Ebel du 9.1 1.1795, VI, p. 185.
138. Lettre au frère du 4.6.1799, VI, p. 330.
139. Hyperions Jugend, III, p. 224.
140. Versohnender... (I" version), Il, p. 132.
141. II, p. 697.
142. A n die Parzen, I, p. 241.
143. Patmos, II, p. 172.
144. Was sollen Gotier irn Garthaur.2 (variante de Der Gang aufi Land, II, p. 582).
145. Versohnender... (1- version), II, p. 131.
146. Mnémosyne (3'version), II, p. 198.
147. Versohnender... (3'version), II, p. 137.
148. Ibid. (Ireversion),p. 132.
149. I, p. 309.
150. Der blinde Sanger, II, p. 5 5 .
151. Cf. U. Gayer, op. r i t . , notamment p. 314-316.
((
Du << Dieu présent >>
au << Dieu plus médiat
d’un Apôtre
Jean-Miguel Garrigues.
Non coerci maximo
Contineri tamen minimo
Divinum est. m
U
(Exergue d’Hypérion
tirée de l’épitaphe
de saint Ignace de Loyola)
In memoriam d’Erich Przywara SJ. ‘
Holderlin s’est toujours présenté lui-même comme un poète. Depuis son enfance
il a senti que sa vocation poétique était lourde d’une parole décisive qu’il était chargé
de transmettre, ou plutôt d’incarner pour l’époque qu’il voyait s’ouvrir avec ce tournant
de siècle. Toute sa vie et son œuvre ont tourné autour de ce noyau celé qu’était pour
lui sa vocation poétique et, quand finalement il s’est abîmé dans la silencieuse
simplicité de son Umnacbtzmg, le monde l’a pris pour un fou.
Toutes ses pensées se sont arrêtées à un point autour duquel il tourne et tourne
toujours. On dirait un vol de pigeons tournant autour de la girouette, sur le toit.
Ça tourne en rond tout le temps, jusqu’à ce que ça s’abatte à bout de forces
disait de lui le menuisier Zimmer chez qui Holderlin a passé les quarante années de
sa folie. Et il ajoutait : (( I1 faut le prendre comme un enfant, alors il est doux et
gentil. )) C’est lui qui a répété ce que personne ne voulait entendre
A vrai dire il ne manque de rien. C’est ce qu’il a de trop qui l’a rendu fou. A
vrai dire il n’est pas fou du tout, ce qu’on appelle fou (Pl., p. 1109 sq.).
370
Ce que la simplicité d u menuisier saisissait intuitivement, Holderlin au seuil de
sa folie l’a exprimé dans des vers bouleversants :
Un signe, tels nous sommes, et de sens nul,
Morts à toute souffrance, et nous avons presque
Perdu la parole en pays étranger.
(t
Mnémosyne IY, Pi.,p . 879)
Et pourtant Holderlin lui-même a qualifié sa vocation poétique, dont le noyau devait
faire de lui un signe monstrueux et incompréhensible pour son temps, d’occupation
innocente : (( Poétiser, cette occupation la plus innocente de toutes »,écrit-il à sa mère
en janvier 1799 (Pl., p. 696). C’est que cette occupation si innocente est née en lui
de souffrances secrètes dont il témoigne dès son enfance. A dix-sept ans il écrit à un
ami :
il ne faut pas t’étonner si chez moi tout prend un aspect si mutilé et si contradictoire
[...] Non, mon cœur ne bat pas comme le tien, il est si mauvais; autrefois il était
meilleur mais ils me l’ont pris (lettre de 1787, PI., p. 19).
Ce thème d u (( cœur )) reviendra constamment sous la plume de Holderlin pour
signifier le lieu où se noue sa vocation secrète. I1 ne faudra pas l’interpréter comme
une image propre à la sensiblerie romantique, car voici ce qu’il écrivait déjà à l’âge
de quatorze ans à ce diacre Kostlin qu’il appelait son (( père N spirituel :
J e suis certain que par son Saint-Esprit, Dieu saura orienter mon cœur; et dès lors
je vous prie humblement, mon cher M. le Diacre, d’être mon guide, mon père,
mon ami (mais cela vous l’êtes depuis longtemps déjà); permettez-moi de vous
tenir au courant de toute circonstance qui contribuerait à me former le cœur ...
(PI., p. 16).
O n sait par ailleurs que la famille de Holderlin, sa mère surtout à laquelle il
était si attaché, baignait dans le milieu piétiste wurtembergeois. Ce grand piétisme
souabe d u xvw siècle alliait la tradition théosophique boehmienne à la mystique d u
sentiment et de la sanctification diffusée par G. Arnold au début d u siècle grâce
surtout à sa traduction des HomélieJ .piritueiles de saint Macaire qui devaient connaître
un immense succès. Comme on sait d’autre part que ce diacre Kostlin, qui fut le
père spirituel d u jeune Holderlin, était disciple direct des deux grands théologiens
mystiques souabes d u siècle, Bengel et Oetinger, on peut entrevoir à quel degré de
profondeur le thème holderlinien d u (( cœur », comme nœud de sa vocation poétique,
s’enracine dans la tradition mystique souabe qui conjugue la mystique rhénane
(transmise par Boehme) d u Gemüt et la mystique macarienne (introduite par Arnold)
d u Hem. Holderlin emploie très souvent et indistinctement les deux termes allemands.
C’est le secret de ce qui advient dans son cœur qu’il a remis à quatorze ans
entre les mains d’un père spirituel pour que Dieu le forme par son Esprit-Saint. Et
c’est ce secret qui semble le mettre à l’écart dès son adolescence :
Je suis maintenant si seul, dans un tel calme - et c’est ce qui me convient - mais
si loin, si loin de mon ami B.; quel dommage. Je n’ai presque personne à qui
parler [...I Seigneur Dieu! II faut que je te l’avoue, ce que j’ai à supporter est pire
que je ne te l’ai écrit récemment! Tu peux m’en croire, Dieu m’a gratifié d’une
bonne part de souffrances! Je ne veux pas en parler. (Lettre de 1787. Pl., p. 23.)
Au même moment il devait être d’ailleurs tuberculeux, car il écrit : Je crache
souvent d u sang. N Et, vers la même époque :
37 1
N’en ai-je pas assez supporté! N’ai-je pas connu, tout gamin, ce qui ferait frémir
un homme? [...] Seigneur Dieu! Suis-je seul à être ainsi? Tous les autres plus
heureux que moi? Et qu’ai-je donc commis? (Lettre de 1787, Pl., p. 20.)
Ce qui met Holderlin adolescent à part de ses camarades, il le laisse entrevoir
- timidement car il sait à quel point cela sonne ridicule en plein siècle des Lumières
- dans une
lettre à un ami :
J’eus l’idée, une fois mes années d’université terminées, de me faire ermite, et
cette idée m’a tellement plu, que pendant tout une heure, je crois, je fus ermite
en pensée. Tu vois, je ne rougis pas de t’avouer mes faiblesses et c’est ce qui
m’excuse à tes yeux. Mais veille surtout à ce que cette lettre ne tombe pas entre
les mains d’un étranger hostile, car on dirait : en voilà un fou! (Lettre de 1787,
Pl., p. 29.)
I1 ne savait pas si bien dire. Quand son chemin l’aura finalement conduit au
lieu de son cœur, quand il sera entré dans la solitude de sa folie pour y vivre pendant
quarante années, ceux qui l’entourent le prendront pour un fou. Seul le menuisier
qui l’a accueilli dans sa maison pressent la vérité :
On ne doit pas s’y tromper, c’est tout de même un homme libre [...I Vous pouvez
être certain qu’il saisira son chapeau, s’inclinera profondément et vous dira : Votre
Majesté a ordonné que je m’en aille. N C’est ainsi qu’il donne aux gens ce qu’ils
peuvent désirer tout en restant, quant à lui, un homme libre. (In Pierre-Jean
Jouve : PoèmeJ de la folie de Holderlin, Paris, Gallimard, 1963, p. 146.)
<(
))
Quant à cette vocation d’ermite qu’il porte dans son cœur, elle confirme à quel
point Holderlin s’enracine dans le courant du piétisme le plus profond et le plus
authentiquement chrétien du X V I I I ~siècle. On se rappellera en effet que la lecture des
textes macariens et de la Vie des Pères da désert avait suscité, en plein protestantisme
et en pleine Aufklarung, une lignée d’ermites qu’on a pu appeler une (( Thébaïde
protestante ».
Holderlin se place, par contre, délibérément à l’écart du luthéranisme officiel
qu’il refuse comme (( témoin N de la foi de son cœur, ainsi que de la révolte
antichrétienne d’une partie de sa génération :
Mais les docteurs de la Loi et les pharisiens de notre époque qui font de cette
chère et sainte Bible un bavardage insipide, mortel pour l’élan de l’esprit et du
cœur, ceux-là je les récuse comme témoins de ma profonde foi vivante. Je sais
bien comment ils en sont venus là, et puisque Dieu leur pardonne de tuer le
Christ de pire manière que n’ont fait les Juifs - car ils transforment en lettre
morte sa parole et sa personne vivante en creuse idole - puisque Dieu leur
pardonne, je leur pardonne également. Mais je refuse de dévoiler mon cœur à ceux
qui le méconnaissent; c’est pourquoi je me tais devant les théologiens profissionneis
(c’est-à-dire devant tous ceux qui ne le sont pas librement et du fond du cœur,
mais par acquit de conscience et par métier), tout comme devant ceux qui tournent
le dos à tout cela parce que dès leur jeunesse on leur a imposé la lettre morte et
le terrifiant commandement de croire, qui les a détournés de toute religion, ce
premier et dernier besoin de l’homme. (Lettre de 1789. Pl., p. 695; c’est l’auteur
qui souligne.)
I1 marque encore plus nettement sa distance par rapport à la philosophie ambiante
en écrivant à son frère en 1794, juste après ses études universitaires à Tübingen :
On devient un homme grâce à la sainte et inébranlable résolution de ne jamais
laisser berner sa conscience par la pseudo-philosophie des autres ou par la nôtre,
372
par la ténébreuse philosophie des Lumières qui, sous couleurs de préjugés, violent
tant de devoirs sacrés. (Pl., p. 319.)
Aussi éloigné de la théologie officielle que de la philosophie ambiante, Holderlin
suit le chemin de l’évangklisme simple et sincère que lui a transmis son milieu piétiste
souabe :
Assister à la misère de ses frères, sans qu’aucun effort ne puisse y remédier, voilà
qui est dur à supporter. Ce vaste sujet est aussi le thème ordinaire de mes sermons
adressés au peuple. Soyez sûre que je parle du fond du cœur. Je pense souvent,
en descendant de chaire : N’aurais-tu éveillé qu’une seule étincelle d’amour du
prochain et de compassion profonde et agissante, estime-toi heureux. Oh! n’eusséje rien réalisé de pleinement utile au monde, il me resterait du moins ia conscience
d’avoir un jour à instruire et à éclairer d’un cœur fraternel une paroisse (Lettre de
1793, PI., p. 95).
((
))
Le propre de Holderlin c’est d’avoir conservé toujours son cœur fidèle à son
appel même à travers ses amours, son activité littéraire auprès de Schiller et de la
société mondaine, au milieu même des préoccupations philosophiques qu’il partage
avec ses condisciples et amis du séminaire de Tübingen : Hegel et Schelling.
Le chant de son cœur viendra toujours de cette proximité (qui n’est pas une
immédiateté cependant) du clocher de l’église qu’il célébrera dans un poème tardif:
En bleu adorable fleurit
Le toit de métal du clocher. Alentour
Plane un cri d’alouette, autour
S’étend le bleu le plus touchant [...I
Alors le silence est vie.
(PL, p . 939)
Dans ce silence qui entoure le clocher comme cette présence bleutée de Dieu
dans laquelle il demeure, surgissent les paroles de ses poèmes :
Si simples sont les images, si saintes,
Que parfois on a peur, en vérité,
Elles, ici de les décrire.
(Ibid.)
Certaines de ces images ont déjà retenu son cœur quand, à dix-huit ans, lors
d’un voyage à Spire, il écrit :
Le matin j’ai réservé ma première visite à la cathédrale. C’est un des édifices les
plus curieux que j’aie vus au cours de mon voyage, le seul que j’aie examiné à
fond et à loisir [...I Au-dessus figurez-vous l’autel en marbre, son allure majestueuse
avec ses flambeaux, et au-dessus la voûte immense; j’y serais resté une heure
chaque jour sans m’y lasser. (Lettre de 1788. Pl., p. 47.)
De retour à son séminaire il avoue : ((Jamais je ne me suis senti si à l’étroit. ))
A-t-il, eu le pressentiment d’un lieu où le cœur croyant peut reposer dans le mystère
de I’Eglise? Pressentiment auquel ferait écho cette phrase qui est pratiquement la
seule qui nous ait été rapportée du temps de sa folie : ((Je suis précisément sur le
point de rne faire catholique )) ,(P.-J. Jouve, op. rit., p. 130). Itinéraire typique vers
la plénitude du mystère de 1’Eglise inauguré par un autre protestant mystique et
poète, Angelus Silesius, que Holderlin connaissait sans doute car il était tenu en haute
estime par ses deux amis idéalistes Hegel et Schelling.
373
C’est au séminaire de Tübingen, en étudiant avec ces deux génies philosophiques
qu’étaient Hegel et Schelling, que Holderlin connaîtra un tournant décisif dans sa
foi chrétienne. I1 s’en ouvre par lettre à sa mère :
J e n’ai pas tardé à m’apercevoir que les preuves d e l’existence d e Dieu et d e
l’immortalité que fournit la raison étaient si imparfaites qu’un adversaire résolu
en réfuterait sans peine l’ensemble [...I C’est à ce moment que me sont tombés
entre les mains les écrits d e Spinoza, grand h o m m e d u siècle passé ...
Quand on sait l’influence qu’a eue la lecture de Spinoza sur la genèse de
l’idéalisme de Hegel et de Schelling, on imagine la tempête qu’a pu soulever dans
la jeune tête de Holderlin la lecture de ce métaphysicien panthéiste qu’il déclare luimême (( athée au sens strict du mot ». Dans sa tête ... et dans son cœur?
J’ai constaté qu’en examinant les choses d e près, la raison, la froide raison que le
cœur délaisse, nous amène forcément à adopter ses idées, si l’on veut tout expliquer.
Mais que faire alors d e la foi d e mon cœur qu’anime d e façon irrécusable le désir
d’éternité, de Dieu? Mais n’est-ce pas précisément ce que nous désirons qui nous
inspire les plus grands doutes? qui donc nous aidera à sortir de ce labyrinthe? Le
Christ .... I1 doit savoir qu’il y a un Dieu et ce qu’il est, étant intimement lié à
la divinité. Etant Dieu même. (Lettre d e 1791. PI., p . 70.)
La foi de son cœur s’en remet donc au Christ pour apprendre de lui qui est
Dieu.
Holderlin a senti clairement, dès la crise de Tübingen, que (( c’est précisément
ce que nous désirons qui nous inspire les plus grands doutes N (c’est lui qui souligne),
car la mégalomanie du désir accouple l’homme à l’abîme de la volonté de volonté
dans laquelle l’Absolu se présente comme Néant et comme mort. Dans cette fusion
titanesque dans laquelle il a entrevu prophétiquement la figure du monde contemporain, s’accomplit la (( mort de Dieu D telle que l’annoncera pathétiquement plus
tard Nietzsche. A moins que le Dieu divin ne se retire lui-même de la sphère du
désir d’Absolu.
Holderlin verra plus tard, dans le retrait de Dieu apprenant à l’homme une
fidélité par-delà la dynamique de la Volonté de Puissance, l’essence même de la
Tragédie :
La présentation d u tragique repose sur ceci que le monstrueux, comment le Dieu
et l’homme s’accouplent, et comment, toute limite abolie, la puissance panique
d e la Nature et le tréfonds d e l’homme deviennent Un dans la fureur, se conçoit
par ceci que le devenir un illimité se purifie par une séparation illimitée [...I En
un tel moment, l’homme oublie : il oublie le Dieu, et fait volte-face, sans manquer
certes à la piété, comme un traître [...I Il lui faut suivre le détournement catégorique
d e Dieu et ainsi par la suite, il ne peut en rien s’égaler à la situation initiale.
(Remarques sur Edipe. PI., p . 9 5 7 : trad. légèrement modifiée.)
Ainsi le retrait de Dieu rompt irréversiblement, dans la katego,rische Umkehr, la
circularité de la Volonté de Puissance qui s’accomplit dans cet (( Eternel retour du
pareil )) chanté par Nietzsche comme le mouvement de l’être du Surhomme. C’est
pourquoi Holderlin pourra dire que (( le défaut de Dieu est notre secours »,entrevoyant
ainsi dans l’athéisme de la volonté de volonté le moment décisif de l’économie divine
elle-même, car
Dieu et l’homme, afin que le cours d u monde n’ait pas d e lacune, et que la
mémoire d e ceux d u ciel n’échappe pas, se parlent dans la figure tout oublieuse
d e l’infidélité, car l’infidélité divine, c’est elle qui est le mieux à retenir. (Remarques
SUT Edipe, PI., p. 958.)
374
Cette expérience d u désir d’Absolu comme moteur secret de la mort de Dieu
ne s’est pas donnée à Holderlin à partir d’une réflexion philosophique, mais au sein
d’un cheminement mystique de chrétien. En effet, dans les Remarques sur Antigone il
considère que cette manière de demeurer fidèle à Dieu quand il s’est retiré de la
sphère d u désir, (( cette ferme demeurance devant la marche d u Temps, est une
héroïque vie d’ermite D (Pl., p. 962). Nous avons vu plus haut que cette allusion
s’enracine dans une vocation personnelle. Par contre il dénonce déjà dans sa première
lettre au diacre Kostlin, son père spirituel, ses (( impulsions généreuses )) vers Dieu,
car ((c’était surtout la Nature qui exerçait une action extrêmement vive sur mon
cœur n (lettre de 1784; Pl., p. 15).
Quand plus tard le spinozisme lui montrera à quel point l’élan panthéiste vers
l’union avec Dieu conduit i l’Absolu immanent de la Mort de Dieu, Holderlin pose
la question décisive :
Mais n’est-ce pas précisément ce que nous désirons qui nous inspire les plus grands
doutes? Qui donc nous aidera à sortir de ce labyrinthe? Le Christ. (PI., p. 7’0;
c’est Holderlin qui souligne.)
Par son abaissement volontaire le Christ lui montrera l’issue hors d u labyrinthe
circulaire de la Volonté.
Dans cette crise de Tübingen (1791) s’annonce déjà ce qui sera le tournant de
la maturité de Holderlin : la vaterlandiscbe Umkehr, le retour à la patrie, c’est-à-dire
à la terre du Père. C’est le Christ qui lui découvrira (( ce qu’est Dieu », c’est son
attitude qui lui donnera accès à la paternité divine. (( Le Christ a sous le soleil
semblance d’un mendiant )) (« L’unique »; Pl., p. 867), il n’a pas fait éclater la
puissance de la gloire divine qui aurait menacé d’absorber l’homme en l’anéantissant
car
...le monde sans cesse, avec un cri
De joie, s’arrache à cette terre, la laissant
Dépouillée où l’humain ne le sait retenir.
(U
L’unique w , Pi.,p . 866)
Dans son abaissement le Christ s’est placé sous le soleil comme un mendiant »,
c’est-à-dire sous la gloire d u Père et a renoncé à sa propre gloire avec laquelle il
aurait pu s’attirer le monde. C’est la tentation satanique, dont (( le lieu est le désert ))
(« L’unique », ibid.), de s’attirer irrésistiblement l’humanité par la toute-puissance
divine. L’attitude d u Christ est tout autre :
Alors le jour du soleil devint ténèbres, le Jour
Royal, et saisi d’une douleur divine,
De lui-même il brisa son sceptre
Aux rigides rayons de flamme, pour qu’au temps
Propice tout fît retour.
(U
Patmos », PI.,p. 870)
L’abaissement d u Christ qui (( s’est dépouillé lui-même )) (S. Paul aux Philippiens,
2, 7) évite, aux yeux de Holderlin, que le désir insatiable de l’homme qui cherche
impatiemment à se diviniser et à s’éterniser, ne s’attache avidement à la divinité d u
Christ. Car, il l’avoue lui-même,
Je le sais, la faute
Est de moi seul. Car une ferveur trop vive
A toi me lie, ô Christ!
(U
L’unique », PI.,p . 864)
375
En s’approchant de lui les disciples doivent être attentifs à ne pas s’arrêter au
premier moment de son économie de présence :
Mais qu’il faut éviter de choses! L’excès d’amour
Dans l’adoration est riche en danger et blesse
Le plus souvent. Mais ces hommes ne voulaient point quitter
Le visage du Seigneur
Ni la patrie. Cet amour, tel le feu dans le fer, leur était
Chose innée, et comme une peste, l’ombre
de Celui qu’ils aimaient marchait i leur côté.
(U Pntmos U , Pi.,p . 875)
C’est justement du danger suprême d’un divin offert sur son visage comme une
patrie natale (Heimdt) que le Christ guérit lui-même l’homme assoiffé d’absolu. Le
poème (( Patmos )) commence en effet par ces mots :
Tout proche
Et difficile à saisir, le Dieu!
Mais là où est le danger, croît
Aussi le salvifique.
(Pi.,p . 867)
Le danger et le salvifique sont à la fois daris le Christ, sont le Christ lui-même.
Dangereux parce qu’il semble d’emblée ouvrir à l’homme la patrie de l’union au
divin, il sauve (( en brisant son sceptre solaire N (« Patmos ») par sa kénose, puis par
son départ. Le Christ, en se présentant (( sous le soleil, dans la semblance d’un
mendiant », c’est de lui-même qu’il met fin à l’infini désir de la volonté car (( le
consentement du Christ vient de lui-même )) (a L’unique »). C’est en référence à cette
eschatologie de la volonté que Holderlin peut dire, en conclusion, cette phrase
énigmatique : (( Mais le Christ est la fin N (ibid.). En effet, d’une part (( il parfait ce
qui manquait encore aux autres [dieux grecs : Dionysos et Héraclès] en présence
céleste N (ibid.), portant ainsi le danger d u désir absolu de Dieu à son paroxysme.
Mais en même temps, c’est lui-même qui retourne le mouvement du désir de Dieu.
Au moment de sa mort, quand apparemment il accomplit son destin (( empédocléen ))
en passant à Dieu, il se présente néanmoins non pas au sommet de l’enthousiasme
extatique, mais dans la figure du mendiant penché vers la terre, dans la kénose et
l’humilité :
Puis il mourut.
Ses amis purent une dernière fois
Contempler la figure inclinée, nonobstant (la mort), devant Dieu
De Celui qui se renonçait.
(U Patmos », PI., p . 874, trad. modijée)
Les disciples avaient cru trouver, cependant, dans le visage du Seigneur l’immédiateté rayonnante d u divin, l’objet de leur désir, leur patrie :
Ils aimaient
La vie sous le soleil et ils ne voulaient pas quitter
Le visage du Seigneur
Ni la patrie.
(Ibid., p . 870, trad. Iégèrement modijée)
Les disciples avaient trouvé dans l’immédiateté d u divin en Christ la patrie
(Heimat) adéquate à leur désir, mais ce n’était pas la patrie du Père (Vaterland).
376
Toute l’attitude du Christ consiste, pour Holderlin, à faire passer de l’une dans
l’autre. Et c’est paradoxalement ainsi qu’il introduit les disciples dans la vraie patrie,
le Vateriand, la demeure du Père qui habite une lumière inaccessible. C’est ce
retournement eschatologique du désir d’absolu qu’expérimentent les disciples, que
Holderlin appelle << le salvifique )) :
Et c’était comme une joie
Désormais d’habiter la douce nuit aimante
Et d e garder dans des yeux simples
Les abîmes d e la Sagesse.
Pour quelqu’un
Etait devenu sa patrie (Vaterland) un petit espace.
(U
Patmosr, GStA, Il, I , 176
U.
115-120)
Le (( quelqu’un )) en qui se produit le retournement du désir d’Absolu et l’entrée
dans le Vaterland, c’est le disciple du Christ. Dans ses RernarqueJ sar Antigone
Holderlin opposait déjà le divin tragique de la Grèce auquel le héros cherche à s’unir,
au a Dieu d’un Apôtre )) :
La présence d u tragique repose sur le fait que le Dieu immédiat, tout Un avec
l’homme - car le Dieu d’un Apôtre est plus médiat, est la plus haute entente
dans l’Esprit le plus haut -, que l’infinie possession ... (PI., p. 9 6 3 ; trad. légèrement
modifiée).
Le disciple du Christ a connu le plus haut danger dans la présence absolue de
Dieu dans le Christ, mais A travers la kénose puis le retrait de Celui-ci il est entré
dans la vraie patrie, dans le domaine d u Père (Vateriand) qui n’aspire pas l’homme
dans une fusion extatique en l’arrachant à sa terre. Au contraire, le disciple qui a vu
s’ouvrir dans la kénose et le retrait du Christ le mystère du Père, peut demeurer sur
la terre qui lui est donnée maintenant comme patrie, comme terre du Père en ce sens
que c’est seulement en ne la désertant pas vers l’absolu, que l’on peut par l’humilité
filiale rester fidèle à Dieu dans la non-immédiateté de sa paternité :
Père d u Temps, ou Père de la terre, parce que c’est sa nature, contrairement à
l’éternelle tendance, d e retourner le désir d e quitter ce monde pour l’autre en un
désir d e quitter un autre monde pour celui-ci. (Remarques sur Antigone, Pl., p. 962.)
Une lettre à Ebel de 1795 montre que Holderlin a perçu de très bonne heure
le tournant eschatologique du divin dans le (( Fils du Temps )) comme ouverture au
N Dieu plus médiat d’un apôtre », au (( Père du Temps »; faire advenir ce tournant
dans son monde encore tenté par le divin absolu du c theion a grec, c’est la vocation
<( hespérique )) du croyant moderne :
...l’Église invisible et militante doit donner naissance au grand Fils d u Temps, au
Jour d’entre les jours que l’homme à p i appartient mon âme (un apôtre aussi peu
compris par ses épigones actuels qu’ils ne se comprennent eux-mêmes) appelle
1’Acènement du Seigneur. (Pl., p. 367.)
L’apôtre dont il est question ici, c’est probablement le même qu’il rencontrera
plus tard, définitivement, à Patmos. En effet c’est bien saint Jean qui écrit :
Et maintenant demeurez en lui ...
Pour ne pas être confondus par lui à son Avènement.
(1Jn 2,28)
377
Dans le Christ le disciple reçoit un (( cœur pur », c’est-à-dire pour Holderlin
qu’il peut N garder Dieu purement et avec différenciation )) (« Le Vatican »). I1 a connu
en effet dans le Christ la plus haute tentation de fusion avec l’Absolu :
Demeurer pur devant un tel visage,
C’est un destin, c’est une vie avec
Un cœur, et qui dure au-delà de la moitié
p. 875)
Patmos », PI.,
(c
La (( moitié )) c’est le moment du détournement catégorique du divin ... à la
suite duquel l’homme ne peut plus en rien s’égaler à la situation initiale )) (Remarques
sar Edipe, Pl., p. 958), détournement qu’accomplit le Christ quand par sa mort et
son départ il soustrait Dieu à l’immédiateté désirée par les disciples, les amenant de
cette manière à demeurer sur la terre jusqu’à son retour. Celui qui incarne aux yeux
de Holderlin ce destin de disciple est saint Jean, le disciple le plus aimé, le plus
immédiat au Christ. Le soir de la dernière Cène, incliné sur la poitrine d u Christ qui
...aimait la simplicité
Du disciple, les prunelles attentives de l’homme
Contemplèrent, tout proche, le visage du Dieu,
Quand s’accomplit le mystère du cep, et tous ensemble
Ils étaient assis à l’heure de la Cène.
(C
Patmos », PI.,
p . 869)
Jean a donc connu le danger de l’immédiateté du divin en Christ comme aucun
autre homme, même parmi les disciples, ne l’a connu. C’est pourquoi Patmos, le
lieu où s’exprime symboliquement son destin, apparaît au poète comme une île de
Grèce, terre de tragédie habitée par le divin, située dans l’Asie solaire :
Mystérieuse
Dans une buée d’or, à chaque pas
Du soleil plus immense...
Tu t’ouvris à moi comme une fleur
Asie!
(U
Patmos
»,
PI.,
p. 868)
Mais Jean, en connaissant le plus terrible du danger, a découvert en même
temps le salvifique du Christ. Dans le désert dévoré par la présence immédiate de
Dieu, il a appris à demeurer pur, à ne pas s’extasier dans l’absolu, alors même que
rien sur la terre ne semblait plus retenir le cœur de l’homme mis en présence du
visage de Dieu :
Ile de la lumière!...
Et la native innocence est déchirée...
Mais Jean, sur ce sol privé de tout lien, demeurait pur
Patmos
(U
»,
PI.,
p . 1219)
Et pourtant son amour pour l’Unique risquait de l’arracher à la terre rendue
déserte par le rayonnement du divin :
Mais à Un seul s’attache
L’amour. D’ailleurs
Est toujours puissant et tenté
De mourir un désert plein de
Visions, si bien que rester dans l’innocente
378
Vérité est une douleur. Mais elle vit
Ainsi. Le Céleste entre et sort.
(t
L’unique », PI., p . 1217)
Dans ses Remarques sur Antigone Holderlin appelle (( cette toute ferme demeurance
devant le mouvement du Temps N dans lequel Dieu se détourne catégoriquement,
(( une héroïque vie d’ermite N. Jean, parce qu’il est demeuré pur sur le sol privé de
tout lieu du désert, (( en plein midi )) - comme dira plus tard Nietzsche - de la
présence de l’Absolu, est par excellence le disciple du Christ et le type des ermites.
I1 est justement celui qui, après avoir connu l’intimité du (( visage de Dieu )) pendant
la Cène, a reçu par la suite du Christ sur le point de le quitter, la vocation de
(( demeurer jusqu’à ce qu’Il vienne )) u n , 2 1,22).
Le mot «: demeurer N shoisi par le Christ pour signifier la vocation de Jean, verbe
clé qui exprime dans son Evangile les rapports entre le croyant et Dieu, articule pour
Holderlin la (( médiateté )) du (( Dieu d’un Apôtre ». Médiateté déchirante car (( demeurer dans l’innocente vérité est une douleur; mais elle vit ainsi )). C’est pourquoi celle
que le poète appelle pourtant (( île de lumière », Patmos,
N’habite pas comme Chypre
La riche en sources ou quelqu’une
Des autres îles
La mer avec faste
Mais dans une demeure
Plus pauvre, elle est pourtant
Pleine d’accueil.
Et quand, jeté d’un naufrage ou pleurant
Sa patrie ou
L’étreinte d’un ami perdu,
Quelque étranger l’aborde, elle se fait
Pitoyable à sa plainte ...
Telle jadis elle prit soin de l’aimé d u Dieu,
D u voyant dont la jeunesse bienheureuse
Avait suivi, compagne
Inséparable, le Fils d u Très-Haut.
(. Patmos
a,
PI., p . 869)
Patmos articule en effet les deux temps du destin de Jean : île de la Lumière »,
elle circonscrit le lieu désert où il se tient sous la gloire du visage de Dieu; (( demeure
pauvre et pleine d’accueil », elle garde le secret de sa (( toute ferme demeurance ))
quand il a renoncé à trouver dans le Christ la patrie (Heimat) de son désir, pour Lui
demeurer fidèle sur la terre dans la (( douce nuit aimante N qui suit son départ. C’est
pourquoi le poète peut apprendre à Patmos comment, (( là où est le danger, croît
aussi le salvifique )). Patmos c’est le destin de Jean qui, disciple par excellence, a
connu au plus haut point la présence de Dieu dans le Christ et le secret de son
abaissement et de son retrait. Jean peut ainsi introduire Holderlin dans la (( médiateté ))
du (( Dieu d’un Apôtre ».
Parti, au début du poème, en Grèce pour rejoindre la patrie divine, le domaine
du (( plus aimé », le poète qui avait demandé en partant (( l’eau de l’innocence »,
découvre dans la Grèce solaire de l’Asie, (( dans la profusion des routes sans ombre »,
l’île de Patmos, la (( demeure plus pauvre N du retrait de Dieu en Christ. Pour lui
aussi dans la Demeure de saint Jean, un petit espace est devenu la patrie (Vateriand) N
(« Patmos ))). Car la (( pauvre demeure N de Patmos, de même que la (( figure de
mendiant N du Christ (( qui se renonce de lui-même », sont le seuil de la vraie patrie,
du domaine du Père (Vateriand). C’est pourquoi Holderlin peut conclure le poème
Patmos en disant au Christ :
3 79
Il y a une seule chose que je sais :
La volonté du Père
Eternel est pour toi chose
Du plus grand prix. Silencieux au tonnant ciel d’orage
Brille son signe. Et Quelqu’un sous le ciel est là debout
Pour tout son temps de vie. Car le Christ vit encore.
(U Patmos 1, PI., p. 872; c’est Holderfin qui souligne)
La kénose du Christ et son retrait tracent la (( médiateté )) d u (( Dieu d’un
Apôtre )) comme le (( signe, brillant dans le ciel », de sa volonté dans l’accomplissement
de laquelle le Fils, à travers la mort et le départ, le révèle comme Père.
Ce signe mystérieux de la paternité-filiation qui brille dans le ciel retentissant
de la volonté du Père, le Christ l’a donné aux disciples pour qu’ils puissent (< demeurer
purs )) sur la terre après son départ, sans chercher à le rejoindre dévorés par le désir
d’éternité :
Mais ces hommes ne voulaient point quitter
Le visage du Seigneur
Ni la patrie (Heimat). Cet amour, tel le feu dans le fer, leur était
Chose innée, et comme une peste réellement, l’ombre
Du Bien-Aimé, le visage nuisible du Dieu, marchait à leur côté.
Alors il fit sur eux descendre
L’Esprit, et la Demeure en vérité
Fut ébranlée, et les orages de Dieu grondèrent,
Tonnant au loin, créant des hommes...
(. Patmos », Ansütze zur letzteren Fassung, éd. Beissner minor, p. 37.5)
Ce (( signe )) d u Père qui a brillé au-dessus du Christ dans l’orage de sa volonté
sur la terre, est donné aux disciples comme l’Esprit qui, dans le tonnerre de la
Pentecôte, fait d’eux des homme? nouveaux. Ce don de l’Esprit coïncide d’ailleurs
pour Holderlin (ainsi que pour 1’Evangile de Jean : 19,30) avec l’instant de la mortdépart du Christ :
Puis il mourut. Que de choses là-dessus
Seraient à dire! Er ses amis le virent encore, des cimes
De la joie, leur jeter le regard suprême d’un vainqueur.
Ils sentirent pourtant descendre, le soir
Etant venu, la tristesse en eux et le trouble...
Ils ne voulaient pas quitter
Le visage du Seigneur, ni la patrie ...
Alors il fit sur eux descendre l’Esprit.
(U
Patmos », PI., p. 868-869)
L’Esprit est ce qui rend l’homme capable de demeurer », qui lui donne (( une
vie avec un cceur qui dure au-delà de la moitié », c’est-à-dire qui endure le détournement catégorique de Dieu qui s’accomplit dans la kénose et le retrait du Christ.
L’Esprit est donné aux disciples (( à l’heure où les héros de la mort se tenaient là
tous ensemble )) (« Patmos », Pl., p. 870) pour accomplir en eux la K uaterfündiscbe
Umkehru, le retournement de leur désir d’Absolu qui les aurait entraînés à la suite
du Christ dans une mort eiiipédocléenne d’union au divin. I1 les adapte ainsi au
retrait de Dieu qu’il leur ouvre comme patrie, non la Heimat de leur désir du Dieu
immédiat, mais le domaine du Père : le Vaterfand. Le retrait du Christ qui dans sa
kénose ouvre le (( passage au Père )) non comtne extase empédocléenne mais comme
obéissance filiale à sa volonté, est le lieu même d’où est donné l’Esprit aux apôtres
380
pour qu’ils demeurent dans le rapport médiat au (( Dieu d’un apôtre »,dans la paternitéfiliation :
Oui, quitter déjà le visage
Des amis bien-aimés
Et par-delà les montagnes
S’en aller solitaire où les disciples par deux fois
Et d’un seul cœur avaient reconnu la venue de l’Esprit divin.
(. Putmos
Y,
PI.,
p. 870)
L’Esprit est donc le signe de la paternité-filiation, le a signe du Père brillant au
tonnant ciel d’orage N comme chiffre de sa volonté, sous lequel s’est placé le Christ,
(( dans la figure d’un mendiant »,
en se renonçant de lui-même N dans sa kénose.
En ce sens l’Esprit est (( le salvifique N qui, dans le Christ, retourne le danger extrême
de la présence plénière de Dieu en l’homme. Quand le Christ (( saisi d’une douleur
divine brise de lui-même son sceptre aux rigides rayons de flamme, et que le jour
du soleil, le jour royal, devint ténèbres )) (« Patmos D)les disciples, (( créés par l’Esprit
dans un destin magnifique, comme des dents de dragon N (ibid.), ne sentent plus le
soir étarit venu, descendre la tristesse et le trouble )), mais (( c’était comme une joie
désormais d’habiter la douce nuit aimante D (ibid.). Ils ne sont plus ces assoiffés
d’Absolu, dont le Christ a d’une goutte apaisa le soupir de lumière, la sauvagerie
assoiffée )) (ibid.), Ils savent maintenant que
Les voix de Dieu ressemblent
A d u feu. Mais c’est tâche difficile, en ce qui
Est grand, d e maintenir la grandeur, et non point
Délectation.
(* Patmos », PI.,
p. 873)
L’Esprit leur a donné un (( cœur pur N qui ne cède pas à la a délectation )) du
divin et qui garde le mystère du retrait de Dieu en vivant joyeusement dans sa (( nuit
aimante n :
Et c’était désormais comme une joie
D’habiter la douce nuit aimante
Et d e garder dans des yeux simples
Introublés, les abîmes de la Sagesse. Et de vivantes
Images verdoient aussi aux pentes des montagnes.
(K
Patmos
P,
PI., p. 8 7 0 , trud. Iégèrement modijiée)
Au pied des (( montagnes du Temps )) qui séparent l’homme de Dieu et que
celui-là ne transgresse plus comme au début du poème où (( les Aigles, les fils des
Alpes sans frémir passent l’abîme 1) vers le divin désiré, c’est là que l’Esprit fait éclore
à l’abri du soleil desséchant les (( vivantes images ». Elles sont le reflet, dans les (( yeux
simples )) du disciple, de cette (( infidélité divine qui est le mieux à garder )) (Remarques
sur Edipe, Pl., p. 958), de cette (( nuit aimante n dans laquelle (( le Dieu et l’homme,
afin que le cours du monde n’ait point de lacune et que la mémoire de ceux du ciel
n’échappe pas, se parlent dans la figure tout oublieuse de l’infidélité )) (ibid.).
En introduisant l’homme dans le détournement catégorique du divin qui est le
destin du Christ, l’Esprit le rend semblable au Fils. L’homme trouve ainsi désormais
en lui-même 1’« image )) qui lui permet de garder fidèlement le retrait du Dieu Père
du Christ :
38 1
Ainsi j’aurai aussi la richesse de pouvoir
Forger une image et, ressemblant,
De voir le Christ comme il fut.
( K Patmos », Pi., p . 871, trad. modi@)
Cette vie de l’homme qui est entré, à l’image du Christ, sous le (( signe du
Père )) est admirablement chantée par Holderlin dans une ébauche d’hymne :
Qu’est-ce donc que les hommes? Une image de la divinité
Comme tous les mortels cheminent sous le ciel :
Ils le contemplent. Et lisant, en quelque sorte comme
Dans un écrit, les hommes imitent la richesse de l’infini.
( K Qu’est-ce que la vie? », PI., p . 887, trad. modijiée)
L’esprit, surgissant de la kénose-retrait du Christ, introduit l’homme dans la
pureté nocturne du Dieu caché que l’on ne peut approcher que dans l’imitation
filiale :
Plus pure n’est pas l’ombre de la nuit avec les étoiles
Si je pouvais dire ainsi, que l’homme, qui est nommé
Une image de la divinité.
(f En bleu adorable », PI., p . 939, trad. modijiée)
En entrant dans l’image filiale, l’homme est guéri de son désir d’un absolu
immédiat car, dans (( L’esprit du temps )) :
La perfection atteint telle unité en cette vie
Que la noble aspiration de l’homme s’en arrange.
(Pl., p . 1035)
La vie de l’homme est désormais rythmée par le mouvement de l’Esprit :
Le devenir de l’Esprit n’est point caché pour les hommes
Et comme est la vie que les hommes se sont trouvée,
C’est de la vie le jour, le matin de la vie,
Comme les hautes heures sont les richesses de l’Esprit.
( c Devenir de /Esprit », Poèmes de la folie, p. 100)
C’est en effet l’Esprit qui, en maintenant l’homme filialement dans le domaine
du Père (Vateriand), accorde synergiquement son agir à la volonté de Celui qui
demeure en retrait par-delà les (( montagnes du Temps )) :
Les lignes de la vie sont diverses
Comme les routes et les contours des montagnes
Ce que nous sommes ici, un Dieu là-bas peut le parfaire
Avec des harmonies et l’éternelle récompense et le repos.
( c Les lignes de La vie Y, PI.,p . 1023)
Cette vie de fils accordée à la volonté du Père est vécue par Holderlin
comme la vie innocente de l’enfant :
((
fou N
Comme le Père du ciel regardera
Avec joie l’enfant grandi
Marchant sur les champs riches en fleurs
Avec d’autres qui lui sont chers.
(U La naissance d u n enfant Y, GStA, II, 1, 266)
382
Si l’homme qui vit dans l’Esprit est un (( enfant grandi », il ne devient cependant
vraiment image de Dieu que par la mort. Mort qui n’est plus l’entrée dans l’absolu
du désir, mais le serein accomplissement de l’innocence filiale :
La beauté n’est dévolue qu’aux enfants,
Est de Dieu l’image même, peut-être Leur sûr trésor est quiétude et silence,
Q u i tourne aussi à la gloire des anges.
(* Sur la mort d’un enfant U ,
poème de la filie, PI., p . 1022)
Il arrivait à Holderlin, pendant ses quarante années de liberté folle, de dire :
I1 ne m’arrivera rien. )) C’est que son existence est morte à l’inquiétude du désir et
vit libérée dans l’Esprit :
((
Q u a n d je m’en vais par la prairie,
Q u a n d j’erre aux champs, je suis toujours
L’homme pieux, l’homme docile
Par les épines épargné.
Mon abri bouge avec la brise,
Et l’Esprit gaiement me demande
Où donc perdure l’être intime
Jusqu’au jour d e son dénouement ...
Les heures sonnent au clocher
Quelque image que l’on contemple
La paix d u cœur nous est rendue
Et ce sommeil de nos souffrances.
(* L a vie joyeuse », poème de la folie,
PI.,
p . 1024- 1025)
Délivré dans l’Esprit de l’anxieuse volonté de perdurer, Holderlin fou, tout en
chantant (( La vie joyeuse », peut écrire ailleurs :
J’ai de ce monde goûté l’agrément
Jeunesse a fui, lointaines, ô si lointaines heures,
Avril et mai, juillet aussi sont partis
J e ne suis plus rien, je ne vis plus volontiers.
( ( i J a i de ce monde », poème de lu folie, PI.,
p . 1022)
Holderlin fou, ayant expérimenté (( la fin qu’est le Christ )) (« Patmos D), est
accordé dans l’Esprit, qu’il nomme (( le matin de sa vie )) (« Devenir de l’Esprit P), à
l’Aurore eschatologique qui monte du Couchant :
Le jour nouveau descend des collines lointaines,
Le matin, qui s’est éveillé des crépuscules,
R.it aux humains paré d e sa fraîcheur allègre;
Le cœur de l’homme est traversé d e douces joies.
Une nouvelle vie se dévoile à l’avenir.
(. Printem@ », poème de lu folie, PI.,
p . 1029)
Dans le détournement catégorique du divin en Christ, auquel il reste eschatologiquement approprié par l’Esprit, il a appris que : (( Vivre est une mort, et la mort
elle aussi est une vie )) ( NEn bleu adorable D). La vie qui est une mort, c’est le désir
de s’éterniser dans l’Absolu divin qui dévore l’humain :
383
Douleur aussi, cependant, lorsque l’été
IJn homme est couvert de rousseurs.
Etre couvert des pieds à la tête de maintes taches!
Tel est le travail du beau soleil;
Car il appelle toute chose à sa fin.
(. En bleu adorable v , PI., p . 941)
Mais le Holderlin fou ne craint plus la dévastation solaire de l’Absolu, car
quand d u ciel de midi luit la haute lumière sur toi », il y a entre le rayonnement
divin et lui (( le nuage de l’Esprit, gris et humide )) (« Le cimetière )), poème de la
folie, PI., p. 1026). Cette nuée ténébreuse de l’Esprit qui trace la a médiateté d u
Dieu d’un apôtre », signifie non pas l’absence de Dieu mais son ouverture comme
Père, car
((
Dieu est-il inconnu?
Est-il comme le ciel évident!
Je le croirais plutôt.
(U
En bleu adorable v , PI.,
p . 939)
Le nuage de l’Esprit est (( le signe brillant dans le ciel d’orage D («Patmos ») de
la volonté d u Père, dans lequel (( le Christ s’est renoncé de lui-même »,et qui accorde
médiatement l’homme à Dieu dans le retrait de la paternité-filiation :
Qu’est-ce que Dieu? Inconnu, néanmoins
Plein d’attributs est le visage du ciel, de Lui
(U Qu’est-ce que Dieu?
Dans la
((
N,
PI., p. 887)
médiateté N que maintient l’Esprit, les hommes
Images de la divinité [...I contemplent le ciel.
Et lisant en quelque sorte comme dans un écrit,
Imitent la richesse de l’infini.
Le simple ciel nu est-il donc riche?
Les nuages sont pareils à des fleurs...
(U Qu’est-ce que la vie? U PI., p . 887)
Suivant dans l’Esprit la soumission d u Christ, jusqu’à la mort, à (( la volonté
d u Père qui est pour lui la chose de plus haut prix n («Patmos N), Holderlin découvre
que cette (( mort est aussi une vie ». En effet celle-ci le relie eschatologiquement au
Père par la filiation, seule patrie (Vaterland) à lui enfin accordée au.près d u TrèsHaut que nul désir ne peut saisir :
A la fin tu vas Le trouver.
Aucun mortel ne peut le saisir.
Du Très-Haut je veux faire silence.
Fruit interdit, comme le laurier, pourtant I1 est
Le plus la patrie (Vaterland).
Celui-là pourtant le goûte
Chacun à la fin.
(. Un jour j’ai interrogé la muse >, PI., p . 893, trad. légèrement modifiée)
Accordé par l’Esprit à la (( fin )) dans le Père (( qu’est le Christ N (« Patmos »)
Holderlin, enfant, fou ou innocent, entre dans le mystère de l’humilité filiale, c’està-dire dans l’eschatologie. I1 conclut tous les derniers poèmes de sa folie par les mots
(( avec humilité D
(mit Untertanigkeit), les signes d’un nom nouveau que lui seul
384
1. La maison natale de Hôldertin à LaufTen, sur le
Neckar.
2. Niirtingen, vers 1850.
3. Holderlin en 1786.
4. Silhouette d'Holderlin, vers 1797.
5. Le Stift de Tubingen, vers 1820.
6. Louise Nast (1768-1839). Silhouette à partir
d'une ombre portée,
7. G.W.F. Hegel (1770-1831). Lithographie de
F.W. Bollinger.
8. F.W.J. Schelling (1775-1854). Dessin de
Friedrich Tieck.
9. Hôlderlin en 1792.
10. Suzette Gontard. Buste de
Landolin Ohmacht.
11. La maison de la famille
Gontard « Zum weiBen
Hirsch », à Francfort.
12. Isaak von Sinclair (17751815).
13- Friedrich V, landgrave de
Hesse-Hombourg (17481820) .
14. Caroline, comtesse de
Hesse-Hombourg (17461821) .
15. Augusta, princesse de
Hesse-Hombourg (17761871).
16. La maison du consul Meyer
à Bordeaux, vers 1801.
17. L'hymne « l'Unique ».
18. La tour de Holderlin à Tubingen.
Aquarelle de M . Yelin, vers 1850.
19. Homburg vor der Höhe.
20. Friedrich Hölderlin.
Dessin de J.G. Schreiner et R. Lohbauer,
27 juillet 1823.
2 1 . Hölderlin. Fusain de J.G. Schreiner, 1825-1826.
comprend en dehors de Celui qui le lui a donné, et y inscrit des dates qui varient
de plusieurs siècles, signifiant par là que les coordonnées de l’espace et du temps ne
circonscrivent plus le lieu d’où monte son chant.
Que la charité, la foi et l’espérance ne s’effacent jamais de mon cœur, j’irai alors
n’importe où avec la certitude de pouvoir dire à la fin : j’ai vécu!
Puissé-je parcourir ainsi chacun des jours de ma vie, toujours entre ciel et terre,
partagé entre l’humilité et la foi, et mériter ainsi le doux sommeil et le repos
espéré. (Lettre à sa famille, en 1800, Pl., p. 980, 986 sq.)
Mais le paisible abandon eschatologique dans l’Esprit de Holderlin fou ne doit
pas faire oublier les souffrances qu’il a endurées avant que le danger suprême du
Christ ne devienne pour lui salvifique. C’est ce qu’il confiera, au seuil de sa folie, à
la Mère du Christ :
Beaucoup j’ai pour toi
Et pour ton Fils
Souffert, ô Madone,
Depuis que j’ai entendu parler de Lui,
En tendre jeunesse.
(U
A la Madone
.v,
PI., p. 888)
Avant que comme (( aux plus aimés du Dieu, égalité d’âme lui ait été donnée ))
il a connu le désir nostalgique et dévorant de l’Absolu qui lui fermait tout accès au
Père :
Et maint chant
Que de chanter au Très-Haut, au Père,
J’avais médité,
Me l’a dévoré la mélancolie.
(Ibid.)
Ce n’est qu’à Patmos que Holderlin apprendra auprès de Jean comment la
Vierge a su demeurer, elle qui (( a vu, divinement dolente en l’âme forte, mourir les
deux )) (NA la Madone N),à savoir Jean-Baptiste et le Christ.
Mais avant d’entrer dans (( la plus haute entente dans l’Esprit le plus Haut
auprès du Dieu plus médiat d’un apôtre )) (RemarqueJ Jur Antigone), Holderlin est
allé jusqu’au bout de la tragique dialectique de l’esprit à la recherche de la pleine
conscience de soi, de la parousie du Sujet comme le Dieu de l’idéalisme absolu
(désigné par Hegel comme Esprit Absolu) :
La présence du tragique repose sur le fait que le Dieu immédiat, tout Un avec
l’homme - car le Dieu d’un apôtre est plus médiat, est la plus haute entente au
sein de l’Esprit le plus haut -, que l’infinie possession par l’esprit, en se séparant
salutairement, se saisit d’elle-même infiniment, c’est-à-dire en des oppositions, dans
la conscience (Bewusstsein) qui supprime (aufhebt) la conscience, et que le Dieu
est présent dans la figure de la mort. (Remarques JUT Antigone, PI., p. 957, trad.
légèrement modifiée; c’est Holderlin qui souligne.)
Le Dieu Absolu, atteint dans la Parousie de la conscience à travers le mouvement
négatif du désir qui le saisit infiniment par 1’Aufhedtlng de toute limite, n’est plus
pour Holderlin qu’un (( Dieu présent dans la figure de la mort ». I1 annonce déjà
Nietzsche quand, à Tübingen, alors que Hegel et Schelling découvrent avec enthousiasme le panthéisme spinoziste et son Absolu athée, il se pose la question décisive :
385
Mais n’est-ce pas précisément ce que nous désirons qui nous inspire les plus grands
doutes? Qui donc nous aidera à sortir de ce labyrinthe? (Lettre de 1791. Pl.,
p. 70; c’est Holderlin qui souligne.)
Alors que pour Hegel le moment négatif n’est que le travail de l’esprit dans
son impatience d’Absolu, la question radicale de Holderlin le pousse à voir l’instance
de la (( séparation )) comme (( salutaire )) en elle-même. C’est en effet, à ses yeux, la
plus haute possibilité de l’homme de pouvoir faire face au désir infini de conscience
de Soi qui menace de l’accoupler, comme Antigone, au (( Dieu présent dans la figure
de la mort )) :
C’est une grande ressource de l’âme, dans son travail secret, qu’au moment de la
plus haute conscience, elle s’esquive de la conscience, et qu’avant que le Dieu présent
ne s’en empare effectivement, elle l’affronte d’une parole hardie et souvent même
blasphématoire, gardant ainsi vivante la sainte possibilité de I‘Esprit. (Remarques
sur Antigone, Pl., p. 961.)
Pour garder vivante cette sainte possibilité de l’Esprit, c’est-à-dire (( l’entente du
Dieu plus médiat d’un apôtre au sein de l’Esprit le plus haut B, Holderlin, rencontrant
le danger )) du Dieu présent au moment de la plus haute conscience, l’a affronté en
(( s’esquivant de la conscience N ce qui constitue, surtout au plus fort de l’idéalisme,
le propre de la folie. L’interprétation qu’en donne Holderlin est cependant tout autre :
cette (( ferme demeurance devant le mouvement du Temps, réellement la plus haute
conscience », est conçue par lui comme (( une héroïque vie d’ermite )) (Remarques sur
Antigone).
S’il a affronté héroïquement (( le Dieu présent dans la figure de la mort », c’est
qu’il avait expérimenté au plus haut point l’annihilation de soi qu’entraîne paradoxalement l’accession à la conscience absolue de soi :
La conscience de soi à son apogée ressemble alors toujours à des choses qui n’ont
pas de conscience mais qui accueillent, dans leur destin, la forme de la conscience.
Une telle chose voilà ce qu’est un pays devenu désert qui, dans l’exubérance
originelle de sa fécondité, amplijie excessivement les effets de la lumière solaire et,
dès lors devient aride. (Remarques sur Antigone, Pl., p. 961.)
C’est dans le désert hanté par le danger de l’Absolu que Holderlin a rencontré
le Christ, (( sous la figure d’un mendiant sous le soleil », (( se renonçant de lui-même ))
et traçant ainsi dans sa kénose et son retrait la médiateté du Dieu Père. I1 lui a été
donné ainsi d’entrer finalement dans ce qu’il ne pouvait encore qu’espérer à l’époque
de Tübingen :
Qui donc nous aidera à sortir de ce labyrinthe? Le Christ... I1 doit savoir qu’il y
a un Dieu et ce qu’Il est, étant intimement lié à la divinité. Etant Dieu même.
(Lettre de 1791. Pl., p. 70; c’est Holderlin qui souligne.)
Ce n’est qu’après le long chemin d’Hypérion et d’Empédocle vers la Grèce solaire
habitée par le divin, que Holderlin revenant, (( comme un signe privé de sens, mort
à toute souffrance, ayant presque perdu la parole en pays étranger )) (« Mnémosyne »),
vers son Vaterland chrétien, va faire le chemin qui mène de la Grèce à Patmos :
Quand j’eus nouvelle
Que l’une parmi les proches îles
Etait Patmos,
Le désir me saisit
D’y descendre et de tenter là-bas
L‘approche de la grotte obscure.
386
Car Patmos
N’habite point, comme Chypre ou quelqu’une
Des autres îles
La mer avec faste,
Mais dans une demeure plus pauvre, elle est pourtant
Pleine d’accueil.
(c Patmos Y, FI., p . 868-869.)
Délivré, dans la pauvre grotte de l’Apocalypse, de l’obsession grecque d’un divin
immédiat, Holderlin pouvait écrire à Schiller, le maître qui avait incarné pour lui
l’idéal du pèlerinage aux sources grecques pendant la période d’Hypérion, ces lignes
qui sonnent presque comme une provocation :
Depuis quelques années je me consacre de façon presque constante à la littérature
grecque. Après en avoir commencé l’étude je n’ai pu l’interrompre sans qu’elle
m’ait rendu la liberté qu’elle vous ravit si facilement au début. (Lettre de 1801. Pl.,
p. 1000.)
Et il s’écarte de tout l’hellénisme esthétique de l’époque en écrivant carrément
à son ami Bohlendorff :
II est particulièrement dangereux de tirer les règles de notre art de la seule perfection
grecque. J’y ai longtemps peiné et je sais désormais qu’à part ce qui doit être,
chez les Grecs et chez nous le plus haut, à savoir le rapport vivant, le destin, il
ne nous est pas du tout permis d’avoir avec eux quelque chose d’identique. (Lettre
de 1801. FI., p. 1003-1004, trad. légèrement modifiée.)
Pour Holderlin, l’homme occidental doit imiter les Grecs uniquement en étant
aussi fidèle à son destin qu’ils le furent au leur. O r l’occidental vit dans la revendication
du Dieu (( plus médiat )), du (( Dieu d’un apôtre )) :
Pour nous, vu que nous vivons sous le règne du Zeus qui est le plus proprement
lui-même, ce Zeus qui non seulement érige une limite entre cette terre et le monde
farouche des morts, mais encore force plus décisivement vers la terre l’élan panique
éternellement hostile à l’homme, l’élan toujours en chemin vers l’autre monde [...I
et que notre poésie doit être hespérique. (Remarques sur Antigone, Pl., p. 963;
Holderlin souligne.)
Pour faire retour à la terre de leur Vuterland et cesser d’aspirer au rapport des
Grecs avec le divin, les Occidentaux doivent devenir hespériens c’est-à-dire entrer,
par le détournement catégorique de Dieu en Christ, dans le ((règne du Zeus plus
proprement lui-même )) :
Quand reconnaîtra-t-on chez nous que dans son expression la force suprême est
en même temps la plus modeste et que le divin, quand il se manifeste, ne peut
aller sans une certaine humilité. (Lettre de 1798, PI., p. 680.)
C’est probablement la suprême modestie de la manifestation du (( Zeus plus
proprement lui-même N reconnue dans (( la figure de mendiant du Christ N, qui conduit
Holderlin à parler dans la dernière lettre écrite avant la folie (( du côté mystérieux et
plus divin de notre sainte religion dans son originalité par rapport aux Grecs )) (lettre
de 1804 à la princesse de Hombourg). Ce Dieu (( plus divin N Holderlin l’a découvert
à Patmos auprès de Jean, le type de l’homme hespérique, car son Dieu est le (( Dieu
plus médiat d’un apôtre )) dont le Christ a trace la dimension paternelle :
Nous avons vénéré la Terre, notre mère,
Et voici peu, la lumière du soleil
387
Ne sachant point, mais le Père aime,
Le maître du monde, avant toute chose,
Que la lettre en sa fermeté soit maintenpe avec soin;
Que ce qui dure soit bien interprété.
(. Patmos », PI.,
p . 8 7 3 , trad. Iégèrement modifiée)
Cette (( lettre )) d u Père c’est l’Écriture comprise à sa racine comme le (( signe ))
de sa volonté sous lequel s’est placé le Christ, c’est sa loi, c’est-à-dire pour Holderlin
le (( statut )) de la médiateté propre à sa paternité. La dimension ciel-terre comme
distance paterno-filiale devient dès lors le seul rapport possible des hommes à Dieu :
Qu’est-ce donc que la vie des hommes? Une image de la divinité.
C’est sous le ciel que cheminent tous les tewestres : ils
Le contemplent, Et lisant, en quelque sorte, comme
Dans un écrit, les hommes imitent la richesse et
L’infini. Le simple ciel nu
Est-il donc riche? Les nuages d’argent sont pareils
A des fleurs.
(c
Qu’est-ce donc que la vie?
»,
PI.,
p . 887)
I1 est apparu plus haut que ces nuages-écriture du Père sont les nuages de
l’Esprit. Ils séparent et accordent les hommes au Père, tracent le signe N de sa volonté
dans le ciel, c’est-à-dire sa (( lettre, ce qui dure et doit être bien interprété )) par les
hommes qui demeurent sur la terre comme sur le Vaterfand. En traçant le retrait du
Père les nuages de l’Esprit protègent l’homme de l’éclat trop immédiat du divin :
Quand du ciel de midi luit la haute lumière
Sur toi, quand le printemps s’y attarde avec plaisir,
Quand le nuage de l’Esprit là-bas, gris et humide...
(c
Le cimetière vi PI.,
p . 1026)
En voilant le ciel bleu ils accordent à l’homme la (( richesse et l’infini )) du Père
selon un mode médiat qu’il peut imiter en demeurant (( terrestre )) :
Mais quand l’azur
Est effacé, le bleu simple, voici paraître
Le mât du ciel - qui ressemble à du marbre - tel du minerai :
Signe de la richesse.
(c
Qu’est-ce donc que la vie?
v,
PI.,
p . 887.)
Cette (( imitation de la richesse infinie N du Père est rythmée par l’écriture de
l’Esprit qui trace dans les nuages qui le voilent, le signe-bénédiction de sa volonté :
Que de révélations le Dieu prodigue!
Car depuis un long temps déjà les nues
(Euvrent d’en Haut vers la terre et, plein
De promesses, le désert sacré s’enracine.
(t
Les Titans v , PI., p . 893)
La bénédiction du Père, à travers (( les nuages d’argent, pareils à des fleurs, d’où
tombent en pluie l’humide et la rosée )) (« Qu’est-ce que la vie? »), est conçue comme
une a promesse qui enracine le désert ». En faisant de lui un (( désert sacré », la
promesse salvifique )) du Père l’enracine, exorcisant ainsi le (( lieu où le danger croît »,
dans le développement dévastateur du désir de Dieu, car
388
Le Dieu qui médite hait
L’intempestive croissance
(U Lorsque pourtant ceux du ciel y, PI.,p . 898)
Le Christ est venu justement sauver les hommes de cette croissance intempestive
dans laquelle les entraîne leur volonté d’Absolu. Le Christ, parfaitement accordé au
(( Père dont les œuvres lui sont connues de tout temps )) (« Patmos »), (( s’est renoncé
de lui-même »,car (( la volonté d u Père est pour lui chose d u plus haut prix », et a
pu ainsi, dans son obéissance filiale, (( maintenir fermement la lettre )) et (( bien
interpréter ce qui dure », le statut d u Père, pour le salut des hommes :
Oui, le Christ était debout, solitaire,
Sous le ciel visible et les astres (visible à Qui libre pouvoir
Fut consenti par Dieu sur les statuts, et sur les
Péchés du monde ...
(U L’unique m, Pi.,p. 866)
Les (( péchés d u monde N viennent justement de l’ignorance d u statut paternel,
qui libère la mégalomanie d u désir d’absolu s’exprimant sous la forme d’une infinie
croissance d u vouloir-savoir et de l’activité humaine :
...les péchés du monde; cette incompréhensibilité (Unverstündiidkeit).Des connaissances (Kenntnisse), quand l’affairement (das Geschüfiige) de l’homme déborde ce
qui perdure. (« L’unique », Pl., p. 866, trad. modifiée.)
(( Ce qui perdure N (Bestandiges), c’est le (( statut )) (Eingesetztes) du Père, car U le
Père veut que la lettre soit fermement maintenue et que ce qui dure (Bestehendes)
soit bien interprété N (« Patmos »). Le Christ est donc celui qui ouvre, comme
dimension entre ciel et terre, le statut d u Père et contient ainsi le danger de l’accélération
infinie d u désir affairé de l’homme. Il apporte
...de Dieu la conscience du devoir,
Mais du Seigneur qui sort du ciel,
Puis vient le temps de la loi imparticipable
Le ministère...
Remettre en ordre les pensées tombées
Dans le mal. Car Dieu hait
D‘une haine redoutable, les fronts omniscients.
(U
Patmos Y, PI., p . 1219)
Le statut d u Père donné dans le Christ cmnme révélation de la conscience morale
contient l’activité frénétique des fronts omniscients. Cet affairement angoissé de la
Volonté, Holderlin, à l’aube d u monde contemporain, le voit déjà à l’œuvre autour
de l u i :
Je reconnais dans les petits comme dans les grands côtés de l’activité et du caractère
des hommes un seul e t même caractère, un seul et unique destin. Oui, c’est ce besoin
d’avancer, de sacrifier un présent assuré à quelque chose d’incertain, de différent,
de meilleur, que je considère comme la cause première des faits et gestes de tous
les hommes qui m’entourent... Favoriser la vie, accélérer et perfectionner la marche
permanente de la Nature, idéaliser ce qu’il rencontre, voilà le besoin le plus
particulier, spécifique de l’homme, et tous ses arts, ses occupations, ses déficiences
et ses souffrances procèdent de ce besoin [...I Même lorsqu’ils s’acharnent à se
détruire mutuellement, c’est encore parce qu’ils ne peuvent se contenter du présent,
parce qu’ils veulent le transformer, et c’est ainsi qu’ils se précipitent prématurément
389
au tombeau de la Nature et qu’ils accélèrent la marche du monde (lettre à son frère ;
1799, Pl., p. 790 sq.).
Cette lettre est écrite au moment où Holderlin prépare sa tragédie Empédocle.
Or dans son Fondement pour /Empédocle le poète rattache (( le vivant esprit artistique
mettant tout à l’épreuve )) des Agrigentins (( hyperpolitiques, procéduriers et calculateurs », à l’élan panique qui pousse Empédocle, le héros en qui s’accomplit leur
destin, vers le tombeau de la Nature », dans le feu divin de l’Etna qui n’est autre
que (( le Dieu présent dans la figure de la mort au moment de la plus haute conscience ».
Et ce mouvement panique d u désir que Holderlin suspectait déjà à quatorze ans
comme (( l’action extrêmement vive de la Nature sur mon cœur », est maintenant
dénoncé ouvertement comme étant le mal, c’est-à-dire a l’élan naturel (Naturgang),
éternellement hostile à l’homme, que le Zeus plus proprement lui-même force plus
décisivement vers la terre N (Remarques sur Antigone). Au seuil de notre époque,
Holderlin a prononcé symboliquement la secrète articulation de la technique moderne
et de la mystique du (( Dieu présent dans la figure de la mort »,dénouant peut-être
ainsi l’avenir hespérique de l’occident.
Le Christ est celui qui accomplit, pour Holderlin, le retournement de la Volonté
d’Absolu de l’homme, en le faisant entrer dans (( la plus haute entente [VerJtand,
opposé à 1’Unverstandlicbkeit omnisciente de la conscience] au sein de l’Esprit le plus
haut, car le Dieu d’un apôtre est plus médiat N (Remarques sur Antigone). L’Esprit
surgit en effet du (( statut N du Père que le Christ a instauré sur la terre, par son
obéissance et son retrait, qui font d’elle le Vaterland. En séparant l’homme de l’élan
panique de la Nature qui l’attire vers le (( Dieu présent », 1’«Esprit ferme N maintient
l’homme dans le retrait du Père et lui révèle une beauté divine qui n’est plus celle
de l’extase, propre à la Nature, mais celle de l’innocente (( pureté 1) filiale de (( l’image
de Dieu )) :
Les portes [de l’église] sont encore de la Nature...
Mais la pureté est, elle, beauté aussi.
Du départ au-dedans naît un esprit ferme.
Si simples sont les images, si saintes,
Que parfois on a peur, en vérité,
Elles ici de les décrire.
(U En bleu adorable v , Pi., p. 939, trad. iégèrement modijiée)
Ces (( images vivantes que l’Esprit fait éclore )) («Patmos ») sont ces (( hommes
au destin magnifique que l’Esprit crée n (ibid.),capables de demeurer purement accordés
au Père dans son retrait, en (( imitant son infinie richesse N (« Qu’est-ce que la vie? ») :
Un homme peut-il dire en regardant en Haut :
Tel je voudrais être? Oui, tant que dans son cœur
Dure la bienveillance toujours pure,
L’homme peut se mesurer avec le divin
Non sans bonheur.
Dieu est-il inconnu?
Est-il comme le ciel évident?
Je le croirais plutôt.
Telle est la mesure de l’homme.
Riche en mérites, c’est poétiquement toujours
Qu’habite l’homme sur la terre. Mais l’ombre
De la nuit avec les étoiles n’est pas plus pure
Si j’ose dire, que
L’homme, qu’il faut appeler une image de Dieu.
( c En bleu adorable y, Pi.,p . 939, trad. légèrement modijiée)
390
Ces vers admirables articulent et récapitulent tout ce qui a été dit de l’audacieuse
liberté de la vie dans l’Esprit qui, en faisant de l’homme une (( image de Dieu »,lui
permet de (( se mesurer purement à Dieu )) dans la (( nuit étoilée N de son retrait
paternel. Et cela (( non sans bonheur, tant que la bienveillance toujours pure dure dans
son cœur », tant qu’il garde dans (( l’Esprit ferme N la médiateté du Père.
Se mesurer au divin d’une autre manière c’est, pour Holderlin, le destin chaotique
des Titans qui (( ont dérobé la force du ciel N (« A la Madone »>. Les Titans sont cette
race empédocléenne qui, aveugle au mystère du Christ, n’a vu en lui que la suprême
immédiateté du (( Dieu présent dans la figure de la mort D :
Mais quand Celui qui ébranle l’univers
Plonge dans l’abîme
Pour lyi donner vie, ils croient
Que 1’Etre divin descend auprès
Des morts et il s’éveille une clarté
Souveraine au gouffre du tumulte
Où rien ne demeure caché.
( U Les Titans P, Pi., p . 894, trad. légèrement modifiée)
Cette présence disponible de l’Absolu ils la trouvent dans le Christ en la personne
de qui la Vierge a mis Dieu au monde :
Comme proie les Princes-Titans les dons
De la Mère empoignent
(U A la Madone Y , PI., p . 892)
Cette puissance du divin en Christ est avidement dévorée dans (( le gouffre
tumultueux D qui n’est autre chose que l’insatiable vouloir des Titans pour qui a rien
ne demeure caché »,eux que Holderlin nommait (( les fronts omniscients )) (« L’unique »>,
qui vivent dans la U clarté souveraine )) et mortelle du midi, (( au moment de la plus
haute conscience ». Et à l’heure méridienne de la divinisation titanesque, la parole,
en laquelle se trace le statut du Père, est complètement effacée dans la figure du Dieu
absolument présent en l’homme :
Puisque tu donnas
Aux mortels
Tentante figure de dieux
Pourquoi une parole? Ainsi pensai-je, car il hait le parler celui qui
Epargne la lumière de vie nourricière du cœur.
( U A la Madone v , Pi., p . 892)
Le Titan, qui s’est approprié jalousement la (( clarté souveraine )) du divin
disponible en Christ, est l’homme muet, incapable d’interpréter le (( signe n du Père
qu’il porte pourtant en lui :
Un signe, tels nous sommes, sans aucun sens,
Morts à toute souffrance, et nous avons presque
Perdu la parole en pays étranger.
( U Mnémosyne Y , PI., p . 879, trad. légèrement modifiée)
Mais Holderlin, à l’heure de la tentation titanesque où il entre dans le (( moment
de la plus haute conscience »,se sentant emparé par le (( Dieu présent dans la figure
de la mort », s’écrie :
39 1
L’homme affronte seul et sans peur le Dieu,
Q u a n d il le faut;
Sa simplicité le garde ...
Jusqu’à ce que le défaut d e Dieu lui soit secours.
(Pl., p. 780, trad. légèrement modifiée)
Ces vers appartiennent à une ode intitulée (( Vocation de poète ». O n comprend
mieux le sens du dernier vers, à première lecture si scandaleux, si on le rapproche
du poème (( En bleu adorable )) où il est dit que demeurer pur dans le retrait de
Dieu c’est
...la mesure d e l’homme.
Riche en mérites c’est poétiquement toujours
Q u e l’homme habite sur la terre.
(PI., p. 939, trad. légèrement mod+ée)
Fidèle à sa
((
vocation de poète », Holderlin
au moment d e la plus haute conscience, s’est esquivé de la conscience, et avant
que le Dieu présent ne s’empare de lui effectivement, il L’a a