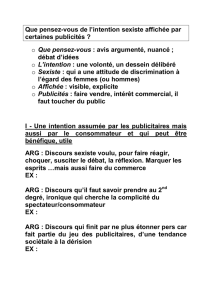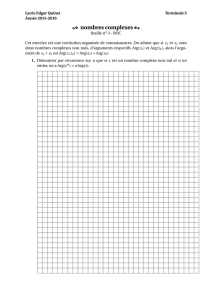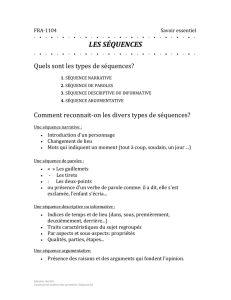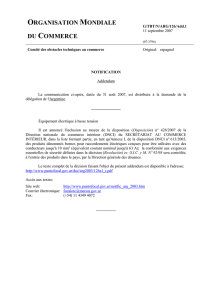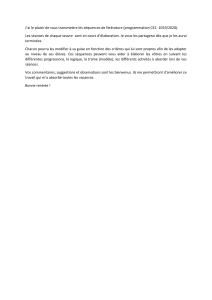M. Jean-Michel Adam
L'argumentation dans le dialogue
In: Langue française. N°112, 1996. pp. 31-49.
Abstract
Jean-Michel Adam, L'argumentation dans le dialogue
Within the frame of textlinguistics and of a theory of the levels of discourse organization, this article provides a study of the forms
of the insertion of argumentation in written dialogues (drama, fiction, newspaper interviews). Argumentation is first dealt with as a
microlinguistic phenomenon (connected clauses and sentences) and is then examined as a macrolinguistic phenomenon
(expanded argumentative sequences).
Citer ce document / Cite this document :
Adam Jean-Michel. L'argumentation dans le dialogue. In: Langue française. N°112, 1996. pp. 31-49.
doi : 10.3406/lfr.1996.5359
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/lfr_0023-8368_1996_num_112_1_5359

Jean-Michel
ADAM
Université de
Lausanne
L'ARGUMENTATION
DANS
LE
DIALOGUE
1.
L'organisation
périodique
et
séquentielle
des
textes
dialogaux
écrits
1.1.
Le
cadre
théorique
d'une
linguistique
textuelle
Le
modèle
de
la
structure
compositionnelle
des
textes
que
je
propose
—
et
qui
rompt
avec
l'idée
même
de
«
typologie
des
textes
»
—
n'a
de
sens
que
dans
la
perspective
globale
d'une
théorie
des
plans
d'organisation
du
discours.
J'ai
esquissé
ce
cadre
théorique
dans
mes
Éléments
de
linguistique
textuelle
(1990)
et
dans
Les
textes
:
types
et
prototypes
(1992).
Cette
réflexion
est
proche
de
certaines
propositions
de
Bernard
Combettes
(1992)
et
de
Michel
Charolles
(1988, 1993). En
distinguant
divers
plans
d'organisation
de
la
textualité,
nous
cherchons
tous
trois
à
rendre
compte
du
caractère
profondément
hétérogène
d'un
objet
irréductible
à
un
seul
mode
d'organisation,
d'un
objet
complexe
mais
en
même
temps
cohérent.
Dans
cette
perspective,
les
textes
appar
aissent
comme
des
configurations
réglées
par
des
plans
d'organisation
en
constante
interaction.
Ces
plans
d'organisation
principaux
et
les
sous-plans
qui
les
composent
peuvent
être
considérés
comme
autant
de
sous-théories
(ou domaines)
d'une
théorie
d'ensemble.
Une
théorie
des
plans
d'organisation
est
nécessaire
parce que
les
solidarités
syntaxiques
(structurales
et
locales)
n'ont
qu'une
portée
discursive
très
limitée
:
Une
fois
que
l'on
est
sorti
du
domaine
de
localité
dans
lequel
ces
connexions
peuvent
fonctionner,
d'autres
systèmes
de
connexion
interviennent.
Ces
systèmes
ne
reposent
pas
sur
des
critères
structuraux,
ils
mettent
enjeu
des
marques
ou,
plus
exactement,
des
instructions
relationnelles
capables
d'exercer
leur
pouvoir
à
longue
distance.
(Charolles
1993
:
305).
Le
besoin
d'une
définition
des
plans
d'organisation
résulte
tout
simplement
de
l'objet
transphrastique
de
la
linguistique
du
texte.
En
effet,
les
connexions
proprement
tex
tuelles
sont,
d'une
part,
capables
de
fonctionner
à
longue
distance
et,
d'autre
part,
à
la
différence
des
connexions
phrastiques,
elles
n'entrent
pas
dans
des
schémas
aussi
contraints
que
les
schémas
syntaxiques.
Ceci
explique
que
le
texte
soit
une
«
entité
structuralement
ouverte
»
(Charolles
1993
:
311),
nécessitant
un
corps
de
concepts
descriptifs
propre
:
La
constatation
que
les
domaines
textuels
et
morpho-syntaxiques
sont
—
dans
une
large
mesure
—
indépendants,
que
la
cohérence
du
texte
n'est
pas
la
résultante
de
faits
de
grammatic
alité,
conduit
aussi
à
s'interroger
sur
la
pertinence
des
catégories
linguistiques
habituellement
reconnues.
Le
travail
sur
le
texte
entraîne,
par
définition,
l'obligation
d'éla
borer
des
notions
spécifiques
qui
ne
peuvent
recouvrir
—
sinon
partiellement
—
les
concepts
utilisés
en
grammaire
phrastique.
Ces
derniers
ne
sont
évidemment
pas
à
rejeter
en
bloc
;
ils
possèdent
leur
propre
utilité,
dans
leur
ordre,
mais
ne
peuvent
être
«
réutilisés
»
tels
quels,
dans
une
problématique
qui
s'attache
à
un
autre
domaine
que
le
leur.
(Combettes
1992
:
113).
31

Les
plans
d'organisation
sont
constitués
d'unités
qui
ne
s'intègrent
pas
les
unes
dans
les
autres
pour
former,
par
emboîtement
hiérarchique,
des
unités
de
rang
supérieur.
Ces
plans
possèdent
assez
d'autonomie
pour
être
disjoints
théoriquement
et
donc
étudiés
séparément,
de
façon
indépendante.
Interagissant
en
permanence,
ils
ne
disposent
toutefois
que
d'une
autonomie
très
relative
:
Les
convergences
entre
marques
relevant
de
différents
plans
d'organisation
du
discours
sont
très
souvent
de
type
heuristique
préférentiel.
Ce
ne
sont
pas
des
règles
déterministes.
Au
niveau
du
discours,
où
il
y
a
développement
en
parallèle
de
systèmes
de
solidarité,
les
marques
appartenant
à
ces
plans
sont
amenées
soit
à
se
corroborer
et
se
renforcer,
soit,
au
contraire,
à
s'inhiber
et
à
se
contrecarrer.
(Charolles
1993
:
313).
L'étude
de
ces
relations
et
leur
modélisation
est
une
tâche
primordiale
de
la
linguistique
textuelle.
En
raison
des
interactions
entre
les
plans
d'organisation,
le
cadre
de
cette
théorisation
ne
peut
être
que
celui
des
modèles
intégrant
la
complexité.
M.
Charolles
a
raison
de
parler
de
modèles
«
de
type
interactif
et
massivement
parallèle
dans
lesquels
on
jouera
sur
des
constellations
d'indices
pondérés
s'inhibant
ou
se
renforçant
»
(1993
:
314).
1.2.
Une
théorie
des
plans
d'organisation
Je
propose,
pour
ma
part,
de
distinguer
deux
plans
d'organisation
principaux.
Le
premier
[A]
assure
l'articulation
textuelle
des
suites
de
propositions
et
permet
d'expli
quer
le
fait
qu'un
texte
ne
soit
pas
une
suite
aléatoire
de
propositions.
Texture
[Al]
et
structure
compositionnelle
[A2]
assurent
la
continuité
textuelle.
Le
second
plan
[В]
а
trait
à
Г
organisation
pragmatique.
Trois
plans
de
cette
organisation
pragmatique
doivent,
à
mon
sens,
être
distingués
et
envisagés
dans
leur
interdépendance.
Du
sens
des
unités
lexicales
aux
isotopies
(polyisotopie
et
hétérotopie
engendrée
par
des
figures),
en
passant
par
le
thème
ou
topic
global,
une
représentation
est
construite
(«
monde(s)
»)
qui
correspond
à
Г
organisation
sémantico-référentielle
du
texte
[Bl].
Les
phénomènes
de
prise
en
charge
des
propositions
(focalisation,
polyphonie,
modalisation)
correspon
dent
quant
à
eux
à
Г
organisation
énonciative
[B2].
Enfin,
les
buts
ou
visées
sont
constitués
d'actes
de
langage
successifs
et
globaux
qui
correspondent
à
Г
organisation
illocutoire
[B3].
Soulignons,
au
passage, que
la
combinaison
de
ces
trois
points
de
vue
complémentaires
permet
de
considérer
les
textes
comme
constitués
de
suites
de
propos
itions
(unités
sémantiques
Bl),
de
suites
de
clauses
(unités
énonciatives
B2)
et/ou
de
suites
d'actes
de
langage
(unités
illocutoires
B3).
Faute
de
place,
je
ne
parlerai
pas
ici
de
fi-tte
organisation
pragmatique
et
concentrerai
mon
propos
sur
deux
aspects
de
la
texture
et
de
la
structure
compositionnelle.
La
texture
phrastique
[Al],
en
tant
que
système
de
solidarités
structurales
et
locales,
n'a
qu'une
portée
discursive
très
limitée.
Des
connexions
transphrastiques
sont,
en
revanche,
responsables
de
l'articulation
à
distance
des
énoncés.
Cette
texture
transphrastique
met
en
jeu
des
marques
qui
déclenchent
des
instructions
en
vue
de
l'établissement,
par
l'interprétant,
de
relations
entre
les
unités
linguistiques.
32

TEXTURE
[A.I]
TEXTURE
PHRASTIQUE
:
Domaines
classiques
de
la
linguistique
allant
du
phonème
au
syntagme.
TEXTURE
TRANSPHRASTIQUE
:
Liages
transphrastiques
allant
de
l'anaphore
et
de
la
progression
thématique
aux
faits
de
connexion
en
général
(organisateurs
et
connecteurs,
structure
périodique
du
discours).
Segmentation
(recouvrant
tous
les
phénomènes
de
ponctuation
liés
à
la
matérialité
de
la
mise
en
texte
écrite
comme
orale).
Dans
la
suite
du
présent
article,
je
ne
vais
insister
que
sur
deux
de
ces
plans
d'organisation
:
prioritairement
la
structure
périodique
du
discours,
marquée
par
des
connecteurs
(Adam
1990
:
72-83
&
1991
:
151-160),
et
secondairement
la
segmentation
typographique
(Adam
1990
:
68-72
&
1991
:
161-190).
Il
faut
ajouter
à
cette
première
organisation
micro-linguistique,
relativement
admise
par
les
linguistes
qui
travaillent
sur
l'unité
texte,
un
plan
d'organisation
macro-linguistique,
moins
communément
reconnu
(non
pris
en
compte
par
M.
Charol-
les
et
très
partiellement
envisagé
par
B.
Combettes),
que
je
désigne
comme
la
structure
compositionnelle
des
textes
[A2].
Ce
plan
d'organisation
concerne,
à
la
fois,
de
façon
inséparable,
l'articulation
des
types
de
séquences
de
base
et
les
plans
de
textes
plus
ou
moins
rhétoriquement
stabilisés.
Les
plans
de
textes
sont
généralement
fixés
par
l'état
historique
d'un
genre
de
discours
:
plan
canonique
des
articles
de
revues
de
psycholog
ie,
des
annonces
de
films
dans
les
programmes
de
télévision,
articles
de
dictionnaire
ou
d'encyclopédies,
recettes
de
cuisines,
catalogues
d'exposition,
dispositio
du
plaidoyer
de
la
tradition
rhétorique,
structures
du
sonnet
italien
ou
élisabéthain,
structure
en
actes
et
scènes
du
théâtre.
Cette
liste
ouverte
recouvre
l'ensemble
des
pratiques
discur
sives
réglées.
On
peut
ainsi
résumer
ce
que
j'entends
par
«
structure
compositionnelle
des
textes
»
:
STRUCTURE
•
STRUCTURE
RHÉTORIQUE
:
•
STRUCTURE
SÉQUENTIELLE
:
(Proto-)types
de
séquences
de
base
:
Modes
d'articulation
des
séquences
:
•
Suites
linéaires
:
•
Insertion
:
COMPOSITIONNELLE
[A.2]
Plans
de
textes
plus
ou
moins
réglés
par
des
genres
discursifs
•
Narratif
•
Descriptif
•
Argumentatif
•
Explicatif
•
Dialogal
•
Séquences
coordonnées
•
Séquences
alternées
•
Séquences
enchâssées
Conformément
au
fonctionnement
complexe
dont
il
a
été
question
plus
haut,
plans
de
texte
et
structure
séquentielle
ne
sont
pas
toujours
utilisés
de
façon
convergente.
Un
principe
de
composition
peut
l'emporter
sur
l'autre
et
un
texte
apparaître
comme
un
récit
canonique
ou
bien
comme
dépourvu
de
toute
organisation
séquentielle
au
profit
d'une
structuration
rhétorique
particulière.
Le
plus
souvent,
un
plan
de
texte
prend
en
charge
l'organisation
globale
tandis
que
la
structuration
séquentielle
organise
telle
ou
33

telle
partie
ou
sous-partie
d'un
plan.
Mes
propositions
théoriques
relatives
aux
(proto)-
types
séquentiels
ont
pu
laisser
croire
que
tout
texte
était
exclusivement
réglé
par
ce
second
principe
de
composition,
mais
il
faut
bien
voir
que
les
textes
sont,
en
fait,
très
souplement
structurés
et
que
l'importance
des
plans
de
texte
est
essentielle.
Certains
textes
ne
comportent
pas d'organisation
séquentielle
canonique
et
leur
plan
de
texte
n'a
rien
d'un
plan
préétabli.
Dans
ce
cas,
d'autres
plans
d'organisation,
sémantique
et/ou
illocutoire
(actes
de
discours)
par
exemple,
prennent
le
dessus
;
les
marques
de
connexion
en
général
et
surtout
la
segmentation
jouent
alors
un
rôle
primordial.
L'interaction
entre
les
plans
d'organisation
explique
le
fait
qu'une
organisation
séquent
ielle
descriptive
ou
argumentative,
comme
nous
allons
le
voir
plus
loin,
ne
parvienne
pas
à
se
mettre
en
place
et
qu'il
ne
reste
que
des
propositions
descriptives
éclatées
ou
des
micro-
mouvements
argumentatifs
de
type
périodique.
1.3.
De
la période
à
la
séquence
argumentative
Pour
Aristote,
c'est
la
notion
rythmique
de
nombre
qui
définit
la
période.
Plus
tardivement,
la
notion
se
grammaticalise
et
les
ouvrages
de
rhétorique
définissent
la
période
comme
une
phrase
complexe
dont
l'ensemble
seul
forme
«
un
sens
complet
»
et
dont
chaque
proposition
constitue
un
membre,
la
dernière
formant
une
chute
ou
clausule. Depuis Dumarsais
(article
«
construction
»
de
Г
Encyclopédie),
la
période
n'est
plus
«
qu'un
assemblage
de
propositions
liées
entre
elles
par
des
conjonctions
».
Dans
l'article
«
Mot
»
de
VEncyclopédie
Méthodique
du
XVHIe
siècle,
Nicolas
Beauzée
cite
l'abbé
Girard
en
soulignant
la
«
vérité
»
de
cette
remarque
:
[...]
Les
Conjonctions
sont
proprement
la
partie
systématique
du
discours,
puisque
c'est
par
leur
moyen
qu'on
assemble
les
phrases,
qu'on
lie
les
sens,
et
que
l'on
compose
un
Tout
de
plusieurs
portions,
qui,
sans
cette
espèce,
ne
paraîtraient
que
comme
des
enumerations
ou
des
listes
de
phrases,
et
non
comme
un
ouvrage
suivi
et
affermi
par
les
liens
de
l'analogie
(1986
:
580).
Largement
développée
par
les
grammairiens
et
les
stylisticiens
classiques,
cette
notion
est
réapparue
récemment
sous
la
plume
de
linguistes
spécialistes
de
l'oral
(D.
Luzzati
1985). En
l'absence
d'unité
minimale
de
l'oral,
ces
derniers
ont
eu
besoin
de
définir
des
blocs
d'unités
entretenant
entre
elles
des
liens
hiérarchiques
de
dépendance
morpho-syntaxiquement
marqués.
Se
référant
partiellement
à
ces
travaux,
M.
Charol-
les
(1988)
a
été
le
premier
à
considérer
la
période
comme
un
plan
d'analyse
textuelle.
A.
Berrendonner
et
M.-J.
Reichler-Béguelin
ont
recouru
également
à
la
notion
de
période
pour
dépasser
celle
de
phrase
:
«
Dans
Malgré
la
pluie,
je
vais
arroser
les
fleurs,
le
morceau
Malgré
la
pluie
sert
à
accomplir
un
acte
de
concession,
et
c'est
une
clause,
au
même
titre
que
je
vais
arroser
les
fleurs
;
on
a
donc
affaire
à
une
phrase
qui
transcrit
un
assemblage
de
deux
clauses,
ou
période
binaire
»
(1989
:
113).
En
me
concentrant
ici
sur
les
liages
de
propositions
par
des
connecteurs
—
qui
ne
constituent
qu'une
partie
des
phénomènes
périodiques
—
,
je
dirai
qu'un
micr
omouvement
argumentatif
élémentaire,
interne
à
une
structure
périodique,
correspond
soit
à
un
ordre
progressif
:
Donnée
(argument)
—
[inference]
—
>
Conclusion
soit
à
un
ordre
régressif
:
Conclusion
<
—
[inference]
—
Donnée
(arg).
Dans
l'ordre
progressif
34
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%