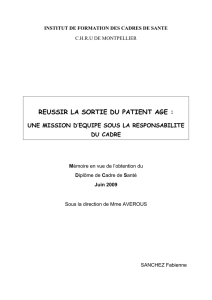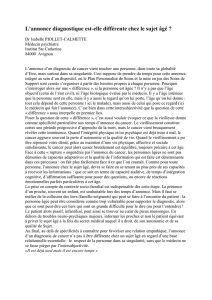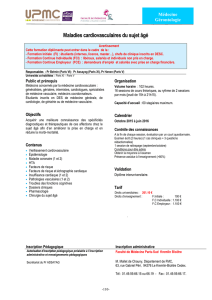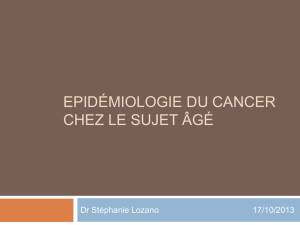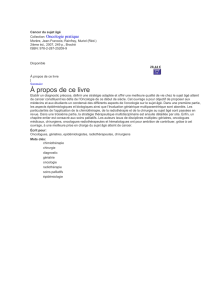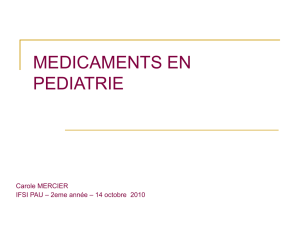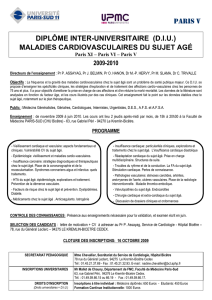Série « pneumologie de la personne âgée »
Coordonnée par Vincent Niname
Pharmacocinétique chez le sujet âgé
F. Péhourcq, M. Molimard
Département de Pharmacologie, CHU Pellegrin-Carreire, Bordeaux.
Tirés à part : M. Molimard
Département de Pharmacologie, CHU Pellegrin Carreire,
330076 Bordeaux Cedex.
Réception version princeps à la Revue : 12.06.2001.
Retour aux auteurs pour révision : 13.08.2001.
Réception 1
ère
version révisée : 12.10.2001.
Acceptation définitive : 22.10.2001.
Résumé
Les changements physiologiques qui interviennent chez le sujet
âgé de plus de 65 ans sont à l’origine de modifications de la
pharmacocinétique des médicaments. Chez le sujet âgé ne pré-
sentant aucune pathologie particulière, ces variations pharma-
cocinétiques peuvent concerner l’absorption, la distribution, le
métabolisme et l’excrétion des médicaments. Parmi ces différen-
tes étapes pharmacocinétiques celle qui est le plus modifiée par
l’âge est l’excrétion rénale, conséquence de l’altération physio-
logique de la fonction rénale chez le sujet âgé. On observe donc
une diminution de la clairance rénale qui concernera les médi-
caments dont le rein est la principale voie d’élimination. Les
variations des paramètres pharmacocinétiques d’un médicament
nécessitent son ajustement posologique afin d’éviter des phéno-
mènes de toxicité ou au contraire une inefficacité thérapeutique.
D’une manière générale, la posologie doit être réduite chez le
sujet âgé du fait d’une diminution de nombreuses fonctions orga-
niques.
Mots-clés : Pharmacocinétique vSujet âgé.
Rev Mal Respir 2002 ; 19 : 356-62
Rev Mal Respir 2002 ; 19 : 356-62 © SPLF, Paris, 2002 8S25
© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 31/03/2020 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

Pharmacokinetics in the elderly
F. Péhourcq, M. Molimard
Summary
Physiological changes that occur in the aging process may
directly affect drug pharmacokinetics. In the absence of disease
or other pathologic conditions, age-related changes in pharma-
cokinetics principally affect drug absorption, distribution, meta-
bolism or elimination. One factor that does change consistently
with age is renal clearance, consequently a common pharmaco-
kinetic change is reduced drug clearance, especially for drugs
excreted largely unchanged by the kidneys. Alteration of the
pharmacokinetics of drugs in the elderly may necessitate adjust-
ment of dosages to prevent toxicity or inadequate therapy.
As a broad generalization, dosage should be reduced in elderly
patients, reflecting the general decline in body function with age.
Key-words: Pharmacokinetics vElderly.
Rev Mal Respir 2002 ; 19 : 356-62
Introduction
Les effets pharmacologiques observés chez le sujet âgé
peuvent être très différents de ceux mis en évidence avec la
même dose chez un sujet plus jeune de même sexe et de poids
comparable. Ces changements peuvent être dus à des modifi-
cations d’ordre pharmacocinétique ou pharmacodynamique.
L’âge en dehors de toute pathologie peut intervenir sur les
paramètres contrôlant la pharmacocinétique et donc sur la
concentration des médicaments. En effet, toutes les étapes du
devenir du médicament dans l’organisme : l’absorption, la dis-
tribution, le métabolisme et l’élimination peuvent être
influencées par le vieillissement. Ces changements font que les
personnes âgées sont plus exposés aux effets indésirables des
médicaments notamment lors d’administrations chroniques.
Pourtant la pharmacocinétique des médicaments dans les dos-
siers d’autorisation de mise sur le marché est le plus souvent
réalisée chez des sujets jeunes. Les recherches de pharmacolo-
gie clinique depuis de nombreuses années ont apporté bon
nombre d’éléments permettant une utilisation plus rationnelle
des médicaments chez les personnes de plus de 65 ans.
Absorption
D’une manière générale, l’absorption des médicaments
est peu modifiée chez le sujet âgé dont l’état de la muqueuse
gastrique est non altérée par rapport à l’adulte [1]. Cependant,
il est indispensable de considérer les modifications physiologi-
ques dues à l’âge rencontrées au cours du phénomène
d’absorption (tableau I), ces dernières étant susceptibles de
modifier la pharmacocinétique de certains médicaments.
Tableau I.
Principales modifications physiologiques dues à l’âge pouvant
modifier la pharmacocinétique.
Absorption Diminution de la sécrétion acide gastrique
Diminution de la vitesse de vidange gastrique
Diminution de la motilité gastrointestinale
Diminution du débit sanguin
Diminution de la surface d’absorption
Distribution Diminution de la masse corporelle
Diminution de l’eau corporelle
Diminution de l’albuminémie
Diminution de la vascularisation tissulaire
Augmentation relative de la masse graisseuse
Augmentation de α1-glycoprotéine acide
Métabolisme Diminution de la masse hépatique
Diminution du flux sanguin hépatique
Diminution du pouvoir métabolique hépatique
Excretion Diminution du flux sanguin rénal
Diminution de la filtration glomérulaire
Diminution de la fonction tubulaire
F. Péhourcq, M. Molimard
Rev Mal Respir 2002 ; 19 : 356-62
8S26
© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 31/03/2020 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

La valeur du pH gastrique augmente en raison d’une
diminution de la sécrétion acide. Ce changement de pH peut
entraîner une modification de la dissolution de la forme galé-
nique, de l’état d’ionisation et de la solubilité de certaines
molécules en particulier celles ayant des propriétés basiques
[2].
La vidange gastrique, la motilité intestinale et le débit
sanguin diminuent en fonction de l’âge. Des auteurs [3] ont
montré que la diminution de la vidange gastrique peut modi-
fier d’un facteur 3 la biodisponibilité orale de la L-dopa chez
des sujets âgés parkinsoniens dans le sens d’une augmentation.
L’augmentation de l’absorption de la L-dopa est aussi due à
une diminution de l’activité de la dopa décarboxylase périphé-
rique de la muqueuse gastrique chez le sujet âgé [4].
L’augmentation de la quantité absorbée peut s’observer
pour les médicaments qui ont un effet de premier passage
important. Castelden et coll. [5, 6] ont montré que chez le
sujet âgé la biodisponibilité orale du propranolol était très
augmentée du fait de la diminution de l’effet de premier pas-
sage hépatique. Ce phénomène ne s’explique pas par une
modification du processus de résorption (vitesse de passage et
quantité globale résorbée restant les mêmes) mais par un ralen-
tissement du métabolisme.
En général, le changement pharmacocinétique se situe
plutôt au niveau de la vitesse d’absorption plutôt que de la
quantité absorbée. La vitesse d’absorption est appréciée sur la
courbe pharmacocinétique par la valeur du tmax (temps
observé au pic de concentration Cmax). Chez le sujet âgé, on
observe pour certains médicaments, tels que la digoxine, le
chlordiazépoxide ou le nitrazépam, une valeur de tmax allon-
gée, témoin d’une absorption ralentie [7].
Il faut aussi souligner que les formes pharmaceutiques
solides se délitent lentement et de manière souvent incomplète
chez le sujet âgé, ce qui limite la phase d’absorption. Les formes
pharmaceutiques liquides semblent mieux indiquées.
Autres voies d’administration :
phénomène de résorption
Les autres voies d’administration ont été moins étudiées
chez le sujet âgé. Néanmoins, il a été montré une diminution
de la résorption d’antibiotiques de la classe des -lactamines
(pénicillines et céphalosporines) après injection intramuscu-
laire chez le sujet âgé [8, 9]. Ceci pose le problème de l’efficacité
d’une antibiothérapie prescrite sur plusieurs jours [10].
En conclusion, prévoir la résorption d’un médicament
chez la personne âgée est difficile. La résorption dépend du
médicament lui-même, c’est-à-dire de sa forme galénique et
des propriétés physicochimiques, et des nombreux facteurs
physiologiques qui sont modifiés avec l’âge.
Distribution
Il est indispensable pour la majorité des médicaments de
quitter le compartiment sanguin pour être distribué dans des
compartiments tissulaires où se situent leurs sites d’action.
Cette distribution est appréciée quantitativement par le
volume apparent de distribution (V), qui peut être modifié en
fonction de l’âge.
Le volume dans lequel le médicament va se répartir peut
être modifié pour plusieurs raisons. Parmi les plus importan-
tes, on note une augmentation de la masse graisseuse au détri-
ment de la masse musculaire, une diminution de l’eau corpo-
relle totale, une diminution de la perfusion sanguine des tissus
et aussi une modification de la liaison aux protéines plasmati-
ques (tableau I).
Modifications des différents compartiments
tissulaires de l’organisme
et de leur perfusion sanguine
L’augmentation de la masse graisseuse au détriment de la
masse musculaire entraîne d’une manière générale une aug-
mentation du volume de distribution des molécules lipophiles
et une diminution du volume de distribution des molécules
hydrophiles [11]. Ainsi, les molécules très lipophiles telles que
la thiopental ou les antidépresseurs tricycliques auront chez le
sujet âgé des volumes de distribution plus grands du fait de leur
répartition plus importante dans les graisses [12, 13]. A
l’opposé, les molécules plus hydrophiles telles que le paracéta-
mol ont un plus petit volume de distribution [14]. Ces varia-
tions du volume de distribution peuvent être à l’origine de
modifications de la demi-vie d’élimination (t
1/2
) du médica-
ment à condition que la clairance totale (Cl) chez le sujet âgé
varie dans le même sens.
La cinétique de répartition dans ces différents comparti-
ments va être modifiée par la diminution du débit cardiaque
estimée de 1 % par an au delà de 30 ans, et donc par la
diminution de la perfusion des organes. Ainsi, le temps de
transport à l’organe cible ou au compartiment de stockage peut
être diminué ce qui peut se traduire par un délai d’action
prolongé voir dans le cas de redistribution vers un troisième
compartiment par une durée d’action également prolongée.
Ce phénomène peut expliquer la nécessité de donner des doses
d’induction plus faibles lors d’une anesthésie [12].
Modification de la fixation
aux protéines plasmatiques
Le pourcentage de liaison d’un médicament aux protéi-
nes plasmatiques est un facteur déterminant dans l’intensité de
son action pharmacologique. En effet, seule la concentration
libre se répartie dans les tissus principalement par un phéno-
mène de diffusion passive, elle est donc la seule forme active
pharmacologiquement [15].
Pour les raisons précédement citées, il serait plus judi-
cieux de considérer la concentration libre d’un médicament
pour apprécier son efficacité et sa toxicité. Mais de manière
générale, les fourchettes thérapeutiques sont établies à partir
des mesures de concentrations totales en médicament. Ceci est
Pharmacocinétique chez le sujet âgé
© SPLF, Paris, 2002 8S27
© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 31/03/2020 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

souvent suffisant dans le cadre du suivi thérapeutique, la
mesure de la concentration libre n’est justifiée que dans le cas
de médicaments très liés aux protéines plasmatiques (pourcen-
tage de liaison supérieur à 90 % [1]) ou quand la liaison varie
en fonction de la concentration. La liaison peut aussi être
modifiée dans certains états pathologiques (ex : insuffisance
hépatocellulaire, insuffisance rénale), au cours d’interactions
médicamenteuses ou encore en fonction de l’âge [16]. De plus,
les médicaments sont liés de manière différente tant sur le plan
qualitatif que quantitatif suivant que ce sont des molécules à
caractère acide ou basique.
Nature des protéines plasmatiques fixatrices
et leurs modifications chez le sujet âgé
Les médicaments peuvent se lier réversiblement sur dif-
férentes protéines : l’albumine, l’α1-glycoprotéine acide, les α,
et γglobulines et les lipoprotéines. Chez le sujet âgé, la
concentration en protéines totales ne varient que légèrement
mais la répartition peut être différente.
L’albumine, protéine de gros poids moléculaire
(67 000 Da) est quantitativement la plus répandue dans le
plasma. Elle est capable de lier les médicaments acides et basi-
ques sur des sites de liaisons spécifiques et différents. Les médi-
caments acides, porteurs de charges négatives au pH plasmati-
que se lient par des forces de nature électrostatique sur un
nombre réduit de sites de haute affinité et saturables. Par
contre, les molécules neutres et basiques se lient sur des sites de
nature différente et en plus grand nombre par l’intermédiaire
de liaisons hydrophobes [17].
La concentration en sérum albumine est plus faible de
19 % chez le sujet âgé que chez l’adulte. Cette hypoalbuminé-
mie est due à une diminution de la fonction rénale et de la
capacité de synthèse protidique du foie [18]. Les taux de sérum
albumine peuvent être aussi plus faibles du fait d’une malnu-
trition. Par voie de conséquence, le pourcentage de fixation des
médicaments à cette protéine est plus faible. Cette hypoalbu-
minémie touche plus particulièrement la liaison des médica-
ments acides, qui ont un liaison diminuée de 12,5 % en
moyenne [18].
L’α1-glycoprotéine acide lie préférentiellement les molé-
cules de nature basique c’est à dire chargées positivement au
pH plasmatique. De nombreux médicaments, tels que le pro-
pranolol, l’imipramine la carbamazépine et le vérapamil se
lient avec une affinité importante à cette protéine [16]. Mais,
les concentrations plasmatiques en α1-glycoprotéine acide
étant beaucoup plus faibles que celles de l’albumine, la capacité
totale de fixation sur cette protéine des molécules basiques est
faible et saturable aux concentrations thérapeutiques. Ces
molécules basiques se lient donc aussi à l’albumine sur des sites
en grand nombre et spécifiques.
Le rôle biologique de l’α1-glycoprotéine acide est encore
mal défini, cette protéine augmente dans certains états tels que
les traumatismes, les infections en particulier myocardiques,
les cancers, les phénomènes inflammatoires et même le stress.
On peut donc s’attendre à une augmentation de cette protéine
chez le sujet âgé et donc à une augmentation de la liaison des
médicaments basiques, mais cette modification reste faible et
sans grande conséquence [19].
Les lipoprotéines lient des molécules lipophiles neutres et
basiques, telles que la quinidine, l’amitriptyline et le diltiazem.
Il a été montré que les lipoprotéines lient certaines molécules
quand les autres protéines sont saturées [16]. Les taux de ces
protéines (VLDL, LDL et HDL) augmentent avec l’âge. Mais
leur rôle étant moins important quantitativement que celui de
l’albumine et de l’α1-glycoprotéine acide, leurs variations ont
peu ou pas de répercussion sur la pharmacocinétique des médi-
caments qui leur sont liés.
En conclusion, les protéines plasmatiques capables de lier
les médicaments sont nombreuses et de nature très différentes.
Tandis que les molécules à caractère acide se fixent essentielle-
ment à l’albumine, les médicaments neutres ou basiques de
fixent à différents types de protéines. En conséquence, chez le
sujet âgé, la liaison aux protéines plasmatiques peut être dimi-
nuée, pour des médicaments acides très liés, tels que les cépha-
losporines ou les antiinflammatoires ou globalement inchan-
gée.
L’augmentation de la fraction libre plasmatique (fu)
entraîne :
– une diminution transitoire de la concentration plasmatique
totale ;
– une augmentation probable des concentrations tissulaires ;
– une modification du volume de distribution qui peut être à
l’origine d’une majoration des effets thérapeutiques ou de
l’apparition de phénomènes toxiques.
Il faut donc souligner l’influence de la fixation protéique
sur la valeur du volume apparent de distribution.
Modification de la fixation protéique
et modification du volume de distributions
D’une manière générale, le volume de distribution d’un
médicament dépend de ses caractéristiques physicochimiques
et de sa liaison aux protéines plasmatiques et tissulaires.
Les molécules ayant un caractère hydrophile seront pré-
férentiellement confinées dans le compartiment sanguin et les
liquides interstitiels. Une diminution de leur liaison plasmati-
que ne modifiera pas significativement la distribution de tels
médicaments. Par contre, les molécules lipophiles traversent
facilement les membranes biologiques et ont de grand volume
de distribution d’autant plus important que leur liaison tissu-
laire est importante. Certains médicaments, comme l’amioda-
rone, la digoxine et les antidépresseurs tricycliques entrent
dans cette catégorie. Mais le changement de leur volume de
distribution est plutôt dû au modification des compartiments
tissulaires qu’à la diminution de la fixation plasmatique chez le
sujet âgé.
En conclusion, plusieurs auteurs s’accordent pour dire
que le changement induit par l’âge dans la composition des
compartiments tissulaires joue un rôle plus important dans la
F. Péhourcq, M. Molimard
Rev Mal Respir 2002 ; 19 : 356-62
8S28
© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 31/03/2020 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.

valeur du volume apparent de distribution que les modifica-
tions de la fixation plasmatique [19, 20].
Les conséquences cliniques de la modification de la
liaison plasmatique dépendent à la fois de l’intensité de cette
liaison et de la pharmacocinétique du médicament concerné,
en particulier de son index thérapeutique. Pour simplifier, on
peut dire que la modification de la liaison plasmatique pourrait
avoir un impact pour les médicaments très liés aux protéines
plasmatiques et ayant un index thérapeutique étroit.
Métabolisation
Certains médicaments sont métabolisés en proportion
importante, en conséquence, toutes les modifications physio-
logiques de la fonction hépatique dues à l’âge seront suscepti-
bles d’avoir des répercussion sur leur métabolisation. En fonc-
tion de l’âge, on observe une diminution de la masse
hépatique, du flux sanguin hépatique et du pouvoir métaboli-
que hépatique (tableau I). Globalement le métabolisme hépa-
tique diminue d’environ 30 % après 70 ans [21].
Le flux sanguin hépatique diminue de 0,3%à1,5%par
an à partir de 25 ans. Théoriquement, les médicaments les plus
concernés sont ceux dont la clairance hépatique intrinsèque est
élevée tels que la morphine, les béta-bloquants, le vérapamil,
etc. Pour de tels composés, la clairance hépatique évolue dans
le même sens que le débit sanguin hépatique [22].
Les voies métaboliques de phase I, en particulier les réac-
tions d’oxydation sont les plus touchées avec l’âge en raison de
la diminution de l’activité des enzymes microsomiales et en
particulier du cytochrome P450. L’antipyrine, molécule à fai-
ble coefficient d’extraction et à clairance presque totalement
métabolique, renseigne sur la capacité des mécanismes oxyda-
tifs. Donc, le ralentissement de ces réactions métaboliques
peut être mis en parallèle avec la diminution de la clairance à
l’antipyrine chez les sujets âgés [23]. La déméthylation, réac-
tion de phase I, est concernée par cette modification. La thio-
ridazine, neuroleptique de la famille des phénothiazines, passe
par cette voie métabolique et a donc une clairance métabolique
diminuée. Il est recommandé de donner des doses moindres de
ce médicament chez le sujet âgé pour éviter des concentrations
trop élevées source d’effets secondaires plus importants [24].
La désipramine du fait d’un ralentissement de la voie de démé-
thylation a elle aussi une clairance ralentie et par voie de consé-
quence une demi-vie plus longue chez le sujet âgé [25].
Peu ou pas de changement sont observés dans les proces-
sus de conjugaison, biotransformations de phase II [26]. Le
paracétamol, par exemple, est conjugé par glycurono et sulfo-
conjugaison et aucun changement n’a été observé avec l’âge
[27]. Il n’est pas nécessaire de modifier la posologie du paracé-
tamol chez le sujet âgé, aucun phénomène d’accumulation
n’est observé après administration en chronique pendant 1
semaine [28].
Une diminution du métabolisme dans son intensité peut
avoir une conséquence directe sur la biodisponibilité d’un
médicament ayant un effet de premier passage hépatique
important. En effet, si le métabolisme est saturé, la biodispo-
nibilité augmente et des phénomènes de toxicité peuvent
apparaître en raison d’une plus grande concentration circu-
lante en principe actif. C’est le cas par exemple du propranolol
[6], du métoprolol [29] ou de la lidocaïne [30]. Les auteurs de
ces études ont soulignés que chez le sujet âgé la diminution de
l’effet de premier passage hépatique peut avoir des conséquen-
ces cliniques qui imposent de diminuer les doses des médica-
ments pour lesquels cet effet est important.
À partir d’études faites chez l’animal, il a été évoqué le fait
que les enzymes microsomiales répondaient moins bien au
phénomène d’induction enzymatique en fonction de l’âge
[31]. Il semble que ceci soit vrai pour beaucoup de médica-
ments mais avec toutefois des exceptions. L’effet inducteur
enzymatique du tabac a une influence beaucoup plus grande
sur la clairance du propranolol chez des sujets d’âge compris
entre 40 et 57 ans que chez des sujets de plus de 60 ans
(37,9 ±1,89 ml/h/kg versus 29,6 ±3,16 ml/h/kg) [32]. De la
même façon, l’effet inducteur de la rifampicine est dépendant
de l’âge [33]. Par contre, l’effet inducteur du tabac est le même
en termes d’augmentation de la clairance de la théophylline
(substrat du cytochrome P-448) chez les sujets fumeurs jeunes
et âgés [34].
En ce qui concerne le phénomène d’inhibition enzyma-
tique, quelques études sont consacrées à un inhibiteur enzyma-
tique puissant la cimétidine [35, 36]. Elles montrent que l’effet
inhibiteur enzymatique de ce médicament est indépendant de
l’âge tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
Élimination
Tous les composés hydrosolubles sont éliminés par voie
rénale, c’est-à-dire la molécule parent et les métabolites. Pour
les médicaments très éliminés par voie rénale (>60%dela
dose administrée), une diminution de la capacité rénale peut
considérablement modifier leur pharmacocinétique.
Le flux sanguin rénal diminue avec l’âge d’environ 1 %
par an à partir de 50 ans. En dehors de toute pathologie spéci-
fique, une diminution de la filtration glomérulaire en fonction
de l’âge est normale [37]. On observe aussi une perte de la
fonction tubulaire et une diminution de la capacité de réab-
sorption (tableau I). La mesure de la clairance à la créatinine est
un bon paramètre pour estimer l’état fonctionnel du rein en
terme de capacité d’élimination ; l’ajustement posologique de
médicaments éliminés essentiellement par voie rénale se fait à
l’aide de ce paramètre. La clairance rénale et donc, la clairance
totale de médicaments essentiellement éliminés par le rein sont
diminuées en fonction de l’âge proportionnellement à la dimi-
nution de la clairance de la créatinine. Parallèlement, on
observe un allongement de la demi-vie d’élimination et une
Pharmacocinétique chez le sujet âgé
© SPLF, Paris, 2002 8S29
© 2020 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 31/03/2020 Il est interdit et illégal de diffuser ce document.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%