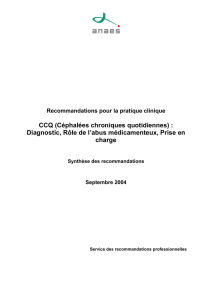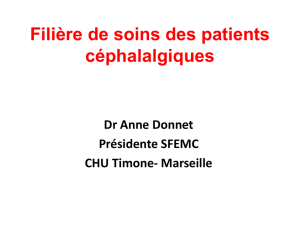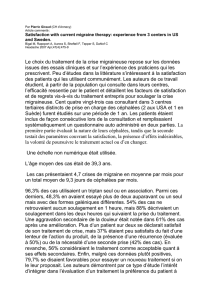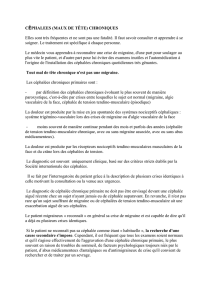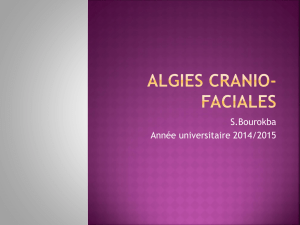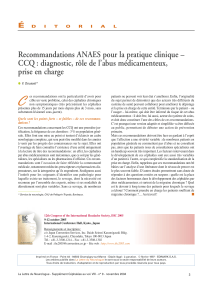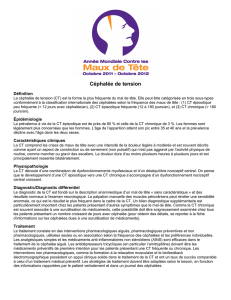4-094-A-10
Céphalées
et
migraines
de
l’enfant
J.-C.
Cuvellier
Les
céphalées
primaires
de
l’enfant
et
de
l’adolescent
comprennent
la
migraine,
les
céphalées
de
type-
tension,
les
céphalées
trigéminovasculaires
et
les
céphalées
chroniques
quotidiennes.
Dans
la
migraine
sans
aura,
la
céphalée,
frontale
et
bilatérale,
est
plus
courte
que
chez
l’adulte.
L’aura
la
plus
fréquente
est
visuelle,
mais
sa
typologie
et
son
rapport
temporel
à
la
céphalée
est
moins
stéréotypées
que
chez
l’adulte.
Les
céphalées
de
type-tension
sont
d’intensité
légère
à
modérée,
pressives,
sans
autre
signe
d’accompagnement
qu’une
photo-
ou
une
phonophobie.
Elles
sont
associées
à
diverses
comorbidités.
Les
céphalées
trigéminovasculaires,
exceptionnelles
en
pédiatrie,
associent
une
douleur
extrêmement
sévère
de
siège
trigéminal
à
des
signes
végétatifs
selon
des
modalités
temporelles
différentes
qui
per-
mettent
de
distinguer
algie
vasculaire
de
la
face,
hémicrânie
paroxystique
et
syndrome
Short-lasting
Unilateral
Nevralgiform
headache
with
Conjunctival
injection
and
Tearing
(SUNCT).
Les
céphalées
chroniques
quotidiennes
surviennent,
par
définition,
au
moins
15
jours
par
mois.
Problème
de
santé
publique,
d’incidence
croissante,
elles
sont
dominées
par
la
migraine
chronique.
Les
deux
principales
comorbidités
à
rechercher
sont
l’abus
d’antalgiques
et
les
troubles
psychopathologiques.
Le
diagnostic
des
céphalées
primaires
est
facilité
par
l’emploi
de
la
seconde
édition
de
la
classification
développée
par
l’International
Headache
Society
(ICHD-II).
En
dehors
de
la
migraine
sans
aura,
les
critères
diag-
nostiques
pédiatriques
ne
diffèrent
pas
de
ceux
de
l’adulte.
La
prise
en
charge
thérapeutique,
dictée
par
l’analyse
soigneuse
des
facteurs
déclenchants,
du
retentissement
fonctionnel,
et
des
comorbidités
somatiques
et
psychiatriques,
est
au
mieux
globale,
dans
une
perspective
multidisciplinaire
biopsycho-
sociale.
Peu
d’études
contrôlées
ont
évalué
l’efficacité
des
médicaments
en
dehors
de
la
migraine,
où
le
traitement
de
crise
repose
sur
l’ibuprofène
et
le
sumatriptan.
Les
thérapeutiques
préventives
privilé-
gieront
les
méthodes
non
médicamenteuses,
comme
la
relaxation.
Les
prescriptions
sont
adaptées
à
la
situation
concrète
du
patient
et
font
l’objet
d’une
réévaluation
régulière,
avec
le
souci
de
prévenir
l’abus
d’antalgiques.
©
2013
Elsevier
Masson
SAS.
Tous
droits
réservés.
Mots-clés
:
Céphalées
primaires
;
Migraine
de
l’enfant
;
Migraine
de
l’adolescent
Plan
■Introduction
2
Stratégie
diagnostique
2
Prise
en
charge
2
■Migraine
3
Migraine
sans
aura
3
Migraine
avec
aura
3
Diagnostic
3
Évolution
3
Physiopathologie
3
Prise
en
charge
thérapeutique
4
■Céphalées
de
type-tension
5
Diagnostic
6
Comorbidités
6
Physiopathologie
7
Évolution
7
Traitement
7
■Céphalées
trigéminovasculaires
7
■Céphalées
chroniques
quotidiennes
7
Généralités
??
■Conclusion
9
EMC
-
Pédiatrie 1
Volume
8
>
n◦2
>
avril
2013
http://dx.doi.org/10.1016/S1637-5017(13)59750-X
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 03/07/2013 par SCD Paris Descartes (292681)

4-094-A-10 Céphalées
et
migraines
de
l’enfant
< 30 min
Durée 2–30 min
Localisation : orbitaire
unilatérale
Signes végétatifs
Jusqu’à 5 crises/j
Sensible à l’indométhacine
Hémicrânie paroxystique
Durée 15–180 min
Localisation : orbitaire
unilatérale
Signes végétatifs
Jusqu’à 8 crises/j
Céphalée primaire
Migraine
SUNCT
Céphalée
primaire à la
toux*
Céphalée
hypnique*
Céphalée primaire
du froid*
Céphalée primaire en
coup de poignard*
Céphalée primaire
d’effort*
Céphalée primaire
avec activité sexuelle**
Céphalée de type
tension
> 30 min
Durée 1–72 h
Localisation :
frontotemporale
ou unilatérale
Typologie : pulsatile
Nausées ou
vomissements
Photophobie ou
phonophobie
Durée 30 min–7 j
Localisation : bilatérale
Typologie :
pression/serrement
Absence de : nausées,
vomissements,
photophobie et
phonophobie
Déclenchés par
Non Non Oui
Algie vasculaire
de la face
Crises de 5 s à 4 min
5 à 200 crises/j
Toux Localisation
faciale
Effort physique Réveil Froid
Figure
1.
Arbre
décisionnel.
Orientation
générale
devant
une
céphalée
primaire.
*Ces
céphalées
primaires
ne
sont
pas
abordées
dans
le
texte.
Elles
correspondent
au
quatrième
groupe
de
la
première
partie
de
l’ICHD-II.
AVF
:
algie
vasculaire
de
la
face
;
ICHD-II
:
seconde
édition
de
la
classification
de
l’International
Headache
Society
;
SUNCT
:
Short-lasting
Unilateral
Nevralgiform
headache
with
Conjunctival
injection
and
Tearing.
Introduction
La
grande
majorité
des
céphalées
de
l’enfant
et
de
l’adolescent
sont
des
céphalées
primaires.
Elles
correspondent
à
la
pre-
mière
partie
de
la
seconde
édition
de
la
classification
(ICHD-II),
développée
par
l’International
Headache
Society
(IHS),
qui
est
d’une
aide
précieuse
au
diagnostic [1].
L’une
des
nouveautés
de
l’ICHD-II
est
d’avoir
introduit
des
items
propres
à
l’enfant.
La
qualité
du
diagnostic
est
le
meilleur
garant
d’un
traitement
adéquat.
Généralités.
Stratégie
diagnostique
La
stratégie
diagnostique
repose
sur
une
analyse
précise
des
caractéristiques
cliniques
tout
en
excluant
parallèlement
des
céphalées
secondaires.
Pour
chaque
entité,
le
dernier
item
de
l’ICHD-II
«
non
attribué
à
un
autre
désordre
»
résonne
comme
un
leitmotiv,
qui
laisse
au
clinicien
toute
liberté
sur
la
stra-
tégie
à
adopter.
Elle
s’inspire
de
celle
décrite
dans
l’article
EMC/AKOS
–Céphalées
chez
l’enfant
(hors
céphalées
récurrentes)
auquel
nous
renvoyons
le
lecteur [2].
La
distinction
entre
les
diffé-
rentes
céphalées
primaires
repose
exclusivement
sur
la
description
des
céphalées
(type,
localisation,
intensité,
durée
et
fréquence)
et
des
signes
d’accompagnement
(Fig.
1).
Prise
en
charge
Dictée
par
l’analyse
soigneuse
des
facteurs
déclenchants,
du
retentissement
fonctionnel,
des
comorbidités
somatiques
et
psy-
chiatriques,
elle
est
idéalement
globale,
dans
une
perspective
multidisciplinaire
biopsychosociale [3].
L’objectif
ne
se
limite
pas
au
soulagement
des
céphalées,
mais
vise
à
la
restauration
d’un
fonctionnement
scolaire,
familial,
et
social
satisfaisant.
La
fac¸on
dont
l’enfant
ou
l’adolescent
appréhende
et
gère
sa
douleur,
les
facteurs
de
stress
psychosociaux
et
économiques,
les
difficultés
familiales,
les
problèmes
comportementaux,
le
retentissement
sur
les
résultats
scolaires
ou
les
loisirs
sont
autant
de
points
qui
doivent
être
abordés,
car
ils
sont
susceptibles
de
précipiter
et/ou
d’entretenir
les
céphalées.
Il
faut
amener
l’enfant
à
gérer
la
situa-
tion
de
céphalée,
c’est-à-dire
développer
sa
capacité
à
faire
face
ou
coping [4].
Prise
en
charge
non
pharmacologique
Les
techniques
utilisées
(relaxation,
training
autogène,
rétro-
contrôle
[biofeedback],
thérapie
cognitivocomportementale,
auto-
hypnose)
ont
une
efficacité
démontrée [5,
6] et
sont
bien
acceptées
par
l’enfant
et
les
parents.
Elles
visent
à
diminuer
l’anxiété
et
le
stress
et,
partant,
la
perception
de
la
douleur.
Lors
des
séances
de
relaxation,
des
consignes
ritualisées
(sen-
sation
de
relâchement,
de
bien-être,
imagerie
mentale)
sont
éventuellement
associées
à
une
verbalisation
des
expériences
ressenties.
Le
rétrocontrôle
consiste
à
capter
et
à
amplifier,
par
l’utilisation
d’un
appareillage
électronique
ou
informatique,
un
paramètre
physiologique
(température
corporelle,
activité
2EMC
-
Pédiatrie
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 03/07/2013 par SCD Paris Descartes (292681)

Céphalées
et
migraines
de
l’enfant 4-094-A-10
musculaire,
résistivité
cutanée,
etc.)
et
à
le
transformer
en
signaux
auditifs
ou
visuels.
L’objectif
est
de
permettre
au
sujet
de
contrôler
ces
signaux
et
d’apprendre
à
moduler
ses
propres
réactions
phy-
siologiques.
De
fac¸on
ultime,
il
arrive
à
répéter
l’expérience
par
lui-même,
seul,
en
l’absence
du
thérapeute.
L’hypnose
modifie
notablement
l’état
de
conscience
du
sujet
(un
état
de
relaxation
y
est
souvent
associé).
Le
professionnel
instaure
une
relation
spé-
cifique
avec
le
patient
et
le
guide
en
lui
proposant
des
images
mentales
agréables
de
confort
ou
de
bien-être.
L’autohypnose
apprend
au
patient
à
retrouver
seul
cet
état
de
conscience
modifié,
déconnecté
partiellement
de
l’environnement
externe.
Les
méthodes
d’inspiration
psychanalytique
sont
a
priori
moins
souhaitables,
mais
peuvent
rendre
service
dans
des
cas
particu-
liers.
Prise
en
charge
pharmacologique
En
dehors
de
la
migraine,
peu
d’études
contrôlées
sont
dispo-
nibles.
Le
choix
du
médicament
sera
adapté
à
la
situation
concrète
du
patient.
Migraine
La
prévalence
est
de
7,7
%
et
croît
avec
l’âge
(3
%
chez
les
3
à
7
ans,
4–11
%
chez
les
7
à
11
ans
et
8–23
%
chez
les
adolescents)
avec
un
sex-ratio
de
0,6 [7–9].
Les
premières
crises
de
migraine
sur-
viennent
à
un
âge
moyen
de
7,2
ans
chez
le
garc¸on,
de
10,9
ans
chez
la
fille.
La
migraine
est
responsable
d’un
absentéisme
scolaire
significatif.
Migraine
sans
aura
La
migraine
sans
aura
(MSA)
est
la
forme
de
migraine
la
plus
fréquente
(60
à
85
%).
Les
principales
différences
par
rapport
à
l’adulte,
dont
a
tenu
compte
l’ICHD-II [1],
sont
:
•
une
durée
plus
courte
de
la
crise
(en
général
2
à
4
heures,
parfois
moins
de
1
heure)
;
•
une
céphalée
plus
souvent
frontale
et
bilatérale
que
temporale
et
unilatérale
;
•des
signes
digestifs
souvent
au
premier
plan.
Pendant
la
crise,
l’enfant
est
abattu,
irritable,
et
souhaite
qu’on
le
laisse
tranquille.
La
photophobie
le
conduit
à
s’isoler
dans
un
endroit
sombre,
la
phonophobie
se
traduit
par
des
injonctions
à
autrui
pour
qu’il
fasse
moins
de
bruit.
Chez
les
très
jeunes
enfants,
incapables
de
verbaliser,
la
survenue
paroxystique
des
symptômes
et
leur
intensité,
jointe
à
des
signes
digestifs,
une
pâleur
ou
des
vertiges
sont
autant
de
signes
auxquels
les
parents
seront
d’autant
plus
attentifs
qu’ils
sont
eux-mêmes
migraineux.
Inutile
de
dire
qu’un
traitement
d’épreuve
en
pareils
cas
ne
peut
que
s’avérer
judicieux.
La
crise
est
fréquemment
inaugurée
par
des
prodromes,
dont
les
plus
fréquents
sont
:
modifications
du
visage,
fatigue
et
irritabilité [10].
Au
fur
et
à
mesure
que
l’enfant
se
rapproche
de
l’adolescent,
la
sémiologie
se
modifie
pour
se
rapprocher
de
celle
de
l’adulte.
Migraine
avec
aura
L’aura
la
plus
fréquente
est
visuelle,
se
manifestant
par
des
dis-
torsions,
une
vision
floue
ou
trouble.
Typiquement,
les
éléments
surajoutés
sont
dans
un
dégradé
de
gris,
sous
forme
de
segments
de
droites,
de
lignes
brisées,
fixes
par
rapport
au
champ
visuel.
Sco-
tome
uni-
ou
bilatéral,
vision
de
taches
colorées,
hallucinations
ou
vision
monoculaire
sont
plus
rares.
La
bizarrerie
des
signes
visuels
peut
égarer
le
clinicien,
réalisant
le
«
syndrome
d’Alice
au
pays
des
merveilles
».
Les
auras
sensitives
et/ou
langagières
surviennent
rarement
sans
aura
visuelle
associée.
Les
critères
de
l’ICHD-II [1] ont
des
exigences
temporelles
strictes
:
l’aura
doit
durer
de
5
à
60
minutes,
la
céphalée
doit
débu-
ter
dans
l’heure
qui
suit
le
début
de
l’aura.
La
chronologie
aura
puis
céphalée
est
moins
souvent
respectée
chez
l’enfant
que
chez
l’adulte,
ce
qui
explique
que
ces
critères
sont
moins
souvent
vérifiés
que
ceux
de
MSA.
Certains
enfants,
en
particulier
les
plus
jeunes,
ont,
pour
des
raisons
cognitives,
des
difficultés
à
préciser
la
durée
ou
la
chronologie
des
éléments
constituant
leur
aura.
Dans
la
migraine
de
type
basilaire,
la
richesse
de
la
séméiologie
(troubles
visuels
bilatéraux
intéressant
les
champs
visuels
nasaux
et
temporaux,
ataxie,
vertiges,
acouphènes,
dysarthrie,
paresthé-
sies,
déficit
moteur,
nystagmus,
diplopie,
trouble
de
conscience,
nausées,
vomissements,
pâleur,
léthargie)
contribue
à
égarer
le
diagnostic.
La
séméiologie
devient
moins
bruyante
et
«
plus
clas-
sique
»
avec
l’âge.
La
migraine
hémiplégique
(MH)
familiale
est
une
variété
héré-
ditaire
rare
de
migraine
avec
aura
motrice,
définie
par
la
présence
d’un
déficit
moteur
au
cours
de
l’aura,
associé
à
au
moins
un
autre
symptôme
(visuel,
sensitif
et
aphasique)
et
par
l’existence
d’une
MH
chez
au
moins
un
apparenté
au
premier
ou
au
second
degré.
Des
signes
cérébelleux
sont
parfois
associés.
La
transmission
est
autosomique
dominante
avec
une
pénétrance
d’environ
90
%.
Les
trois
gènes
identifiés
(CACNA1A
[localisé
en
19p13],
ATP1A2
[1q23]
et
SCN1A
[2q24])
codent
pour
des
transporteurs
ioniques,
mais
ne
rendent
compte
que
de
60
à
70
%
des
cas
de
MHF [11].
La
MH
sporadique
se
manifeste
de
fac¸on
similaire,
mais
en
l’absence
de
sujet
apparenté
atteint.
La
tendance
actuelle
est
d’en
rap-
procher
la
migraine
confusionnelle,
où
le
dysfonctionnement
bihémisphérique,
contemporain
d’anomalies
lentes
bilatérales
diffuses
à
l’électroencéphalogramme
(EEG),
entraîne
confusion,
agitation,
ou
somnolence,
pendant
moins
de
24
heures.
Un
traumatisme
crânien
mineur,
comme
une
tête
au
football,
est
un
facteur
déclenchant
classique.
La
place
manque
pour
abor-
der
les
syndromes
périodiques
de
l’enfance,
naguère
qualifiés
d’équivalents
migraineux.
Diagnostic
Les
critères
diagnostiques
de
l’ICHD-II
de
MSA
ont
une
spécifi-
cité
de
plus
de
90
%,
mais
une
faible
sensibilité [12].
Pour
les
10
%
restants,
hormis
le
cas
où
l’enfant
consulte
avant
la
cinquième
crise,
cela
correspond
essentiellement
à
deux
cas
de
figures
:
•
la
durée
de
la
crise
est
inférieure
à
une
heure
;
•
en
l’absence
de
signes
d’accompagnement
digestifs,
il
n’existe
qu’une
photophobie
ou
une
phonophobie,
mais
pas
les
deux.
En
pareils
cas,
l’analyse
de
signes
non
retenus
par
l’ICHD-II [1],
comme
la
pâleur,
l’irritabilité,
les
vertiges,
le
soulagement
par
le
sommeil,
permet
de
trancher.
Une
note
annexée
aux
critères
de
MSA
indique
qu’«
une
localisation
bilatérale
est
commune
chez
les
jeunes
enfants
»
et
que
«
des
céphalées
occipitales
sont
rares
chez
les
jeunes
enfants
et
doivent
rendre
prudents
».
La
même
remarque
est
valable
quand
l’hémicrânie
concerne
le
même
côté
à
chaque
crise.
On
sera
d’autant
plus
prudent
que
l’enfant
est
plus
jeune
(moins
de
3
à
4
ans)
et
que
le
début
des
crises
est
récent.
Dans
ces
cas,
une
imagerie
par
résonance
magnétique
(IRM)
cérébrale
est
recommandée.
En
ce
qui
concerne
la
migraine
avec
aura
(MA),
l’ICHD-II [1] fournit
des
critères
diagnostiques
séparés
pour
l’aura
et
la
céphalée
(qui
sont
ceux
de
la
MSA).
Il
est
nécessaire
de
demander
des
explorations
paracliniques
lors
du
premier
épisode
de
migraine
de
type
basilaire
ou
de
MH
familiale
(IRM
cérébrale
avec
angio-RM).
Évolution
Trente
à
50
%
des
enfants
migraineux
guérissent
en
grandis-
sant,
en
particulier
les
garc¸ons [13].
Bille
a
suivi
sur
40
ans
une
cohorte
de
73
enfants
migraineux
:
entre
13
et
19
ans,
62
%
des
sujets
n’avaient
plus
de
migraine [14].
À
l’âge
adulte,
après
40
ans,
cette
proportion
était
de
46
%.
Ce
pronostic
favorable
fait
partie
des
informations
à
communiquer
à
l’enfant
et
à
ses
parents.
Physiopathologie
La
théorie
vasculaire
postulait
que
l’aura
résultait
d’une
ischémie
cérébrale
transitoire,
induite
par
une
vasoconstriction
artérielle,
tandis
que
la
céphalée
résultait
d’une
vasodilatation
EMC
-
Pédiatrie 3
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 03/07/2013 par SCD Paris Descartes (292681)

4-094-A-10 Céphalées
et
migraines
de
l’enfant
Identifier les facteurs
déclenchants
Éduquer enfant et
parents à gérer les
facteurs déclenchants
Modifier l’hygiène de vie
Analyser :
− état émotionnel
− situation familiale
− relations interpersonnelles
− résultats scolaires
− événements de vie
− comorbidités psychiatriques
Arguments en faveur de céphalées
secondaires (anamnèse, examen clinique)
Conseiller la tenue d’un
calendrier de céphalées
Envisager un entretien
psychologique
Non
Oui
Établir un protocole de
traitement individualisé :
− à tout âge : ibuprofène
− à partir de 12 ans :
sumatriptan spray nasal
− si échec : autres triptans
Envisager un traitement préventif
si modifications de l’hygiène de vie
inefficaces et :
− plus de 6 jours de céphalées/mois
− retentissement fonctionnel notable
− traitement de crise inefficace et/ou
mal toléré
Prise en charge non pharmacologique :
− relaxation
− rétrocontrôle
− thérapie cognitivocomportementale
− autohypnose
Traitement préventif :
− flunarizine
− propranolol
− amitriptyline
− pizotifène
− topiramate
Si échec, autres médicaments
Évaluer :
− les caractéristiques des céphalées
− l’histoire de la maladie
− les signes et symptômes neurologiques
Prendre en charge
la maladie causale
Figure
2.
Arbre
décisionnel.
Schéma
général
diagnostique
et
thérapeutique
général
dans
la
migraine.
«
rebond
»
qui
activait
les
nocicepteurs
périvasculaires.
La
démonstration,
par
des
techniques
de
neuro-imagerie
fonc-
tionnelle,
que
l’hypodébit
persistait
après
l’aura
et
que
les
céphalées
apparaissaient
avant
le
début
de
l’hyperémie
a
remis
en
cause
cette
théorie,
au
bénéfice
de
la
théorie
neuronale
pri-
mitive.
Celle-ci
postule
que
l’aura
et
l’induction
des
crises
sont
d’origine
neuronale,
et
que
la
céphalée
est
due
à
une
activa-
tion
et/ou
à
une
sensibilisation
du
système
trigéminovasculaire
(STV) [15] :
Chez
un
sujet
prédisposé
génétiquement,
les
facteurs
déclen-
chants
activeraient
l’hypothalamus
et
des
noyaux
adrénergiques
et
sérotoninergiques,
situés
dans
le
mésencéphale
et
la
protubé-
rance.
Cela
entraînerait
une
vasoconstriction
artériolaire
corticale
et
une
dérégulation
des
systèmes
inhibiteurs
de
contrôle
de
la
douleur.
Les
symptômes
de
l’aura
migraineuse
s’expliquent
par
la
propagation
sur
le
cortex
de
la
dépression
corticale
envahissante
(DCE).
Les
fibres
sensitives
du
trijumeau
libèrent
du
calcitonin
gene-related
peptide
(CGRP)
et
de
la
substance
P
autour
des
vaisseaux,
responsables
d’une
inflammation
aseptique.
Une
cascade
de
phénomènes
(vasodilatation,
extravasation
des
protéines
plasmatiques,
dégranulation
des
mastocytes
et
acti-
vation
des
plaquettes)
aboutit
au
relargage
veineux
massif
de
sérotonine.
Le
lien
entre
les
deux
phénomènes
est
peu
clair.
L’activation
du
STV
pourrait
être
soit
d’origine
«
périphérique
»
du
fait
du
passage
d’une
DCE
sur
le
cortex
(MA),
soit
d’origine
«
centrale
»
par
démo-
dulation
des
systèmes
de
contrôle
de
la
douleur
dans
le
tronc
cérébral
(MSA).
Prise
en
charge
thérapeutique
(Fig.
2) [16–20]
Les
idées
fausses
étant
largement
répandues
et
tenaces,
la
part
consacrée
aux
explications
doit
être
conséquente.
On
peut
parler
de
véritable
éducation
thérapeutique
échelon-
née
sur
plusieurs
consultations.
Traitement
de
crise
Lors
d’une
première
consultation,
l’accent
est
mis
sur
le
trai-
tement
de
crise,
encore
trop
souvent
négligé
par
nombre
de
médecins [21].
Le
repos
dans
l’obscurité
est
souvent
réalisé
spontanément
par
l’enfant
sans
consigne
médicale.
Deux
médicaments
ont
fait
la
preuve
de
leur
efficacité
et
constituent
l’ossature
de
la
majorité
des
prescriptions
:
ibuprofène
et
sumatriptan [22–24].
Le
paracétamol
a
une
efficacité
faible
(le
gain
est
d’environ
15
%
par
rapport
au
placebo) [22].
Trois
autres
triptans
(almotriptan,
rizatriptan
et
zolmitriptan)
ont
également
fait
la
preuve
de
leur
efficacité
chez
l’adolescent,
mais
ils
n’ont
l’AMM
en
France
qu’à
partir
de
l’âge
de
18
ans [25–29].
Opiacés
et
tramadol
sont
décon-
seillés [16].
4EMC
-
Pédiatrie
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 03/07/2013 par SCD Paris Descartes (292681)

Céphalées
et
migraines
de
l’enfant 4-094-A-10
“
Point
important
Prise
en
charge
thérapeutique
générale
de
la
migraine
•Expliquer
ce
qu’est
la
migraine
•Rassurer
enfant
et
parents
sur
l’absence
de
processus
expansif
intracrânien
sous-jacent
•Prôner
quelques
règles
d’hygiène
de
vie
◦
alimentation
équilibrée
(en
limitant
la
consommation
des
sodas
à
base
de
cola)
◦
activité
physique
modérée
régulière
◦
hygiène
de
sommeil
•Conseiller
à
l’enfant
migraineux
et
à
ses
parents
d’apprendre
à
reconnaître
les
facteurs
déclenchants
des
accès,
en
vue
de
leur
éviction
•Remettre
une
notice
écrite
reprenant
les
informations
données
pendant
la
consultation.
Un
livret
d’information
est
disponible
sur
Internet
(www.migraine-enfant.org)
“
Point
important
Facteurs
déclenchant
les
crises
de
migraine
La
majorité
des
enfants
migraineux
(94–100
%)
ont
au
moins
un
facteur
déclenchant
de
leurs
crises
migraineuses
et
le
plus
souvent
plusieurs
:
dans
notre
étude,
le
nombre
moyen
de
facteurs
déclenchants
par
enfant
était
de
sept.
Les
facteurs
déclenchants
les
plus
fréquemment
en
cause
sont
le
stress,
notamment
scolaire,
le
manque
ou
l’excès
de
sommeil,
les
conditions
météorologiques,
les
jeux
vidéo
et
les
stimuli
sensoriels
(bruit,
forte
luminosité,
odeurs).
Contrairement
à
une
croyance
répandue,
l’alimentation
est
rarement
en
cause
(chocolat
!).
Il
est
judicieux
d’individualiser
la
stratégie
thérapeutique
en
fonction
des
caractéristiques
habituelles
des
accès
migraineux
du
patient.
Une
réévaluation
régulière
du
traitement
de
crise
est
impéra-
tive,
en
portant
une
attention
toute
particulière
à
la
prévention
de
l’abus
d’antalgiques
(ne
pas
dépasser
deux
jours
de
prises
d’antalgiques
par
semaine
de
fac¸on
régulière [30,
31]),
sinon,
il
faut
envisager
l’instauration
d’un
traitement
préventif,
après
tenue
préalable
d’un
calendrier
de
crises.
Traitement
préventif
Chaque
fois
que
possible,
on
privilégiera
les
mesures
non
pharmacologiques.
Un
traitement
préventif
médicamenteux
est
proposé
en
cas
d’échec
des
mesures
précédentes
ou
d’indisponibilité
des
professionnels
les
pratiquant.
L’instauration
d’un
traitement
préventif
doit
être
envisagée
chez
30
à
40
%
des
patients [32].
Le
choix
du
médicament
dépend
de
l’individu,
des
effets
thé-
rapeutiques
associés
(par
exemple,
le
choix
de
l’amitriptyline
est
judicieux
en
cas
de
troubles
de
l’humeur
ou
du
sommeil)
et
des
effets
indésirables.
Il
est
conseillé
de
commencer
à
faible
dose
puis
de
titrer
jusqu’à
obtention
de
la
posologie
efficace,
tout
en
sur-
veillant
l’apparition
d’effets
indésirables.
La
durée
du
traitement
préventif
conseillée
est
de
9
à
15
mois [33].
Peu
d’études
contrôlées
ont
évalué
l’efficacité
des
médicaments
utilisés
chez
l’enfant.
Deux
études
contrôlées
contre
placebo
ont
montré
l’efficacité
de
la
flunarizine,
à
la
posologie
de
5
mg/j
;
une
étude
contrôlée
contre
placebo
a
montré
l’efficacité
du
“
Point
important
Les
grandes
règles
du
traitement
de
la
crise
de
migraine
•L’objectif
du
traitement
de
crise
est
de
:
◦
restaurer
un
état
normal,
◦
en
soulageant
rapidement
(en
moins
de
deux
heures),
◦
et
régulièrement
la
céphalée
et
les
symptômes
asso-
ciés,
◦
sans
récurrence
de
la
douleur
dans
les
24
heures
sui-
vantes,
◦
avec
peu
ou
pas
d’effets
indésirables.
•Les
moyens
d’y
parvenir
consistent
en
:
◦
la
prise
la
plus
rapide
possible
à
partir
du
début
de
l’accès,
◦conseiller
à
l’enfant
d’avoir
le
médicament
toujours
à
portée
de
main,
y
compris
à
l’école,
◦lui
remettre
si
besoin
un
certificat
l’autorisant
à
en
disposer
à
l’école,
◦
le
respect
d’une
posologie
correcte.
•Limitation
du
nombre
de
jours
de
prises
afin
de
prévenir
l’abus
d’antalgiques
(deux
jours
de
prises
d’antalgique
par
semaine).
•Le
protocole
de
traitement
de
crise
proposé
sera
testé
sur
au
moins
trois
crises
avant
de
conclure
et
de
faire
les
adaptations
souhaitables.
“
Point
important
Le
taux
élevé
de
réponse
placebo
Le
taux
élevé
de
réponse
placebo
observé
dans
les
études
menées
chez
l’adolescent
a
un
impact
négatif
sur
l’interprétation
statistique
de
l’effet
du
médicament
de
crise.
La
durée
plus
courte
de
l’accès,
la
consigne
d’attendre
que
l’intensité
soit
modérée
à
sévère
pour
prendre
le
triptan
et
la
nécessité
de
se
faire
aider
du
per-
sonnel
de
l’école
ou
de
rentrer
à
domicile
pour
traiter
l’accès
ont
tous
pu
contribuer
à
ce
taux
élevé
de
réponse
placebo.
Les
adolescents
seraient
particulièrement
vulné-
rables
à
l’effet
participation
à
une
étude
et
anticiperaient
l’efficacité
du
médicament.
propranolol
à
la
posologie
de
60
mg/j
et
du
pizotifène
à
la
poso-
logie
de
0,5
à
1,5
mg/j [34].
Les
études
récentes
ont
concerné
les
antiépileptiques.
Seuls
le
valproate
de
sodium
et
le
topiramate
l’ont
été
de
fac¸on
contrôlée,
concluant
à
l’inefficacité
du
premier
et
à
la
probable
efficacité
du
second [35].
La
plupart
des
médica-
ments
utilisés
dans
le
traitement
de
fond
de
la
migraine
sont
bien
tolérés.
Céphalées
de
type-tension
La
plus
fréquente
des
céphalées
de
l’enfant
a
une
prévalence
comprise
entre
9,8 [36] et
72,8
%[37] !
Celle
des
céphalées
de
type-
tension
(CTT)
chroniques
est
comprise
entre
0,1
et
5,9
%[38].
Le
sex-ratio
est
de
1
avant
11–12
ans,
suivi
d’une
nette
prédominance
féminine
après
la
puberté.
Les
CTT
commencent
souvent
vers
7
ans.
EMC
-
Pédiatrie 5
© 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 03/07/2013 par SCD Paris Descartes (292681)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%