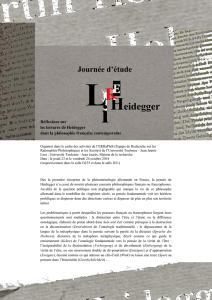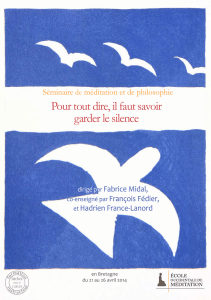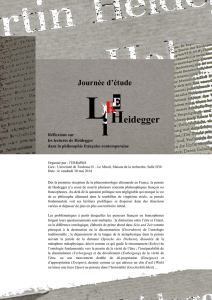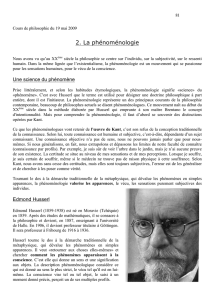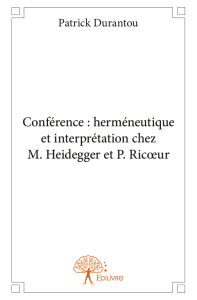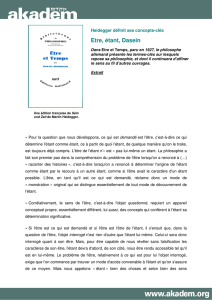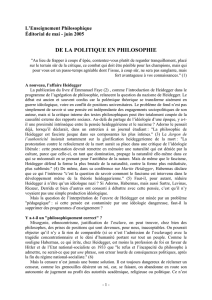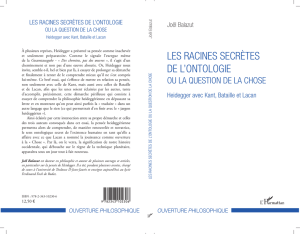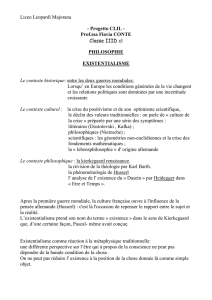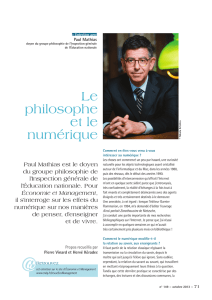1
L’être, le sens et le réel
Mémoire rédigé par Florian FORESTIER
Sous la direction de Madame le Professeur Catherine MALABOU
Université PARIS 10
Année 2004-2005
Remerciements :

2
A Catherine Malabou pour avoir accepté de diriger ce travail, et pour avoir écrit
les ouvrages qui lui ont donné matière à se poursuivre.
A Alain Cugno et François-David Sebbah pour les discussions qui en ont
stimulé l’écriture.
A Jean-Luc Nancy pour avoir pris la peine de me répondre et m’avoir prodigué
ses encouragements ; pour être à l’origine de l’oeuvre qui m’a guidé.
A Julien Starck et Mathieu Aud’hui parce qu’en dépit de nos divergences, ce
texte est issu d’un souci commun que de nombreux échanges ont alimenté
A ma mère pour m’avoir soutenu et assisté. A mon oncle Daniel Tisseyre pour
m’avoir aidé pour la mise au point du texte et sa mise en en forme informatique.
PLAN
INTRODUCTION, P. 4.

3
LE SENS ET LA TEMPORALITE. P. 14.
LE PRESENT, OU « L’ETRE AU PRESENT ». APORIES. P. 25.
LA PRESENCE, LE SENS ET L’ORIGINE DU MONDE. LA SINGULARITE. P. 37.
ARCHITECTURE DE LA PRESENCE 1 : FORME ET PERSPECTIVE. P. 52.
ARCHITECTURE DE LA PRESENCE 2 : ECHELLES, CONSISTANCES ET RYTHMES. P. 65.
REEL ET ENGAGEMENT 1 : LA QUESTION DE LA METHODE. P. 77.
REEL ET ENGAGEMENT 2 : L’INDIVISIBLE PLUTOT QUE LE DIVISIBLE. P. 86.
CONCLUSION P. 94.
ANNEXE
LE « CONCEPT DE DIEU ». P. 98.
RETOUR SUR LA DECONSTRUCTION. LE STATUT DE LA VERITE. P. 102.
INDEX. P. 106.
BIBLIOGRAPHIE. P. 108.

4
INTRODUCTION
1. Heidegger s’est appliqué à penser cette chose insaisissable que ce qui se présente ne le fait jamais
que dans ce qu’il a appelé « l’ouvert de la présence ». Ce qui est n’apparaît dans un horizon à partir
duquel il devient pensable et « calculable » qu’à partir du fait d’être, lequel constitue la dimension
originaire dont toutes ses variations intelligibles peuvent se dégager. En d’autres termes, toute
appréhension de ce qui est en terme d’objet saisi dans la permanence instituée de ce qu’il présente, ne
fait jamais qu’occulter que c’est en tant que ce qui se présente est qu’il peut entrer dans le jeu de la
présence. Tout « lissage du temps » dans l’enchaînement d’une série d’objets liés les uns aux autres et
désamarrés inverse le mouvement originaire de l’exister et le saisit dans l’essentialisation de ce qu’il
projette plutôt que dans le geste en lequel il s’en investit. A force de s’abandonner de cette façon à
l’occultation de ce qu’est la présence, on finit par établir sa vie selon des plans qui chassent
abstraitement tout sens de l’effectivité de l’exister, pour le mettre au crédit d’une production elle-
même suspendue et vaine. Ou alors on finit par tomber dans « l’à quoi bon », le triste résidu d’une
histoire appréhendée téléologiquement à partir de sa fin dès lors que cette fin se brise, s’évanouit dans
le néant ou se poursuit indéfiniment comme les pièces de Beckett. C’est exactement contre cette
tendance insidieusement à l’œuvre qu’Heidegger nous prémunit :
« Ce qui séjourne toujours en passant, le présent, se déploie depuis et selon le double ajointement de la présence à
l’absence. Mais en tant que présent, ce qui séjourne toujours en passant, da Je-weilige, peut, précisément lui et lui
seul, demeurer en son séjour, s’arrêter en son séjour.
1
»
Comme l’expliquait Didier Franck dans son séminaire sur Heidegger et le christianisme, l’être est
articulé, c’est-à-dire qu’on ne peut comprendre le mouvement de l’existence sans penser l’articulation
selon laquelle elle accède à elle-même. L’étant est étant seulement parce qu’il est, mais il n’est qu’en
cela qu’il se présente en s’instituant, en se détachant du fait brut de l’être pour se manifester comme
une constance. Mais ce qui est n’est autre que ce qui se tient dans l’ouvert de la présence, et celui-ci
n’est rien à son tour que le fait pour le monde articulé où se montre l’étant d’être « vraiment », en et à
partir de soi-même. Tel est le « pli » de la présence : l’être est originairement un « s’accomplir de soi-
même », en lequel le présent se retourne et se plie, « se charge de lui-même », bref, s’assume en tant
qu’il est le présent - c'est-à-dire ouvert sur l’énigme du fait d’être. Le « qu’ » est l’objet insigne de la
pensée de Heidegger. En lui, le reflux vers la présence dans l’assomption du présent n’est pas un
rétrécissement de la temporalité, mais une écoute de l’articulation originaire de celle-ci
2
. Cette réserve,
c’est le dépouillement du poème qui recueille la proximité de la terre, le geste du poète qui consent à
l’existence et reflue vers ce que la parole prononce originairement
3
. La parole est l’espacement
1
Cité oralement par Didier Franck lors de son séminaire Heidegger et le christianisme, à Paris X et à l’ENS de Paris. Nous
n’avons pas pu trouver les références précises de cette citation.
2
Selon laquelle se joue le jeu du présent, du passé et de l’avenir. Cf. Temps et Etre, dans Questions III et IV.
3
Elle qui est la di-mension de l’être. Cf. en annexe, notre lecture de L’origine de l’oeuvre d’art.

5
originel d’un jeu de tensions
4
. En elle se joue « l’appropriation à soi de la tâche de l’être ». Pour
l’entendre, la poésie se veut un toucher du silence.
2. Dans ce retrait, cette réserve, quelque chose se clôt pourtant dont Heidegger ne parle pas. On ne sait
pas - et le pessimisme de Heidegger lui-même n’est guère encourageant - si le poète, en cette tenue,
fait autre chose que celui qui se retire sur la plus haute dune en espérant que la mer l’épargnera. Quand
nul ne sait où la mer s’arrête, on ne sait pas non plus si les derniers îlots préservés ne vont pas bientôt
disparaître à leur tour, et si, dans une résistance farouche à la clôture, nous ne sommes pas déjà les
proies de ce à quoi nous résistons. Peut-être la garde de l’être impose-t-elle au contraire que ses
bergers rompent leur réserve et qu’ils osent à leur tour dévaler dans le tumulte de l’étant…
L’existence quotidienne est quotidienne au point que son pouvoir d’érosion finit par défaire les
procédés que nous avons mis en place pour rester sur le qui vive et ne pas nous laisser sédimenter dans
l’atemporalité de l’habitude. Heidegger a beaucoup insisté sur ce point : le monde, ouvert pour et face
à nous, est un horizon général de stabilité (de solidité et de fiabilité, en allemand Verlässlichkeit)
auquel nous nous confions. L’existence ne peut être que quotidienne, parce que tout surgissement
demande qu’on lui aménage un terreau. Sans ce sempiternel retour du même, sans la mise en forme
que Kierkegaard nomme la vie éthique, rien : rien qu’on puisse bâtir, aucune proximité qu’on puisse
préserver, aucune distance qu’on puisse accueillir. L’étranger, l’errant absolu, celui sur qui aucune
temporalité n’a prise, flotte plutôt qu’il n’existe et ne vit pas plus qu’une vie hallucinée
5
. Que cette
fluence soit entretenue dans la culture de l’affect, l’intensification et la machination de son corps n’y
change rien, bien au contraire. Qu’est-ce d’abord qu’une pure intensité ? Quelle pureté se conserverait,
hors de l’immédiateté de sa manifestation autrement qu’en une fuite d’affect à affect, en ouvrant une
véritable dépendance ? Une existence engloutie dans l’affect se cherche à tâtons plutôt qu’elle ne
s’exalte. Elle se traverse en plein vertige et ne retient rien du paysage.
Nous ne cessons d’oeuvrer dans et pour le monde, de nous engager à l’intérieur de son cercle
d’échanges, serré par les échéances et les temporalités qui le gouvernent. Il y a les temporalités
journalières, le temps du travail, le temps des sociétés ; il y a celui des calendriers, celui des petites
choses, il y a les aménagements à l’intérieur d’espaces-temps plus réduits… Mais il y a aussi les temps
biologiques, qui s’accommodent tant bien que mal aux calendarités professionnelles. Il y a les temps
du projet… Il y a même la temporalité spéciale de l’inconscient, celle qui ne connaît plus la durée,
l’avant, l’après, et qui n’est qu’une sédimentation anarchique à laquelle se confrontent et se
ressourcent les stratégies d’individuation. Nous avons tenté de retracer ailleurs
6
, en suivant le chemin
4
Qui a d’abord été pensé comme combat du monde et de la terre, puis comme le jeu des quatre, la terre, le ciel, les divins et
les mortels.
5
Nous ne lisons seulement le désarrois ni la quête d’un bonheur immédiat dans l’Etranger de Camus mais quelque chose
d’inhumain, d’insoutenable.
6
Cf. à ce sujet notre texte d’annexe, La prise du symbolique sur le vivant.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
1
/
112
100%