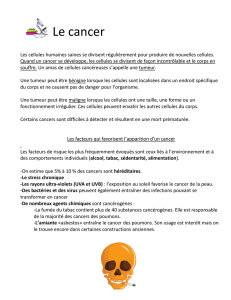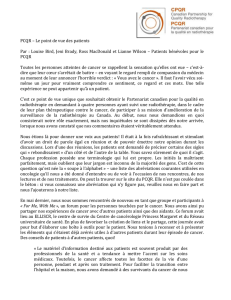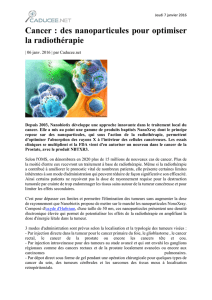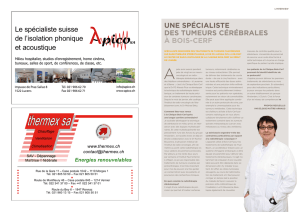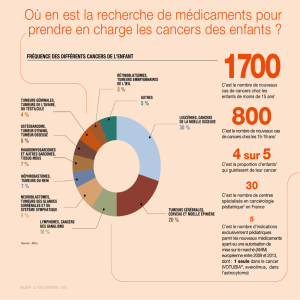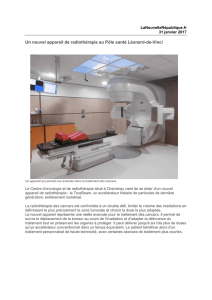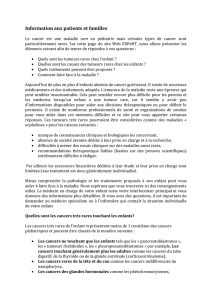Télécharger le PDF - Institut Roi Albert II

Cliniques
universitaires Saint-Luc
Av Hippocrate, 10
1200 Bruxelles
Belgique
Tel: 02/764.11.11
Fax: 02/764.37.03
www.saintluc.be
www.centreducancer.be
NEWSLETTER 13 - OCTOBRE 2010
Innovation
Research
Care
Excellence
Spécial cancers des
voies aérodigestives
supérieures
Dans ce numéro
ccancer newsletter n13 2.indd 1 24/09/10 09:59

edito
Michel SYMANN,
rédacteur en chef
et Marc HAMOIR
rédacteur invité
Le combat d’un trio vertueux
contre trois vices pernicieux
Editeur responsable: Marc Hamoir,
Président du Centre du Cancer.
Cliniques universitaires Saint-Luc,
10, av. Hippocrate 1200 Bruxelles
Rédacteur en chef: Michel Symann
Coordinatrice de rédaction: Charlotte De Valkeneer
Photos: © CAV des Cliniques / Hugues Depasse, D. R.
Dans ce numéro de la «Newsletter», les membres
de la clinique de cancérologie cervico-maxillo-
faciale s’illustrent par la grande qualité des
articles proposés, l’homogénéité de l’ensemble de
leur contribution et l’exemplarité de leurs interac-
tions multidisciplinaires.
Les tumeurs malignes des voies aérodigestives
supérieures sont d’une gravité particulière pour
trois raisons. Elles sont situées au sein ou à
proximité de structures anatomiques et physiolo-
giques vitales, souvent gravement perturbées par
le volume tumoral. En majorité carcinomes épi-
dermoïdes, ces tumeurs sont douées d’une grande
malignité locale et régionale. Enfin, le terrain sur
lequel elles se développent explique pour une
part la fréquence des évolutions défavorables, des
affections intercurrentes mortelles et l’incidence
élevée d’un second cancer.
Deux toxiques exogènes, consommés volontaire-
ment, le tabac et l’alcool sont les responsables
majeurs des cancers de la cavité buccale, du
pharynx et du larynx. Un troisième larron étiolo-
gique a été récemment identifié, la famille des
papillomavirus humains, expliquant la stabilité
de l’incidence des cancers des voies aérodiges-
tives supérieures alors même que les campagnes
contre le tabagisme infléchissent la fréquence et
la mortalité des cancers bronchiques. Peut-on
espérer que l’introduction récente chez les jeunes
filles de la vaccination contre les papillomavirus
humains pour le cancer du col inverse à terme ces
résultats épidémiologiques ORL décevants? Cela
reste à démontrer.
Vous lirez dans cette issue de la News comment
les progrès de l’imagerie médicale et de l’en-
doscopie affinent le bilan préthérapeutique et
permettent de tailler sur mesure une stratégie
thérapeutique individuelle combinant la chirurgie,
la radiothérapie et les traitements systémiques,
trio vertueux en extraordinaire développement
depuis deux décennies.
En effet, les trois modalités thérapeutiques sont
en pleine évolution. La chirurgie d’aujourd’hui se
caractérise par des exérèses rigoureuses sur le
plan de la logique oncologique, mais néanmoins
plus fonctionnelles, par le développement de la
chirurgie réparatrice et par les progrès de l’anes-
thésie et de la réanimation.
Ces dernières années, la radiothérapie a connu
des progrès technologiques particulièrement
riches amenant à de véritables révolutions dans la
prise en charge des patients. Imagerie multimo-
dalité comme support à la radiothérapie de haute
précision, radiothérapie guidée par l’image, radio-
thérapie par modulation d’intensité, méthodes
d’asservissement ou de synchronisations à la
respiration sont autant de progrès qui expliquent
la complexité croissante de la mise en œuvre de la
radiothérapie moderne.
L’oncologie médicale est la dernière venue dans
cette approche multidisciplinaire. Chimiothérapie
et radiothérapie synchrone dans le contexte adju-
vant, ainsi que chimiothérapie d’induction ont
confirmé leur bénéfice et trouvé leur place dans
les algorithmes des choix de stratégie thérapeu-
tique. Enfin, les thérapies ciblées, associées ou
non à la chimiothérapie conventionnelle, confir-
ment leur intérêt dans les traitements aussi bien
des formes locorégionales que des rechutes des
cancers épidermoïdes des voies aérodigestives
supérieures.
Dernière perle de ce numéro, une vignette pour
parler franglais, de l’histoire clinique d’une nona-
génaire. Ce cas illustre avec éloquence que l’âge
en soi n’est pas une contre-indication à un traite-
ment anticancéreux et justifie pleinement l’intérêt
contemporain pour l’oncogériatrie.
Voies aérodigestives supérieures
Sinus paranasaux
Cavité nasale
Cavité orale
Larynx
Nasopharynx
Oropharynx
Hypopharynx
ccancer newsletter n13 2.indd 2 24/09/10 09:59

Tumeurs de la TêTe eT du cou
Tumeurs des voies aérodigesTives supérieures
glandes salivaires
Rendez-vous
ou accueil
• Chirurgie cervico-faciale ORL
Pr M. HAMOIR
Dr S. SCHMITZ
• Chirurgie orale et maxillo-
faciale
Dr M. MAGREMANNE
Dr P. MAHY
Pr H. REYCHLER
• Chirurgie plastique
Pr B. LENGELE
• Oncologie médicale
Pr J.-P. MACHIELS
• Radiothérapie oncologique
Pr V. GREGOIRE
• Rhinologie ORL
Pr P. ROMBAUX
• Coordination de soins
en oncologie
Mme D. MOREAU
M. T. TRINH
• Coordination de recherche
clinique médicale
Mme L. NGUYEN GIA
• Onco-Psychologie
Mme F. LIEUTENANT
02 764 19 42
02 764 19 42
02 764 57 02
02 764 57 02
02 764 57 02
02 764 19 42
02 764 18 12
02 764 47 57
02 764 19 42
02 764 12 72
02 764 12 73
02 764 42 12
02 764 21 60
GUIDE DES CONSULTATIONS
EXAMENS MÉDICO-TECHNIQUES - HOSPITALISATION
Le combat d’un trio vertueux
contre trois vices pernicieux
sommaire
Les cancers des voies aérodigestives
supérieures: épidémiologie
et classification histologique
B. Weynand ................................................................. 4
Manifestations cliniques, mise au point
et stadification des cancers des voies
aérodigestives supérieures
M. Magremanne ....................................................... 8
Les grands principes qui régissent
la stratégie de traitement des cancers
des voies aéro-digestives supérieures
M. Hamoir ................................................................. 12
Il y a chirurgie et chirurgie
des tumeurs malignes des VADS
H. Reychler .............................................................. 16
La Radiothérapie par Modulation d’Intensité
dans les tumeurs de la sphère cervico-maxillo-
faciale: état de la question et défis futurs
V. Grégoire ............................................................... 20
Thérapies ciblées dans le cancer
épidermoïde de la sphère cervico-maxillo-
faciale
JP. Machiels ............................................................ 24
Quelle attitude face à un cancer
de la tête et du cou récidivant?
M. Hamoir ................................................................. 28
Cancer du plancher buccal
chez une nonagénaire
H. Reychler .............................................................. 31
News ............................................................................34
ccancer newsletter n13 2.indd 3 24/09/10 09:59

Les cancers des voies aérodigestives
supérieures:
épidémiologie et classification
histologique
Centre du Cancer. Clinique de Cancérologie Cervico-maxillo-faciale (CCMF), Services d’Anatomie pathologique
2
et d’Oto-rhino-
laryngologie, Unité de Chirurgie Cervico-faciale
2
. Cliniques universitaires Saint-Luc.
Birgit [email protected]
hygiène dentaire déficiente, ainsi que l’im-
munosuppression à long terme et l’infec-
tion syphilitique chronique. Rarement, des
syndromes héréditaires ont été incriminés,
comme le syndrome de Plummer-Vinson [3].
Ces dernières années, le papillomavirus
humain (HPV) a émergé comme étiologie
possible de certains CVADS, en particulier
ceux de la sphère oropharyngée, qui appa-
raissent à un âge plus jeune (entre 20 et 40
ans) avec un sexe ratio de 1. Le virus HPV
est clairement sexuellement acquis et l’on
décrit une association avec un nombre élevé
de partenaires sexuels vaginaux (26 et plus),
plus de 6 partenaires sexuels oraux au
cours de la vie et le développement d’un
cancer ano-génital induit par l’HPV chez la
femme. Sa prévalence globale dans le
CVADS est estimée à 26 %. Le sous-type 16
est le plus fréquemment décrit, suivi par
l’HPV18 [4]. La présentation clinique est éga-
lement différente dans le sens ou l’on
observe plus souvent des petites tumeurs
associées à un envahissement ganglion-
naire majeur. Le virus HPV peut être mis en
évidence au sein d’un CVADS, soit directe-
ment, soit indirectement par la détection de
l’expression immunohistochimique du p16
(Figure 2).
Le développement d’un CVADS est la consé-
quence d’un processus à étapes multiples
avec des modifications moléculaires et
génétiques progressives qui aboutit en fin
de compte à la transformation d’une
muqueuse normale en cancer invasif. Les
modifications génétiques sous-jacentes
comprennent une perte d’hétérozygocité de
certains chromosomes (3p14, 9p21, 17p13,
8p, 11q, 13q, 14q, 6p, 4q27 et 10q23), une
amplification, une délétion, une sur ou sous
expression de certains oncogènes et des
gènes suppresseurs de tumeurs, parmi les-
quels ont été identifiés: EGF-R (epidermal
growth factor receptor), p53, Rb (retino-
blastoma protein), p65, cyclooxygenase 2
(COX-2), p16, cycline D1, phosphatase et
PTEN (phosphatase and tensin homolog).
Certains gènes tels ceux qui encodent
E-cadherin, chemokine, VEGF (vascular
endothelial growth factor), PDGF (plateled
Les cancers des voies aérodigestives supé-
rieures (CVADS) représentent 4-5 % des
tumeurs malignes diagnostiquées en
Belgique [1]. Leur incidence a graduellement
diminué pendant les 2 dernières décennies
à l’exception des cancers de la cavité orale
et de l’oropharynx. Ils restent cependant le
5e cancer le plus fréquent dans le monde
(Figure 1) et la 6éme cause de mortalité par
cancer. Ils se développent habituellement
vers l’âge de 50 ans avec un sexe ratio
homme/femme de 5,1 en Belgique [2].
Les facteurs de risques qui y sont classi-
quement associés sont l’abus d’alcool et de
tabac. Tous deux semblent avoir une action
synergique sur la surface muqueuse.
Certains carcinogènes produits par le tabac
induisent des mutations du p53 décrites
dans le CVADS. Les effets de l’alcool sont
moins clairs, mais on suppose que ce carci-
nogène augmente la perméabilité de la
muqueuse, induit des dommages hépa-
tiques et/ou diminue l’immunité. Le
mâchonnement du bétel est très populaire
en Inde et dans les régions du Sud-Est asia-
tique où l’incidence du carcinome épider-
moïde est la plus importante dans le monde.
La noix d’Arec, le composant majeur du
bétel, induit des dommages génétiques.
D’autres facteurs de risque ont été associés
au développement du CVADS, comme le
cannabis, une hygiène alimentaire caracté-
risée par une faible teneur en vitamines et
fibres, un mauvais état de la dentition et une
BIRGIT WEYNAND1 ET SANDRA SCHMITZ2
4
Figure 1
Taux d’incidence globale des
tumeurs de la cavité orale et
de l’oropharynx (tous âges
confondus) chez l’homme. Taux
standardisés pour l’âge (ASR, world
standard population) par 100.000
habitants par an. De J. Ferlay et
al.,Globocan 2000 (2001).
<4.0 <6.1 <8.7 <15.4 <47.4.
ccancer newsletter n13 2.indd 4 24/09/10 09:59

Finalement, la vaccination systématique
contre le virus HPV pour éviter le dévelop-
pement des cancers du col utérin pourrait
également réduire l’incidence des CVADS
dans les deux sexes.
La classification OMS des cancers de la tête
et du cou la plus récente date de 2003 [7].
Elle recense le carcinome épidermoïde
comme le type histologique le plus fréquent
(Figure 2 et 3). Par définition il s’agit d’une
tumeur épithéliale maligne caractérisée
par une différentiation squameuse, à savoir
la présence de globes cornés, de cellules
kératinisées et de ponts intercellulaires en
proportions variables qui permettent de
distinguer trois grades de différentiation:
bien, moyennement et mal différencié.
Différentes variantes ont été décrites.
derived growth factor), FGF (fibroblast
growth factor), TGFα et TGFβ (transforming
growth factor α et β), IL-8 (interleukine –8)
ainsi que leur récepteur respectif sont
impliqués dans les stades précoces de la
cancérogenèse ainsi que dans la progres-
sion métastatique [5].
Plus de 50 % des lésions prémalignes sont
porteurs d’une mutation p53, un autre gène
suppresseur de tumeur, laissant présager
qu’il s’agit d’un événement précoce dans la
carcinogenèse de ces tumeurs. En
revanche, le mécanisme moléculaire de la
carcinogenèse induite par le virus HPV est
différent. La grande majorité des tumeurs
HPV positives expriment les oncoprotéines
virales E6 et E7.
Celles-ci inhibent les protéines suppres-
sives de tumeurs codées respectivement
par les gènes p53 et Rb qui ici restent non
mutés (wild type). La surexpression de p16
s’explique par la suppression de son inhibi-
tion par Rb, lui-même inactivé par la pro-
téine E7. Actuellement, la détection immu-
nohistochimique du p16 au sein d’un
carcinome épidermoïde est un bon indica-
teur d’une tumeur induite par l’HPV.
Pourquoi s’intéresser particulièrement au
virus HPV dans le cadre du CVADS? Le dia-
gnostic d’un cancer HPV positif a des impli-
cations cliniques majeures. On s’est rendu
compte que les tumeurs HPV positives
répondaient mieux aux traitements clas-
siques du CVADS et avaient une meilleure
survie globale, sans maladie. Ceci peut être
expliqué par une absence de cancérisation
de champ, une surveillance immunitaire
accrue, une faible expression de l’EGF-R et
une restauration des voies de l’apoptose
comme p53 n’est pas muté [3]. Une méta-
analyse récente spécifie même qu’une aug-
mentation de la survie globale existe uni-
quement pour les tumeurs HPV positives
provenant de l’oropharynx [6].
Un autre intérêt potentiel est la détection
du virus HPV dans les métastases gan-
glionnaires isolées du cou qui oriente vers
une localisation primitive au niveau de
l’oropharynx.
BIRGIT WEYNAND1 ET SANDRA SCHMITZ2
Les cancers des voies aérodigestives
supérieures:
épidémiologie et classification
histologique
5
Figure 2
À gauche, lésion bourgeonnante de la face
interne de la joue droite correspondant à
un carcinome épidermoïde en histologie.
Expression immunohistochimique du p16
(marquage brun du cytoplasme de la plupart
des cellules tumorales) sur le prélèvement
biopsique correspondant.
Figure 3
À gauche, image endoscopique d’une
tumeur de la face endolaryngée de
l’épiglotte.
À droite, pièce de résection chirurgicale
correspondante, il s’agit d’une laryngectomie
partielle supraglottique.
ccancer newsletter n13 2.indd 5 24/09/10 09:59
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
1
/
36
100%