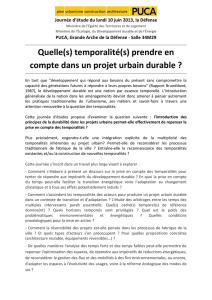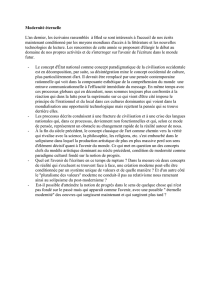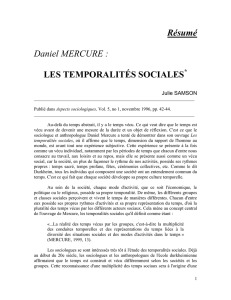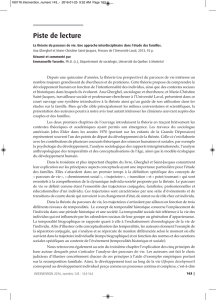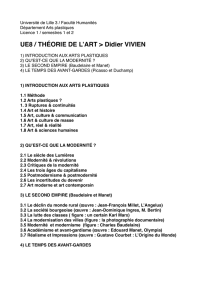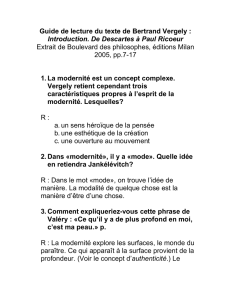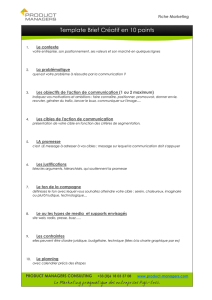Pour introduire notre sujet et ... problématiques que nous souhaitons explorer, nous allons gloser autour Jean-Paul KARSENTY

1
Jean-Paul KARSENTY*
L’ECONOMISME, MATRICE DE VULNERABILITE GENERALISEE
Pour introduire notre sujet et dessiner progressivement les
problématiques que nous souhaitons explorer, nous allons gloser autour
de la notion d’action.
On peut s’accorder sur une observation minimale : l’homme et les
hommes ont toujours agi ; de plus, ils ont toujours été agis par les effets
de leurs actes. Mais, à en rester là, on négligerait alors l’intérêt, cognitif
au moins, de recourir aux différents paradigmes et aux multiples
repères permettant d’approcher l’homme et/ou les hommes « en
actes ».
Cet intérêt-là renvoie à une préoccupation moderne. Il n’aura,
certes, point fallu attendre le philosophe français Henri BERGSON
pour penser l’homme en action, pour le considérer dans une dynamique
permanente, pour l’envisager par l’action, voire tout entier dans et pour
l’action ! Assurément, l’homme est un motif, c’est-à-dire un moteur,
pour lui-même. En outre, s’il se déplace dans l’espace, c’est parce qu’il
se meut du fait des motifs qu’il se donne à lui-même et qu’il observe
chez les autres d’une part, d’autre part parce qu’il est mu du fait de
motifs qui ne dépendent pas de lui. A l’échelle collective, on
remarquera que si les mythologies – et les formations religieuses – ont
été forgées comme des représentations générales, elles l’ont été dans la
perspective de donner des cadres à l’action, et peut-être même comme
des représentations dont la cohérence d’ensemble entendait proposer à
toute intention d’action de l’homme et des hommes les conditions
générales de sa légitimité ou de son efficacité.
Il reste que ce n’est qu’avec la modernité que l’émancipation
relative des hommes à l’égard de mythologies préconstruites s’est
manifestée. Elle l’a fait sous la forme d’une tension entre connaissance
et action que les hommes ont prise en charge, en principe de manière
désormais autonome de toute transcendance. Le processus
d’individuation a alors donné à l’homme les traits de la particularité,
c’est-à-dire de la partie du tout des hommes. La méthode scientifique
en pleine expansion a inspiré ce processus : en effet, du calcul des
* Ancien secrétaire général du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie,
économiste au CNRS, membre du Centre d'études des techniques, des connaissances
et des pratiques (Cetcopra) de l'Université de Paris 1

2
probabilités et de la loi des grands nombres du mathématicien suisse
BERNOUILLI à la fin du 17e siècle jusqu’au calcul du bonheur et des
peines du philosophe anglais BENTHAM à la fin du 18e, la
construction de la particularité aura été guidée par de telles quasi-lois
de la nature au service de la vie quotidienne des hommes. Finalement,
cette émancipation relative des hommes dans la particularité ne fut que
l’antichambre de l’étape ultérieure de leur « majorité », au sens kantien
et des Lumières, celle de la possibilité de la singularité. Cette
singularité moderne, mentale et comportementale, s’est alors déployée
et a pris des formes variées. Elle a autorisé en particulier chez les
hommes le développement et l’exercice de capacités à la réflexivité et à
l’anticipation. Jusqu’à aujourd’hui.
Aujourd’hui précisément, cela n’empêche pourtant pas que la
question « Sommes-nous encore modernes ? » soit débattue dans nos
contrées. Depuis une trentaine d’années, au moins. Après Hannah
ARENDT, surtout. Qu’en est-il de cette tension entre connaissance et
action ? Ne serait-il pas pertinent de tester l’hypothèse selon laquelle
l’action deviendrait toujours davantage justifiée et validée… par
l’action elle-même, autrement dit sans qu’elle ne soit plus,
intentionnellement au moins, confrontée aux repères rationnels et
sensibles de la connaissance ? Serions-nous alors entrés dans une ère
d’hyper-modernité, fantasme déqualifiant la modernité ? Le cas
échéant, l’aurions-nous fait sous l’effet d’une instrumentalisation
excessive du temps – des diverses temporalités donnant ses expressions
concrètes au temps – qui résulterait, fait nouveau, de l’établissement
d’un lien désormais non nécessaire entre action et connaissance ; avec
quelles conséquences éventuelles ?
Par ailleurs, l’action, comme source de subsistance (pour couvrir
des besoins), d’existence (pour exercer des liens) et de consistance
(pour désirer des valeurs) en appelle spontanément à l’œuvre, à
l’ouvrage, au travail ; à l’opus, aux opera et à leurs operanda. Or, il
conviendrait de considérer en ceux-ci la caractéristique de puissance
(ce qui fut peu fait jusqu’à présent), c’est-à-dire l’opus par unité de
temps, bref, la puissance d’agir.
Enfin, en vue d’achever de dresser le tableau sommaire des outils
que notre propos va mettre en relation, la question « Quels sont
aujourd’hui les acteurs génériques en puissance d’agir de façon réelle et
distincte ? » renvoie aux hommes (à leurs volontés collectives en
formations diverses et innombrables), à l’homme (à son désir, infini et
indéfini, en 6 milliards d’exemplaires différents), enfin, à la nature ou à
la biogée [1] (à ses régularités nombreuses et finies ou à ses événements
infinis, agissant ou rétroagissant). Ce faisant, en nous appuyant sur
quelques-unes parmi les relations principales existant de fait entre ces
acteurs génériques en puissance d’agir et/ou en situation d’être agis du

3
point de vue spécifique de l’action d’ordre économique, apparaîtra le
critère de leur vulnérabilité éventuelle.
Nous allons donc, à grands traits, ausculter l’état de notre
modernité et ce qu’en font ses acteurs, rien d’autre, comme des
« condamnés à vivre dans le monde où nous vivons », pour le dire à la
façon de François FURET. Au lecteur impatient ou à celui que j’aurais
déjà égaré, je précise que la principale question attachée au fil rouge de
notre progression discursive sera la suivante : « Dans quelle mesure, et
comment, l’effet d’un certain enchaînement de temporalités forcées
transforme-t-il nos actions en agenda, c’est-à-dire en actions
nécessaires, vulnérabilisant alors les hommes des générations à venir
dans leur capacité d’engendrer librement de nouveaux actes ? ».
I. Parce que chronoclastes, les logiques contemporaines les plus
puissantes sont délétères.
S’il est attristant de le constater chaque jour davantage, il n’est
pas banal de le dire ainsi : les différentiels de rythmes, de dynamiques,
de temporalités (et donc, souvent, de puissance) affectés aux/affectant
les acteurs dans leur diversité ne permettent pas aux logiques qui
traversent nos sociétés de coopérer entre elles ; ils ont plutôt tendance à
exciter les relations entre ces logiques et à les rendre conflictuelles.
Examen.
I.1. La logique de financiarisation de l’économie est en train
d’asservir la logique de marchandisation de l’innovation dans
l’économie du fait de la puissance différentielle et univoque que lui
confèrent son rythme, sa dynamique et sa temporalité.
… C’était en juillet 2010. Sous l’impulsion du Président
OBAMA, le point d’équilibre de la plus importante réforme jamais
imposée à l’activité du monde financier depuis le New Deal du
Président ROOSEVELT a été déterminé par le rapport d’influence
entre son conseiller Paul VOLCKER, l’ancien directeur de la Réserve
Fédérale américaine, et Timothy GEITHNER, l’actuel Secrétaire au
Trésor des États-Unis d’Amérique, et leurs épigones respectifs. Cette
réforme a été considérée par certains comme une esquisse sans portée
véritable et par d’autres comme le début d’une courageuse régulation
du système financier international. Il reste que personne ne conteste que
l’enjeu était bien de contraindre la puissance d’agir d’acteurs dont
l’intervention conditionne et impacte aujourd’hui les parties les plus
entreprenantes de l’activité économique sur la totalité du globe. Car le

4
pouvoir financier, la finance de marché surtout qui en constitue la
partie la plus dynamique, est le premier pouvoir, et pour l’instant le
seul, dans l’histoire de l’humanité à (s)’être globalisé [2].
Or, l’une de ses caractéristiques majeures, et rarement présentée
comme telle, réside dans le fait que ce pouvoir est l’un des plus mal
connus parmi les grands pouvoirs de portée planétaire (en voie de
globalisation comme en voie de mondialisation) ; et peut-être le plus
mal connu d’entre eux si l’on songe que la science financière qui trouva
sa source principale en Mésopotamie figure aujourd’hui parmi les plus
indigentes des sciences contemporaines. Aux dires même des
impétrants régulateurs de ce pouvoir, on avance dans ce monde à
tâtons, sans connaissance, face à des acteurs auxquels échappent, sinon
leurs propres mobiles individuels et collectifs, du moins l’essentiel de
la compréhension des modus operandi et des effets de leurs actes,
souvent trop innovants pour souffrir quelque validation théorique et
même pratique. Un travail de connaissance des pratiques concrètes et
des techniques des acteurs financiers dont la virtuosité ingénieuse a été
remarquable depuis quelques dizaines d’années, autrement dit un
travail approfondi et patient de recherche, devra constituer, à
l’évidence, l’effort de base d’une refondation de cette science.
Bref, le hiatus est abyssal entre la capacité inégalée des pratiques
financières sur les faits et événements sociaux et humains dans le
monde, et l’incapacité à peine concevable des sciences financières à
expliquer et à comprendre, donc à prévoir et à anticiper ! Pour l’instant,
on commence à comprendre que l’activité financière supposée servir le
développement de l’activité économique a construit un nouveau socle
épistémologique et pratique, voilà 50 ans environ, autour d’une
autonomie logique qui a conféré à la notion même de promesse, cœur
de son métier, un nouveau statut ; et qu’elle l’aurait construit en initiant
une instrumentalisation des temporalités différentes de celles qui ont
inspiré toute l’époque historique moderne [3] ! Il semble que l’on ne
sache pas, en revanche, si le forçage de l’outil temporel aurait procédé,
ou non, d’une intention de modifier en profondeur la notion même de
promesse, objet central, on vient de le dire, de la transaction dans
l’activité financière. Il semble enfin que l’hypothèse soit encore mal
explorée selon laquelle le forçage de l’outil temporel résulterait
de l’effet conjugué des caractéristiques des deux puissants
quasi-équivalents généraux contemporains que sont la monnaie d’une
part, l’informatique d’autre part, conférant à l’activité financière
globalisée une performativité sans égale.
Aussi, peu ou prou, se contente-t-on aujourd’hui de constater que
« la finance » dans son ensemble produit d’innombrables promesses
(trente fois plus en moyenne, dit-on quelquefois, que ce que l’activité
économique réelle des hommes en réclamerait), d’une durée de plus en

5
plus faible [4] : un volume de plusieurs centaines de transactions sur un
titre par fraction de seconde n’est pas rare aujourd’hui. Donc, il serait
raisonnable de penser que le pouvoir financier globalisé contemporain
ne prend plus… d’engagement, qu’il ne répond plus d’une quelconque
responsabilité mais plutôt d’un processus innovatif permanent
incapable de se penser lui-même comme source d’un service et/ou
d’une valeur ajoutant(s). En effet, toute promesse fondée sur un tel jeu
purement spéculatif reste-t-elle engagement ou bien ne mute-t-elle pas
en pari ? Question conséquente : le pouvoir financier globalisé ne
serait-il pas devenu un « acteur collectif privatif » non susceptible – par
défaut de capacité réflexive qu’imposerait pourtant la promesse – de
penser la plus grande entreprise de « vulnérabilisation » jamais
engendrée dans l’histoire de l’humanité en dehors, bien sûr !, de toutes
celles qui ont induit intentionnellement des actes de guerre tout au long
de l’histoire des hommes ?
Individus, groupes économiques et sociaux, institutions, nations,
humanité, biogée dans ses différentes formes sont rendus vulnérables, à
degrés et modalités divers, lorsque leur contribution directe ou indirecte
à la production et/ou à la consommation de biens et de services fait
appel aujourd’hui à (ou dépend de) la finance de marché. Donc, sur
toute la Terre géographique, en monde occidentalisé. Pourquoi ? Parce
que la plus grande partie de l’activité financière de marché progresse
par operanda non connus : elle détermine des actes à poser (des actes
seulement dits mais de fait imposés), des choses qui doivent être faites,
des agenda donc au sens étymologique, enfin non sans avoir désigné
auparavant ces choses qui doivent être détruites, ces delenda.
Annuler les temporalités associées à la promesse, n’assurer que le
risque tendant vers zéro, viser la performance absolue, voilà le
triptyque tangentiel de la finance de marché appuyée sur la titrisation,
technologie de production d’actifs toxiques parmi les plus délétères des
technologies qui aient jamais été inventées ! Or, ce triptyque entre en
contradiction avec l’économie de marché et le cœur même du
développement des sociétés modernes, à savoir l’innovation. En effet,
quand l’innovation de finance de marché engendre une telle
dynamique, elle menace gravement l’innovation dans l’économie de
marché elle-même. Les choses se passent, en effet, comme si
l’innovation financière non régulée ne laissait aucune chance à
l’innovation économique de contribuer à créer biens et services en lui
enjoignant rythmes, dynamiques et temporalités univoques, au mépris
de la diversité des secteurs et des acteurs d’entreprise. L’innovation
dans les biens et les services économiques résulte, en effet, d’une
promesse temporelle qui traduit généralement un engagement allant de
quelques semaines ou de quelques mois à quelques années, voire à
quelques dizaines d’années ; elle suppose un risque réel à assurer ; elle
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%