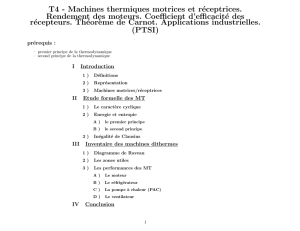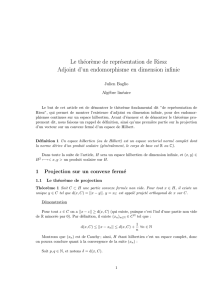ALG`EBRE 1 - ENS de Lyon

Laurent Berger
ALG`
EBRE 1

Laurent Berger
UMPA, ENS de Lyon, UMR 5669 du CNRS, Universit´e de Lyon.
E-mail : [email protected]
Url : http://perso.ens-lyon.fr/laurent.berger/

ALG`
EBRE 1
Laurent Berger


TABLE DES MATI`
ERES
1. Groupes ...................................................................... 7
1.1. Sous-groupes et quotients .................................................. 7
1.2. Actions de groupes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3. Groupes sym´etriques ...................................................... 10
1.4. Groupes lin´eaires sur un corps fini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Repr´esentations des groupes finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.1. Repr´esentations, sous-repr´esentations et morphismes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.2. Caract`eres et fonctions centrales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.3. D´ecomposition des repr´esentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4. Tables des caract`eres ...................................................... 20
3. Anneaux et modules ........................................................ 23
3.1. Modules .................................................................. 23
3.2. Id´eaux .................................................................... 25
3.3. Corps des fractions ........................................................ 26
3.4. Anneaux principaux et euclidiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.5. Anneaux factoriels ........................................................ 27
3.6. Anneaux noeth´eriens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4. Polynˆomes et corps finis .................................................... 31
4.1. Polynˆomes et racines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4.2. Le th´eor`eme de Hilbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
4.3. Polynˆomes `a coefficients dans un anneau factoriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.4. Corps finis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
5. Modules de type fini sur un anneau principal ............................ 37
5.1. Modules libres de type fini et matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5.2. Diviseurs ´el´ementaires pour un anneau principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5.3. Modules de type fini sur un anneau principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
5.4. Groupes ab´eliens de type fini et r´eduction des endomorphismes . . . . . . . . . . . . 42
6. Produits tensoriels .......................................................... 45
6.1. Produits tensoriels d’espaces vectoriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
6.2. Produits altern´es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
6.3. Produits tensoriels de modules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
1
/
58
100%