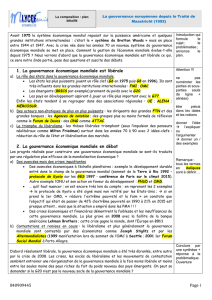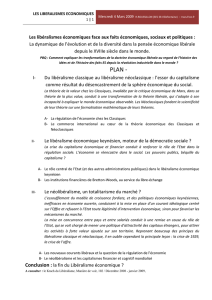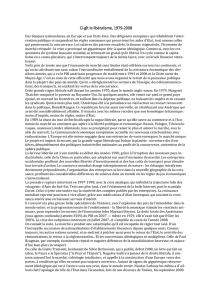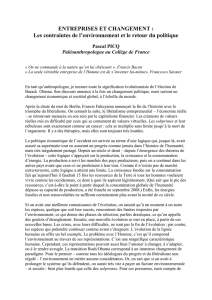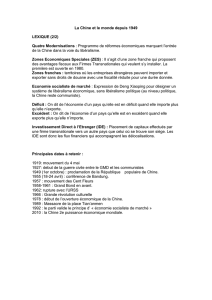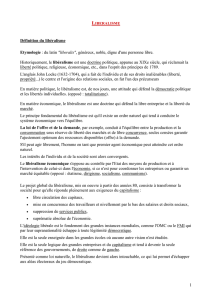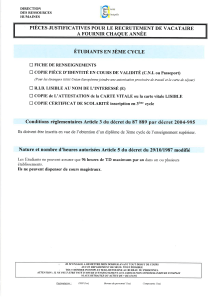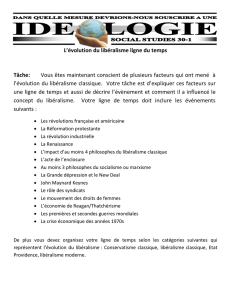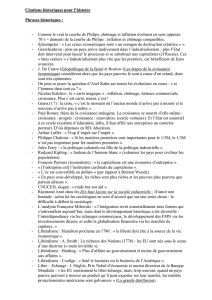La critique communautarienne du libéralisme politique et ses

Revue Française de Pédagogie, n° 143, avril-mai-juin 2003, 113-139 113
La critique communautarienne
du libéralisme politique
et ses implications possibles
pour l’éducation
Jean-Claude Forquin
«Considérée en elle-même et pour elle-même, l’école fonctionne comme un
laboratoire des questions posées à la démocratie par le développement même de
la démocratie, écrit Marcel Gauchet dans Pour une philosophie politique de l’édu-
cation (Blais, Gauchet et Ottavi, 2002, p. 22). Ses concepts fondateurs, la liberté
et l’égalité, y sont mis à l’épreuve, dans leur solidarité complexe, avec une
ampleur et une intensité dans l’expérimentation dont on n’a pas l’expérience
ailleurs. L’école est aujourd’hui l’institution où le problème principal de la démo-
cratie, en tant que régime des droits de l’individu, à savoir le problème de l’arti-
culation de l’individu avec le collectif, est testé avec le plus d’acuité. » L’intérêt
d’une approche en termes de « philosophie politique de l’éducation » est ainsi,
comme on le voit dans l’ouvrage qui vient d’être cité, de proposer une sorte
d’éclairage croisé : penser l’éducation en termes politiques, à partir des concepts
et des modèles de la philosophie politique, mais aussi utiliser les questions
d’éducation comme révélateur, analyseur ou amplificateur de ce qui, dans la pen-
sée politique démocratique contemporaine, risque de demeurer au niveau de l’im-
pensé ou du « mal pensé », ce que, dans le même texte, Marcel Gauchet appelle
«la tache aveugle » de la pensée individualiste-démocratique contemporaine, à
savoir cette question du point d’articulation entre droits individuels et contrainte
collective. Se donnant pour objet d’évoquer certains aspects et certains apports
essentiels du débat qui se développe au sein de la philosophie politique anglo-
saxonne depuis les années 1980 entre ce qu’il est convenu d’appeler la pensée
«libérale » et la pensée « communautarienne », la présente contribution s’inscrit
dans le même type de problématique et de perspective. À coup sûr ce débat
comporte en effet d’importantes implications du point de vue des politiques édu-
catives et des conceptions du curriculum. Ce terme d’« implications » ne doit pas
être entendu ici cependant dans un sens fort, dans une acception « application-
niste ». L’idée d’une « philosophie appliquée » est généralement discutable. Elle
le serait ici d’autant plus que, le plus souvent, les questions d’éducation ne
sont pas abordées de façon explicite ou systématique, mais plutôt de manière
occasionnelle, oblique ou indirecte par les auteurs qui font l’objet de la présente
NOTE DE SYNTHÈSE

114 Revue Française de Pédagogie, n° 143, avril-mai-juin 2003
étude. Disons plutôt que ce qui peut être recherché à partir de la lecture de ces
auteurs, ce sont moins des réponses que des questions, moins des idées que des
concepts, moins des orientations que des possibilités d’éclairage, des ressources
ou des supports pour un travail de réflexion et de problématisation autour de certains
thèmes ou de certains enjeux éducationnels qui seront retenus ici seulement
«pour l’exemple ».
UN DÉBAT RÉCENT OPPOSANT DEUX « FRONTS » HÉTÉROGÈNES
Comme toujours dans l’histoire des idées, il faut bien entendu faire la part de
ce qui, dans une telle catégorisation, relève d’une illusion classificatoire née du
besoin dichotomique de l’esprit. Le débat entre ceux qu’on désignera ici comme
«libéraux » et « communautariens » n’oppose pas en réalité deux doctrines ou
deux écoles de pensée clairement identifiables, mais plutôt, selon le mot de Berten,
Da Silveira et Pourtois (1997, p. 4), deux « fronts » hétérogènes, discontinus et
instables, entre lesquels peuvent avoir lieu des échanges et des permutations. Il
s’agit moins en fait d’un débat que d’un ensemble de débats qui relèvent de
plans différents, la morale, la politique, la sociologie, l’anthropologie, l’épistémo-
logie. De plus, pour chaque problème considéré, il n’existe pas une réponse libé-
rale et une réponse communautarienne mais un continuum de réponses dont
seuls les deux extrêmes sont indiscutablement dans l’un ou dans l’autre camp.
On a pu parler ainsi d’un « communautarisme radical » et d’un « communauta-
risme modéré » (Buchanan, 1989, p. 855), la même chose valant pour le libéra-
lisme. Cependant, comme le soulignent Berten, Da Silveira et Pourtois, les
membres de chacune des deux « équipes » (selon l’image de Taylor, 1997 [1989],
p. 87) ont incontestablement en commun un « air de famille ». « Les libéraux se
sentent les héritiers de Locke, de Kant et de Stuart Mill. Ils partagent le même
souci de la liberté de conscience, le même respect des droits de l’individu et une
méfiance commune vis-à-vis de la menace que peut constituer un État paterna-
liste. Chacun à sa manière adhère à la formule de Constant : « Prions l’autorité
de rester dans ses limites ; qu’elle se borne à être juste, nous nous chargerons
d’être heureux » (Constant, 1986, 289). Les communautariens, quant à eux, ont
des racines dans l’aristotélisme, dans la tradition républicaine de la Renaissance,
dans le romantisme allemand ou dans l’herméneutique contemporaine. Ils parta-
gent une égale méfiance envers la morale abstraite, une certaine sympathie
envers l’éthique des vertus et une conception de la politique où il y a beaucoup
de place pour l’histoire et les traditions. Chacun à sa manière adhère à la formule
d’Aristote : “La polis est antérieure à l’individu.” » (Berten, Da Silveira et Pourtois,
p. 6)
Situer dans les années 1980 l’apparition de ce débat entre libéraux et commu-
nautariens comporte aussi une part d’arbitraire. La problématique de la communauté
(Gemeinschaft vs Gesellschaft, tradition vs modernité, holisme vs individualisme,
philosophie romantique vs rationalisme et universalisme des Lumières) constitue
un héritage beaucoup plus ancien de la pensée sociologique et politique. Et dans
l’espace nord-américain notamment, on peut dire que cette notion de commu-
nauté constitue depuis longtemps l’un des mots-clefs du vocabulaire de l’édu-
cation. Il s’agit cependant d’une notion fortement polyvalente, dont l’aire d’appli-
cation varie selon qu’on se situe à l’échelle de la classe, de l’établissement
scolaire, du milieu local ou territorial proche (l’aire d’habitation, le quartier, la ville,
le « pays »), du milieu social, socioculturel ou ethno-culturel d’appartenance, ou

La critique communautarienne du libéralisme politique et ses implications possibles pour l’éducation 115
de la nation tout entière, voire d’une entité plus large ou plus diffuse, comme le
suggère aujourd’hui l’idée d’une « communauté d’apprentissage » ou « commu-
nauté apprenante » virtuelle portée par les nouveaux moyens de communication
à distance (Burbules, 2000). Ce qu’on désigne aujourd’hui spécifiquement, en
Amérique du Nord principalement, sous le nom de philosophie ou de pensée poli-
tique communautarienne correspond certainement à un champ plus restreint (et
qu’on ne saurait confondre non plus avec ce qu’on a pris l’habitude en France de
caractériser sous le nom de « communautarisme », lequel renvoie plus particuliè-
rement à la question de la reconnaissance et de la gestion des différences dans
le contexte des sociétés contemporaines multiethniques ou multiculturelles).
L’émergence de ce champ peut être comprise en grande partie comme un effet
de choc en retour, de contrecoup ou de réaction suite à l’audience nouvelle et au
profond renouvellement conférés à la philosophie politique libérale par la parution
en 1971 de la Théorie de la justice de John Rawls (trad. 1987). Il est significatif
que l’ouvrage souvent considéré comme le plus caractéristique, ou en en tout cas
celui qui se réclame le plus explicitement, de cette nouvelle approche, à savoir le
livre de Michael Sandel Liberalism and the Limits of Justice, paru en 1982 (trad.
1999), se présente essentiellement comme une critique méthodique et systéma-
tique des thèses de John Rawls. Mais, si l’on considère les contributions pro-
duites au cours de la période par chacun des deux « camps », en classant, avec
cependant toutes les précautions et spécifications nécessaires, des auteurs
comme Charles Larmore (1987), Ronald Dworkin (1995 [1977]), Thomas Nagel
(1991), William Galston (1991), Amy Gutman (1980), Bruce Ackerman (1980,
1992), Joseph Raz (1986), Will Kymlicka (1989b) ou Robert Nozick (1988 [1974])
du côté libéral, et des auteurs comme Alasdair MacIntyre (1997a [1981]), Charles
Taylor (1998a [1989]) ou Michael Walzer (1997 [1984]) du côté communautarien,
on se trouve bien évidemment en présence d’un éventail beaucoup plus large et
ouvert d’argumentations, comme le révèle une exploration même sommaire de la
très vaste littérature consacrée depuis une vingtaine d’années à ce débat (San-
del, 1984, Mouffe, 1987, Sosoe, 1988, 1991, Buchanan, 1989, Rasmussen, 1990,
Lenoble, 1991, Van Gerven, 1991, Iroegbu, 1991, Avineri et De Shalit, 1992, Hon-
neth, 1992, Mulhall et Swift, 1992, Bell, 1993, De Benoist, 1994, Friedman, 1994,
Gutman, 1994, Walzer, 1995 [1990], De Lara, 1996, Paul et Miller, 1996, Kymlicka,
1996, 1999 [1990], Berten, Da Silveira et Pourtois, 1997, Olssen, 1998, Mesure et
Renaut, 1999).
LE LIBÉRALISME : UN IDÉAL POLITIQUE ANTI-PATERNALISTE
ET ANTI-PERFECTIONNISTE
La philosophie politique libérale repose sur deux principes qui sont le respect
absolu de l’autonomie de la personne et le caractère imprescriptible et inaliénable
des droits individuels. « Nombre de libéraux, écrit Kymlicka (1999 [1990], p. 218)
estiment que la valeur de l’autodétermination est si évidente qu’elle ne requiert
aucun plaidoyer spécifique. Permettre aux individus de s’autodéterminer est la
seule façon de les respecter en tant que personnes morales à part entière, affir-
ment-ils. Leur refuser ce droit à l’autodétermination revient à les traiter comme
des enfants ou des animaux plutôt que comme des membres à part entière de la
collectivité. » De cette nature autonome découlent des droits qui sont posés,
selon l’expression de Dworkin, comme des « atouts » (trumps), ce qui signifie que
leur prise en compte doit primer sur toute autre considération, y compris la consi-
dération du « bien commun » ou du bien-être général telle qu’elle peut prévaloir

116 Revue Française de Pédagogie, n° 143, avril-mai-juin 2003
dans une optique utilitariste. On sait que cette critique de l’utilitarisme constitue
par exemple chez Rawls un des « points forts » de la théorie de la justice. Au nom
du bonheur de tous, considéré comme une grandeur globale qu’il s’agit de maxi-
miser indépendamment de ses caractéristiques de distribution, l’utilitarisme peut
être amené en effet à sacrifier certains droits individuels, enfreignant le principe
kantien qui veut que toute personne soit considérée « jamais seulement comme
un moyen, mais toujours aussi comme une fin ». C’est précisément, on le sait,
pour éviter ce risque d’instrumentalisation que, dans la théorie de Rawls, les
adeptes de la « position originelle » placés dans les conditions équitables du
«voile d’ignorance » décideront de placer au premier rang des principes de justice
l’accès de chacun à un système aussi étendu que possible de libertés de base
égales pour tous.
Cette priorité donnée aux droits et aux libertés individuelles induit une autre
thèse, moins évidente intuitivement mais tout aussi importante conceptuellement,
de la philosophie libérale, qu’on désigne bien souvent, par référence à une dis-
tinction formulée il y a un siècle par le philosophe Henry Sidgwick, comme « la
priorité du juste (right) sur le bien (good)» (Rawls, 1988, Taylor, 1988, Larmore,
1991 [1990]). Cette thèse, qui trouve tout d’abord sa justification forte dans la
doctrine kantienne du devoir, et qu’on présente plus généralement comme carac-
téristique des morales « déontonlogiques » modernes par opposition aux morales
«téléologiques » des Anciens, peut revêtir aussi une dimension politique. Dans
les termes proposés par Michael Sandel, on dira qu’une société où le juste pré-
vaut par rapport au bien est une société qui « ne cherche à promouvoir aucun
projet particulier mais donne l’occasion à ses citoyens de poursuivre leurs objec-
tifs propres, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec une liberté égale
pour tous », donc une société qui « doit se guider sur des principes qui ne pré-
supposent aucune idée du bien » (Sandel, 1997 [1984], p. 256). « Pour ce libéra-
lisme, poursuit Michael Sandel, ce qui fait d’une société une société juste, ce
n’est pas le télos, le but ou la fin qu’elle poursuit, mais précisément son refus de
choisir à l’avance parmi des buts ou des fins concurrentes. La société juste s’ef-
force par sa Constitution et ses lois de fournir à ses citoyens un cadre dans
lequel ils sont libres de rechercher leurs propres valeurs et fins, tant que cette
recherche n’empiète pas sur la liberté égale des autres citoyens » (ibid.).
Une autre formulation de cette même idée passe par la notion d’un « État
neutre », à savoir un État qui ne justifie pas ses actions sur la base de la supé-
riorité ou de l’infériorité intrinsèques de telle ou telle conception de la vie bonne
et qui ne tente pas d’influencer délibérément les jugements des individus quant
à la valeur de ces diverses conceptions. John Rawls oppose cette position à celle
des doctrines dites « perfectionnistes », lesquelles impliquent une conception
spécifique des qualités qui méritent le plus d’être encouragées et développées
chez les individus et proposent que les ressources de l’État soient distribuées de
façon à favoriser un tel développement (Théorie de la justice, § 50). Et Charles
Larmore va jusqu’à considérer ce postulat de neutralité comme « ce qui décrira
le mieux la conception morale minimale du libéralisme » (1997, p. 145), un idéal
que cet auteur qualifie aussi de « procédural » (ibid., note 1), une notion qu’il faut
entendre par opposition à la conception « substantielle » de ce qui est morale-
ment bon ou intrinsèquement désirable qui sous-tend les mots d’ordre politiques
«perfectionnistes », qu’il s’agisse de cultiver la vertu, de répandre le bonheur ou
simplement de « changer la vie ». « Pourquoi les libéraux sont-ils donc hostiles au
paternalisme étatique ?, demande Will Kymlicka. Parce que, d’après eux, nous
n’accéderons pas à une vie meilleure si notre existence est orientée de l’extérieur
en conformité à des valeurs que nous n’avons pas intériorisées. Le chemin de la

La critique communautarienne du libéralisme politique et ses implications possibles pour l’éducation 117
vie bonne passe par une existence autonome qui obéit à nos propres convictions
quant aux valeurs » (Kymlicka, 1999, p. 222). C’est pourquoi Rawls, qui estime
que toute tentative d’imposer aux individus une conception spécifique de la vie
bonne porte atteinte à leurs intérêts essentiels, se montre partisan d’une distri-
bution des « biens premiers » fondée sur ce qui peut être appelé « une théorie
faible du bien », laquelle peut servir à justifier toute une gamme de genres de vie
différents.
À côté de cette justification fondamentale, d’ordre philosophique et moral, de
la neutralité libérale (Kymlicka, 1989a), on peut aussi trouver cependant une argu-
mentation de nature assez différente, plus proprement historique et sociologique,
centrée sur la notion de pluralisme : c’est, dans les sociétés démocratiques
contemporaines, l’irréductibilité des conflits de valeurs, l’absence de consensus
sur les contenus substantiels d’une vie bonne qui justifieraient l’adoption par
l’État d’un principe de neutralité et d’impartialité axiologiques. On peut noter qu’à
une telle dualité semble correspondre au sein des libéraux une divergence, obser-
vée par certains commentateurs (Enslin, Pendbury et Tjattias, 2001), en ce qui
concerne la doctrine de la citoyenneté démocratique et de l’éducation à la
citoyenneté, les uns, comme William Galston (1995), faisant, au nom du respect
du pluralisme social et culturel (y compris à l’égard des subcultures traditionnel-
lement hostiles à l’idée d’autonomie individuelle), passer la vertu de tolérance
avant l’idéal d’autonomie, les autres, comme Amy Gutmann (1995), privilégiant au
contraire l’idéal d’autonomie et les exigences de justice au détriment d’une exi-
gence de tolérance inconditionnelle à l’égard de n’importe quel mode de vie.
L’ARGUMENTATION COMMUNAUTARIENNE
Même si elle s’enracine dans un long passé, marqué notamment par la
réaction romantique à la philosophie des Lumières (Legros, 1990, Chaumont,
1991, Taylor, 1998a [1989]), ce qui, aujourd’hui, peut être caractérisé dans les
pays anglo-saxons comme une pensée typiquement « communautarienne »
semble un phénomène récent, limité à un groupe d’auteurs relativement restreint
(quoique hérérogène) et dont l’apport orignal s’exprime principalement dans le
cadre d’un débat avec le libéralisme. Plusieurs lignes d’argumentation alimentent
la critique communautarienne du libéralisme.
Les limites de la justice
Dans le débat entre philosophes libéraux et communautariens, l’enjeu théo-
rique le plus important concerne peut-être la question de la place et du statut de
la justice. On connaît la formulation très forte de Rawls dans le premier chapitre
de sa Théorie de la justice :«La justice est la première vertu des institutions
sociales comme la vérité est celle des systèmes de pensée. » Michael Sandel
(1999 [1982]) soutient pourtant, contre Rawls, que la justice n’est pas la vertu pre-
mière de la vie sociale, c’est tout au plus une vertu palliative, un substitut à l’ab-
sence d’amour, un remède à l’effondrement des solidarités communautaires, et
surtout une réponse au pluralisme moral des sociétés contemporaines, une
manière de combler ou de compenser l’absence d’une conception du bien par-
tagée par tous. On attend de plus en plus la justice quand on est de moins en
moins d’accord sur ce qu’est le bien, c’est-à-dire sur ce qui rend la vie digne
d’être vécue et l’action humaine susceptible d’être évaluée ou estimée. D’autres
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
1
/
28
100%