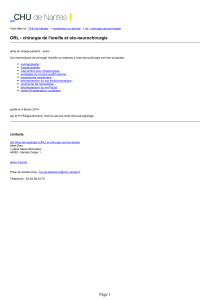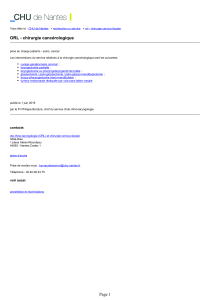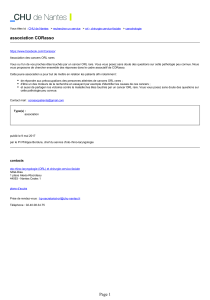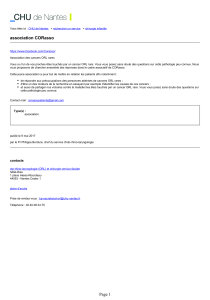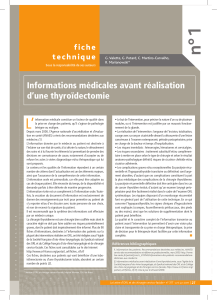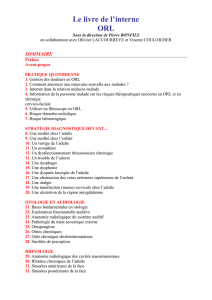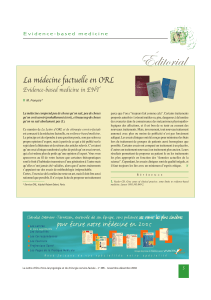Lire l'article complet

ACTUALITÉ
9
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no283 - mai 2003
L
a réunion de printemps de l’Association française
d’ORL pédiatrique s’est tenue cette année dans le
cadre extraordinaire de l’Institut international de
la prospective, sur le site du Futuroscope, à Poitiers. Le
Pr J.M. Klossek et le comité d’organisation avaient prévu un
programme très attractif car faisant le point sur des problèmes
d’exercice quotidien tant des ORL que des pédiatres et des
médecins généralistes.
OTITES À RÉPÉTITION
La première table ronde, modérée par J.M. Triglia (Marseille) et
E.N. Garabédian (Paris), avait pour thème les otites à répétition
chez l’enfant.
●En préambule, E. Berrard-Dessert (médecin généraliste, Poi-
tiers) a rappelé que l’otite moyenne aiguë est très fréquente chez
le nourrisson entre 6 et 24 mois et la première cause de pres-
cription d’antibiotiques dans cette classe d’âge. Dans son expé-
rience, le diagnostic est fait beaucoup plus tard que chez le grand
enfant ou l’adulte, après deux ou trois jours d’évolution, car les
parents ne s’inquiètent pas trop de la fièvre et ne repèrent pas
bien les manifestations de la douleur chez l’enfant. La conjonc-
tivite purulente est un signe d’appel fréquent, à tel point qu’elle
a écrit un protocole, qui est soumis aux parents lors de l’admis-
sion en crèche, stipulant qu’en cas de conjonctivite purulente les
puéricultrices commenceront le traitement par collyre, mais que,
le soir même, les parents devront montrer l’enfant à son méde-
cin, en particulier pour vérifier s’il n’a pas une otite moyenne
aiguë. Elle souligne aussi qu’un des problèmes majeurs des otites
moyennes aiguës répétées est le retentissement sur la vie fami-
liale et le nombre d’arrêts de travail pour enfant malade que cela
induit. Le contrôle des tympans au bout de 2-3 jours est difficile
à obtenir. En cas d’évolution non satisfaisante, elle préconise une
consultation spécialisée pour paracentèse et prélèvement bacté-
riologique. De même, si le tympan reste toujours anormal d’une
consultation à l’autre, elle conseille une consultation chez l’ORL,
qui jugera de l’opportunité d’un traitement plus agressif tel qu’une
adénoïdectomie, voire la pose d’aérateurs transtympaniques.
●S. Hounkanlin (pédiatre, Poitiers) a davantage parlé des otites
récidivantes et de la nécessité, dans ces cas, de calmer l’anxiété
des parents, très inquiets au sujet de l’avenir de l’enfant, en par-
ticulier sur le plan auditif, dans la mesure où l’évolution sera a
priori favorable. Outre la maîtrise des épisodes aigus récurrents,
il faut envisager, pour prévenir les récidives, des traitements adju-
vants (cf. infra), tout en sachant qu’un des problèmes qui se posera
sera la compliance à ces traitements.
●J.N. Margo, qui exerce l’oto-rhino-laryngologie depuis plus
de vingt ans dans le Cotentin, a remarqué qu’il y a eu une évo-
lution des traitements des otites moyennes aiguës de l’enfant. Il
a effectué de très nombreuses paracentèses entre 1981 et 1990.
Puis les paracentèses sont devenues rares au cours des années
1990-95. Depuis cette date, il en fait un peu plus, toujours dans
un but de documentation bactériologique. Les paracentèses ne
se font pas dans l’urgence, à n’importe quelle heure du jour et
de la nuit, mais après un arrêt de l’antibiothérapie pendant
24 heures au moins, dans le cadre de l’hôpital de jour de méde-
cine, après le réexamen de l’enfant par un pédiatre vérifiant que
la persistance des signes généraux n’est pas due à une patholo-
gie associée, en particulier pulmonaire ou urinaire. Il fait les
paracentèses sous inhalation d’un mélange équimolaire d’oxy-
gène et de protoxyde d’azote, après prémédication au Nubain®
Compte-rendu de l’AFOP
Spring meeting of the French Paediatric ENT Society
●
M. François*, E. Lescanne**
* Service ORL, hôpital Robert-Debré, 48, boulevard Sérurier, 75935 Paris
Cedex 19.
** Service ORL, hôpital Clocheville, 49, boulevard Béranger, 37000 Tours.
Mots-clés : Otites à répétition - Infections rhinosinusiennes à répétition - Amygdalectomie - Inflammation des voies aériennes -
Récepteurs épithéliaux - Aérateurs transtympaniques - Allergies - Test de diagnostic rapide.
Keywords: Recurrent acute otitis media - Recurrent rhinosinusitis - Tonsillectomy - URI - Epithelial receptors - Tympanostomy
tubes - Allergy - Streptococal test.
**ORL 283 18/06/03 16:26 Page 9

ACTUALITÉ
10
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no283 - mai 2003
ou à Hypnovel®. Sur les trois dernières années, il a pratiqué
182 paracentèses chez 125 enfants. Il a retrouvé 52 fois un pneu-
mocoque, qui était de sensibilité diminuée à la pénicilline dans
44 cas. Il a retrouvé aussi 41 Haemophilus influenzae, dont
19 étaient sécréteurs de bêtalactamases.
●M. Mondain a réactualisé, à partir des données de la littéra-
ture, les facteurs de risque des otites moyennes aiguës répétées.
En effet, les articles ont souvent des conclusions contradictoires,
tenant au fait qu’il y a des biais de recrutement dans les études
épidémiologiques et que les séries sont souvent trop petites. Parmi
les publications les plus récentes, il a sélectionné celle de
P. Homoe et al., qui a porté sur 18 % des enfants de deux villes
du Groenland, soit 740 enfants. L’ethnie, le nombre d’enfants
dans la fratrie, le type d’habitat, l’allaitement maternel ne sont
pas des facteurs prédictifs. Les facteurs prédictifs d’otites
moyennes aiguës répétées sont essentiellement les antécédents
familiaux et la crèche.
●J.M. Polonovski et P. Allouch (Versailles) ont présenté la bac-
tériologie de ces otites. En cas d’échec de traitement ou de rechute
précoce, le germe retrouvé est le même que celui qui était pré-
sent initialement, alors qu’en cas de réinfection ou d’otites
moyennes aiguës répétées, les germes peuvent être les mêmes ou
changer. Par ailleurs, en cas d’otites répétées, le risque de ren-
contrer un germe résistant (Haemophilus influenzae sécréteur de
bêtalactamases ou pneumocoque de sensibilité diminuée à la péni-
cilline) augmente beaucoup. L’antibiothérapie modifie la flore
rhinopharyngée, qui est colonisée par d’autres germes, avec
acquisition ou changement du niveau de résistance. Ce phéno-
mène est multifactoriel et dépend autant de l’immunité locale que
de l’immunité générale. Sur le plan personnel, ce n’est en géné-
ral pas grave car, après arrêt de l’antibiothérapie, il y a recoloni-
sation rapide du rhinopharynx par les germes commensaux habi-
tuels. Mais il en est autrement sur le plan collectif, car ces
antibiothérapies répétées favorisent la transmission de germes de
portage résistants.
●Selon J.P. Fontanel (Poitiers), les examens complémentaires
devant des otites moyennes aiguës répétées doivent être orientés
par la clinique et aussi simples que possible. Une carence mar-
tiale sera repérée sur la NFS et la ferritinémie. L’hypertrophie
des végétations adénoïdes est diagnostiquée au mieux par la fibro-
scopie nasopharyngée. L’adénoïdectomie selon Paradise (2002)
et Matila (2003) n’est pas intéressante dans ce contexte, sauf s’il
existe une obstruction nasale. Le reflux gastro-œsophagien peut
être responsable d’otites répétées et d’otites séromuqueuses. Il
sera objectivé par une pHmétrie. L’allergie doit être recherchée,
surtout en cas d’antécédents familiaux d’allergie ou d’asthme
associé. En revanche, les déficits immunitaires ne sont jamais
révélés par des otites moyennes aiguës isolées, et le dosage des
IgG totales est inutile.
Les traitements chirurgicaux ne sont envisagés qu’avec prudence.
L’adénoïdectomie, selon R.Nicollas, est proposée en cas d’échec
des traitements médicaux, quand le caractère récidivant est mal
toléré sur le plan familial. La pose d’aérateurs transtympaniques
permet de traiter le confinement de l’oreille moyenne, qui favo-
rise la répétition des épisodes aigus. Mais le risque chez le nour-
risson est la survenue d’otorrhées répétées (cf. infra).
INFECTIONS RHINOSINUSIENNES À RÉPÉTITION
La deuxième table ronde, modérée par J.M. Klossek (Poitiers) et
P. Dessi (Marseille), avait pour thème les infections rhinosinu-
siennes à répétition de l’enfant.
●En préambule, C. Berrard (médecin généraliste, Poitiers) et
B.Lamome(pédiatre, Poitiers) ont souligné les difficultés de dia-
gnostic de ces rhinosinusites répétées. La différence entre rhi-
nites, rhinopharyngites et rhinosinusites répétées leur semble
assez difficile, voire même spécieuse. L’anxiété parentale exa-
gère peut-être ce qui n’est que la “maladie d’adaptation”. Tous
deux insistent également sur le problème de la compliance pour
des recommandations d’hygiène (en particulier le mouchage) et
les traitements de fond au long cours.
●A. Brunaud (Les Ulis) abonde dans leur sens. Selon lui, étant
donné qu’il y a plus de 200 virus susceptibles de provoquer un
rhume risquant d’évoluer vers une rhinosinusite, le problème ini-
tial du praticien est de faire la part de ce qui est normal et de ce
qui est plus inquiétant. Parmi les causes favorisantes, il insiste sur
les causes générales telles que l’allergie, la déficience martiale, la
pollution (et en particulier le tabac). La socialisation précoce est
un facteur reconnu d’infections récidivantes, mais, d’un autre côté,
elle protégerait contre le risque d’allergie. Les déficits immuni-
taires sont rarement en cause et ne devraient être recherchés que
si l’enfant fait d’autres infections graves pleuropulmonaires ou
urinaires. L’ORL est bien outillé pour rechercher une cause locale.
Il faut en premier lieu éliminer un corps étranger nasal. L’endo-
scopie nasale permet de préciser le siège de l’obstruction ou de
visualiser le pus au niveau du méat moyen avant d’en faire un pré-
lèvement à visée bactériologique. Elle permet aussi de vérifier que
les végétations adénoïdes n’obstruent pas les choanes. En pour-
suivant la progression du nasofibroscope vers le bas, l’ORL peut
également voir le larynx et regarder s’il n’y a pas des signes indi-
rects de reflux gastro-œsophagien, plus particulièrement au niveau
de la margelle postérieure et de la face laryngée de l’épiglotte.
L’endoscopie nasale permet aussi de faire le diagnostic de tumeur
endonasale, qui sera précisé par l’examen tomodensitométrique.
La mucoviscidose doit être suspectée devant des infections rhi-
nosinusiennes qui traînent, surtout si l’on retrouve du pyocyanique
sur le prélèvement endonasal ou si l’endoscopie montre des
polypes. Les maladies mucociliaires sont excessivement rares et
leur diagnostic est réservé aux services spécialisés (le test à la sac-
charine est pratiquement impossible à réaliser chez l’enfant).
●T. van den Abbeele a fait un bref rappel de la nosologie des infec-
tions des voies aériennes supérieures de l’enfant, qui ont fait l’objet
d’une conférence de consensus (essentiellement européenne, même
si des Américains y ont participé) à Bruxelles en 1996. C’est ainsi
que l’on ne doit plus parler de sinusite, mais de rhinosinusite, car
les infections sinusiennes existent rarement sans composante nasale
chez l’enfant. Elles surviennent essentiellement chez les enfants
de plus de 10 à 12 ans. Il ne faut pas les confondre avec les rhino-
pharyngites, d’origine virale, survenant essentiellement avant
6 ans, et qui guérissent spontanément en une semaine.
●Il n’y a pas de liste type d’examens complémentaires dans les
rhinosinusites aiguës répétées de l’enfant (P. Froehlich, Lyon).
Les examens sont orientés par les données recueillies à l’interro-
**ORL 283 18/06/03 16:26 Page 10

11
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no283 - mai 2003
gatoire et les résultats de la fibroscopie endonasale. C’est ainsi
que la découverte d’un polype isolé, évocateur d’un polype de
Killian, conduit à la réalisation d’un examen tomodensitométrique,
alors que la découverte de plusieurs polypes impose de faire pra-
tiquer un test de la sueur, qui sera suivi, en cas de positivité, d’une
consultation en service spécialisé. Si le symptôme prédominant
est l’obstruction nasale, il faut faire une enquête sur l’environne-
ment de l’enfant (cf. infra), rechercher une hyperréactivité bron-
chique et faire pratiquer des tests allergologiques. Si l’enfant est
polysymptomatique avec, en plus de l’obstruction nasale, une rhi-
norrhée, des céphalées, etc., il faut rechercher une hyperréactivité
bronchique et faire pratiquer des tests allergologiques, mais aussi
penser à la responsabilité éventuelle d’un reflux gastro-œsopha-
gien (pHmétrie) ou d’un déficit immunitaire. L’examen tomo-
densitométrique a des indications limitées dans cette pathologie ;
il ne doit être demandé que si l’on envisage un geste chirurgical,
en cas d’échec des traitements médicaux. Pour P. Dessi comme
pour T. van den Abbeele, un scanner normalisé après traitement
médical est pratiquement une contre-indication à un traitement
chirurgical dans le cadre des rhinosinusites répétées.
●La bactériologie des rhinosinusites répétées de l’enfant est mal
connue. Il ne faut pas oublier que les fosses nasales et le rhino-
pharynx abritent une flore commensale. Les seuls prélèvements
interprétables sont ceux faits par ponction de sinus (mais ils ne
sont jamais effectués, car il faudrait une anesthésie générale) ou
des prélèvements protégés au niveau du méat moyen. D’après les
données dont nous disposons, trois germes prédominent : Strep-
tococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae et Moraxella
catarrhalis. La fréquence des germes résistants (Haemophilus
sécréteurs de bêtalactamases et pneumocoques de sensibilité
diminuée à la pénicilline) augmente pendant l’hiver. Certains
germes sont plus fréquents dans certaines pathologies (tableauI).
●Le traitement médical des rhinosinusites répétées a été abordé
par R. Marianowski. Pour le traitement antibiotique, nous ren-
voyons le lecteur aux recommandations de l’AFSSAPS de 2001.
Qu’il suffise de dire que les AMM et les recommandations nous
donnent le choix entre l’association amoxicilline-acide clavula-
nique, le cefpodoxime, qui est une céphalosporine orale de troi-
sième génération, et la pristinamycine, et que le traitement doit
durer de 10 à 15 jours. L’auteur recommande une cure courte de
corticoïdes per os de 1 mg/kg/j d’équivalent prednisone. Il ne faut
pas négliger les traitements associés, en particulier le mouchage,
le lavage des fosses nasales au sérum salé iso- ou hypertonique.
En cas d’allergie, il faut prescrire des antihistaminiques locaux ou
généraux et, en cas de reflux gastro-œsophagien, le traitement
devra comporter un antisécrétoire. Le traitement de fond com-
prend la correction d’une carence martiale, l’arrêt du tabagisme
passif, l’éviction temporaire de la crèche, les immunomodulateurs.
●Pour terminer, E. Serrano et J. Percodani ont fait le point sur
le traitement chirurgical des rhinosinusites répétées de l’enfant.
Le Caldwell-Luc et la méatotomie inférieure sont abandonnés.
Le drainage des sinus n’est pas validé. Il reste la méatotomie
moyenne et l’ethmoïdectomie endonasale. Il faut bien poser les
indications de cette dernière du fait des risques de complications.
AMYGDALECTOMIE
F. Denoyelle et B. Baujat ont présenté les résultats d’une enquête
nationale auprès des ORL sur l’amygdalectomie en France. Cette
présentation a été commentée et complétée par Y.Manac’h (Paris)
et D. Boudigues (anesthésiste, Poitiers).
L’enquête a été effectuée par la Société française d’ORL et de
chirurgie de la face et du cou à la suite de la demande de la Société
française d’anesthésie-réanimation de participer à une conférence
de consensus sur l’anesthésie dans l’amygdalectomie. En sep-
tembre 2002, les 1 900 adhérents de la Société française d’ORL
et de chirurgie de la face et du cou ont reçu ce questionnaire écrit
qui comportait, sur une seule page, des questions fermées et
ouvertes sur la pratique de l’amygdalectomie. Trente pour cent
des questionnaires ont été retournés, ce qui est beaucoup si l’on
considère que tous les ORL ne pratiquent pas d’amygdalectomie.
La moyenne d’âge des opérateurs était de 48 ans, 55 % étaient
des libéraux, 20 % des hospitaliers et 25 % avaient un exercice
mixte libéral et hospitalier. Tous ensemble, ils pratiquent près
des deux tiers des amygdalectomies pratiquées en France, d’après
les données du PMSI 2000. Soixante-quatorze pour cent des
amygdalectomies sont faites par dissection sous intubation et
26 % au Sluder, dont 18 % non intubées et 8 % sous intubation.
Toutes techniques confondues, 27 % des ORL pratiquent des
amygdalectomies en ambulatoire. Les complications déclarées
semblent plus fréquentes lors d’amygdalectomies par dissection
que lors d’amygdalectomies au Sluder sans intubation
(tableau II). Mais, comme l’ont fait remarquer Y. Manac’h et
D. Boudigues, cela demanderait à être précisé, car il n’y a aucune
commune mesure entre un laryngospasme sans suite au réveil et
une inondation des voies aériennes inférieures par un saignement
Tableau I. Germes retrouvés fréquemment dans les prélèvements au
méat moyen dans certaines pathologies particulières.
Asthme Chlamydiae, mycoplasmes
Mucoviscidose Pseudomonas, Haemophilus influenzae,
staphylocoque
Thalassémie Klebsiella
Drépanocytose Streptococcus pneumoniae
Ventilation artificielle Pyocyanique, staphylocoque, entérobactéries
Handicap neurologique Entérobactéries, anaérobies
Dyskinésie ciliaire Pyocyanique, Haemophilus influenzae
Tableau II. Taux de complications déclarées dans l’enquête sur
l’amygdalectomie, en fonction de la technique opératoire utilisée.
Type Dissection Sluder Sluder
de avec avec sans
complication intubation intubation intubation
Hémorragique 1 % 0,5 % 0,4 %
Anesthésique 0,05 % 0,01 % 0,03 %
**ORL 283 18/06/03 16:26 Page 11

ACTUALITÉ
12
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no283 - mai 2003
brutal. Pour D. Boudigues, il est du devoir de l’anesthésiste d’uti-
liser une technique lui permettant de protéger les voies aériennes.
J.J. Valenza (Nantes) et D. Boudigues signalent une complica-
tion très grave et trop peu connue des ORL : l’encéphalopathie
hyponatrémique due à des volumes de perfusion trop importants
(cf. éditorial du Pr van den Abbeele dans le numéro 271 de mars
2002 de La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale).
VOIES AÉRIENNES ET RÉCEPTEURS ÉPITHÉLIAUX
P. Contencin (Paris), I. de Gaudemar (Paris) et H. Allain (Rennes)
ont présenté une mise au point sur les dernières découvertes
concernant l’inflammation des voies aériennes et les récepteurs
épithéliaux, découvertes offrant de nouvelles pistes pour la com-
préhension et donc le traitement des toux chroniques.
Le système nerveux autonome, mais peut-être aussi le système
nerveux central, jouent un rôle dans l’inflammation chronique.
Cela a été plus particulièrement étudié dans les toux chroniques.
Il n’existe pas un centre anatomique de la toux, mais un centre
fonctionnel, qui a des connexions corticales, ce qui explique
l’existence de toux volontaires, psychogène et hystérique. Le star-
ter de la toux est au niveau de l’épithélium, avec des récepteurs
à l’irritation chimique ou mécanique, situés essentiellement au
niveau du larynx et de la carène. Ceux-ci initient la toux et des
récepteurs-fibres C mécaniques, qui stimulent la synthèse locale
de médiateurs ayant pour effet final une inhibition de la toux.
L’infection virale, en provoquant une desquamation de l’épithé-
lium respiratoire, met à nu les terminaisons nerveuses et dimi-
nue la synthèse d’enzymes qui dégradent des neuromédiateurs
de type tachykinines, ce qui amplifie le réflexe tussigène. Il y a
aussi une boucle d’amplification du message au niveau central.
Et les récepteurs au glutamate, autre neuromédiateur, déclenchent
des potentiels à long terme avec un effet mémoire. Ainsi peut
s’expliquer un abaissement, chez certains patients, des seuils de
déclenchement de la toux et, au maximum, la persistance de la
toux alors que sa cause initiale a disparu.
L’après-midi a été consacré à des ateliers dont le principe
était de remplacer un exposé magistral par une interaction
avec le public à partir de cas concrets.
AÉRATEURS TRANSTYMPANIQUES : DU PROBLÈME
DE LEUR INDICATION AUX PROBLÈMES DE LEUR SUIVI
Les réactions de l’auditoire à propos des cas cliniques présentés
par M. François (Paris) et H. Girschig (Boulogne) ont fait appa-
raître des points de divergence, mais aussi des points consen-
suels. Par exemple, en ce qui concerne les examens complé-
mentaires comme l’audiométrie, voire, en cas de coopération
insuffisante de l’enfant, l’enregistrement des potentiels évoqués
auditifs, il est important de distinguer les examens qui permet-
tent de confirmer un diagnostic clinique otoscopique d’épanche-
ment rétrotympanique de ceux qui permettent d’apprécier la gêne
auditive. Contrairement à ce que croient beaucoup de parents,
l’impédancemétrie n’est pas un test d’audition, et une courbe
d’impédancemétrie plate ne permet pas de prédire la perte audi-
tive, qui peut être de 5 à 40 dB. Il est très important de vérifier
l’audition dans les suites d’une pose d’aérateur transtympanique
pour s’assurer que cette otite séreuse ne masquait pas une apla-
sie mineure ou une surdité de perception légère.
Tous les auditeurs se sont accordés pour recommander de prendre
des précautions lors des shampooings et de la toilette ; en parti-
culier, l’enfant ne doit pas immerger sa tête dans l’eau du bain.
Toutefois, avec un aérateur long, de type T-tube, il n’y a pas de
contre-indication pour la natation et les sports nautiques à la mer.
L’étude française multicentrique de François et al., en 1992, avait
du reste montré que, paradoxalement, les enfants qui avaient le
plus d’otorrhées sur aérateur transtympanique étaient ceux qui se
baignaient le moins (tableau III).
En cas d’otorrhée sur aérateur transtympanique, le traitement,
si l’otorrhée est survenue plus de 15 jours après la pose de l’aéra-
teur, et s’il ne s’agit pas d’un nourrisson, est fondé sur les gouttes
auriculaires. Le type de gouttes, la posologie et la durée du trai-
tement ont été récemment réévalués par la Société française
d’ORL et de chirurgie de la face et du cou et ont fait l’objet d’une
publication, au moins en ce qui concerne le texte court, dans le
numéro de février 2002 de Consulter en médecine générale
(pages 33 et 34).
Il faut être très prudent dans les indications de pose d’aérateur
transtympanique chez les enfants de moins de 12 à 18 mois, car
ils le tolèrent mal, avec un risque notablement plus élevé d’otor-
rhée que chez les enfants plus âgés. En outre, plus la première
pose d’aérateur a été précoce, plus il y a un risque de pose itéra-
tive, donc de perforation séquellaire.
INFECTIONS À RÉPÉTITION ET ALLERGIE EN PRATIQUE
J. Dubin (Angers) a exposé les problèmes que se posent les ORL
concernant les allergies rhinosinusiennes chez l’enfant, en parti-
culier les points clés de l’interrogatoire, la place des examens
complémentaires et la stratégie thérapeutique. K. Breuil (pneumo-
allergologue, Poitiers) y a répondu de manière très vivante, à par-
tir d’un cas clinique.
●L’interrogatoire est fondamental en allergologie et doit bien
entrer dans les détails, de manière à s’assurer qu’il n’y a pas de
malentendu sur les termes employés. Les antécédents familiaux
doivent rechercher la notion d’eczéma, d’asthme, de choc ana-
phylactique. Mais les circonstances d’apparition de ces derniers
Tableau III. Pourcentage d’enfants ayant eu une otorrhée sur aéra-
teur transtympanique en fonction du nombre de bains en mer ou en
piscine au cours des 3 mois d’été (François et al. Ann Ped 1992).
Otorrhée (%)
Pas de bain 31
1 à 5 bains 33
6 à 20 bains 12
Plus de 20 bains 6,7
**ORL 283 18/06/03 16:26 Page 12

13
La Lettre d’Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale - no283 - mai 2003
doivent être précisées car, par exemple, en ce qui concerne les
venins d’hyménoptères, il y a autant de chocs chez les allergiques
que chez les non-allergiques. Dans les antécédents personnels, il
faut rechercher la notion d’eczéma, à différencier d’un Leiner-
Moussous, d’asthme, mais aussi de bronchiolite, et d’intolérance
aux protéines du lait de vache. En ce qui concerne l’environne-
ment, il faut faire préciser le type de literie, s’il y a une moquette,
des rideaux, si la maison est humide ou non. Une socialisation
précoce protégerait contre l’allergie ; cela demande à être véri-
fié sur une plus grande échelle. En attendant, il faut s’enquérir
de la présence d’animaux à l’école. En ce qui concerne l’ali-
mentation, la tendance est actuellement à diversifier (c’est-à-dire
donner autre chose que du lait) de plus en plus tard, une diversi-
fication trop précoce pouvant être source d’allergies alimentaires.
Les vaccins sont également remis en cause. Ils sont actuellement
soupçonnés de faciliter les maladies allergiques par déséquilibre
de la balance lymphocytaire.
●Les examens complémentaires ne doivent être prescrits qu’à
bon escient. L’éosinophilie sanguine, par exemple, n’est pas un
bon repère, car elle n’est ni sensible ni spécifique. Le dosage
des IgE totales peut aussi être trompeur, leur taux s’élevant après
les infections virales. Il n’en reste pas moins que le dosage des
IgE totales est un élément pronostique en cas d’eczéma impor-
tant : si le taux est extrêmement élevé (supérieur à 1 000), le
pronostic n’est pas aussi bon que si le taux des IgE totales est
bas. Les tests sanguins de débrouillage type Phadiatop®sont
peu recommandés par les allergologues, car il y a des faux néga-
tifs. La référence reste les tests cutanés. Ceux-ci sont réalisables
à tout âge si la peau est réactive, ce dont on s’assure par un
témoin négatif (au sérum physiologique) et un témoin positif
(à l’histamine ou à la codéine). Il faut arrêter les corticoïdes
locaux au moins 8 jours avant les tests, les antihistaminiques
par voie orale 2 à 3 jours avant (mais 6 semaines avant pour
Zaditen®). Les corticoïdes oraux ou inhalés ne perturbent pas
la pratique des tests cutanés. Les allergènes testés sont fonction
des données de l’interrogatoire.
●Le traitement comporte trois volets : l’éviction de l’allergène,
les antihistaminiques et la désensibilisation. En ce qui concerne
l’allergie aux acariens, les conseils d’éviction se sont simplifiés
par rapport à ce que l’on préconisait il y a une dizaine d’années.
L’attention doit se focaliser sur la chambre, avec ménage régulier,
aération et, surtout, housse de matelas anti-acariens, couette et
oreiller synthétiques. La désensibilisation ne doit être entreprise
que si les symptômes de l’allergie nasosinusienne sont atténués,
en pratique par des antihistaminiques. La désensibilisation par voie
orale ne se conçoit que chez des patients très motivés qui devront
prendre les gouttes prescrites tous les jours, sans se tromper dans
les doses ou les flacons. La désensibilisation injectable est confiée
au médecin généraliste, qui fera une injection sous-cutanée par
semaine (les infirmières ne sont plus habilitées à faire les injec-
tions de désensibilisation). Le traitement adjuvant est progressi-
vement arrêté. La posologie des antihistaminiques est en général
diminuée dès la fin du deuxième mois. Il faut réévaluer le patient
cliniquement au bout des 3 à 4 premiers mois avant de prendre la
décision de poursuivre ou non le traitement de désensibilisation
spécifique. La durée du traitement est d’environ trois ans.
ANGINES : TEST DE DIAGNOSTIC
RAPIDE ET ANTIBIOTHÉRAPIE
(E. Lescanne, Poitiers)
Avec 9 millions de consultations chaque année, l’angine repré-
sente l’une des affections les plus courantes en France. D’origine
virale dans 60 à 90 % des cas, elle peut aussi correspondre à une
angine à streptocoque bêtahémolytique du groupe A (SGA). Ce
germe est le seul pathogène responsable d’angine pour lequel le
bénéfice d’une antibiothérapie est démontré (hormis des formes
exceptionnelles à Corynebacterium diphtheriae, Neisseria gonor-
rhoeae et fusospirilles). L’antibiothérapie vise quatre objectifs
validés qui sont la prévention des complications non suppura-
tives (RAA principalement), la régression plus rapide des symp-
tômes, la prévention des complications suppurées locorégionales
et la réduction de la transmission à l’entourage. L’absence de
possibilité d’identification de l’agent causal en consultation sur
la seule clinique a justifié le traitement de toutes les angines par
une antibiothérapie efficace sur le SGA. La conséquence évaluée
en 1999 est, de fait, une surconsommation d’antibiotiques en
France. Ses répercussions sont à la fois écologiques (résistances
bactériennes accrues) et économiques (8,4 millions d’ordon-
nances d’antibiotiques pour seulement 4,5 millions de prescrip-
tions justifiées).
Dès lors, la préoccupation des différentes conférences de consen-
sus et réunions d’experts a été de définir les critères en faveur
d’une angine streptococcique au moment du diagnostic. De nom-
breux algorithmes tenant compte de signes ou de scores cliniques
ont été proposés pour orienter la stratégie thérapeutique afin d’évi-
ter l’attente de 24 à 48 heures nécessaire pour la culture d’un pré-
lèvement de gorge. La validité de ces algorithmes a été diverse-
ment appréciée et n’a pas été retenue en France comme un moyen
d’éviter le recours aux antibiotiques.
La recherche d’antigènes de paroi spécifiques du SGA, acces-
sible grâce au test de diagnostic rapide (TDR) qui décèle le SGA
en quelques minutes, au cabinet ou en visite, a été retenue et
recommandée dès 1996. Depuis l’hiver 2002, sa diffusion gra-
tuite par la CNAM aux médecins généralistes constitue l’inno-
vation dans l’angine. Cette diffusion fait suite à une période
d’éducation et de contrôle des bonnes pratiques, validée par
l’expérience en Bourgogne de médecins formés au TDR. Com-
mencée en novembre 1999, cette campagne s’est achevée en juin
2002. Son analyse a ensuite porté sur les résultats de question-
naires reçus lors de quatre périodes d’évaluation de 15 jours répar-
ties au cours d’une année (janvier 2000, mars 2000, juin 2000,
janvier 2001). Durant 20 mois, 732 médecins, soit près de 50 %
des médecins bourguignons concernés par l’utilisation du TDR,
ont participé à la campagne Test’Angine. Sur 3 915 question-
naires médecins reçus, le test était positif dans 27 % des cas et
un antibiotique n’était prescrit que dans 47 % des cas. Parmi les
3 347 patients (ou parents) interrogés, 87 % ont répondu au ques-
tionnaire d’évaluation post-test. Les résultats ont montré que
97 % avaient bien toléré le test, 97 % acceptaient de renouveler
le TDR en cas de future angine et 77 % avaient compris la fina-
lité du test. Finalement, le test, réalisé dans 98 % des cas, a per-
mis de réduire à 41 % le taux de prescription d’antibiotique en
cas d’angine. En pratique, ce prélèvement de gorge est classique,
**ORL 283 18/06/03 16:26 Page 13
 6
6
1
/
6
100%