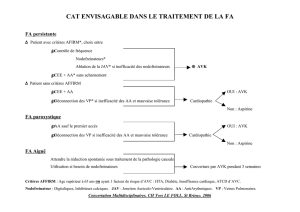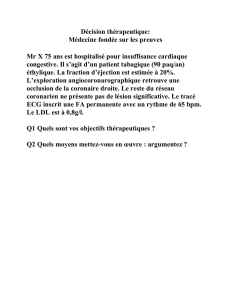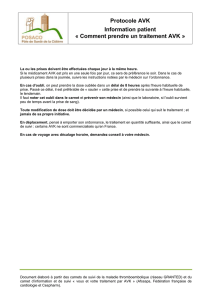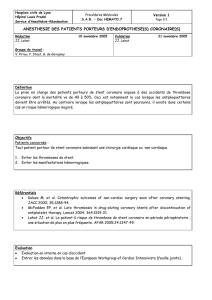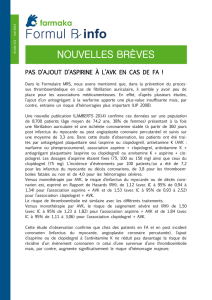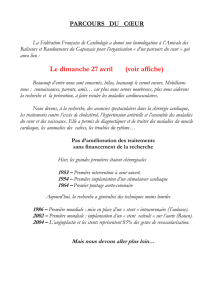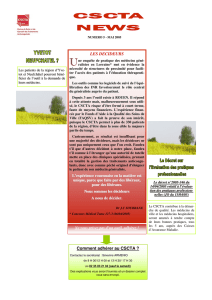Nous de faisons

éditorial
éditorial
Directeur de la publication
Claudie Damour-Terrasson
Rédacteur en chef
M. Komajda
Rédacteur en chef adjoint
C. Bauters
Rédactrice en chef adjointe (congrès)
N. Baubion
Comité de rédaction
C. Adams - M.C. Aumont - J.P. Batisse
N. Danchin - B. Gallet - X. Girerd
G. Helft - P. Jauffrion - S. Kownator - C. Leclercq
C. Le Feuvre - J.P. Metzger - D. Thomas
Conseiller scientifique : Pr A. Vacheron
Conseil de rédaction
É. Bruckert - J.P. Charliaguet - A. Cohen-Solal
F. Delahaye - P. Gibelin - T. Lavergne
G. Montalescot - R. Roudaut - C. Sebag
Comité de lecture
Prs J.P. Bassand (Besançon) - M. Bertrand (Lille)
M. Bory (Marseille) - M. Brochier (Tours) - J.C. Daubert (Rennes)
J. Delaye (Lyon) - Y. Grosgogeat (Paris)
L. Guize (Paris) - P.G. Hugenholtz (Oosterbeek - Pays-Bas)
H. Kulbertus (Liège) - R. Leighton (Savannah - États-Unis)
J. Lekieffre (Lille) - S. Levy (Marseille) - A. Maseri (Londres)
G. Nicolas (Nantes) - M. Salvador (Toulouse)
Fondateur : Alexandre Blondeau
Société éditrice : EDIMARK SAS
Président-directeur général
Claudie Damour-Terrasson
Rédaction
Directeur délégué de la rédaction : Béatrice Hacquard-Siourd
Secrétaire générale de rédaction : Magali Pelleau
Rédactrices-réviseuses : Cécile Clerc, Sylvie Duverger,
Muriel Lejeune, Catherine Mathis, Odile Prébin
Infographie
Premier rédacteur graphiste : Didier Arnoult
Responsable technique : Virginie Malicot
Rédactrices graphistes : Mathilde Aimée,
Christine Brianchon, Cécile Chassériau, Catherine Rousset
Dessinateurs d'exécution : Stéphanie Dairain,
Antoine Palacio
Commercial
Directeur du développement commercial :
Sophia Huleux-Netchevitch
Directeur des ventes : Chantal Géribi
Directeur d’unité : Nathalie Bastide
Régie publicitaire et annonces professionnelles
Vincent Le Divenach
Tél. : 01 46 67 62 92 – Fax : 01 46 67 63 10
Abonnements
Lorraine Figuière - Tél. : 01 46 67 62 74
2, rue Sainte-Marie, 92418 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 46 67 62 00 - Fax : 01 46 67 63 10
E-mail : [email protected]
Site Internet : www.edimark.fr
Photos : © Russel Pearce, © Mikael Mazighi.
Ns s d s p ité s
r p it
Ns s d s p ité s
r p it
La Lettre du Cardiologue
3
La Lettre du Cardiologue - n° 401 - janvier 2007
Lors d’une angioplastie coronaire, dans plus de 90 % des cas, l’on pro-
cède à la mise en place d’un stent coronaire. En eff et, la faisabilité,
la sûreté de l’implantation du stent et les bons résultats à distance
expliquent l’expansion de la technique, permise par l’amélioration du maté-
riel et l’environnement antithrombotique. Plusieurs essais randomisés ont dé-
montré, il y a quelques années, la supériorité de l’association aspirine à dose
antiagrégante et thiénopyridine sur la monothérapie par aspirine et sur la
bithérapie aspirine-antivitamine K (AVK), dans la prévention de la thrombose
coronaire après mise en place d’un stent. En pratique, le clopidogrel a remplacé
la ticlopidine, responsable d’effets secondaires plus fréquents et graves. Les
recommandations actuelles des sociétés savantes sont de prescrire la bithé-
rapie aspirine-clopidogrel quatre semaines après la mise en place d’un stent
nu, et de 6 à 12 mois après celle d’un stent actif (l’aspirine doit être prescrite
à une dose inférieure ou égale ou 100 mg/j). Les cas récemment rapportés
concernant des thromboses tardives de stents actifs pourraient inciter à une
prescription prolongée de la bithérapie, mais le bénéfi ce de cette prescription
n’est pas démontré, car la bithérapie expose à un risque accru de un pour cent
par an d’hémorragies majeures par rapport à la monothérapie par aspirine.
D’autre part, le risque hémorragique des AVK en association avec deux agents
antiplaquettaires a été peu évalué dans la littérature (le risque hémorragique
pourrait approcher les 10 % à un mois).
Environ 5 % des patients bénéficiant de la mise en place d’un stent coronaire
sont sous anticoagulants au long cours (AVK), généralement en raison d’une
fibrillation auriculaire, d’une valve mécanique ou d’antécédents thrombo-
emboliques veineux. Se pose chez ces patients la question du traitement
antithrombotique optimal lors de la mise en place d’un stent. En effet, le risque
hémorragique est majoré dans le cas de la prescription d’une “trithérapie”
antithrombotique associant AVK, aspirine et clopidogrel. Faut-il prescrire la
bithérapie aspirine et clopidogrel en plus des AVK, et pendant combien de
temps ? Les données tirées de l’evidence based medicine (EBM), la médecine
fondée sur des preuves, sont très pauvres en ce domaine, et les pratiques sont
en conséquence très diverses dans la prise en charge de ces patients.
Quel traitement antithrombotique
après la mise en place d’un stent
coronaire chez un patient
sous antivitamine K ?
Antithrombotic therapy after PCI in patients
receiving anticoagulant therapy
IPG. Helft*
* Institut de cardiologie, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris.

éditorial
éditorial
4
L’évaluation du rapport bénéfi ce/risque est nécessaire dans le
cas de la prescription d’un traitement antithrombotique triple
“aspirine à petites doses, clopidogrel, AVK”.
La Lettre du Cardiologue - n° 401 - janvier 2007
Essayons d’apporter quelques éléments de réflexion qui
permettent d’éclairer une situation difficile. Tout d’abord, il
est utile de réévaluer la nécessité d’une anticoagulation au
long cours. Il existe des cas, notamment dans le domaine de
la maladie thromboembolique veineuse, où l’indication du
traitement par AVK doit être remise en question, par exemple
après un premier épisode thromboembolique idiopathique
pour lequel un traitement éventuellement prescrit au long
cours pourrait être interrompu, la durée du traitement
préconisée étant de 6 à 12 mois. Ensuite, il convient,
dans chaque cas, d’essayer d’évaluer individuellement le
rapport bénéfice/risque de la trithérapie par rapport à une
prescription “allégée”. Par exemple, en cas de fibrillation
auriculaire, on pourra s’aider du score de CHADS 2, le
risque annuel d’accident vasculaire cérébral variant de
moins de 2 % pour un score de 0 à plus de 15 % pour un
score de 6. L’indication du maintien absolu des AVK varie
en fonction du score. On se rappellera également que les
AVK sont supérieurs à l’association aspirine-clopidogrel en
cas de fibrillation auriculaire (étude ACTIVE, dans laquelle le
score de CHADS 2 moyen était égal à 2). En cas de prothèse
valvulaire mécanique, il est formellement déconseillé
d’arrêter le traitement par AVK au profit de la bithérapie
aspirine-clopidogrel.
Le risque hémorragique devra également être soigneusement
apprécié. L’âge, des antécédents d’accident vasculaire
cérébral, de saignement digestif, ou l’insuffisance rénale
sont autant de facteurs de risque de saignements. Les
facteurs prédictifs de thrombose de stent sont, quant à eux,
l’insuffisance rénale, les lésions de bifurcation, le diabète, une
fraction d’éjection ventriculaire basse et un arrêt prématuré
du traitement antiplaquettaire.
Sur le plan pratique, la réalisation de l’angioplastie par voie
radiale semble très intéressante. En effet, elle permet d’éviter
l’arrêt des AVK plus facilement que par voie fémorale, et
elle diminue également les complications hémorragiques au
point de ponction ; les relais AVK-héparine sont, de leur côté,
grevés d’un pourcentage non nul d’accidents thrombotiques
ou hémorragiques. D’autre part, la mise en place d’un stent
nu semble préférable sur le plan du risque hémorragique. En
effet, la durée de la trithérapie n’excède jamais un mois dans
ce cas, alors qu’en cas de mise en place d’un stent actif elle est
quelquefois prescrite plus longtemps. Avec un stent actif, on peut
être tenté de prolonger quelques mois l’association aspirine-
clopidogrel en plus des AVK, en se disant qu’on préviendra
mieux la thrombose de stent tant redoutée. On ne sait pas si
en cas de coprescription des AVK le maintien de la bithérapie
antiplaquettaire est nécessaire. L’alternative consistant à
arrêter un antiagrégant plaquettaire (plutôt le clopidogrel,
compte tenu des résultats favorables connus de l’association
aspirine-AVK dans un certain nombre d’indications) à la fin
du premier mois semble possible pour certains.
Dans le cas de l’interruption des AVK pour la réalisation de
l’angioplastie, se pose aussi la question de leur reprise rapide
ou du relais par héparine de bas poids moléculaire (HBPM).
Les AVK ont l’avantage de la prise orale et l’inconvénient
de leur durée d’action prolongée en cas de saignement ; les
HBPM ont l’avantage de leur maniabilité et l’inconvénient
de deux injections sous-cutanées par jour pendant plusieurs
semaines éventuellement.
Sous AVK, s’il y a coprescription d’aspirine et de clopidogrel,
il convient d’informer le patient du risque hémorragique
majoré sous trithérapie. Il convient également de renforcer
la fréquence de la surveillance par l’INR (International
Normalized Ratio). Il faut bien entendu impérativement
éviter la coprescription d’une molécule pouvant augmenter
l’INR. Il paraît logique aussi de viser la zone basse de la
fourchette d’INR ciblée.
En conclusion, il faut être conscient du risque hémorragique
majoré par une trithérapie antithrombotique souvent
indispensable (AVK, aspirine à petites doses, clopidogrel)
chez les patients nécessitant un traitement par AVK et
bénéficiant de la mise en place d’un stent coronaire. La voie
radiale semble offrir l’avantage d’une non-interruption plus
aisée des AVK. La durée de la trithérapie ne doit pas dépasser
un mois pour un stent nu ; les données sont un peu plus
incertaines pour les stents actifs. L’information du patient
et la surveillance renforcée de l’INR devraient permettre de
diminuer les complications hémorragiques inhérentes à cette
trithérapie antithrombotique. ■
1
/
2
100%