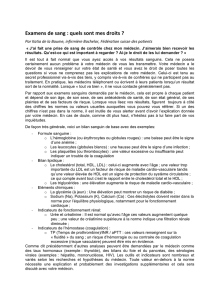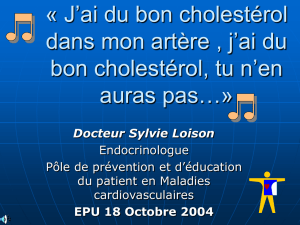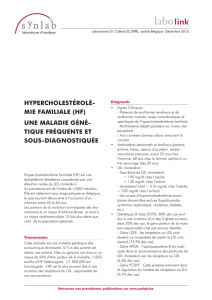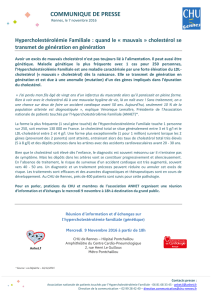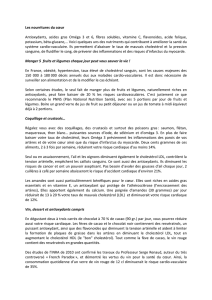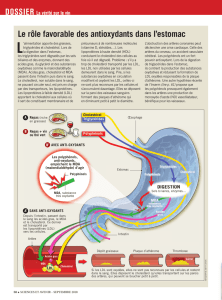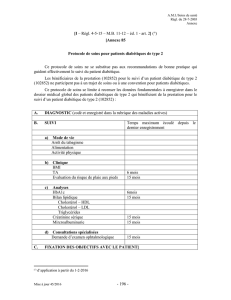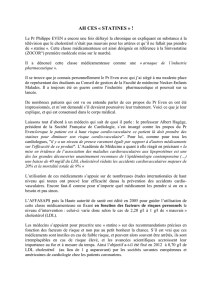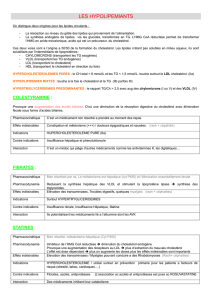L’hypercholestérolémie en pratique Hypercholesterolemia in real life m

51
Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2006
L’hypercholestérolémie
en pratique
Hypercholesterolemia in real life
■
■
J.M. Lecerf*
mise au point
* Service de médecine interne,
CHRU de Lille, service de nutrition,
Institut Pasteur de Lille.
L
e traitement de l’hypercholestérolémie se
simplifie-t-il ou se complique-t-il ? La
suprématie des statines pourrait faire croire
à la première hypothèse, les recommandations
successives de l’ANAES et de l’AFSSAPS pour-
raient laisser entendre que la deuxième l’emporte.
En tout cas, ce traitement est de plus en plus
efficace et codifié ; l’hypercholestérolémie ne se
traite pas au hasard.
L
ES PRÉALABLES
Comme pour toute pathologie, il ne faut absolu-
ment pas faire l’impasse sur un bon diagnostic
et une évaluation précise des causes et consé-
quences.
L’hypercholestérolémie peut être soit isolée,
soit mixte, c’est-à-dire associée à une hypertri-
glycéridémie. On exclura l’hypertriglycéridémie
isolée. On parle d’hypercholestérolémie isolée
pour des valeurs de cholestérol total supé-
rieures à 2 g/l, les triglycérides étant en perma-
nence normaux (<2 g/l). La mesure associée du
cholestérol HDL permet de déduire le cholesté-
rol LDL par la formule de Friedewald (cholestérol
LDL = cholestérol total – [cholestérol HDL + tri-
glycérides]) (en g/l) ou dosé directement
lorsque le taux de triglycéride est trop élevé
(>4 g/l), car la formule de Friedewald n’est alors
plus adaptée.
Dans l’hyperlipidémie mixte, le cholestérol et
les triglycérides sont élevés de façon associée
mais pas toujours simultanée, le bilan étant
effectué alors que le patient est à jeun depuis
12 heures.
Le bilan étiologique permet d’éliminer bien sûr
une cause secondaire, et en particulier une
hypothyroïdie, cause la plus fréquente, par un
dosage de la thyréostimuline ultrasensible
(TSH us). L’enquête familiale permet de détecter
une hypercholestérolémie familiale hétérozygote.
Celle-ci peut se confirmer sur le caractère héré-
ditaire de l’affection et sur un niveau de choles-
térol total le plus souvent compris entre 3 et
5 g/l, éléments associés ou non à des xan-
thomes tendineux ou à un xanthélasma. Dans
ces cas, la recherche d’une dyslipidémie doit
être réalisée systématiquement dans la descen-
dance (à partir de l’âge de 6 ans).
■
■La prise en charge d’une hypercholestérolémie est bien codifiée.
■
■Elle répond à des objectifs précis en fonction des facteurs de risque.
■
■Elle passe en priorité par un changement du mode de vie et/ou une perte de poids
si nécessaire.
■
■Les médicaments hypolipémiants font une large place aux statines, mais de nouvelles
molécules se font également une place (ézétimibe, acide nicotinique).
■
■Les associations ont une place de plus en plus grande dans les modalités théra-
peutiques.
... Points forts ...
... Points forts ...
Mots-clés : Hypercholestérolémie -
Cholestérol LDL - Statines - Régime
hypolipémiant.
Keywords: Hypercholesterolemia -
LDL-cholesterol - Statin - Hypolipidic
diet.

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2006
52
mise au point
L’évaluation des facteurs de risque est une
étape fondamentale pour la détermination du
niveau des objectifs thérapeutiques (tableau I).
Outre l’interrogatoire, cela nécessite la réalisa-
tion d’une glycémie à jeun et, selon les cas, une
exploration cardiovasculaire. Il est bien sûr utile
de calculer l’indice de masse corporelle et de
mesurer le tour de taille.
Enfin, une enquête alimentaire est indispen-
sable tant pour apprécier le rôle éventuel de
l’alimentation dans cette dyslipidémie que pour
connaître les habitudes du patient afin d’établir
une prescription.
D’autres mesures et examens tels que
protéine C réactive (CRP) ultrasensible, lipopro-
téine (a) [Lp (a)], homocystéïnémie, épreuve
d’effort ou imagerie carotidienne ne sont pas
justifiés à titre systématique.
L
ES MOYENS
Les moyens thérapeutiques reposent sur la
nutrition d’une part et les médicaments d’autre
part.
Rôles de la nutrition
●La perte de poids : une diététique modéré-
ment restrictive et une activité physique accrue
sont incontournables pour une perte de poids
souvent primordiale, en cas de surcharge pon-
dérale ou d’obésité, au cours d’une dyslipidémie
mixte, avec ou sans syndrome métabolique. Il
peut être nécessaire d’avoir recours à des médi-
cations antiobésité spécifiques (orlistat, sibutra-
mine, rimonabant) qui peuvent améliorer, de
façon indirecte essentiellement, le profil lipi-
dique.
● La nutrition a également un rôle crucial dans la
prévention cardiovasculaire. L’efficacité de la
nutrition a été formellement démontrée en pré-
vention secondaire. Celle-ci doit comporter un
accroissement des nutriments protecteurs via la
consommation de fruits et légumes, de poisson
et de produits de la pêche, de céréales com-
plètes et de légumes secs, de margarines et
d’huiles riches en acides gras oméga 3.
● La diététique est également susceptible de
contribuer à la baisse du cholestérol LDL. La
substitution partielle des acides gras saturés
par les acides gras polyinsaturés (oméga 6) et
mono-insaturés (oméga 9) peut faire baisser le
cholestérol LDL de 7 à 15 % ; la consommation
de fibres alimentaires – pectine (pomme), hemi-
cellulose (pain complet), ß-glucane (avoine),
etc. –, a également un effet hypocholestérolé-
miant. Les protéines de soja à plus de 25 g/j par
jour font significativement baisser le cholestérol
LDL. Enfin, les phytostérols et phytostanols,
ainsi que les policosanols, présents dans des
aliments et/ou apportés sous forme de complé-
ments alimentaires, sont des substances natu-
relles à effet hypocholestérolémiant bien
démontré.
La diététique doit être prescrite dans tous les
cas, en première intention et en permanence.
Médicaments hypolipémiants
Sont ici décrits les médicaments hypolipémiants
actuellement disponibles en France.
●Les statines ont révolutionné le traitement de
l’hypercholestérolémie. On dispose aujourd’hui,
dans un ordre de puissance croissant – à dose
égale – de la fluvastatine, de la pravastatine, de
la simvastatine, de l’atorvastatine et de la rosu-
vastatine. Une dose de 20 mg permet d’obtenir
une baisse du cholestérol LDL de 25 à 55 %. Le
doublement de dose pour chaque statine entraîne
une baisse supplémentaire d’environ 6 % du
Tableau I. Facteurs de risque cardiovasculaire devant être pris en compte pour le choix de l’objectif théra-
peutique selon les valeurs du cholestérol LDL.
Facteurs de risque
Âge– homme de 50 ans ou plus
– femme de 60 ans ou plus
Antécédents familiaux de maladie coronaire précoce
– infarctus du myocarde ou mort subite avant 55 ans chez le père ou chez un parent
au 1
er
degré de sexe masculin
– infarctus du myocarde ou mort subite avant 65 ans chez la mère ou chez un parent
au 1
er
degré de sexe féminin
Tabagisme actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans
Hypertension artérielle permanente traitée ou non
(se reporter aux recommandations spécifiques)
Cholestérol HDL <0,40 g/l (1,0 mmol/l) quel que soit le sexe
Facteur protecteur
Cholestérol HDL ≥ 0,60 g/l (1,5 mmol/l) : soustraire alors “un risque” au score de niveau
de risque

53
Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2006
cholestérol LDL. Fluvastatine, simvastatine et
atorvastatine peuvent être prescrites jusqu’à
une dose de 80 mg/j. La baisse des triglycérides
est modeste, quoique plus nette pour les deux
dernières venues, et l’évolution du cholestérol
HDL est variable et modeste.
●Les fibrates gardent une place, avec le fénofi-
brate, le ciprofibrate, le bézafibrate et le gemfi-
brozil, les deux premiers ayant un effet à la fois
hypocholestérolémiant (20 à 30 %) et hypotri-
glycéridémiant, et les deux derniers un effet sur-
tout hypotriglycéridémiant.
●L’ézétimibe est le nouveau venu dans le
monde des hypolipémiants. Ce premier inhibi-
teur de l’absorption du cholestérol intestinal ali-
mentaire et biliaire entraîne une baisse supplé-
mentaire du cholestérol LDL de 20 % en associa-
tion avec les statines.
●La cholestyramine est une résine qui augmente
l’élimination des acides biliaires. Elle est de
moins en moins utilisée, car difficile à associer
avec d’autres traitements médicamenteux et pas
toujours très bien tolérée sur le plan digestif.
●L’acide nicotinique vient d’être mis sur le mar-
ché. Il a un double effet, à la fois hypotriglycéri-
démiant et d’élévation du cholestérol HDL. Son
utilisation est limitée par l’apparition de bouf-
fées de chaleur, qui sont réduits par une aug-
mentation très progressive de la posologie.
●D’autres médications sont à l’étude : les ago-
nistes des PPAR dans le syndrome métabolique
et les inhibiteurs de la
cholesterol ester transfer
protein (
CETP), susceptibles d’élever le cholesté-
rol HDL.
L
ES INDICATIONS
Elles tiennent compte des objectifs à atteindre,
du niveau initial des lipides plasmatiques, de la
puissance des médicaments, du terrain (patho-
logie associée, tolérance, etc.).
Les objectifs dépendent exclusivement du
niveau de risque cardiovasculaire et donc essen-
tiellement du nombre de facteurs de risque. Il
faut les évaluer initialement et les réévaluer
régulièrement, car certains sont évolutifs ; leur
prise en compte permet de constater que cer-
tains patients reçoivent à tort un traitement
médicamenteux et que d’autres sont sous-
traités.
Dès lors que le patient a un cholestérol LDL
supérieur à 1,60 g/l et/ou présente au moins un
facteur de risque cardiovasculaire, des conseils
relatifs à son mode de vie (alimentation et acti-
vité physique) doivent être prodigués et répétés.
La place des aliments enrichis en phytostérols et
phytostanols n’est pas établie : ils diminuent le
cholestérol LDL, mais leur bénéfice en préven-
tion cardiovasculaire n’a pas été directement
mis en évidence.
En l’absence de facteur de risque, il n’y a pas
d’indication à un traitement médicamenteux si
le cholestérol est inférieur à 2,20 g/l. Par
exemple, une femme de 65 ans (un facteur de
risque) ayant un cholestérol LDL à 2,10 g/l et un
cholestérol HDL à 0,70 g/l (– 1 facteur de risque)
ne doit pas recevoir de médication hypocholes-
térolémiante.
L’objectif est d’atteindre un cholestérol LDL :
– <2,20 g/l s’il n’y a pas de facteur de risque,
– <1,90 g/l s’il y a un facteur de risque,
– <1,60 g/l s’il y a deux facteurs de risque,
– <1,30 g/l s’il y a plus de deux facteurs de
risque,
– <1,00 g/l si le patient est à haut risque cardio-
vasculaire (tableau II).
L
ES MODALITÉS THÉRAPEUTIQUES
En cas d’hypercholestérolémie isolée
●On utilisera en priorité une statine, en com-
mençant à la dose de 20 mg. Seule la rosuvasta-
tine doit être initiée à la dose de 10 mg et en
Tableau II. Les trois catégories de patients à haut risque cardiovasculaire pour lesquels le cholestérol LDL
doit être inférieur à 1 g/l.
Les patients ayant des antécédents :
1. de maladie coronaire avérée (angor stable et instable, revascularisation, IDM, IDM silen-
cieux documenté)
2. de maladie vasculaire avérée (accident vasculaire cérébral ischémique, artériopathie
périphérique à partir du stade II)
Les patients ayant un diabète de type 2, sans antécédent vasculaire, mais avec un haut
risque cardiovasculaire défini par :
3. au moins deux des facteurs de risque suivants : âge, antécédents familiaux de maladie
coronaire précoce, tabagisme, hypertension artérielle, cholestérol HDL <0,40 g/l,
microalbuminurie (>30 mg/24 h)

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2006
54
mise au point
deuxième intention (intolérance ou efficacité
insuffisante des autres statines). La dose sera
doublée tous les deux mois jusqu’à obtention de
l’objectif. Le choix de la statine sera fonction de
l’efficacité moyenne connue et attendue, et de la
baisse souhaitée au vu de l’objectif déterminé.
●Si la dose maximale bien tolérée ne permet
pas d’atteindre l’objectif, l’ézétimibe sera asso-
cié à la dose unique de 10 mg. Par exemple, pour
un patient ayant un objectif à 1,30 g/l, si à la
dose de 40 mg de simvastatine le cholestérol
LDL est à 1,60 g/l, le doublement de la dose
n’entraînera qu’un effet supplémentaire de 6 %,
alors qu’il faudrait une baisse supplémentaire
de 20 % ; dans ce cas, l’ézétimibe peut être ins-
tauré.
●En deuxième intention, en cas d’intolérance
aux statines, on utilisera un fibrate, fénofibrate
ou ciprofibrate.
●En troisième intention, en cas d’intolérance
aux statines et aux fibrates, l’ézétimibe pourra
être utilisé seul, de même que l’acide nicoti-
nique.
●En cas d’hyperlipidémie mixte, le choix se por-
tera en priorité sur une statine, sauf si les tri-
glycérides sont supérieurs à 4 g/l et sont supé-
rieurs au cholestérol total : dans ce cas, les
fibrates sont intéressants ; de même en cas de
syndrome métabolique avec baisse du choles-
térol HDL.
Association d’hypolipémiants
●L’association statine + ézétimibe est logique
et peut permettre d’atteindre l’objectif sur le
cholestérol LDL, en complément de la posologie
maximale tolérée de statine.
●L’association statine + fibrates est de plus en
plus considérée comme efficace et sûre (excepté
le gemfibrozil) dans les hyperlipidémies mixtes
sévères, surtout en utilisant le fénofibrate, qui
n’a pas posé de problème en association avec
des statines dans le cadre de l’étude FIELD.
●L’association statines + acide nicotinique est
particulièrement intéressante si le cholestérol
HDL est bas sous statine, ce qui est souvent le
cas dans les dyslipidémies mixtes.
●L’association statine ou fibrate + cholestyra-
mine est de moins en moins utilisée.
Le traitement correcteur des autres facteurs de
risque s’impose (hypertension artérielle, diabète,
obésité, tabagisme).
T
OLÉRANCE ET SURVEILLANCE
La sécurité des hypolipémiants est très grande.
Toutefois, ils peuvent entraîner des effets cli-
niques indésirables rares (douleurs muscu-
laires, troubles digestifs, insomnie, dysfonction
érectile), mais pouvant justifier l’arrêt du traite-
ment, première étape d’une pause à visée dia-
gnostique.
Les effets indésirables biologiques justifient une
interruption thérapeutique si les transaminases
contrôlées au bout de 3 mois d’instauration thé-
rapeutique sont supérieures à 3 fois la limite
supérieure de la normale et le restent lors d’un
second contrôle un mois après.
De même, le traitement doit être suspendu si les
créatines phosphokinases (CPK) sont supé-
rieures à 5 fois la limite supérieure de la normale.
Les CPK doivent être dosées avant la mise en
place du traitement (statines, fibrates ou ézéti-
mibe) en cas d’hypothyroïdie, d’insuffisance
rénale, de patients âgés de plus de 70 ans, d’an-
técédents d’intolérance aux statines ou aux
fibrates, d’antécédents personnels ou familiaux
de maladie musculaire génétique, d’abus d’al-
cool, et en cas d’apparition de symptômes mus-
culaires inexpliqués.
1
/
4
100%