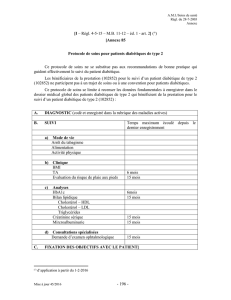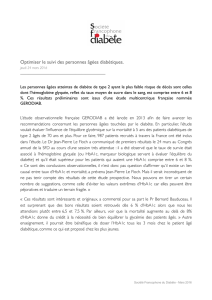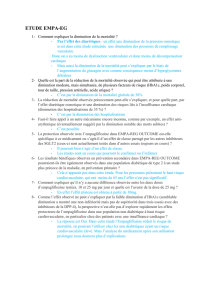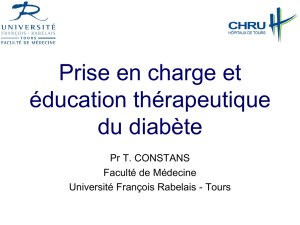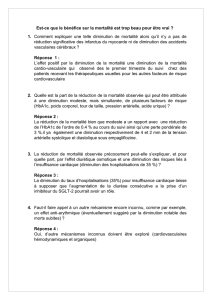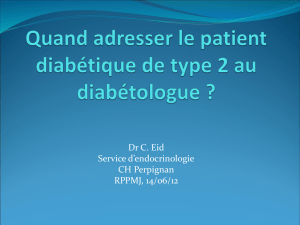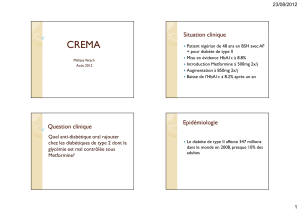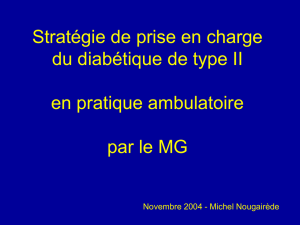Congrès rÉunion

coordonné par
le Pr C. Le Feuvre
8 | La Lettre du Cardiologue • n° 418 - octobre 2008
CONGRÈS
RÉUNION
* Centre hospitalier de Montgardé,
Aubergenville.
Comment dépister
l’ischémie myocardique
silencieuse chez le diabétique ?
Quels traitements prescrire ?
(D’après la communication
du Pr Patrick Henry, hôpital Lariboisière)
Quelques données épidémiologiques
Le cardiologue sera au centre de la prise en charge
du diabétique ; la principale cause de décès chez
le diabétique est la mortalité d’origine cardio-
vasculaire : principalement IDM, mort subite, insuffisance
cardiaque sur HTA ou cardiomyopathie. Le nombre de
patients diabétiques augmente car la population atteinte
d’obésité progresse : on dénombre plus de 25 % d’hommes
et de femmes obèses en Allemagne, en Grande-Bretagne
et au Portugal. Cette augmentation de l’incidence de
l’obésité est multifactorielle : diminution de l’activité
physique, alimentation anarchique et déséquilibrée, et
évolution génétique (phénotype stockeur). Le nombre
de diabétiques augmente ; l’utilisation de metformine
a d’ailleurs été autorisée chez les enfants atteints de
diabète non insulinodépendant (DNID) de type 2.
Quel est l’intérêt de dépister l’ischémie
myocardique silencieuse (IMS)
chez le diabétique ?
Les lésions coronaires sont souvents diffuses et
sévères. Le système de coagulation du diabétique
est déficient (fibrinolyse déficiente, hyperagrégabilité
plaquettaire) et conduit à un athérome galopant. Dans
l’étude GUSTO-1, la mortalité par IDM était 2 fois
plus élevée chez les diabétiques. Une étude menée
en 1998 en Finlande, comparant 1 373 non diabétiques
et 1 059 diabétiques, a montré que le risque de morta-
lité cardiovasculaire était identique chez les patients
non diabétiques ayant des antécédents d’IDM et chez
les patients diabétiques en prévention primaire.
Il faut considérer que tout diabétique est en préven-
tion secondaire d’un accident coronaire.
Durant l’évolution de l’athérome, au cours de la
constitution de la plaque, on constate à un moment
donné une rupture de cette plaque suivie d’une
thrombose et d’une occlusion. On ne connaît pas
de facteur prédictif du risque de rupture de plaque,
sauf le niveau de risque cardiovasculaire. Il est donc
essentiel de contrôler les facteurs de risque associés
au diabète et de veiller à :
obtenir en prévention primaire un taux de HbA1c
➤
inférieur à 6,5 % ;
prescrire de l’aspirine en prévention primaire ; ➤
obtenir un taux de LDL-cholestérol inférieur à
➤
1,3 g/l ;
obtenir une PA inférieure à 130/80 mmHg (ce
➤
qui se fait le plus souvent grâce à une polythérapie
comportant un diurétique).
La recherche d’une IMS est justifiée chez les diabé-
tiques à haut risque, définis selon les recommanda-
tions SFC/ALFEDIAM par les critères suivants :
diabète de type 2, patient âgé de plus de 60 ans
➤
ou dont le diabète est connu depuis plus de 10 ans,
et ayant 2 autres facteurs de risque parmi le tabac,
la dyslipidémie, l’hérédité et l’HTA ;
diabète de type 1, patient âgé de plus de 45 ans
➤
et traité depuis plus de 15 ans, et ayant 2 autres
facteurs de risque ;
diabète de type 1 ou 2 et protéinurie ou atteinte
➤
artérielle périphérique ;
diabète de type 1 ou 2 et microalbuminurie asso-
➤
ciée à 2 autres facteurs de risque ;
sédentaire âgé de plus de 45 ans reprenant une ➤
activité sportive.
De nouvelles solutions en 2008
pour prévenir l’ischémie myocardique ?
Réunion de l’Amicale des cardiologues de Paris et sa région
M.L. Lachurié*
Le thème du programme scientifique de la réunion de l’Amicale des cardiologues de
Paris et sa région était le dépistage de l’ischémie myocardique silencieuse (IMS) et
les moyens de diminuer le risque cardiovasculaire.

Diagnostic de diabète
+ sulfonylurée
(le moins cher)
+ insuline basale
(le plus efficace) + thiazolidinedione
(pas d'hypoglycémie)
+ thiazolidinedione + insuline basale
+ insuline basale
Insuline intensifiée
Insuline intensifiée + metformine ± thiazolidinedione
+ sulfonylurée
Modification du mode de vie
+ metformine
HbA1c ≥ 7 %
HbA1c ≥ 7 %
HbA1c ≥ 7 % HbA1c ≥ 7 %
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
HbA1c ≥ 7 % HbA1c ≥ 7 %
HbA1c ≥ 7 %
Figure 1. Démarche thérapeutique proposée pour abaisser l’HbA1c.
La Lettre du Cardiologue • n° 418 - octobre 2008 | 9
CONGRÈS
RÉUNION
L’interrogatoire permet de rechercher des signes
fonctionnels du type dyspnée ou gêne à l’effort :
l’ischémie n’est donc pas si “silencieuse”. Sinon pour-
quoi la dépister ? La maladie coronaire est fréquente,
grave et de mauvais pronostic malgré le traitement
médical (lésions sévères et diffuses), et il faut géné-
ralement envisager une revascularisation en plus
de l’optimisation du contrôle des autres facteurs
de risque.
Quelles explorations proposer ?
L’ECG d’effort – cet examen est souvent non
➤
contributif ou non réalisable, le diabétique faisant
généralement peu d’effort, pouvant souffrir d’obé-
sité, etc.) ;
La scintigraphie ; ➤
L’écho de stress ; ➤
L’intérêt du scanner coronaire chez le diabétique est
limité du fait des importantes calcifications entraî-
nant des faux positifs, de la diffusion des lésions, des
lésions distales difficiles à voir, et des volumes de
contraste si la fonction rénale est altérée.
Quel suivi cardiovasculaire proposer ?
Examen clinique complet ; ➤
PA ECG ; ➤
Contrôle biologique annuel si le patient est à
➤
bas rique et si le patient est à haut risque, recherche
d’IMS ;
Si les explorations sont négatives, contrôle
➤
régulier ;
Si les examens dépistent une ischémie signi-
➤
ficative (épreuve d’effort précocement positive,
anomalie de perfusion > 10 %), faire une corona-
rographie.
Que proposer
une fois l’IMS dépistée ?
Quelles que soient les lésions, correction inten-
➤
sive des facteurs de risque et traitement médical
optimal (arrêt du tabac, aspirine, statine, inhibiteurs
de l’enzyme de conversion [IEC] ou antagonistes
de l’angiotensine II [AAII], avec une réduction de la
tension à moins de 130/80 mmHg).
Revascularisation par angioplastie, rapide mais ➤
qui ne traite que la lésion dilatée, ou par chirurgie,
geste plus lourd et source de complications mais qui
permet de traiter le maximum de lésions. La méthode
de revascularisation dépend aussi de la motivation du
patient : si le patient n’est pas motivé, on préférera
la chirurgie pour optimiser les résultats.
Comment minimiser
le risque cardiovasculaire ?
Réduire l’HbA1C
(D’après une communication
du Pr E. Larger, hôpital Hôtel-Dieu)
Les résultats de l’étude UKPDS sont négatifs en
termes de réduction des événements cardiovascu-
laires, sauf dans le sous-groupe traité par metfor-
mine.
Les recommandations de la HAS et la démarche
thérapeutique pour réduire l’HbA1c sont illustrées
dans le tableau I et la figure 1.
Quelle cible d’HbA1c doit-on se fixer ? “Lower is
better”? Dans l’étude UKPDS (figure 2), plus l’HbA1c
augmente, plus le risque de microangiopathie est
Tableau I. Les recommandations de la HAS pour réduire l’HbA1c.
Étape Seuil de prescripion Stratégie thérapeutique
1HbA1c > 6 % Mesures hygiéno-diététiques (MHD)
2HbA1c > 6 % après étape 1
(à la phase précoce du diabète)
HbA1c > 6,5 % après étape 1
Monothérapie + MHD : metformine voire IAG
Monothérapie au choix + MHD
Metformine ou IAG ou SU ou glinides
3HbA1c > 6,5 % après étape 2 Bithérapie + MHD
4HbA1c > 7 % après étape 3 Trithérapie + MHD Insuline ± ADO + MHD
5HbA1c > 7 % après étape 4 Insuline ± ADO + MHD Insuline fractionnée + MHD
SU : sulfamide ; ADO : antidiabétique oral.
ou

coordonné par
le Pr C. Le Feuvre
80
60
Incidence sur 1 000 personnes/an (%)
40
20
0
5 6 7 8
Concentration moyenne d’HbA1c (%)
Infarctus du myocarde
Critère de jugement microvasculaire
9 10 11
Figure 2. Étude UKPDS 35,
d’après Stratton IN,
Adler AI, Neil HA et al. BMJ
2000;321(7258):405-12.
• Insuline :
– Basale
– Mélanges
– Bolus
– Basale-bolus
– Pompe
• Chirurgie bariatrique
• Sulfonylurées et glinides
• Metformine
• Thiazolidinediones
• Acarbose
• Rimonabant
• Orlistat
Encadré. Traitement du diabète
de type 2 : médicaments dispo-
nibles en 2008.
10 | La Lettre du Cardiologue • n° 418 - octobre 2008
CONGRÈS
RÉUNION
Tableau II. Fréquence des remboursements de traitements antidiabétiques, hypolémiants et à
visée cardiovasculaire pour les personnes diabétiques traitées. ENTRED 2001, n = 9 987.
Traitement Fréquence
de remboursement (%) IC95
Antidiabétiques oraux
Sulfamides seuls
Biguanides seuls
Inhibiteurs des α-glucosidases seuls
Glinides seuls
Combinaisons d’antidiabétiques oraux sans insuline
80,0
27,8
15,1
2,8
1,5
32,8
(79,2-80,8)
(26,9-28,7)
(14,4-15,8)
(2,5-3,1)
(1,3-1,8)
(31,9-33,7)
Insuline
Avec antidiabétique oral
Seule
20,0
5,9
14,1
(19,2-20,8)
(5,4-6,3)
(13,5-14,9)
Médicaments hypolipémiants 38,9 (38,0-39,9)
Médicaments à visée cardiovasculaire* 69,7 (68,8-70,6)
* Tout médicament à visée cardiovasculaire, à l’exclusion des antiagrégants plaquettaires et des vasodilatateurs.
élevé. En revanche, la corrélation entre l’HbA1c et la
macroangiopathie est moins évidente. Un traitement
intensif pour obtenir une HbA1c inférieure à 6 %
par rapport à un traitement standard s’est soldé
par une surmortalité dans le groupe traité de façon
intensive (étude ACCORD, 10 251 patients). Le taux
de décès annuel était de 1,4 % dans le groupe intensif
versus 1,1 % dans le groupe standard. Face à cette
surmortalité, le NHLBI a interrompu l’étude. Une
des hypothèses expliquant cette surmortalité est
que la baisse de la glycémie serait à l’origine d’une
déstabilisation de la plaque d’athérome.
Le traitement du diabétique repose actuellement sur
plusieurs familles de médicaments (encadré) ; leurs
cibles sont différentes et il est donc intéressant de les
associer pour optimiser les résultats (tableau II).
L’intérêt des incrétines a été plus particulièrement
développé : en 1906 déjà, Moore suspectait que
l’intestin sécrétait un “excitant” du pancréas. Deux
peptides digestifs amplifient la réponse de sécré-
tion d’insuline induite par le glucose : GLP-1 et GIP.
En l’absence d’hyperglycémie, ces peptides sont
sans effet sur la sécrétion d’insuline : pas d’hypo-
glycémie. L’“effet incrétine” est diminué dans le
diabète de type 2 : la sécrétion de GLP-1 est diminuée,
la sensibilité des cellules β au GLP-1 est conservée ;
la sécrétion de GIP est normale, la réponse au GIP
est diminuée.
Le GLP-1 médicament a une demi-vie de 1 à 2 minutes
et nécessite une perfusion continue. Dans la famille du
GLP-1 médicament, on peut citer les agonistes peptidi-
ques résistants à la DPP-4 (exénatide) ou dont la demi-
vie est prolongée par liaison à l’albumine (liraglutide),
et les médicaments qui prolongent l’activité du GLP-1
endogène en inhibant la DPP-4 (gliptines).
Le GLP-1 augmente la sécrétion d’insuline, diminue
la sécrétion postprandiale de glucagon, augmente
la satiété, réduit l’appétit et diminue la vidange
gastrique. L’exénatide (par voie injectable sous-
cutanée x 2/j ; une forme prolongée est à l’étude),
version synthétique d’un polypeptide extrait de la
salive de lézard, se lie aux récepteurs humains du
GLP-1 et résiste à l’action de la DPP-4. Il peut agir
sur l’HbA1c en association avec des antidiabétiques
oraux. Il entraîne une réduction pondérale de 2 à 3 kg
(observée à 2 ans). Les nausées sont les effets indé-
sirables le plus souvent signalés (jusqu’à 50 %) ; leur
fréquence diminue avec le temps.
La DPP-4 est une enzyme ubiquitaire (rein, intestin,
lymphocyte T, glandes salivaires, prostate, placenta).
Les inhibiteurs de la DPP-4, comme la sitagliptine,
augmentent la concentration de GLP-1, ont un effet
neutre sur le poids, un effet protecteur des cellules
bêta de Langerhans, et pas d’effets indésirables. La
sitagliptine se prend per os une fois par jour, n’a
pas d’interaction alimentaire ni médicamenteuse
cliniquement importante. Elle est peu liée aux
protéines ; elle est excrétée principalement par voie
rénale sous une forme inchangée. On peut l’associer
à la metformine.
Tout traitement doit comporter un régime et, en l’ab-
sence de contre-indication, de la metformine. Par la
suite, les associations d’antidiabétiques deviennent
de plus en plus complexes et nécessitent alors un
avis spécialisé (figure 3).
Enfin, devant une HbA1c faussement normale, il faut
être vigilant et songer à évoquer un hypersplénisme,
une hémoglobinopathie ou un saignement chro-
nique, en particulier digestif. À noter aussi chez les

Metformine
Sulfonylurée
Acarbose
GLP-1
Insuline
Rimonabant
Thiazolidinedione
Gliptine
Figure 3. Associations d’antidiabétiques.
Traitement conventionnel
Traitement intensif
60
80
Incidence cumulée de tous les événements
cardiovasculaires (%)
40
20
0
0 1 2 3
Suivi (années)
Patients à risque
Traitement intensif 80 72 65 61 56 50 47 31
Traitement conventionnel 80 70 60 46 38 29 25 14
p < 0,001
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Figure 4. Étude STENO 2, résultats après 13 ans de suivi.
La Lettre du Cardiologue • n° 418 - octobre 2008 | 11
CONGRÈS
RÉUNION
patients traités par rosiglitazones, l’importance du
taux de fractures osseuses chez les femmes et une
baisse de l’hémoglobine.
Réduire la pression artérielle
et protéger l’hypertendu diabétique
(D’après une communication
du Pr J. Blacher, hôpital Hôtel-Dieu)
Par quels moyens peut-on réduire les facteurs de
risque ?
Arrêt du tabac, activité physique ; contrôle de l’ali-
mentation, du poids, de la glycémie, de la pression
artérielle (PA) et des lipides ; prescription d’aspirine.
Dans l’étude STENO 2, 160 patients diabétiques de
type 2 avec microalbuminurie persistante ont été
randomisés en deux groupes de 80 patients, traite-
ment intensif contre traitement conventionnel sur
une période de 8 ans, à l’issue de laquelle les deux
groupes recevaient le même traitement. Les patients
étaient évalués 5 ans après l’essai thérapeutique,
soit 13 ans après le début de l’étude. On note dans
le groupe traitement conventionnel plus d’événe-
ments microangiopathiques pendant l’essai et à
la fin du suivi. L’incidence des événements cardio-
vasculaires (décès d’origine cardiovasculaire, AVC,
IDM, pontage, revascularisation, amputation, etc.)
est plus importante au bout de 8 et 13 ans dans le
groupe traitement conventionnel (figure 4). L’inci-
dence des décès (toute cause) n’est pas différente
entre les deux groupes au bout de 8 ans, mais, au
bout de 13 ans, elle est plus élevée dans le groupe
traitement conventionnel.
Un peu d’épidémiologie
On compte 10,5 millions d’hypertendus traités
en 2006 (1 adulte sur 5), 46 % des 60-69 ans (et
70 % des plus de 80 ans) prennent un traitement
anti-HTA ; 61 % prennent au moins 2 antihyperten-
seurs. Les sartans sont les antihypertenseurs qui
progressent le plus : ils ont été prescrits chez 19,8 %
des patients en 2000 et 36,7 % en 2006 (respective-
ment 33,3 % et 28 % pour les IEC). Le coût moyen
du traitement est de 420 euros par an.
La prescription croissante d’AAII peut s’expliquer
par les résultats positifs de nombreuses études :
dans l’étude RENAAL, menée sur une population
diabétique de type 2, le losartan réduit le risque
d’insuffisance rénale terminale, de dialyse et de
décès. Dans l’essai IRMA II, l’irbésartan à la dose
de 300 mg diminue l’incidence de la néphropa-
thie diabétique et selon l’étude IDNT, l’irbésartan
diminue le risque de doublement de la créatinine et
d’insuffisance rénale terminale, ainsi que le nombre
de décès par rapport à un groupe contrôle et par
rapport à l’amlodipine. Dans l’étude LIFE, menée
sur une population diabétique, le losartan est plus
efficace que l’aténolol (39 % de réduction du risque ;
p < 0,002).
L’étude ADVANCE a permis de démontrer, dans
une population de diabétiques, que l’association
périn dopril-indapamide réduisait les décès d’origine
cardiovasculaire (pas de différence sur les décès
d’origine non cardiovasculaire) ; la réduction du

American Heart Association
AHA
2008
En direct, du 9 au 12 novembre
dans votre e-mail
Journal
en ligne
Avec le soutien
institutionnel de
La Nouvelle-Orléans
9-12 novembre 2008
Recevez en direct
de la Nouvelle-Orléans
les temps forts du congrès
sur simple demande à :
Accédez au compte-rendu
présenté sous forme de brèves
et d’interviews d’experts
en vous connectant sur :
www.edimark.fr/ejournaux/
aha2008.htm
coordonné par
le Pr C. Le Feuvre
12 | La Lettre du Cardiologue • n° 418 - octobre 2008
CONGRÈS
RÉUNION
risque relatif de mortalité toutes causes confondues était de
14 % (p = 0,025).
Quel traitement antihypertenseur prescrire à un diabétique ? Les
IEC et les AA II, en diminuant la PA, réduisent les risques d’AVC,
d’événements coronariens et d’insuffisance cardiaque ; mais, selon
une méta-analyse portant sur 146 838 patients, seuls les IEC
diminuent le risque d’événements coronariens, indépendamment
de la baisse tensionnelle (Blood Pressure Lowering Treatment
Trialists’ Collaboration, 2007).
Les recommandations ESH/ESC 2007 pour le traitement anti-
HTA chez les diabétiques sont les suivantes :
Chaque fois que c’est possible, l’application de règles hygiéno-
➤
diététiques sérieuses doit être encouragée chez tout diabétique.
Dans le cas de diabète de type 2, une attention particulière doit
être portée à la perte de poids et à la restriction de l’apport
sodé ;
La pression artérielle cible est de moins de 130/80 mmHg,
➤
et le traitement médicamenteux doit être instauré même pour
une pression artérielle qui est encore dans la zone “normale
haute” ;
Tous les antihypertenseurs peuvent être utilisés, pour autant
➤
qu’ils soient efficaces et bien tolérés. Une plurithérapie est très
souvent indispensable ;
La baisse de la pression artérielle a un effet protecteur sur
➤
l’apparition et la progression de l’atteinte rénale. Une protection
plus importante encore peut être apportée par un bloqueur du
système rénine-angiotensine (IEC ou antagoniste des récepteurs
de l’angiotensine) ;
Un bloqueur du système rénine-angiotensine doit faire partie
➤
du traitement, et c’est le traitement qui doit être privilégié si une
monothérapie est suffisante ;
En cas de microalbuminurie, un traitement doit être instauré,
➤
même pour une pression artérielle dans la zone normale haute.
Les bloqueurs du système rénine-angiotensine ont une action
antiprotéinurique marquée : ce sont donc les médicaments de
premier choix ;
La stratégie thérapeutique doit comprendre une action sur
➤
tous les facteurs de risque, y compris celui que représente l’usage
d’une statine ;
En raison du risque accru d’hypotension ortho-statique, la
➤
pression artérielle en position debout doit être vérifiée. ■
1
/
5
100%