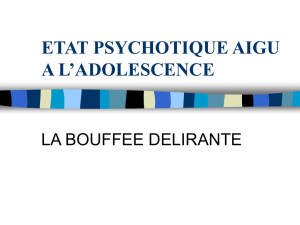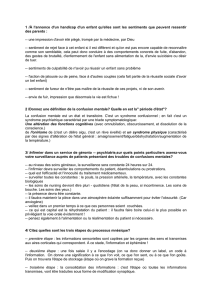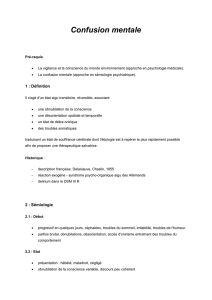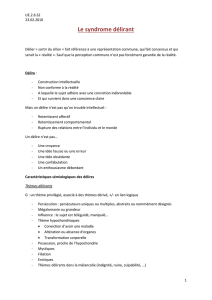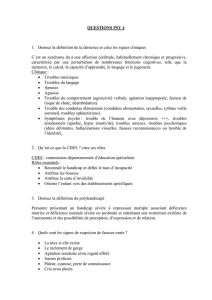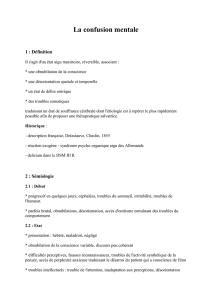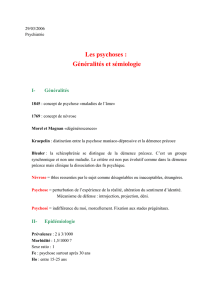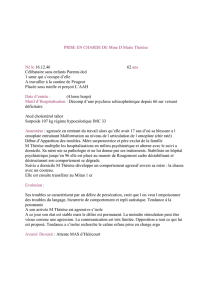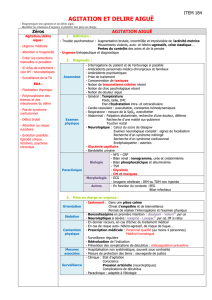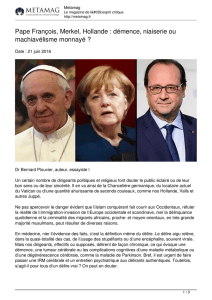Le délire dans la maladie d`Alzheimer

La revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Février 2000 • 11
Il est généralement reconnu que le
délire est le trouble cognitif le
plus fréquent chez les patients âgés
hospitalisés. Compte tenu de la pré-
valence de la démence chez les per-
sonnes très âgées, il n’est pas éton-
nant que ces deux troubles soient
souvent simultanés. La démence et
l’âge avancé sont des facteurs de
risque de délire. Le médecin
chevronné saura facilement dis-
tinguer le délire de la démence, mais
la présence concomitante de ces
deux troubles chez un même patient
se révèle un problème épineux pour
l’équipe soignante.1
« Délire » se dit de l’apparition rapi-
de d’un état altéré de la conscience (en
général une diminution de la con-
science), caractérisé par des difficultés
de concentration, la fragmentation de la
pensée et des perceptions sensorielles
erronées (illusions ou hallucinations).
(Tableau 1) Une vaste gamme d’événe-
ments cliniques peut entraîner ces
tableaux cliniques chez les personnes
âgées (Tableau 2), mais les plus
fréquents sont probablement les infec-
tions et les réactions indésirables aux
médicaments.
Diagnostic
Les altérations de la conscience et la
diminution de la capacité d’attention
sont des indices particulièrement
utiles pour détecter le délire, en
présence ou en l’absence d’une
démence sous-jacente. Pour poser le
diagnostic clinique, les question-
naires d’évaluation de la confusion
(Confusion Assessment Method), de
la vigilance (vigilance A test) sont
utiles; on peut également demander
au patient d’exécuter une tâche qui
exige une attention soutenue, par
exemple, compter à rebours. L’erreur
la plus fréquente en médecine
générale ou en psychiatrie est de
croire, à tort, que le délire chez un
patient atteint de la maladie
d’Alzheimer est un signe de la pro-
gression de la démence sous-jacente.
Le risque est plus grand lorsque le
médecin traitant n’a pas vu son
patient depuis des mois. Dans un tel
contexte, une anamnèse détaillée
révélera l’apparition soudaine de la
détérioration du statut cognitif.
Même en l’absence d’une maladie
d’Alzheimer sous-jacente, le délire est
fréquent chez les personnes âgées. De
Le délire dans la maladie
d’Alzheimer
La démence et le vieil âge sont des facteurs de risque de délire.
Le médecin chevronné saura distinguer le délire de la démence,
mais la présence combinée du délire et de la démence chez un
même patient s’avère un problème épineux pour l’équipe
soignante.
par Peter N. McCracken, M.D., FRCPC
Le DrMcCracken est gériatre
titulaire, Glenrose Rehabilitation
Hospital, directeur, Gériatrie, et
professeur de médecine,
University of Alberta, Edmonton,
Alberta.

10 % à 30 % des personnes âgées hospi-
talisées présentent un état délirant pen-
dant leur séjour.3,4 Dans les unités de
soins chirurgicaux, ce pourcentage est
de l’ordre de 10 % à 15 % pour les
patients de chirurgie générale, et il peut
atteindre 40 % à 60 % dans les unités de
soins orthopédiques.5Malgré l’amélio-
ration perçue au cours des dernières
années, des études prospectives ont
montré que les cliniciens ont de la diffi-
culté à reconnaître le délire. Dans une
étude menée dans une unité de soins
orthopédiques, les chercheurs ont con-
staté que le délire avait été rarement
reconnu par les infirmières et par les
médecins (39 % des infirmières et 22 %
des médecins n’avaient su le re-
connaître). Malheureusement, l’inci-
dence des crises de délire chez les
patients atteints de la MA n’est pas con-
nue.
Chez les personnes âgées de santé
frêle, le délire est rarement reconnu, et
cet état peut être une source de frustra-
tion pour le neurologue, pour le gériatre
traitant, pour le physiatre et pour le
médecin de famille. Le diagnostic du
délire comporte plusieurs embûches.
Par exemple, les changements dans
l’attitude du patient sont mal interprétés
par le personnel hospitalier. En outre, la
nature fluctuante du délire (intervalles
de lucidité), la présentation atypique
(délire hypoactif) et la non-reconnais-
sance de cette urgence médicale poten-
tielle rendent le diagnostic du délire
plus difficile.
Le délire aigu est non seulement
fréquent, il est mortel. Le délire
entraîne un taux de mortalité élevé, de
l’ordre de 20 % à 40 %, et des études
ont montré qu’il avait été deux fois plus
élevé chez les patients souffrant d’un
délire que chez les sujets témoins ne
souffrant pas de délire.6
Outre le taux de mortalité élevé, le
délire entraîne une morbidité impor-
tante : chutes, aspiration, ulcères de
décubitus, incontinence urinaire, déshy-
dratation, insuffisance cardiaque et con-
fusion persistante.7Chez les patients
atteints de démence, le délire peut per-
sister pendant plusieurs semaines, même
après que la cause a été reconnue et
traitée. Malheureusement, pour une pro-
portion élevée de personnes atteintes de
démence, l’état délirant devient perma-
nent.
Pour évaluer ces patients, rien ne
peut remplacer la cueillette d’informa-
tion pertinente et fiable par un inter-
rogatoire du conjoint, des membres de
la famille ou du personnel de l’éta-
blissement. Cette quête de renseigne-
12 • La revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Février 2000
Le délire chez le patient âgé peut être difficile à
reconnaître. Le début semble parfois insidieux parce
que l’état délirant s’installe en plusieurs jours. Le plus
souvent, les premiers changements intéressent le
comportement psychomoteur (somnolence prolongée,
anxiété, difficulté croissante à penser clairement,
insomnie, cauchemars et symptômes psychotiques).
Tableau 1
CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DU DELIRIUM2
• perturbation de la conscience, avec changement de la fonction cognitive ne pou-
vant être expliqué par une démence;
• perturbation s’installant en un temps court (quelques heures ou quelques jours);
• tendance à avoir une évolution fluctuante tout au cours de la journée;
• difficulté pour le patient à fixer, à maintenir ou à changer son attention;
• trouble cognitif (mémoire, orientation, langage) ou trouble de la perception
(interprétations erronées, illusions, hallucinations);
• perturbation du cycle de sommeil et d’éveil, trouble psychomoteur, émotionnel
ou anomalies à l’électroencéphalogramme (EEG);
• mise en évidence que la perturbation est causée par une médication générale,
par une intoxication par une substance ou par le sevrage d’une substance ou par
des étiologies multiples.
Tableau 2
FACTEURS
DÉCLENCHANTS2
Infections
• voies urinaires, voies
respiratoires
Troubles du métabolisme
• hémogramme, Na, Ca, glycémie
Troubles cardiopulmonaires
• hypoxémie, ICC, EP, IM
Troubles neurologiques
• AVC, hématome sous-dural
Rétention
• de l’urine ou des fèces
Facteurs liés à l’environnement du
patient
• cathéters, moyens de contention,
bruit, lumière, présence
d’étrangers, psychotropes,
opioïdes
Médicaments
• médicaments d’ordonnance ou
en vente libre, intoxication,
sevrage

ments s’avère particulièrement impor-
tante dans le cas des patients atteints de
démence parce que l’aggravation
soudaine de leur état confusionnel
chronique peut toujours être démontrée
lorsque l’interrogatoire est suffisamment
poussé. Grâce à ces interrogatoires, à une
étude approfondie des notes des infir-
mières et aux résultats des examens cli-
niques objectifs, le médecin peut poser
un diagnostic de délire, même chez un
patient atteint de démence. Les critères
du delirium dans le DSM-IV (Tableau 1)
doivent servir de lignes directrices.
Caractéristiques cliniques
Nous l’avons dit, le délire chez le
patient âgé peut être difficile à
reconnaître. Le début semble parfois
insidieux parce que l’état délirant
s’installe en plusieurs jours. Le plus
souvent, les premiers changements
intéressent le comportement psy-
chomoteur (somnolence prolongée,
anxiété, difficulté croissante à
penser clairement, insomnie,
cauchemars et symptômes psycho-
tiques). Parfois, l’attention du
médecin traitant sera attirée par un
changement brusque des symp-
tômes psychotiques. Les idées déli-
rantes, influencées par les stimuli
dans l’environnement du patient,
peuvent se manifester. Les halluci-
nations et les illusions sensorielles,
le plus souvent visuelles et très
intenses, sont particulièrement
fréquentes. Même chez les patients
atteints de démence, on observe des
périodes de fluctuation de l’état
délirant, et souvent, les patients
semblent plus lucides le matin et
plus confus le soir. Le cycle de som-
meil et d’éveil est complètement
perturbé. Le délire hypoactif passe
souvent inaperçu, et il se passe des
heures, voire des jours, avant que
cette forme de délire soit diagnos-
tiquée correctement.
Parmi les conséquences fréquentes
du délire, soulignons les séjours très
longs à l’hôpital, une diminution de la
capacité fonctionnelle et un taux plus
élevé d’admission dans les établisse-
ments de soins de longue durée.
Chez les patients atteints de la MA
et d’autres formes de démence, il est
impossible de prévoir si le patient se
rétablira de la crise de délire. L’étude
historique de Levkoff a révélé que six
mois après cette crise, seulement 4 %
de tous les patients avaient recouvré un
état de santé semblable à celui qui
précédait la crise de délire.8
Le Tableau 2 énumère les causes
du délire. Les pathologies courantes,
par exemple, les infections des
poumons et des voies urinaires, les
maladies cardiopulmonaires entraînant
une hypoxémie, les maladies neu-
rologiques et les changements du
métabolisme des psychotropes sont
souvent en cause. Dans bien des cas,
l’étiologie est multiple. Des cliniciens
de longue expérience ont effectué des
recherches approfondies pour décou-
vrir une étiologie cognitive, et ils n’ont
pas réussi à trouver de cause précise
du délire. Dans certains cas, le toucher
rectal, une scintigraphie de la vessie
ou le drainage à l’aide d’une sonde
vésicale (pour évaluer le volume
d’urine résiduelle) révèle une rétention
urinaire ou fécale. Des méthodes plus
effractives, par exemple, une ponction
lombaire ou une biopsie, sont quelque-
fois nécessaires.
Traitement
Le traitement du patient atteint de la
MA et souffrant de délire comporte
trois volets : un traitement spécifique,
un traitement de soutien et un traite-
ment sédatif.
La revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Février 2000 • 13
Tableau 3
MÉDICAMENTS LE PLUS SOUVENT EN CAUSE2
•Narcotiques
•Anticholinergiques
•Benzodiazépines
•Psychotropes
•Antiparkinsoniens
•Médicaments d’usage courant, toutefois moins susceptibles de causer le délire : antagonistes des récepteurs H2, bêtabloquants, AINS
En général, les patients atteints de MA et souffrant de
délire accompagné d’une agitation grave doivent être
traités à l’aide de neuroleptiques pour les empêcher de
se blesser ou de blesser d’autres personnes. Avant de
choisir le neuroleptique, le médecin doit connaître en
détail l’état du patient avant la crise de délire.

Traitement spécifique
Le traitement spécifique a pour but de
déterminer, de traiter et d’éliminer la
cause sous-jacente du délire. Cela si-
gnifie déterminer quel médicament
pourrait expliquer cette détérioration
de l’état du patient et l’arrêt de cette
médication (Tableau 3). Le traitement
approprié est axé sur les causes
énumérées auparavant. L’exploration
diagnostique fait appel aux analyses
de sang pour connaître le bilan héma-
tologique et biochimique du patient;
on ordonnera des cultures de sang,
d’urine et des expectorations, des élec-
trocardiogrammes, la mesure de la sa-
turation en oxygène ainsi que des
radiographies thoraciques et abdomi-
nales.
Traitement de soutien
Dans les cas de délire, le traitement
de soutien fait souvent appel aux
mesures non pharmacologiques. On
tente de créer l’environnement le plus
propice à la guérison du patient. On
doit veiller à lui fournir une prothèse
auditive et des lunettes qui convien-
nent. Des sources d’éclairage appro-
priées, des cadrans, un éclairage
naturel favorable aideront le patient à
reconnaître des lieux familiers. On
essaiera aussi de diminuer le niveau
de bruit dans l’unité de soins, si pos-
sible. On évitera le plus possible de
recourir aux moyens de contention.
Un gardien peut être utile pour
empêcher le patient de se blesser. On
incitera les proches à rester au chevet
du patient. Il est également important
de ne pas laisser de cathéter à demeure.
Traitement sédatif
La sédation convient seulement dans
les cas de délire hyperkinétique ou
caractérisé par l’agitation. Les
patients en phase postopératoire ont
besoin d’analgésiques même lorsque
les narcotiques ont déclenché la crise
de délire. Le plus sage est de pre-
scrire de l’acétaminophène (650 mg
par voie orale) en association avec la
morphine à faible dose (de 2,5 à 5
mg, par voie intramusculaire. ou
sous-cutanée) pour soulager la
douleur perthérapeutique.
En général, les patients atteints de
MA et souffrant de délire accompagné
d’une agitation grave doivent être
traités à l’aide de neuroleptiques pour
les empêcher de se blesser ou de blesser
d’autres personnes. On doit laisser les
cathéters intraveineux en place. Pour
choisir le neuroleptique, le médecin
doit connaître en détail l’état du patient
avant la crise de délire. Même si les
neuroleptiques à action puissante
entraînent des effets extrapyramidaux
importants, la plupart des médecins
préfèrent encore ces agents pour traiter
le délire pour plusieurs raisons. Ils sont
relativement peu sédatifs; ils n’entraî-
nent pas d’effets indésirables car-
diopulmonaires; ils sont administrés
par voie intraveineuse et leur mode
d’administration est bien connu. Par
ailleurs, les neuroleptiques à action
moins puissante tels que la thioridazine
et la chlorpromazine exercent de puis-
sants effets anticholinergiques, ce qui
n’est pas vraiment un avantage pour les
patients atteints d’une MA sous-jacente
—on évitera ces médicaments dans ce
contexte clinique. Lorsqu’on recherche
un effet sédatif, les neuroleptiques à
puissance d’action intermédaire tels
que la loxapine et la perphénézine
s’avèrent des plus utiles. Les médecins
en milieu communautaire acquièrent
une expérience croissante dans le traite-
ment à l’aide d’antipsychotiques,
notamment la rispéridone et
l’olanzépine.9
Au cours des années qui viennent,
les stratégies d’intervention devraient
être axées sur la prévention du délire et
sur la recherche des facteurs de risque
et des facteurs déclenchants.10 Nous
soulignons aussi que le donépézil
soulage les symptômes du délire chez
certains patients atteints de démence,
ce qui ouvre des perspectives de
recherche intéressantes.11 Au Canada, la
quétiapine est approuvée pour le traite-
ment de la schizophrénie mais non pour
celui du délire caractérisé par l’agita-
tion. Il est important de mettre fin au
traitement par le neuroleptique dès que
le délire disparaît. Dans le cas des per-
sonnes âgées traitées par un neurolep-
tique, les médecins doivent se rappeler
de ne pas continuer à prescrire ce
médicament au patient qui retourne
chez lui s’il n’en a plus besoin.
14 • La revue canadienne de la maladie d’Alzheimer • Février 2000
Références
1. Gauthier S: The clinical diagnosis and
management of Alzheimer’s disease
(2eédition). Dunitz, London, 1999; 28.
2. Adapted from DSM IV American
Psychiatric Association 1994.
3. Francis J, Kapoc W: Delirium in hospi-
talized elderly. Journal of Geriatric
Internal Medicine 1990; (5): 65-79.
4. Rockwood K: Acute Confusion in
elderly medical patients. American
Geriatric Society 1989; 37: 150-4.
5. Gustafron K, Bergeson D, et coll. :
Acute confusional states in elderly
patients treated for femoral neck frac-
ture. JAGS 1988;36:525-30.
6. Lipowski Z,J: Transient cognitive disor-
ders (delirium–acute confusional states)
in the elderly. Am J Psychiatry 1983;
140; 11: 1926-36.
7. Juby A: Delirium in the elderly. The
Canadian Journal of CME, 1998;
10(10); 83-104.
8. Leckoff SE, Evans DA, Liptzin B, et
coll. : Delirium: The occurrence and
persistence of symptoms among hospi-
talized elderly patients. Arch Int Med
1992; 152: 334-40.
9. Kinaly SS, Gibson RE, et coll. :
Risperidone: Treatment response in
adult and geriatric patients. Int Journal
Psychiatry Med, 1998; 28(2), 255-63.
10. Inovye SK, Borgardus MPH, et coll. :
A multicomponent intervention to pre-
vent delirium in hospitalized older
patients. NEJM 1999; 348(9);669-76.
11. Wengel SP, Roccaforte WH, Borke
WJ: Donepezil improves symptoms of
delirium in dementia: implications
for future research. Journal of
Geriatric Psychiatry Neurol, 1998;
11(3); 159-61.
1
/
4
100%