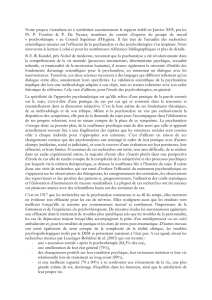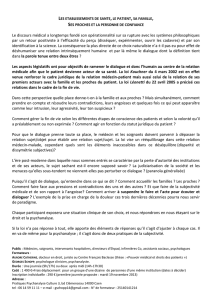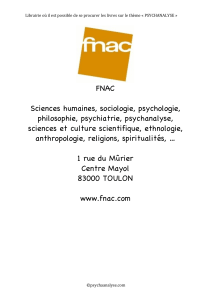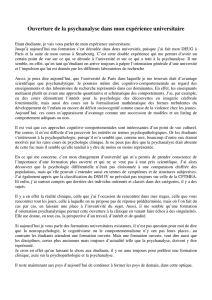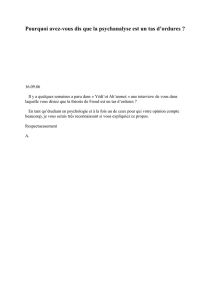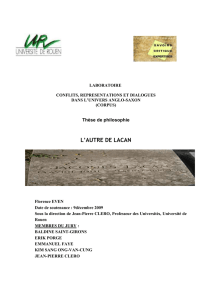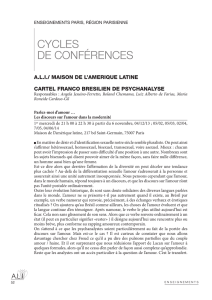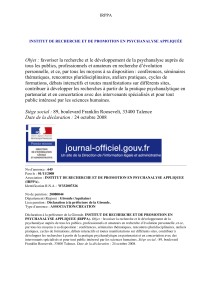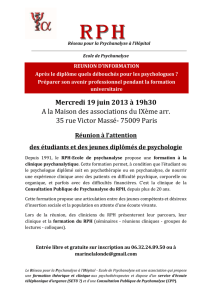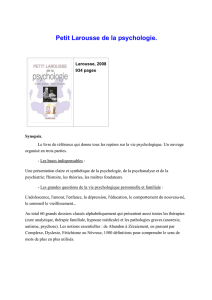Lire l'article complet

48
Le Courrier des addictions (7), n° 2, avril-mai-juin 2005
Psychiatre d’enfants et
psychanalyste d’adultes
Le Courrier : Certains vous
connaissent exclusivement
comme l’un des grands noms
de la psychiatrie française,
côté Salpêtrière, d’autres essen-
tiellement comme l’un des chefs
de file de la psychanalyse :
quels sont, en fait, les grands
moments de votre parcours que
vous aimeriez “stabilo-bosser” ?
Daniel Widlöcher : Le premier
grand moment de mon parcours
est, bien évidemment, celui qui
m’a conduit sur les bancs d’une
faculté de médecine, condition
essentielle pour devenir psy-
chiatre. Il ne faut pas l’oublier !
En 1950, je rencontre Jenny
Roudinesco qui me fait décou-
vrir ce qui alors ne m’attirait pas
spécialement : la psychothérapie
des enfants et la psychanalyse.
Elle me confie un enfant en cure
dont elle assure la supervision et
me conseille à ce moment-là d’al-
ler voir Jacques Lacan, dont elle
me donne l’adresse. Je le ren-
contre en 1952, avant “le drame”
(celui de la scission !), alors que
je venais d’être nommé à l’inter-
nat. Il accepte de me prendre en
analyse, mais à mon retour du
service militaire que je souhaite
alors faire à l’hôpital psychia-
trique des armées d’Alger. En
1953, je retourne le voir et
commence avec lui une analyse
qui durera jusqu’en 1960. J’ap-
prends, au même moment, qu’il
s’est fâché avec les autres
membres de la SPP et créé un
nouveau groupe : la Société fran-
çaise de psychanalyse, avec
Lagache, F. Dolto et Mme
Favez-Boutonnier. Mais, pour
le moment, je fais mon internat
en pédiatrie, un peu de neurolo-
gie, et surtout de la psychiatrie.
Comme cela se pratiquait à
l’époque, je fais ensuite deux cli-
nicats : un chez Michaux à la
Salpêtrière (pour la psychiatrie de
l’enfant), et l’autre chez Delay à
Sainte-Anne. Le pont entre les
deux écoles considérées comme
rivales ! Dans mon entourage,
dans le “petit monde” de l’hôpital
de la Salpêtrière, on me
conseillait à ce moment-là :
“Tais-toi, ne dis surtout pas que
tu es en analyse…” Or, un beau
jour, Michaux, me demande sans
détours : “Vous vous faites psy-
chanalyser Widlöcher ?” “…Oui,
monsieur.” “Avec qui ?” “Lacan,
monsieur.” “C’est très bien ! À
propos : d’accord, faites de la
psychothérapie d’enfants, mais je
ne veux pas ici d’une chapelle
dans laquelle le pape n’aurait
pas le droit d’entrer !” À bon
entendeur, salut ! J’ai retenu la
leçon. Michaux ne voulait pas
qu’on l’ostracise dans son propre
service, comme cela se faisait
dans un autre… Bref. J’ai pour-
suivi ma carrière de chef de cli-
nique, puis d’assistant chez lui,
enseigné la psychologie à Nan-
terre, jusqu’à ce qu’en 1969, le
doyen Castaigne, neurologue,
me propose de remettre sur pied à
la Salpêtrière, un service de psy-
chiatrie d’adultes. Une pareille
offre, cela ne se refuse pas ! C’est
donc à ce moment-là, en 1970,
que je “bascule” de la pédopsy-
chiatrie dans la psychiatrie
d’adultes.
En 1983, j’ai eu l’opportunité de
créer, avec mon ami Pierre
Simon, le pharmacologue, une
unité de recherche Inserm (l’U-
302) sur “Psychopharmacologie
et comportements” que j’ai gérée
pendant douze ans. Nous avions
comme idée forte de démontrer
qu’un médicament qui agit sur le
cerveau a une action également
sur l’esprit. Nous avons travaillé
sur cette hypothèse en défrichant
le terrain de la dépression, en par-
ticulier celui du ralentissement
psychomoteur du déprimé.
Mêler à l’or de la
psychanalyse, le cuivre
de la suggestion :
la nécessaire évolution
Le Courrier : Comment en
êtes-vous arrivé à devenir un
fondateur d’une institution offi-
cielle de la psychanalyse fran-
çaise classique, l’APF, puis le
président de l’Association psy-
chanalytique internationale,
l’API ?
D.W. : Dès la fin de mon analyse
avec Lacan, et ensuite mes super-
visions par Lagache et Favez-
Boutonnier, en 1963-1964, j’ai
commencé à prendre mes dis-
tances avec Lacan. Je n’étais pas
d’accord avec ses pratiques, mais
je restais silencieux. Je me suis
e
n
t
r
e
t
i
e
n
e
n
t
r
e
t
i
e
n
I
n
t
e
r
v
i
e
w
Sur le métier aujourd’hui :
les psychothérapies analytiques
Après l’âge de l’or,
celui du cuivre…
Un entretien avec Daniel Widlöcher*
Propos recueillis par Didier Touzeau et Florence Arnold-Richez
Psychiatre d’enfants, puis d’adultes, ancien chef de service à
la Salpêtrière, enseignant, le Pr Daniel Widlöcher est un
psychanalyste qui fait “école”. Dans tous les sens du terme.
D’abord, parce qu’il est un praticien réputé des cures et de
l’approche psychanalytiques. Ensuite, parce que professeur
émerite à l’université Paris VI, il continue à être très investi
dans les tâches de formation à la psychanalyse des internes
et d’enseignement de la clinique. Enfin, parce qu’il est le
“patron” en France de l’école freudienne “orthodoxe”, et,
depuis quatre ans, de l’Association psychanalytique
internationale dont il est le président. Mais attention !
“Orthodoxe” n’est pas synonyme pour ce grand patron de la
psychiatrie parisienne, de fermeture, de repli sur soi, les deux
pieds dans le même sabot… Chargé de mission auprès
d’Edmond Hervé pour les problèmes hospitalo-universitaires,
en 1982, il a consacré aussi beaucoup d’énergie à la
“société civile”… Médecin clinicien avant tout et homme de
dialogue, le Pr Daniel Widlöcher a tout fait pour ouvrir la
psychanalyse sur le monde et pour introduire dans la “psy”
les techniques de l’évaluation et de la recherche. Il a
d’ailleurs fondé et géré une unité de recherche en psychiatrie
pendant douze ans.
Aujourd’hui, en ce qui concerne l’addiction, il s’interroge :
est-ce vraiment un concept, un modèle ? Ou simplement une
notion utile à la communication, une boîte à outils… comme
une autre ?
*Président de l’Association psychanalytique internationale, professeur
émérite à l’université Paris VI. Correspondance : 248, boulevard
Raspail, 75014 Paris. [email protected]

49
rendu compte que d’autres que
moi, tels Pontalis, Laplanche,
Lang, partageaient mon désac-
cord. Nous nous sommes donc
réunis et, en 1964, nous avons fait
scission en créant l’Association
psychanalytique de France
(APF). Jeune psychanalyste, je
m’investis à fond dans la vie de
cette nouvelle société. J’avais
clairement conscience qu’il ne
fallait pas en rester là, mais ouvrir
la psychanalyse française au
niveau international, dialoguer
avec les autres écoles des autres
pays. En somme, j’étais plutôt du
côté des “Ultramontains” de la
psychanalyse (pôle international
à Rome, pour les catholiques, à
Londres d’ailleurs, pour nous, les
psychanalystes) que de celui des
“Gallicans” (repliés sur leur
pays). Je me suis donc très vite
retrouvé (en 1971) secrétaire de
la Fédération européenne des
psychanalystes, puis, en 1973,
secrétaire de l’API, pour finir, en
2001, président de cette dernière.
Une “vieille dame” puisqu’elle a
été fondée par Freud en 1912,
pour garantir une sorte de label
psychanalytique ! Cette associa-
tion a connu bien des avatars
depuis : en particulier après les
Première et Seconde Guerres
mondiales. Freud lui-même
s’était rendu compte qu’il était
important de faire bénéficier un
plus grand nombre de gens des
thérapies analytiques, surtout
après les multiples traumas subis
au cours de ces conflits. Il propo-
sait donc de tempérer la neutrali-
té propre à la cure par une
“touche” de suggestion, c’est-à-
dire une attitude plus directive à
l’égard de la vie relationnelle ou
des symptômes du patient. Il
appelait cela “mêler à l’or de la
psychanalyse, le cuivre de la
suggestion”. Aux États-Unis et
en Grande-Bretagne, après la
Seconde Guerre, la diffusion de
la psychanalyse s’est étendue à
tout le système de soins et à la
formation de tous les jeunes psy-
chiatres. Pas chez nous. C’est cet
élargissement des techniques qui
a toujours été à l’origine de mul-
tiples dissensions, désaccords,
scissions (dont celle de Lacan),
sur les dosages respectifs de ces
deux métaux, l’or et le cuivre, si
je puis dire. Et surtout autour de
la formation des analystes qui
devaient les fondre dans leur
creuset !...
Le Courrier : Pourquoi tant
de querelles ? Pourquoi cette
furor educandi ?
D.W. : Lorsque deux psychana-
lystes se rencontrent, que font-
ils ? Ils se confortent réciproque-
ment sur leurs pratiques et… ils
forment un troisième psychana-
lyste ! En effet, la plupart des
conflits qui ont éclaté au sein de
la petite communauté des psy-
chanalystes ont tourné autour de
la question de la formation, si
l’on excepte les premières
grandes batailles qui ont opposé
Freud à Jung et Adler… En pas-
sant, je rappelle que la scission
de l’API avec Lacan, en 1963,
s’est faite lorsqu’il lui a été
demandé de mettre fin à ses
fonctions de formateur et non
parce que nous remettions en
cause ses théories ! Et c’est préci-
sément cela qui était pour lui
inacceptable !
En France, nous avons une
conception spécifique de la for-
mation puisque nous considé-
rons que le candidat psychana-
lyste ne commencera sa forma-
tion qu’après sa cure person-
nelle alors qu’en Angleterre et
aux États-Unis, par exemple, il
reçoit son “billet d’entrée” avec
le début de son analyse. À
l’API, nous tenons, certes,
beaucoup à parler d’évaluation
en préalable de la formation.
Toutefois, je ne pense pas qu’il
faille imposer un modèle
unique, un dogme, ce qui
bloque les processus d’évolu-
tion possibles. Les sociétés doi-
vent jouer cartes sur table,
énoncer leurs règles, accepter
l’évaluation des pratiques
qu’elles défendent ! En particu-
lier sur le nombre des séances
hebdomadaires souhaitables, en
dépit de ce que prétendent les
“puritains”, la règle des quatre
séances par semaine est deve-
nue… l’exception ! Il faut le
dire !
Cette question de la formation est
celle qui est la plus pressante
pour nous, car aujourd’hui, le
nombre des psychanalystes, celui
des cures psychanalytiques, les
pratiques ont beaucoup évolué.
Cette situation soulève de très
importantes questions, portant
sur la nature des différences entre
les pratiques, leur place dans le
domaine des soins en santé men-
tale, les recherches, et en particu-
lier celles qui concernent les indi-
cations et l’évaluation des résul-
tats, et la formation des psycho-
thérapeutes dont beaucoup font
seulement des psychothérapies
psychanalytiques. Ils sont très
nombreux actuellement à se for-
mer en dehors des institutions car
il n’existe pas, en France, d’insti-
tutions autonomes.
Relever le défi de
l’évaluation, mais pas
à n’importe quel prix !
Le Courrier : Le rapport d’ex-
pertise collective de l’Inserm
qui évalue l’intérêt des théra-
pies cognitivo-comportemen-
tales, des thérapies familiales
et de couple et des approches
psychodynamiques était donc
bien une nécessité ?
D.W. : La question de l’évalua-
tion est, comme celle de la for-
mation, un sujet permanent de
controverses. Je dois dire que je
trouve indispensable d’ouvrir le
champ des thérapies psychanaly-
tiques d’une part, et d’en faire
l’évaluation d’autre part. Mais
pas n’importe comment, selon
n’importe quels critères, en
confondant les approches sur le
symptôme, à court terme (les
TCC, les thérapies familiales et
de couple), les psychothérapies
analytiques et la psychanalyse
elle-même, qui travaillent à
moyen et long terme. Et en utili-
sant les critères d’efficacité de
l’une pour les comparer à
l’autre ! Pour moi, il ne s’agit pas
de comparer dans l’absolu,
comme si elles étaient identiques
dans leurs buts et leurs moyens,
les méthodes thérapeutiques,
mais, pour une catégorie de
patients donnée, de déterminer la
place de la psychanalyse par rap-
port aux autres modalités de
prises en charge. Est-ce bien inté-
ressant de savoir si la psychanaly-
se obtient effectivement une
réduction de 30 ou 40 % de
symptômes donnés ? Ne vau-
drait-il pas mieux savoir quelles
sont les personnes qui, affligées
de telles difficultés, tirent profit
e
n
t
r
e
t
i
e
n
e
n
t
r
e
t
i
e
n
I
n
t
e
r
v
i
e
w
Bibliographie brève
•Psychothérapie et psychanalyse, dossier coordonné par D. Widlö-
cher. Guide des psychothérapies. Le carnet Psy, avril 2005.
•Débat entre Daniel Widlöcher et Jacques-Alain Miller, PSN
(Psychiatrie Sciences Humaines Neurosciences) janvier-février
2003;vol.i,n° 1.
•Daniel Widlöcher. Affect et empathie. Rev franc Psychanal 1:173-86.
•Daniel Widlöcher. Les nouvelles cartes de la psychanalyse. Paris:
Odile Jacob, 1996.
•Daniel Widlöcher, Françoise Facy, Marcel Clodion, Francis
Derrienic. Épidémiologie et psychiatrie: confrontation et adaptation
aux situations de la Caraïbe. INIST-CNRS, 1993.
•Daniel Widlöcher. Le psychanalyste devant les problèmes de
confrontation. Confrontations psychiatriques 1984;24:141-56.
•Daniel Widlöcher. Psychanalyse et psychothérapies. Paris:
Flammarion Médecine Sciences.
•Daniel Widlöcher. Traité de psychopathologie. Paris: PUF.
•Daniel Widlöcher. Les logiques de la dépression. Paris: Hachette
Littératures/Fayard.

50
Le Courrier des addictions (7), n° 2, avril-mai-juin 2005
de telle ou telle psychothérapie ?
En d’autres termes, il serait plus
productif de déterminer quels sont
ceux qui “répondent” le mieux à
telle approche, et quels sont ceux
qui y sont les plus “résistants”,
pourquoi et selon quels critères…
Et, en définitive, ce dont les
patients ont besoin, est qu’on puis-
se leur proposer une offre variée
de services et approches et, qu’en
fonction des résultats obtenus, on
rectifie à chaque fois “le tir”,
selon un arbre décisionnel classi-
quement utilisé pour soigner des
patients sur le long terme.
Pour ma part, j’ai plutôt envie
d’inciter les thérapeutes de la
TCC à introduire dans leurs
méthodes “un peu” d’analyse, ne
serait-ce que pour faciliter la com-
pliance des patients en leur faisant
toucher du doigt la raison de leurs
résistances personnelles, plutôt
que de s’en tenir à la rééducation
du seul comportement.
Je me souviens de cette étude faite
par Françoise Facy et comman-
ditée par la Direction générale de
la santé sur l’impact possible
d’une campagne en faveur de
l’utilisation de matériel d’injec-
tion stérile, dans le but d’évaluer
l’opportunité de la mise en place
des programmes d’échange de
seringues. Un fort pourcentage
des toxicomanes avait effective-
ment changé ses comportements,
un petit groupe n’avait pas bougé
du tout, et un troisième faisait
exactement le contraire de ce
qu’on leur préconisait (ils réutili-
saient les mêmes seringues). Je
disais alors, qu’au-delà de la satis-
faction que pouvaient apporter
ces résultats aux pouvoirs publics,
ce qu’il fallait étudier, c’était sur-
tout ce dernier groupe. En
d’autres termes, je pense que
l’échec (ou la résistance) théra-
peutique est aussi intéressant que
la réussite. Il en va de même de
cette “évaluation” qui compare
de façon linéaire trois types d’ap-
proches, comme si tous les
patients partaient sur les mêmes
starting-blocks, habillés avec les
mêmes tenues de sport, aux
mêmes couleurs….
Alors, oui, l’évaluation des psy-
chothérapies est indispensable,
je la souhaite et la défend – mais
pas à n’importe quel prix. À
condition qu’elle soit convena-
blement ciblée.
Le Courrier : Cela conforte la
nécessité de réglementer les
professions, comme le stipule
l’amendement Accoyer ?
D.W : Je suis tout à fait pour que
la profession de psychothérapeu-
te soit réglementée et que n’im-
porte qui ne puisse plus se parer
sans contrôle de ce titre. On n’a
que trop vu les désastreux effets
de certaines pratiques incontrô-
lées ! En effet, il faut que l’on
puisse faire la différence entre les
approches de psychothérapie des-
tinées au bien-être (qui ont leur
place) et celles dont la finalité est
de soigner des malades. Cela
pose le problème de savoir où
commence la maladie et quelles
sont les compétences des uns et
des autres et les formations
nécessaires. Le risque de mettre
toutes les psychothérapies dans le
même panier, comme le veulent
les Verts en Belgique, par
exemple, est de vider ce champ
de la thérapie de ses médecins.
C’est ce que veut éviter l’amen-
dement Accoyer, à juste titre.
Reste maintenant à déterminer,
par décrets d’application, qui
aura légalement le droit d’exercer
cette profession ou, plus exacte-
ment, de quelles associations ou
sociétés pourront-ils se récla-
mer ? On voit actuellement
nombre de candidats se presser
aux portes de diverses sociétés ou
groupements qui ont introduit
dans leur libellé le terme de “psy-
chothérapie”, afin d’en obtenir
l’inscription-sésame qui leur est
nécessaire pour être déclarés
“psychothérapeutes” ! À l’in-
verse, nous voyons bien qu’un
excès de réglementations et de
contrôles (qui devraient être
nécessaires pour mettre en appli-
cation cet amendement), risque
d’être préjudiciable au dyna-
misme des psychothérapies.
Imaginons que, demain, le
contrôleur de service décrète
qu’au-delà ou en-deça de tant de
séances dans une cure, ou de telle
ou telle façon d’aborder le
patient… la méthode n’est pas
recevable !
Pourra-t-on marier
Freud et Confucius,
penser l’inconscient
en langue arabe ?
Le Courrier : Ces dernières
années, la psychanalyse a ten-
dance a être quelque peu
décriée, voire délaissée, au
profit d’autres recours psycho-
thérapiques ou pharmacolo-
giques. En particulier dans le
domaine des addictions. Avez-
vous enregistré cette désaffec-
tion relative ?
D.W. : Oui, d’une certaine façon.
Actuellement, l’API compte
entre 10 000 et 11 000 membres,
un nombre qui a augmenté régu-
lièrement (contre 3500 en 1970),
mais qui tend à stagner en Europe
et aux États-Unis. Sa progression
marque le pas aussi en Amérique
Latine. Et surtout – plus inquié-
tant –, les professionnels sont de
plus en plus vieux (60 ans d’âge
moyen !). En revanche, ce
nombre progresse beaucoup dans
les pays d’Europe orientale et en
Extrême-Orient. Reste à savoir si
l’on peut et veut marier Freud et
Confucius, “mondialiser” la psy-
chanalyse, et, dans ce cas, “mon-
dialiser” la pensée occidentale,
ou s’il est possible de penser l’in-
conscient dans la langue chinoise
ou arabe…
Quant à la désaffection enregis-
trée pour la psychanalyse, dans le
domaine des addictions par
exemple, on la doit à la mécon-
naissance des ressources de l’ap-
proche psychanalytique et à l’in-
suffisance, une fois de plus, de la
formation des psychiatres. Mais
de quoi parle-t-on ? De la psycha-
nalyse ou des psychothérapies
psychanalytiques ? De l’or ou du
cuivre ? Il faut théoriser aujour-
d’hui ces dernières, leur donner
un cadre de formation et d’ensei-
gnement, maintenir la psychana-
lyse dans la culture contemporai-
ne, aux côtés et avec les autres
approches… Pourquoi ne serait-il
pas possible de faire bénéficier un
toxicomane à la fois d’une théra-
pie psychodynamique et d’un
traitement à la méthadone ou à la
buprénorphine haut dosage ?
Comme si la nouvelle catégorie
e
n
t
r
e
t
i
e
n
e
n
t
r
e
t
i
e
n
I
n
t
e
r
v
i
e
w
L’amendement Accoyer
Adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale, le 8 octobre 2003,
l’amendement du député de Haute-Savoie et alors vice-président du
groupe UMP, Bernard Accoyer, ajoute un article au code de la santé
publique. Il vise à réglementer la pratique des psychothérapies et en
définir les différentes catégories par décret.
Il est ainsi rédigé :
“Les psychothérapies constituent des outils thérapeutiques utilisés dans
le traitement des troubles mentaux. Les différentes catégories de psy-
chothérapies sont fixées par décret du ministre chargé de la Santé. Leur
mise en œuvre ne peut relever que de médecins psychiatres ou de
médecins et psychologues ayant des qualifications professionnelles
requises par ce même décret (…). Les professionnels actuellement en
activité et non titulaires de ces qualifications, qui mettent en œuvre des
psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de la promulgation
de la présente loi, pourront poursuivre cette activité thérapeutique sous
réserve de satisfaire, dans les trois années suivant la promulgation de
la présente loi, une évaluation de leurs connaissances et pratiques par
un jury. La composition, les attributions et les modalités de fonctionne-
ment de ce jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et du ministre chargé de l’Enseignement supérieur.”

“addiction” résumait à elle
seule une pratique ! Toute noso-
logie est le reflet d’une théorie
explicative, et cette dernière est
elle-même liée à une pratique
thérapeutique (Foucault faisait
dériver “la folie ” de l’enferme-
ment…). Ce que l’on voit bien
se profiler derrière la mise en
avant de ce concept, c’est surtout
l’opposition entre deux modalités
de prise en charge : aux TCC, aux
médicaments, les symptômes ;
aux psychothérapies analytiques,
la prise en charge des troubles de
la personnalité. Or, j’ai des doutes
sur la pertinence de la notion
d’addiction, car, en réalité, les
diverses conduites que l’on
regroupe ainsi, mettent en œuvre
des ressources très différentes !
Existe-t-il vraiment un profil
commun entre une boulimique,
un alcoolique, un cocaïnomane,
un joueur compulsif, etc. ? Même
s’il existe des comparaisons pos-
sibles et si les “over-laps” sont
fréquents entre l’une et l’autre
des conduites considérées
comme des addictions, il n’est
pas sûr qu’on puisse leur pro-
poser une même “psychia-
trie”… Et, en définitive, je suis
persuadé que les points com-
muns entre ces différentes
conduites comptent bien moins
que leurs différences. C’est sur
celles-ci qu’il faut résolument
travailler.
F.A.R
51
L’expertise collective... de la discorde
•Le contexte : commandée dans le cadre du Plan santé mentale, mis en place par le ministre de la Santé
(Bernard Kouchner) en 2001, publiée le 1er mars 2004, en pleine polémique autour de la mise en œuvre
de l’amendement Accoyer, cette expertise collective de l’INSERM a beaucoup “fâché” : un certain nombre
de professionnels, dont Jacques-Alain Miller, gendre de Lacan, ancien président de l’Association mondiale
de psychanalyse (1992-2002), l’ancien ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy, qui l’a fait retirer du site
du ministère (“Vous n’en entendrez plus parler !” a-t-il assuré aux psychanalystes lacaniens lors du 7eforum
des psys…), William Dab, directeur général de la Santé, exaspéré par ce désaveu a démissionné… En
revanche, sa publication a été saluée avec enthousiasme par les associations “d’usagers”.
De quoi s’agit-il ? Rappel :
•Les procédures des expertises : il s’agit d’une expertise collective de l’Inserm (et non d’une confé-
rence de consensus), réalisée selon les procédures habituelles de ce genre de travail, mis en place en
1994, dont le but est d’analyser l’ensemble de la littérature scientifique et médicale disponible sur un
sujet d’actualité “sensible”.
Celles-ci consistent à définir un sujet, puis à rassembler les documents, ensuite à réunir un groupe d’experts
reconnus et indépendants qui en analysent le contenu, le discutent, en font la synthèse...
Depuis plus de dix ans, l’Inserm a publié une cinquantaine d’expertises collectives dans des domaines aussi
divers que les éthers de glycol, l’amiante, les troubles de la vision chez l’enfant, les échographies obstétri-
cales, les dépistages prénatals, la grippe, l’ostéoporose, la migraine, l’obésité… Elle a déjà réalisé plusieurs
expertises collectives dans le champ des troubles mentaux.
•L’expertise sur l’évaluation de l’efficacité des psychothérapies :
– Cette expertise-là a été réalisée à la demande du directeur général de la Santé et de deux associations
“d’usagers” : la Fédération nationale des patients et ex-patients psy (FNAP-PSY) et l’Union nationale des
amis et familles dses malades mentaux (UNAFAM).
– Les huit experts choisis ont passé au crible de l’analyse critique plus de mille études que la littérature inter-
nationale a consacrées à l’évaluation des psychothérapies. Ils en ont retenu 15 portant sur les approches
psychodynamiques (psychanalytiques), une cinquantaine sur les thérapies comportementales et cognitives
(TCC), et 22 sur les familiales et de couple.
– Seules ont été retenues les études portant sur des thérapies dont le but clairement défini était de soigner (et
non à des fins d’épanouissement personnel).
– Les troubles pris en compte étaient : chez l’enfant, les troubles anxieux, dépressifs, envahissants du déve-
loppement, des conduites et l’hyperactivité ; chez l’adulte, les troubles de l’humeur, les différentes formes
d’anxiété pathologique, la schizophrénie, les troubles du comportement alimentaire et de la personnalité. Il
fallaient que dans les études en question, ces troubles aient été évalués à l’aide de questionnaires et échelles
validées, remplies par le psychothérapeute ou le patient. Les experts ont retenu à ce propos le critère de la
persistance ou non des symptômes (d’où : biais fondamental puisque les TCC par exemple, n’agissent que
sur ceux-ci… Par ailleurs, il existe une véritable inflation d’articles concernant les TCC, et très peu les psy-
chothérapies de fond, analytiques).
– Résultats : globalement, les TCC ont “la meilleure note”, et plus particulièrement en ce qui concerne la
boulimie, mais les thérapies familiales “l’emportent” pour ce qui est de l’anorexie mentale. Les thérapies
psychodynamiques semblent plus efficaces pour prendre en charge les personnalités antisociales et
déprimées, alors que les deux autres approches “se débrouilleraient” mieux avec les schizophrènes.
(Pour lire les prises de position sur cette expertise, voir l’Express du 23 février 2004 ; Interview du Dr Jean
Cottraux, l’un des experts, dans Le Quotidien du Médecin du jeudi 17 mars 2005, “Le temps de la méde-
cine”).
e
n
t
r
e
t
i
e
n
e
n
t
r
e
t
i
e
n
I
n
t
e
r
v
i
e
w
Le Courrier des addictions
vous souhaite un bel été et vous remercie
de la fidélité de votre engagement.
Le prochain numéro paraîtra en septembre 2005
1
/
4
100%