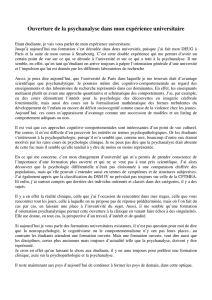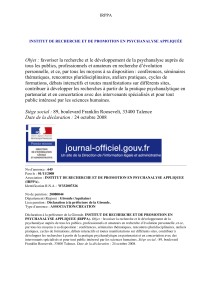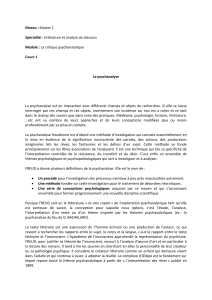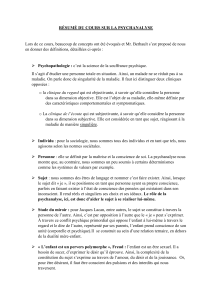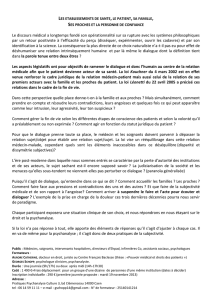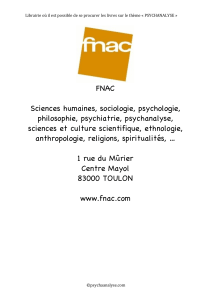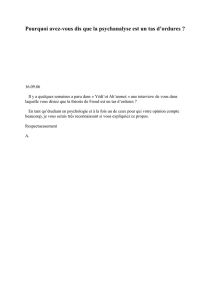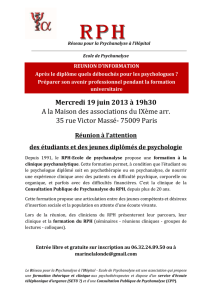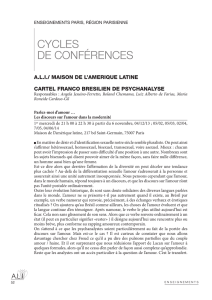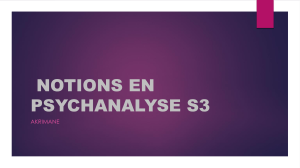Version finale – Fouchet De Neuter Rap psych – ss re¦üf biblio

Notre propos s’attachera ici à synthétiser succinctement le rapport établi en Janvier 2005, par les
Pr. P. Fouchet & P. De Neuter, membres du comité d’experts du groupe de travail
« psychothérapie » au Conseil Supérieur d’Hygiène. Il fait état de l’actualité des recherches
scientifiques menées sur l’efficacité de la psychanalyse et des psychothérapies s’en inspirant. Nous
renvoyons le lecteur à celui-ci pour les nombreuses références bibliographiques et plus de détails.
Si E. R. Kandel, prix Nobel de médecine, reconnaît que la psychanalyse a été révolutionnaire dans
la compréhension de la vie mentale (processus inconscients, déterminisme psychique, sexualité
infantile, et irrationalité de la motivation humaine), il avance également la nécessité d’établir des
fondements davantage scientifiques pour la psychanalyse, en instaurant un dialogue avec les
neurosciences. Toutefois, ces deux sciences recourent à des langages qui diffèrent tellement qu’un
dialogue entre elles, annuleraient leurs spécificités. La validation scientifique de la psychanalyse
implique dès lors une méthodologie adaptée à son objet, tout en restant cohérente avec son cadre
théorique de référence. Cela vaut d’ailleurs, pour l’étude des psychothérapies, en général.
La spécificité de l’approche psychanalytique est qu’elle relève d’une pratique de la parole centrée
sur le sujet, c’est-à-dire d’une pratique du cas par cas qui se construit dans la rencontre et
essentiellement dans sa dimension subjective. C’est la base même de ses fondements théoriques,
de sa méthodologie et de son éthique. Même si la psychanalyse ne vise pas exclusivement la
disparition des symptômes, elle part de la demande du sujet pour l’accompagner dans l’élaboration
de ses propres solutions, tout en tenant compte de la place de ce symptôme. La psychanalyse
s’occupe donc au premier plan, de la souffrance psychique mais de dire aussi que celle-ci apparaît
actuellement souvent liée à une fragilisation des repères que les structures sociales sont censées
ofrir à chaque individu pour s’approprier son existence. C’est d’ailleurs en raison de ces
changements sociaux que des psychanalystes ont aménagé le cadre de leur pratique avec d’autres
champs (médecine, social et judiciaire), et sous le couvert d’une évaluation sur leur pertinence, leur
efficacité, et leurs limites. Si certaines de ces recherches ont tenté, non sans difficulté, de se réaliser
dans un cadre expérimental stricte, la majorité d’entre elles s’inscrit plutôt dans une perspective
d’étude de cas afin de rendre compte de la complexité de la subjectivité et des processus psychiques
par lesquels via la relation thérapeutique, se dénoue la souffrance liée à l’histoire du sujet. Il existe
donc une série de recherches qui ont tenté d’évaluer l’efficacité du traitement psychanalytique en
s’appuyant sur les observations des thérapeutes, les enregistrements des entretiens, les observations
des superviseurs et des proches des patients et, progressivement, l’utilisation des outils statistiques
et l’élaboration d’instruments de mesure standardisés. La plupart de ces recherches ont été menées
sur plusieurs années avec des échantillons basés sur des centaines de cas.
C’est en 1917 que les recherches sur la psychanalyse commence et au fil du temps, elles mettront
en évidence son efficacité pour les cas de névrose. Elles soulignent aussi que les résultats sont
meilleurs lorsqu’elle se termine par consentement mutuel et confirment l’importance de la
formation et de l’expérience du psychothérapeute. De récentes études lui reconnaissent également
une efficacité dans le traitement de troubles plus spécifiques tels que les troubles de la personnalité,
les cas de dépression majeur lorsqu’elles accompagnent la prise d’un antidépresseur ou un suivi
ambulatoire et, pour les troubles de panique et les états de stress post-traumatique. D’autres travaux
ont tenté également de tenir compte de la complexité de la réalité clinique, les troubles
psychopathologiques isolés par le DSM se présentant rarement à l’état pur. A cet égard, citons les
recherches menées par Leuzinger-Bohleber & al. (2003) qui ont montré :
- une « ascension sociale » après la psychothérapie (84,3% des cas),
- une amélioration de leur état général (75%),
- des changements positifs sur leur condition psychique, leur croissance intérieur et leur vie
relationnelle lors de traitement au long court (80%),
- et une meilleure capacité (70 à 80%) à se confronter aux évènements de la vie, une plus
grande estime de soi, davantage d’équilibre dans les humeurs, ainsi que la satisfaction de
leur propre vie.

L’étude montre aussi que les analystes ont eu un jugement plus sévère en comparaison de celui de
leurs anciens patients et que les échelles d’évaluation nous indiquent que ces derniers ne sont plus
perturbés au point d’être diagnostiqués malades. La recherche montre également que les longues
thérapies aident à réduire les coûts en termes de diminution des jours chômés et/ou
d’hospitalisation après le traitement, par une créativité et une efficacité professionnelle accrûe, par
l’engagement professionnel de patients sans emploi ou par plus d’implication dans des enjeux
sociaux et publics.
L’analyse et la comparaison des recherches entre elles, montrent peu de différences dans les
résultats des psychothérapies guidées par une théorie cohérente et pratiquées depuis longtemps. Le
rapport de l’INSERM (2004) fait néanmoins l’exception en montrant la supériorité des thérapies
cognitivo-comportementales, mais son étude présente des biais méthodologiques et ses critères
favorisent certaines psychothérapies, notamment, celles se limitant à traiter un trouble observé, et
sont inappropriés dans le cas de celles qui visent à repérer et modifier les structures fonctionnelles
dont le trouble est le symptôme.
Cela dit, réaliser une étude sur les psychothérapies présente un problème déontologique et
méthodologique relativement important puisqu’il est inadmissible sur le plan humain, de répartir
aléatoirement un ensemble de patients qui consultent pour des problèmes :
- soit dans un groupe expérimental où ils recevront un traitement,
- soit dans un groupe contrôle où ils seront mis sur une liste d’attente,
- ou pire, dans un groupe « placebo » où le thérapeute est chargé d’avoir un minimum de
contact avec le patient et de ne pas utiliser les éléments supposés actifs dans la thérapie,
voire de faire une « pseudo-thérapie » ou une « anti-thérapie ».
Enfin, la validation scientifique à partir de l’évaluation quantitative apparaît difficilement adaptables
à l’objet des psychothérapies psychanalytiques parce qu’elle ne rend pas compte des effets d’une
pratique centrée sur les difficultés liées au « métier de vivre » avec son lot de questions relatives à
l’amour, à la sexualité et plus généralement au sens de la vie ; lot que rencontre tout sujet au cours
de son existence. Dès lors, les critères de recherche utilisés pour étudier l’efficacité de la
psychanalyse, se rapprochent plutôt de ceux des autres sciences humaines, elles-aussi, confrontées
à la difficulté, ou l’impossibilité de se conformer à une validation sur le modèle des sciences de la
nature (biologie, chimie, physique, etc.). De plus, nombre d’epistémologues dénonce un certain
scientisme à imposer un unique type de scientificité (settting expérimental) à l’ensemble des
sciences humaines. Et de noter que l’étude du cas aura été particulièrement propice à réinterroger
la théorie et la pratique psychanalytique (nouvelles hypothèses et/ou découverte de faits ou de liens
nouveaux) et que cette méthode tient compte du style et de la position du psychothérapeute ainsi
que de l’effet de ses interventions.
Ne pouvant énumérer ici l’ensemble des recherches sur la psychanalyse, lesquelles ont donné suite
à des publications nationales et internationales, nous indiquerons néanmoins quelques unes de ces
grandes lignes s’étant développées ces dernières années :
- les nouvelles approches de certains phénomènes psychosomatiques ;
- le traitement plus spécifique des états-limites et de certains sujets présentant un
fonctionnement de type psychotique sans que la psychose ne soit véritablement
déclenchée ;
- à partir des années ’60, mais surtout ’80, de nouvelles perspectives d’accompagnement
psychothérapeutique dans la clinique des psychoses et de l’autisme chez l’adulte, l’enfant et
l’adolescent ;
- ainsi que l’approche institutionnelle de pathologies graves (adultes, enfants et adolescents
psychotiques, névrosés graves ou borderline), y compris dans la clinique de l’autisme ;
Cette clinique centrée sur la singularité du sujet tente de prendre en compte, aussi bien dans le
travail thérapeutique que dans l’évaluation de celui-ci, non seulement les symptômes, mais aussi le

contexte de leur survenue et leurs divers déterminants psychiques (histoire et inscription du sujet
dans le tissu social, ses relations familiales et conjugales, et les diverses questions existentielles qui
se posent à lui).
Soulignons également l’existence des recherches inhérentes au processus de formation initiale et
permanente du psychanalyste. Nombre de travaux de recherche et d’évaluation s’est mis en place
dans les associations psychanalytiques via les séminaires de discussions théorico-cliniques, les
supervisions et contrôles individuels et/ou de groupe, les analyses didactiques et les procédures
dites de la « passe ». Ces méthodes ont leurs limites, mais elles ont l’avantage de respecter la
complexité de la nature humaine, et assurent un contrôle permanent de la pratique qui s’intègrent
à la fois dans une dynamique de recherche et dans la formation continue du clinicien.
Pour terminer, nous ne pouvons rester sans évoquer les témoignages spontanés des analysants eux-
mêmes (en dehors de la procédure de la passe), que ce soient les déclarations publiques de
personnalités, issues d’horizons très divers, sur les bénéfices qu’elles ont retirés de leur cure
psychanalytique – comme Georges Perec, François Cheng, Catherine Clément, Alain Cuny, Gaston
Defferre, Catherine Deneuve, Isabelle Adjani, Dominique Fernandez, Marie-Antoinette Fouque,
Anaïs Nin, Françoise Rey, Françoise Giroud, François Wahl, Madeleine Chapsal, Valéry Giscard
d’Estaing, Eric Cantona, Yannick Noah, etc. – ou les récits de cure plus détaillés publiés par
d’anciens analysants, comme ceux de Béatrix Beck, Marie Cardinal, Jean-Guy Godin, Gérard
Haddad, Pierre Rey, Paul Roazen, François Weyergans, Smiley Blanton, Abram Kardiner, etc. Ces
évaluations subjectives ne sont-elles pas tout aussi pertinents que celles produites dans le cadre
d’études dites objectives qui laissent souvent peu de place à la parole du sujet ?
Laurent Duvivier, le 9 septembre 2016
1
/
3
100%