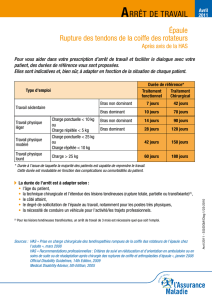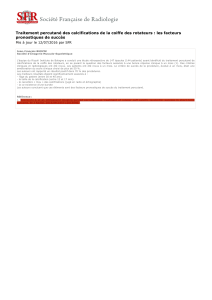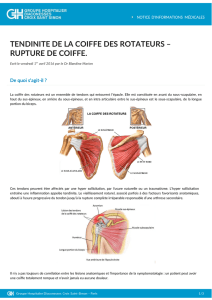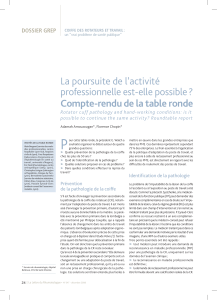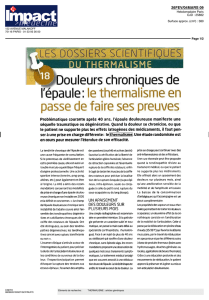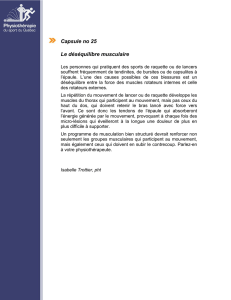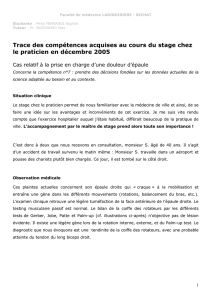Lire l'article complet

La Lettre du Rhumatologue - n° 309 - février 2005
13
Rupture de la coiffe et omarthrose excentrée
Rotator cuff-tear and rotator cuff arthropathy
"
É. Noël*
#L’omarthrose excentrée est toujours la consé-
quence d’une rupture ancienne et massive de
la coiffe des rotateurs.
#
La dégradation fonctionnelle (douleurs et
fonction) et la réduction de l’espace sous-
acromial au fil des mois et des années laissent
supposer que l’évolution d’une rupture de la
coiffe se fait vers une extension de la rupture.
#À l’examen clinique, les amplitudes passives
deviennent limitées à mesure que l’atteinte
de la gléno-humérale progresse.
#Il existe de façon constante une amyotrophie
bien visible de la fosse sous-épineuse et une
amyotrophie palpatoire de la fosse sus-épi-
neuse.
#
Il est important de rechercher une rupture du
biceps car, dans ce type de pathologie, s’il n’est
pas rompu, le biceps peut être luxé ou subluxé
et responsable d’importantes douleurs.
#L’omarthrose excentrée va évoluer radiogra-
phiquement avec une vitesse variable, en
fonction de paramètres mal connus, soit au
niveau de l’articulation gléno-humérale, soit
au niveau de l’acromion.
Mots-clés :
Rupture de la coiffe des rotateurs -
Omarthrose - Acromion.
Keywords: Rotator cuff-tear - Osteoarthritis of
the shoulder - Acromion.
Points forts
DÉFINITION DE L’OMARTHROSE EXCENTRÉE
Elle est toujours la conséquence d’une rupture ancienne et mas-
sive de la coiffe des rotateurs. Elle est caractérisée sur le plan
radiographique par un pincement de l’espace sous-acromial (dis-
tance mesurée, sur un cliché standard de face en rotation neutre,
entre le bord supérieur de la tête humérale et le bord antéro-infé-
rieur de l’acromion) s’accompagnant de remaniements dégéné-
ratifs de type arthrosique de la partie supérieure de la tête humé-
rale et de l’extrémité inférieure de l’acromion. Cette arthrose
sous-acromiale peut évoluer et aboutir à la constitution d’une
néo-articulation sous-acromiale (figure 1).
L’évolution peut se faire soit vers une ostéolyse progressive de
l’acromion et/ou de la tête humérale à l’occasion de crises hyper-
algiques de type épaule sénile, soit vers l’association avec une
arthropathie gléno-humérale, réalisant alors le tableau complet
de l’omarthrose excentrée, ou arthrose sur rupture massive de la
coiffe des rotateurs (figures 2 et 3, p. 14).
ACTUALITÉS SUR L’ARTHROSE DE L’ÉPAULE
*Rhumatologue, clinique Sainte-Anne-Lumière, Lyon.
Figure 1. Arthrose sous-acromiale avec perte du cintre omo-huméral et
néo-articulation sous-acromiale.

La Lettre du Rhumatologue - n° 309 - février 2005
14
ACTUALITÉS SUR L’ARTHROSE DE L’ÉPAULE
La constatation d’une omarthrose excentrée en consultation
amène toujours le praticien à retrouver un tableau ancien de dou-
leurs et de gêne fonctionnelle de l’épaule, correspondant à une
rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs.
C’est cette rupture de coiffe qui constitue le lit de l’omarthrose
excentrée, alors que, dans l’omarthrose centrée, la coiffe est
intacte ou présente parfoisune petite lésion de coiffe qui est tou-
jours secondaire à l’omarthrose.
ÉVOLUTION NATURELLE DES RUPTURES
TRANSFIXIANTES DE LA COIFFE DES ROTATEURS
Elle est mal connue, car son étude nécessite un suivi prolongé,
vu la lenteur d’évolution de cette pathologie. À ce jour, aucune
étude prospective n’a permis de suivre la dégradation progres-
sive des lésions tendineuses de l’épaule au décours d’une rup-
ture de la coiffe des rotateurs, ni de déterminer en particulier le
temps que met l’épaule pour se dégrader et évoluer vers une
arthrose sous-acromiale.
Dans les études rétrospectives, les ruptures transfixiantes de la coiffe
traitées médicalement ont assez rarement bénéficié d’une imagerie
initiale, fiable et analysable a posteriori (arthroscanner ou IRM), car
ce genre d’exploration est plutôt réservé au contexte préopératoire.
La pathologie dégénérative tendineuse étant lentement évolutive,
il faut avoir un recul suffisant pour pouvoir juger de son évolu-
tion. Cependant, les travaux publiés avec un recul supérieur à
4ans sont peu fréquents. Les quelques publications existant dans
la littérature sur le sujet montrent une aggravation fonctionnelle
avec les années et, indirectement, une aggravation anatomique
(évolution radiographique), même si aucune étude d’imagerie
non radiographique ne l’a clairement démontrée. Ainsi, Wallace
et Wiley (1) ont montré que, sur une population de 36 travailleurs
manuels (75 % ayant eu une arthrographie), 81 % gardaient des
douleurs et avaient une force au CYBEX diminuée en moyenne
de 60 %, avec un recul moyen de 5 ans.
Caroit et al. (2),sur une série de 71 patients, retrouvaient 40 %
de bons résultats dans une étude multicentrique (évaluation selon
l’indice algo-fonctionnel de Patte), avec un recul moyen de 6 ans.
Dans cette série, seuls 21 % des patients avaient eu initialement
un diagnostic arthrographique. Les meilleurs résultats concer-
naient les sujets ayant eu une amélioration clinique à court terme,
et les moins bons ceux ayant eu le plus grand nombre d’infil-
trations.
Figure 3. Omarthrose excentrée avec conservation du cintre omo-huméral,
arthrose sous-acromiale et arthrose gléno-humérale.
Figure 2. Omarthrose excentrée avec arthrose sous-acromiale.

La Lettre du Rhumatologue - n° 309 - février 2005
15
Itoi et Tabata (3) ont publié une étude portant sur une série de
62 épaules ayant une rupture de la coiffe des rotateurs prouvée par
arthrographie, avec un recul moyen de 3,4 ans. Selon les critères
de Wolfgang, le résultat obtenu était bon ou excellent dans 82 %
des cas. Dans 23 cas, le recul était supérieur à 5 ans. Les auteurs
ont montré que le résultat se dégradait à partir de la 6eannée sui-
vant le diagnostic initial. La comparaison rétrospective des bons
(n = 15) et des mauvais résultats (n = 8), avec un recul moyen de
6 ans, montrait que les patients ayant à l’examen initial les
meilleures amplitudes actives et une force en abduction conservée
au testing manuel avaient les meilleurs résultats.
Bokor et al. (4) ont publié une série de 53 patients ayant une rup-
ture de la coiffe prouvée par arthrographie et revus avec un recul
moyen de 7,6 ans. Subjectivement, 74 % des 39 patients inter-
rogés étaient satisfaits. Trente-quatre ont été revus cliniquement
et évalués selon le score de l’UCLA : 56 % avaient un résultat
satisfaisant. Ce résultat passait à 63 % pour ceux pris en charge
dans les 3 premiers mois suivant le début des symptômes et
s’améliorait à mesure que le recul augmentait. Ainsi, 61,5 % des
13 malades ayant un recul de plus de 9 ans avaient un résultat
satisfaisant pour le score de l’UCLA. Objectivement, à la révi-
sion, 94 % présentaient une perte de force et 56 % une amyotro-
phie significative.
En 1993, nous avions étudié rétrospectivement (5) une série de
90 épaules avec rupture arthrographique de la coiffe. L’évalua-
tion était faite selon le score de Constant, avec un recul moyen
de 4,7 ans par rapport au début des douleurs. Les excellents et
bons résultats représentaient 40 % des cas. Nous avions retrouvé
72,5 % d’espaces acromio-huméraux réduits par rapport à la
radiographie initiale (recul moyen de 3,8 ans), ce qui témoigne
indirectement de l’évolution des lésions tendineuses.
Nové-Josserand et al. (6) ont étudié les paramètres qui favori-
sent cette ascension de la tête humérale dans les suites d’une
rupture de la coiffe des rotateurs. Deux cent soixante-quatre rup-
tures transfixiantes de la coiffe des rotateurs (ruptures du sus-
épineux isolées ou associées à des ruptures du sous-épineux et/ou
du sous-scapulaire) opérées entre 1984 et 1994 ont été inclues.
Parmi cette population initiale, 84 épaules ont eu un arthros-
canner permettant l’analyse a posteriori des lésions de la coiffe
et de l’état musculaire, ces lésions ayant ensuite toutes été
confirmées lors de l’intervention chirurgicale. Les auteurs ont
retrouvé une relation significative entre la hauteur de l’espace
sous-acromial (EAH) et l’ancienneté des symptômes (p < 0,05).
La hauteur moyenne de l’EAH et le pourcentage de pincement
de l’espace sous-acromial (< 7 mm sur un cliché standard en
position neutre) variaient en fonction de la lésion anatomique de
la coiffe (tableau I).
En ce qui concerne la longue portion du biceps (LPB), seule une
luxation (en dedans par rapport au trochin) s’accompagnait d’une
réduction significative de l’EAH moyen (LPB non rompue : EAH
moyen de 9,2 mm, LPB rompue : EAH moyen de 9 mm, et LPB
luxée : EAH moyen de 5,5 mm et 71 % d’EAH < 7 mm).
Par ailleurs, l’état des muscles de la coiffe, et en particulier leur
dégénérescence graisseuse (7), peut, dans certains cas, influen-
cer fortement la hauteur de l’EAH. Il existait une relation modé-
rément significative (p < 0,05) entre la dégénérescence du sus-
épineux et la diminution de l’EAH (6). Il n’existait pas, en
revanche, de relation entre la dégénérescence musculaire du sous-
scapulaire et la diminution de l’EAH, alors qu’il y avait une très
forte relation entre la dégénérescence graisseuse du sous-épineux
(stade IV) et la hauteur de l’EAH (EAH < 7 mm dans 100 % des
cas et EAH moyen = 2,2 mm).
En résumé, ces constatations de dégradation fonctionnelle (dou-
leurs et fonction) et de réduction de l’espace sous-acromial au fil
des mois et des années laissent supposer que l’évolution d’une
rupture de coiffe se fait vers une extension de la rupture. Celle-
ci s’accompagne, plus ou moins rapidement selon la localisation
de la rupture et l’âge du patient, d’une ascension de la tête humé-
rale (arthrose sous-acromiale), puis d’une arthropathie gléno-
humérale (pincement gléno-huméral avec ostéophyte huméral
témoignant de l’ancienneté des lésions).
PRÉSENTATION CLINIQUE DES OMARTHROSES
EXCENTRÉES
Sur le plan des symptômes, elles peuvent se présenter sous plu-
sieurs aspects :
–être symptomatiques chez des patients qui se sont bien adap-
tés et qui ont peu de douleurs, gardant une élévation antérieure
active normale et ayant essentiellement une perte de force maté-
rialisée par une fatigabilité à l’effort, bras au-dessus du niveau
des épaules ;
–se traduire par des douleurs mécaniques dans la journée, avec
une recrudescence nocturne ;
–s’exprimer par une perte de force maximale avec soit une épaule
pseudo-paralytique (figure 4, p. 16),soit une perte de force com-
plète en rotation externe se traduisant par le “signe du clairon”
(figure 5, p. 16) ;
–évoluer par crises hyperalgiques sur un fond douloureux chro-
nique. Ces crises s’accompagnent d’un épanchement intra-arti-
culaire de l’épaule et parfois d’un hématome, dans le cadre de la
classique épaule sénile hémorragique décrite initialement par De
Sèze. Ce type de tableau a été repris et décrit ultérieurement par
d’autres auteurs (Milwaukee shoulder,épaule destructrice rapide,
Tableau I. EAH moyen et pourcentage d’EAH inférieur à 7 mm en
fonction de la lésion de coiffe (6).
EAH moyen Épaules avec EAH
(mm) < 7 mm (%)
Sus-épineux 9,5 4,5
Sus- et sous-épineux 7,5 28
Sus- et sous-épineux +
sous-scapulaire 5,4 63

La Lettre du Rhumatologue - n° 309 - février 2005
16
ACTUALITÉS SUR L’ARTHROSE DE L’ÉPAULE
Cuff-tear arthropathy). Chaque crise douloureuse s’accompagne
d’une aggravation de l’état radiographique, avec en particulier une
ostéolyse progressive de l’acromion et/ou de la tête humérale.
À l’examen clinique, les amplitudes passives deviennent limitées
à mesure que l’atteinte de la gléno-humérale progresse.
Par ailleurs, outre la perte de force parfois maximale avec épaule
pseudo-paralytique ou “signe du clairon” (perte de force complète
sur les rotateurs externes), il existe de façon constante une amyo-
trophie bien visible de la fosse sous-épineuse et une amyotrophie
palpatoire de la fosse sus-épineuse. Il est important de rechercher
une rupture du biceps car, dans ce type de pathologie, si le biceps
n’est pas rompu, il peut être luxé ou subluxé et responsable d’im-
portantes douleurs.
Lors des “crises articulaires”, un volumineux hématome de
l’épaule et du bras peut être présent (épaule sénile hémorragique),
alors qu’une tuméfaction avec épanchement peut être présente
de manière chronique dans certains cas.
La présence d’un kyste acromio-claviculaire (figures 6, 7) est
classique mais rare. Ce kyste peut être de taille variable (de la
taille d’une prune à celle d’un pamplemousse) ; il traduit la pré-
sence d’un important épanchement articulaire s’échappant à tra-
vers l’articulation acromio-claviculaire pour former cette tumé-
faction (même mécanisme que pour le kyste poplité).
ÉVOLUTION RADIOGRAPHIQUE
DES OMARTHROSES EXCENTRÉES
Une fois l’omarthrose excentrée installée, elle va évoluer radio-
graphiquement avec une vitesse variable, en fonction de para-
mètres mal connus. Cette évolution va se faire soit au niveau de
l’articulation gléno-humérale, avec évolution de l’arthropathie,
soit au niveau de l’acromion, avec phénomènes d’ostéolyse pro-
gressive (figure 8).
Figure 5. Signe du clairon : disparition complète de la rotation externe active.
Figure 6. Kyste acromio-claviculaire compliquant une rupture de la coiffe
des rotateurs.
Figure 7. Kyste acromio-claviculaire vu en IRM.
Figure 4. Épaule pseudo-paralytique.

La Lettre du Rhumatologue - n° 309 - février 2005
17
CONCLUSION
Il est indiscutable que l’évolution d’une rupture de la coiffe des
rotateurs va se faire vers une omarthrose excentrée, qui, sur le plan
de sa stricte définition, associe une arthrose sous-acromiale et une
arthrose gléno-humérale. Cette définition n’est pas forcément
consensuelle. La durée de cette évolution n’est pas bien connue,
et il en est de même pour les facteurs qui peuvent modifier cette
durée. La prise en charge thérapeutique de ces omarthroses excen-
trées est du domaine du traitement symptomatique (médical ou
chirurgical), avec des résultats variables. Il est donc nécessaire de
mieux connaître l’évolution naturelle des ruptures de la coiffe, pour
mieux connaître les risques éventuels d’évolution vers l’omarthrose
excentrée, car, une fois cette pathologie présente, elle peut être
extrêmement invalidante et difficile à prendre en charge.
#
Bibliographique
1. Wallace WA, Wiley AP. The long-term results of conservative management of
full-thickness tears of the rotator cuff. J Bone Joint Surg 1986;68 (B):162.
2. Caroit M, Rouaud JP, Texier T et al. Le devenir des ruptures et des perfora-
tions complètes de la coiffe des rotateurs de l’épaule non opérées. Rev Rhum
1989;56:815-21.
3. Itoi EJ, Tabata S. Conservative treatment of the rotator cuff tears. Clin Orthop
1992;275:165-73.
4. Bokor DJ, Hawkins RJ, Hukell GH, Angelo RL, Schickendantz MS. Results of
non operative management of full-thickness tears of the rotator cuff. Clin Orthop
1993;294:103-10.
5.Noël É. Les ruptures de la coiffe des rotateurs. Résultats du traitement conser-
vateur. In: Simon L, Pelissier J, Herisson Ch (eds). Actualités en rééducation
fonctionnelle et réadaptation, 19esérie. Paris: Masson, 1994:113-8.
6. Nové-Josserand L, Lévigne C, Noël É, Walch G. The acromio-humeral inter-
val. A study of the factors influencing its height. Rev Chir Orthop 1996;82(5):
379-85.
7. Goutallier D, Postel JM, Bernageau J, Lavau L, Voisin MC. Fatty muscle
degeneration in cuff ruptures. Pre and post operative evaluation by CT scan.
Clin Orthop 1994;304:78-83.
Figure 8. Aspect d’ostéolyse de l’acromion apparue au décours d’épan-
chements articulaires à répétition sur une épaule présentant une rupture
massive de la coiffe des rotateurs.
1
/
5
100%