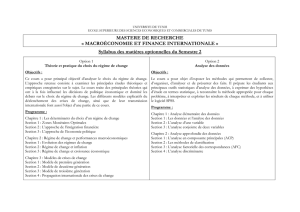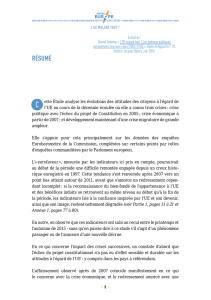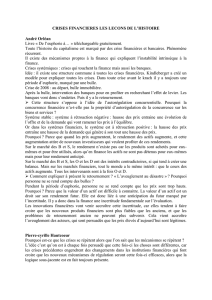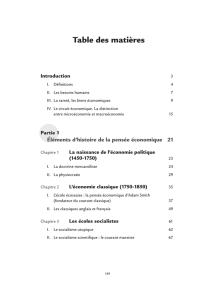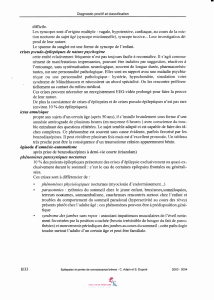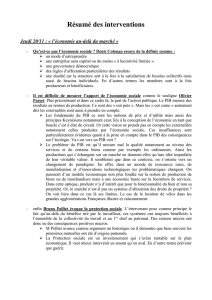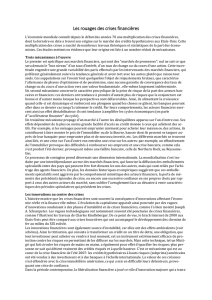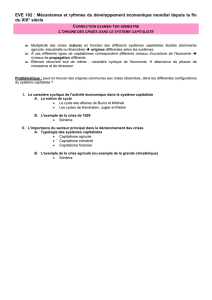Crise : le retour de l’État ? REGARDS sur

documentation
La
Française
REGARDS
sur l’actualité
362
Juin-Juillet 2010
Également dans ce numéro :
L’avenir du monde agricole en débat
Comment sortir la zone euro de la crise ?
Les élections régionales de 2010
La question prioritaire de constitutionnalité : les enjeux
Crise : le retour
de l’État ?

REGARDS
sur l’actualité
Équipe de rédaction
Isabelle Flahault
(rédactrice en chef)
Céline Persini
(rédactrice)
Martine Paradis
(secrétaire)
Comité scientifique
Jean-François Théry
(président)
Anne Belot
Éliane Mossé
Jean-Louis Quermonne
Crédits photographiques
p. 2 AFP Éric Piermont ; p. 4 AFP Pierre Verdy ; p. 6 AFP Aris Messinis ; p. 21 AFP Archives ;
p. 43 AFP Éric Feferberg ; p. 55 AFP Bertrand Guay ; p. 65 AFP Joël Saget ;
p. 73 AFP Patrick Kovarik.
Photographie de couverture
© Images.com/Corbis
Conception graphique
Studio des éditions
Direction de l'information légale et administrative
Avertissement au lecteur
Les opinions exprimées dans les articles n’engagent que les auteurs.
Ces articles ne peuvent être reproduits sans autorisation.
Celle-ci doit être demandée à :
Direction de l'information légale et administrative
29, quai Voltaire
75344 Paris cedex 07
© Direction de l'information légale et administrative
«En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du code de la propriété intellectuelle du
1er juillet 1992, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente publication
est strictement interdite sans autorisation expresse de l’éditeur.
Il est rappelé à cet égard que l’usage abusif et collectif de la photocopie met en danger l’équilibre
économique des circuits du livre ».

1
édito
rial
La crise fi nancière et économique a suscité de
nouvelles réfl exions quant aux relations entre
État et marché. Les plans de relance et la volonté
d’encadrer le monde de la fi nance témoigneraient du retour de l’État
après une période de délégitimation de l’intervention politique dans le
fonctionnement du marché. Mais en quels termes s’analyse ce retour de
l’État ? Comme un retour du politique dans l’économique, et/ou le retour
de l’État providence ? Trois ans après le début de la crise, l’annonce du
plan d’économie budgétaire par le Premier ministre français, le 6 mai
2010, sous la menace de la possible contagion de la tempête fi nancière
et économique grecque, n’infi rme-t-elle pas cette dernière hypothèse ?
Dans ce contexte, comment appréhender le nouveau rôle économique de
l’État ?
Selon Bruno Bernardi, depuis quelques années, les États se comporteraient
moins comme des acteurs économiques face au marché que comme des
facilitateurs de sa dynamique propre. Ainsi, n’assisterions-nous pas à un
renforcement du rôle social et économique de l’État mais, sur le court
terme, à une confi rmation de la tendance antérieure consistant à le
cantonner dans un rôle de régulateur.
Nonobstant, si la crise actuelle a pu être comparée avec la crise de 1929,
les conséquences de cette dernière ont été évitées grâce aux interventions
massives des banques centrales américaine et européenne, et aux plans de
relance engagés. La crise a montré que ces stratégies, « économiquement »
impensables auparavant, sont devenues brusquement possibles, voire même
la politique « normale » à mener face à cette conjoncture. Le choix de la
régulation du marché n’est donc pas seulement technique mais politique.
Ainsi, sur le long terme, la crise a tout au moins rappelé les potentialités
du politique dans l’économie. À la lumière de ce constat, elle a légitimé le
rôle structurel de l’État dans la régulation du marché mais aussi au service
de la croissance économique, pour limiter l’impact négatif des récessions
sur la population et sur les entreprises, tout en créant les bases sociales et
économiques nécessaires à une sortie de crise et une croissance durables à
même d’assurer la réduction des défi cits publics.
Céline PERSINI

S
ommaire
Sommaire
I Éditorial
Instantanés
4 L’avenir du monde agricole en débat
Zoom : Le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche
6 Comment sortir la zone euro de la crise ?
Deux questions à Agnès Bénassy-Quéré
Dossier
Crise : le retour de l’État ?
8 État, marché, et société civile
(Entretien avec Bruno Bernardi)
19 Les crises dans l’histoire
(Pierre Bezbakh)
Encadré :
24 Comment la crise actuelle se compare-t-elle à la Grande Dépression ?
L’évolution du CAC 40 de novembre 2007 à octobre 2008.

3
28 La régulation est-elle la solution pour éviter
les crises économiques ?
(Robert Boyer)
Encadré :
47 Glossaire
48 Repenser le rôle de l’État dans la croissance :
perspectives d’après-crise
(Philippe Aghion et Julia Cage)
Encadrés :
53 - L’État face à la crise
56 - Réduire les défi cits publics
Éclairages
60 Les élections régionales de 2010 : grève des urnes et votes de crise
(Anne Muxel)
70 Les enjeux politiques de la question prioritaire
de constitutionnalité
(Dominique Rousseau)
Encadrés :
71 - La QPC de 1990 à 2010
74 - Première censure de lois par QPC
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
1
/
83
100%