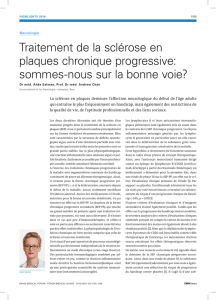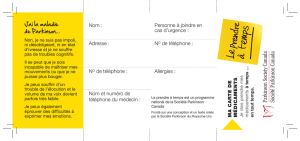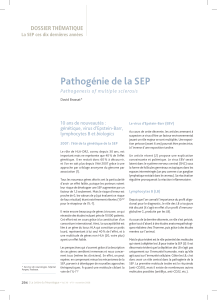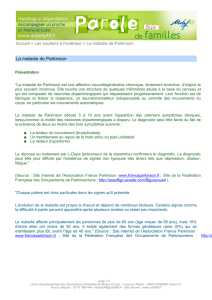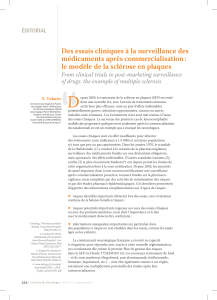Conséquences fonctionnelles de la sclérose en plaques et de la

Conséquences fonctionnelles de la sclérose en plaques
et de la maladie de Parkinson
P. Gallien, A. Duruflé-Tapin et V. Kerdoncuff
INTRODUCTION
La sclérose en plaques et la maladie de Parkinson
sont deux affections neurologiques dont l’ex-
pression pelvi-périnéale pose parfois des pro-
blèmes importants de prise en charge thérapeu-
tique. Les problèmes vésico-sphinctériens, de
sexualité et les troubles digestifs observés pour
chacune de ces deux maladies seront successive-
ment abordés.
SCLÉROSE EN PLAQUES
La sclérose en plaques est une affection démyé-
linisante du système nerveux central du sujet
jeune, touchant deux fois plus souvent la femme
que l’homme. En France, la prévalence atteint
1/1 000 habitants avec une incidence annuelle de
5/100 000. Cette affection se caractérise par une
dissémination spatio-temporelle des lésions qui
peuvent être corticales ou/et médullaires (1, 2).
La conséquence directe est un polymorphisme
extrêmement important de la symptomatologie
clinique, notamment sur le plan vésico-sphincté-
rien (3, 4).
Près de 80 % des patients présentent des
troubles vésico-sphinctériens, un patient sur deux
des troubles du transit intestinal et jusqu’à 70 %
des patients ont des troubles génito-sexuels (5).
Le retentissement de ces troubles sur la qualité de
vie est majeur, d’autant plus qu’ils concernent
une population jeune à prédominance fémi-
nine (6). Chez ces patientes se pose le problème
de l’association des troubles liés à l’atteinte
neurologique, aux éventuels traumatismes obsté-
tricaux et, donc, de la conduite à proposer à ces
femmes lors d’une grossesse pour limiter le
risque périnéal.
Troubles vésico sphinctériens
La survenue des troubles urinaires est variable
dans l’évolution de la maladie. Ils peuvent être
inauguraux dans 2 à 34 % des cas survenant par-
fois de façon isolée. Leur fréquence s’accroît
avec l’importance du handicap coté sur l’échelle
de Kurtzke (7). La symptomatologie est poly-
morphe (3, 4, 8). Le tableau le plus fréquent
associe pollakiurie, impériosité avec ou sans
incontinence. La dysurie est diversement appré-
ciée par les auteurs : dysurie d’attente, de
poussée, jet urinaire haché et impression de ne
pas bien vider sa vessie. La présence d’un résidu
postmictionnel dans ce contexte est fréquente.
L’incontinence est le plus souvent associée aux
impériosités, mais une composante d’inconti-
À un moment ou à un autre de l’évolution de la sclérose en plaques (SEP), quatre malades sur
cinq souffrent de troubles vésico-sphinctériens et un malade sur deux d’une incontinence
fécale. Chez les parturientes atteintes de sclérose en plaques, les modalités d’accouchement et
le pronostic fonctionnel périnéal qui en découle sont moins dépendants de la maladie neuro-
logique que des contraintes obstétricales. Dans la maladie de Parkinson, la reconnaissance des
troubles fonctionnels liés à la maladie neurologique est rendue difficile par l’intrication des
désordres pelvi-périnéaux plus habituels du sujet âgé (pathologie prostatique, troubles de la sta-
tique pelvienne).

528 Pelvi-périnéologie
nence d’effort peut y être associée. Dans ce der-
nier cas, il sera important d’essayer de faire la
part des choses entre ce qui revient à l’atteinte
neurologique et ce qui relève d’une insuffisance
périnéale.
Au cours de la maladie, la symptomatologie va
être fluctuante et nécessiter une réévaluation cli-
nique régulière notamment pour ajuster au mieux
la prise en charge thérapeutique. L’absence de
corrélation entre la symptomatologie clinique et
les dysfonctionnements vésico-sphinctériens en
jeu rend souvent nécessaire une évaluation uro-
dynamique (3, 4). Le plus souvent, le tableau
retrouvé est celui d’une hyperactivité vésicale,
mais une hypoactivité vésicale peut également
être présente. Une dyssynergie vésico-sphincté-
rienne (DVS) est retrouvée dans plus de la moitié
des cas (fig. 1). Un résidu chronique peut donc
être la conséquence soit d’une hypoactivité soit
d’une dyssynergie vésico-sphinctérienne. Son
existence justifie donc une exploration urodyna-
mique pour en déterminer l’étiologie exacte. La
dyssynergie vésico-sphinctérienne peut induire
un régime à haute pression intravésicale (fig. 1)
favorisant l’atteinte du haut appareil rénal dont la
fréquence va augmenter avec l’aggravation du
handicap (9, 10). Pour cette raison une sur-
veillance régulière du haut appareil est nécessaire
chez les patients dont le score atteint 6 sur
l’échelle EDSS de Kurtzke, ce qui correspond à
un périmètre de marche de cent mètres avec aide.
Malgré tout, la complication la plus fréquente
reste l’infection urinaire, qui peut engager le pro-
nostic vital chez des patients sous immunosup-
presseurs. L’existence d’un résidu post mictionnel
supérieur à 200 ml et le sexe masculin sont des
facteurs de risque des atteintes fébriles (11).
L’examen neuropérinéal ne présente pas de par-
ticularité spécifique : l’examen peut être normal
ou retrouver un périnée flasque ou spastique.
Peu d’études ont été réalisées sur les consé-
quences de la grossesse et de l’accouchement sur
les troubles urinaires chez les patientes atteintes
de SEP. Dans une étude récente portant sur une
cohorte de 369 patientes, nous avons pu démon-
trer qu’il n’y avait aucune particularité dans le
contexte de la SEP : le seul élément retrouvé était
une tendance à la baisse de la pression urétrale au
bilan urodynamique, comme pour les femmes
sans pathologies neurologique (12). Chez ces
patientes, les modalités d’accouchement seront
donc déterminées en fonction des risques, obsté-
trical et périnéal, selon les critères habituels et
non en fonction de la notion de SEP.
La prise en charge thérapeutique va passer
dans un premier temps par la recherche d’un
résidu postmictionnel (13). En cas d’absence de
résidu et de complications rénales graves, un trai-
tement symptomatique sera proposé : traitement
de type anticholinergique dans le cadre des syn-
dromes irritatifs, ou à visée sphinctérienne en cas
de syndrome obstructif prédominant (alpha-blo-
quant). La desmopressinne peut être également
proposée dans le cas des pollakiuries nocturnes.
En cas de résidu postmictionnel important (supé-
rieur à 100 ml) ou d’échec thérapeutique, un
bilan complémentaire, notamment un bilan uro-
dynamique, sera nécessaire pour évaluer au
mieux le dysfonctionnement vésico-sphinctérien
et la prise en charge thérapeutique. L’introduction
de la toxine botulique dans le traitement des dys-
synergies vésico-sphinctériennes, et de la capsaï-
cine dans les hyperactivités vésicales pourront
être discutées. Les sondages intermittents restent
une solution thérapeutique dans le cadre des ves-
sies rétentionnistes échappant aux traitements
médicamenteux per os.
La rééducation périnéale peut être tout à fait
intéressante dans le cadre de l’incontinence chez
la femme, surtout quand il existe une composante
d’incontinence d’effort. La persistance d’une
motricité volontaire des muscles releveurs de
l’anus paraît être un préalable nécessaire si l’on
veut obtenir un bon résultat. La chirurgie a peu de
place actuellement, la neuro-modulation est en
cours d’évaluation dans la SEP. Les techniques
d’agrandissement de vessie quand elles peuvent
être discutées le sont souvent dans le cadre d’at-
teinte neurologique sévère ne permettant pas les
autosondages, et une dérivation des uretères est
alors souvent plus adaptée.
Troubles du transit
La constipation est le symptôme le plus fréquent,
concernant 50 % de la population, avec finale-
ment peu de conséquence sur le plan fonctionnel.
En revanche, l’incontinence anale est souvent
sous-estimée et nécessite un dépistage attentif.
Chia, retrouve ainsi un épisode d’incontinence
chez la moitié des patients de son étude (14). Le
plus souvent, l’incontinence est associée à un
tableau de constipation terminale, dans le cadre
d’une altération de la commande volontaire du

périnée, allant jusqu’à un trouble de relaxation du
sphincter anal (15). Une hypoesthésie périanale,
l’absence ou l’altération de la sensibilité rectale
vont contribuer à l’incontinence (16). À l’inverse,
des fuites sur impériosité peuvent être observées
dans le cadre d’une hyperactivité motrice. Swash,
dans une étude portant sur 12 patientes, sur des
arguments électromyographiques a évoqué le rôle
des traumatismes obstétricaux et de la multiparité
dans la genèse de cette incontinence (17). La
prise en charge thérapeutique passe dans un pre-
mier temps par une prise en charge de la consti-
pation : recherche de facteurs favorisants, régime
alimentaire adapté, utilisation de laxatif, lave-
ment et défécation régulière permettent le plus
souvent de régler le problème de l’incontinence.
En cas d’échec des mesures de base, un bilan
fonctionnel s’impose (défécographie, manomé-
trie anorectale avec électromyographie périnéale)
pour adapter au mieux le traitement.
Troubles sexuels
Selon les différentes études 26 à 75 % des
hommes présentent une dysérection. Ces troubles
peuvent s’associer à une baisse de la libido. De
plus, une composante psychogène va souvent
s’associer liée à la peur de l’échec (5, 18). La part
de chacune des composantes est importante à
analyser pour la mise en place d’une thérapie
adaptée. Chez la femme les difficultés sont sou-
vent sous-estimées et non recherchées, alors que
la fréquence est tout aussi grande : baisse de la
libido, anorgasmie, sécheresse vaginale, dyspa-
reunie. Les troubles urinaires sont fortement
intriqués et tendent à majorer les difficultés : la
peur de la fuite urinaire lors des relations
sexuelles peut amener la femme à éviter celles-
ci (19, 20).
Chez l’homme et la femme, la symptomato-
logie générale est également à prendre en
compte : la fatigabilité, symptôme à part entière
extrêmement fréquent, la spasticité, les douleurs,
un syndrome dépressif… L’influence de la tem-
pérature doit également être explorée : une
douche froide préalable peut améliorer les per-
formances.
La prise en charge passe par les moyens thé-
rapeutiques spécifiques classiques et aussi par la
prise en charge des symptômes généraux. L’ex-
plication au niveau du couple est importante, elle
permet de dédramatiser la situation en insistant
sur ce qui revient à l’atteinte organique, évitant
ainsi les quiproquos au sein du couple et en
essayant de les amener à modifier si nécessaire
leurs pratiques amoureuses (21).
MALADIE DE PARKINSON
La maladie de Parkinson idiopathique est une
affection dégénérative du système nerveux central
touchant les neurones dopaminergiques du locus
niger (22, 23). Elle débute insidieusement le plus
souvent vers l’âge de 60-65 ans et s’aggrave pro-
gressivement. 1,5 % de la population âgée de
plus de soixante-cinq ans est atteint avec un sex-
ratio de 1. Les critères cliniques principaux sont
le tremblement de repos, la bradykinésie et la
rigidité avec un début qui est volontiers asymé-
trique. Les troubles vésico-sphinctériens sont fré-
quents, rarement révélateurs (24, 25). Le pro-
blème de l’intrication avec des pathologies
urologiques ou gynécologiques fréquentes chez le
sujet âgé se pose : pathologie prostatique, cer-
vico-cystoptose, etc.
Troubles véscosphinctériens
Les troubles sont polymorphes, le tableau le plus
fréquent associe pollakiurie, impériosité avec par-
fois fuites, le handicap moteur peut parfois
majorer les fuites. Les syndromes obstructifs sont
plus rares. Sur le plan urodynamique le tableau le
plus fréquent est celui d’une hyperactivité vési-
cale, mais une hypoactivité vésicale, ou une dys-
synergie vésico-sphinctérienne peuvent égale-
ment être retrouvées (26). L’interprétation de la
symptomatologie et des données urodynamiques
doit tenir compte du contexte clinique lié à l’âge :
devant une hyperactivité vésicale chez l’homme
il faut éliminer en premier lieu un obstacle pros-
tatique avant de retenir un dysfonctionnement
neurologique. De même, avant de se lancer dans
une chirurgie prostatique, l’étiologie neuro-
logique doit être évoquée, le risque d’inconti-
nence postopératoire est effectivement majeur
dans ce contexte.
Concernant les complications, elles sont rares
et ne paraissent pas liées spécifiquement au dys-
fonctionnement neurologique.
Conséquences fonctionnelles de la sclérose en plaques et de la maladie de Parkinson 529

La présence d’une dyssynergie vésico-sphinc-
térienne ou d’une hypoactivité vésicale peut éga-
lement être un argument diagnostique pour un
syndrome parkinsonien autre, atrophies multi-
systèmes par exemple (26, 27).
Troubles du transit
La constipation est fréquente atteignant 50 % des
patients (28), soit du fait d’un trouble du péri-
staltisme colique, soit en raison d’une constipa-
tion terminale. Mathers, a mis en évidence une
dystonie des muscles du plancher pelvien avec
une activation paradoxale des muscles pubo-
rectaux pendant l’effort (29). Cette complication
terminale peut se compliquer de fécalome ou de
fissure La sévérité de la constipation est corrélée
à la sévérité et à la durée d’évolution de la
maladie (30).
Le traitement comporte une adaptation du
régime alimentaire, la prise de cisapride peut
améliorer le trouble du transit (31).
Troubles sexuels
Les troubles sexuels sont fréquents avec une
baisse de la libido, 60 % des hommes se plai-
gnent de dysérection, chez la femme anorgasmie
et vaginisme sont retrouvés chez un tiers des
patientes (32, 33). Aucune relation n’a été mise
en évidence entre la sévérité du handicap moteur
et l’importance des troubles sexuels, en revanche
la sévérité du handicap est un facteur important
au niveau du couple, qui perturbe la relation
amoureuse. Comme pour les troubles urinaires, il
est important de tenir compte de l’âge des
patients et de la comorbidité qui y est liée.
À côté des traitements symptomatiques, la
prise en charge du couple est un élément impor-
tant. Enfin, il faut signaler certains comportements
d’hypersexualité, qui sont souvent d’origine iatro-
gène liée aux agonistes dopaminergiques (34).
Références
1. Coustans M (2000) Sclérose en plaques : aspects cli-
niques et diagnostiques. Neuropsy 15: 178-82
2. Poser CM (1994) The epidemiology of multiple scle-
rosis: a general overview. Ann Neurol 36: 180-93
3. Amarenco G et al. (1995) Bladder and sphincter
disorders in multiple sclerosis. Clinical, urodynamic
and neurophysiological study of 225 cases. Rev
Neurol 151: 722-30
4. Gallien P et al. (1998) Vesico-urethral dysfunction
and urodynamic findings in multiple sclerosis: a study
of 149 cases. Arch Phys Med Rehabil 79: 255-7
5. Gallien P, Robineau S (1999) Sensory-motor and
genito-sphincter dysfunction in multiple sclerosis.
Biomed Pharmacother 53: 80-5
6. Catanzaro M et al. (1982) Urinary bladder dysfunc-
tion as a remedial disability in multiple sclerosis: a
sociologic perspective. Arch Phys Med Rehabil 63:
472-4
7. Kurtzke JF (1983) Rating neurologic impairment in
multiple sclerosis: an expanded disability status scale
(EDSS). Neurology 33: 1444-52
530 Pelvi-périnéologie
Fig. 1. – Aspect de dyssymétrie
vésico-sphinctérienne, l’absence
de relâchement initial du sphincter
strié est responsable d’un régime à
haute pression intravésical, avec
cliniquement une dysurie d’attente
associée à une pollakiurie.

8. Betts CD et al. (1993) Urinary symptoms and the
neurological features of bladder dysfunction in mul-
tiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 56:
245-50
9. Giannantoni A et al. (1998) Urological dysfunctions
and upper urinary tract involvement in multiple scle-
rosis patients. Neurourol Urodyn 17: 89-98
10. Barbalias GA et al. (1998) Vesicourethral dysfunction
associated with multiple sclerosis: clinical and uro-
dynamic perspectives. J Urol 160: 106-11
11. Gallien P et al. (1998) Les complications urinaires
dans la sclérose en plaques : étude des facteurs de
risque. Ann Réad Med Phys 41: 151-8
12. Durufle A (2001) Influence de la grossesse et de l’ac-
couchement sur les troubles urinaires dans la sclérose
en plaques : à propos d’une cohorte de 368 femmes.
Thèse de médecine, Rennes
13. Conférence de consensus sur la sclérose en plaques
(2001) Rev Neurol 157: 713-21
14. Chia YW et al. (1995) Prevalence of bowel dysfunc-
tion in patients with multiple sclerosis and bladder
dysfunction. J Neurol 242: 105-8
15. Sorensen M et al. (1991) Anorectal dysfunction in
patients with urologic disturbance due to multiple
sclerosis. Dis Colon Rectum 34: 136-9
16. Norbendo A et al. (1996) Disturbances of anorectal
function in multiple sclerosis. J Neurol 243: 445-51
17. Swash M et al. (1987) Parity as a factor in inconti-
nence in multiple sclerosis. Arch Neurol 44: 504-8
18. Chancellor MB, Blaivas JG (1994) Urological and
sexual problems in multiple sclerosis. Clin Neurosci
2: 189-95
19. Hutler B M et al. (1995) Sexual function in woman
with advanced multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg
Psy 59: 83-6
20. Foley FW (1997) Sexuality Multiple sclerosis and
women. MS Management 4: 1-10
21. DasGupta R, Fowler CJ (2002) Sexual and urological
dysfunction in multiple sclerosis: better understan-
ding and improved therapies. Curr Opin Neurol 15:
271-8
22. Hughes AJ et al. (1992) Accuracy of clinical dia-
gnosis of idiopathic Parkinson’s disease: a clinicopa-
thological study of 100 cases. J Neurol Neurosurg
Psy 55: 181-4
23. Quinn NP et al. (1995) Parkinsonism, recognition and
differential diagnosis. Brit Med J 310: 447-52
24. Berger Y et al. (1993) Urodynamic findings in Par-
kinson’s disease. J Urol 138: 836-8
25. Aranda B (1993) Les troubles vésico-sphinctériens
de la maladie de Parkinson. Rev Neurol 9: 476-80
26. Le Bot-Le Borgne MP et al. (2000) Examen urody-
namique et pathologies extrapyramidales, étude à
propos de 52 patients. Ann Réad Med Phys 43: 78-83
27. Stocchi F et al. (1997) Urodynamic and neurophy-
siological evaluation in Parkinson’s disease and mul-
tiple system atrophy. J Neurol Neurosurg Psy 62:
507-11
28. Eadie MJ et al. (1965) Alimentary disorders in par-
kinsonism. Aust Ann Med 14: 13-22
29. Mathers SE et al. (1988) Constipation and para-
doxical puborectalis contraction in anismus and Par-
kinson’s disease: a dystonic phenomenon ? J Neurol
Neurosurg Psy 51: 1503-7
30. Kupsy WJ et al. (1987) Parkinson’s disease and
megacolon: concentric hyaline inclusions (Lewy
bodies) in enteric ganglion cells. Neurology 37: 1253-
5
31. Jost WH et al. (1993) Cisapride treatment of consti-
pation in Parkinson’s disease. Mov Disord 8: 339-43
32. Brown RG et al. (1990) Sexual dysfunction in
patients with Parkinson’s disease and their partners. J
Neurol Neurosurg Psy 53: 480-6
33. Koller WC et al. (1990) Sexual dysfunction in Par-
kinson’s disease. Clin Neuropharmacol 13: 461-3
34. Uitti RJ et al. (1989) Hypersexuality with antipar-
kinsonien therapy. Clin Neuropharmacol 12: 375-83
Conséquences fonctionnelles de la sclérose en plaques et de la maladie de Parkinson 531
1
/
5
100%