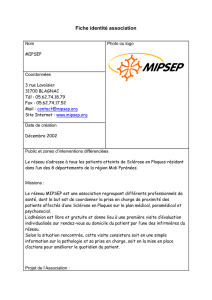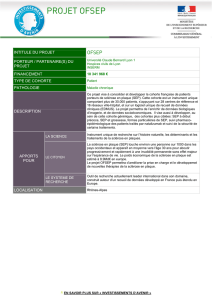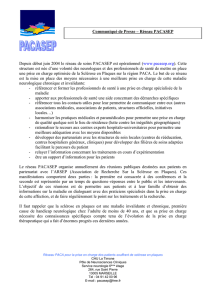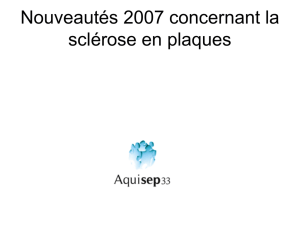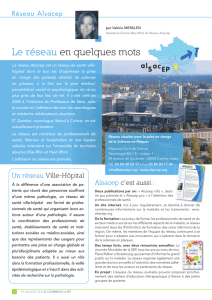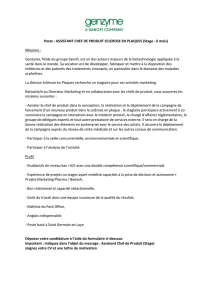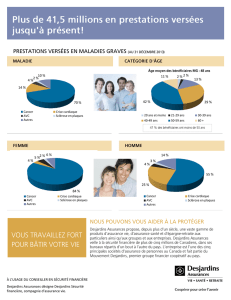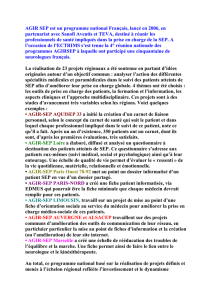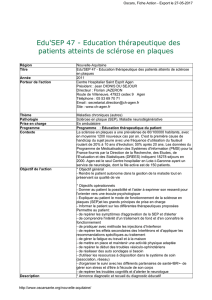Des essais cliniques à la surveillance des médicaments après commercialisation :

224 | La Lettre du Neurologue • Vol. XVI - n° 7 - septembre 2012
ÉDITORIAL
Des essais cliniques à la surveillance des
médicaments après commercialisation :
le modèle de la sclérose en plaques
From clinical trials to post-marketing surveillance
ofdrugs: the example of multiple sclerosis
“
S. Vukusic
Service de neurologie A et Fonda-
tion Eugène-Devic- EDMUS pour
la sclérose en plaques, hôpital
neurologique Pierre-Wertheimer,
hospices civils de Lyon. Centre
des neurosciences de Lyon,
Inserm 1028, et CNRS UMR5292.
Université de Lyon et de Lyon 1.
Depuis 2005, le traitement de la sclérose en plaques (SEP) est entré
dans une nouvelle ère, avec l’arrivée de traitements immuno-
actifs bien plus efficaces, mais au prix d’effets indésirables
potentiellement graves : infections opportunistes, cancers ou autres
maladies auto-immunes. Ces événements rares sont mal connus à l’issue
des essais cliniques. La survenue des premiers cas de leucoencéphalite
multifocale progressive quelques mois seulement après la commercialisation
du natalizumab en est un exemple qui a marqué les neurologues.
Les essais cliniques sont en effet insuffisants pour détecter
des événements rares (inférieurs à 1/1 000) et certaines populations
n’ysont que peu ou pas représentées. Dans les années 1970, le scandale
de la thalidomide(1) a conduit à la création de la pharmacovigilance,
surveillance des médicaments fondée sur une déclaration obligatoire,
mais spontanée, des effets indésirables. D’autres scandales (statines[2],
coxibs[3] et plus récemment Mediator®) ont depuis pointé les limites de
cette organisation liées à la sous-notification. Depuis 2005, les autorités
de santé imposent donc à tout nouveau médicament une surveillance
après commercialisation proactive, toujours fondée sur la pharmaco-
vigilance, mais complétée par des activités de minimisation des risques
etpar des études pharmaco-épidémiologiques. Ces dernières permettent
d’apporter des informations complémentaires sur 3types de risques :
➤risques identifiés importants (détectés lors des essais, avec évaluation
continue de la balance bénéfice/risque) ;
➤risques potentiels importants (signaux au cours des essais cliniques
ouavec des produits similaires, mais dont l’importance et le lien
aveclemédicament doivent être confirmés) ;
➤informations manquantes importantes (en particulier dans
des populations à risque ou non étudiées dans les essais, comme les sujets
âgés ou les enfants).
La communauté neurologique française a montré sa capacité
às’organiser pour répondre avec succès à cette nouvelle réglementation,
en coordonnant elle-même le premier Plan de gestion des risques
danslaSEP via l’étude TYSEDMUS(4). Les nouveaux traitements defond
− et ils sont nombreux (fingolimod, puis alemtuzumab, tériflunomide,
fumarate, laquinimod, etc.) − vont être également soumis à ces règles,
entraînant une multiplication potentielle des études après leur
commercialisation.
1. Botting J. The history of thali-
domide. Drug News Perspect
2002;15:604-11.
2. Furberg CD, Pitt B.
Withdrawal of cerivastatin
from the world market. Curr
Control Trials Cardiovasc Med
2001;2(5):205-7.
3. Dieppe PA, Ebrahim S,
Martin RM et al. Lessons from
the withdrawal of rofecoxib.
BMJ 2004;329(7471):867-8.
4. www.afssaps.fr/content/
download/2502/.../PGR_
Tysabri_Janvier2011.pdf

La Lettre du Neurologue • Vol. XVI - n° 7 - septembre 2012 | 225
ÉDITORIAL
”
Comment organiser ces études ? Comment gérer les passages des
patients d’une étude à une autre lors d’un changement de traitement ?
Comment obtenir des données à long terme ? Comment évaluer
lesrisques cumulatifs de l’utilisation successive de ces médicaments
chezun même patient ? Comment prendre en compte ces nouvelles
obligations sans augmenter la charge de travail des neurologues ?
Un effort de mutualisation des moyens humains, financiers,
méthodologiques et techniques dans une vaste et unique étude de
phaseIV, sur une cohorte unique et ouverte, devrait être la bonne
solution. Ildevrait permettre de répondre aux impératifs réglementaires
et apporter des informations sur la tolérance, l’efficacité et l’évaluation de
la balance bénéfice/risque tout au long de la vie d’un produit. Cette étude
observationnelle, menée dans la pratique quotidienne, sur le long terme,
au sein d’un large groupe de patients, avec un groupe contrôle de sujets
non traités et suivis simultanément, pourrait fournir, de plus, une source
de données unique pour estimer les risques cumulés des traitements et
définir les meilleures stratégies thérapeutiques dans l’avenir.
La France a l’opportunité d’être le premier pays à mettre en place
untel projet. L’Observatoire français de la sclérose en plaques (OFSEP)
fait partie des 10cohortes sélectionnées en janvier 2011 en réponse à
l’appel à projets “Cohortes 2010” dans le cadre du programme
Investissements d’avenir. Il bénéficie ainsi d’un soutien de l’Agence
nationale pour la recherche (ANR) d’environ 10 millions d'euros
pourles10années à venir. Fort des particularités uniques de la prise
encharge de la SEP en France(28centres experts, 17réseaux régionaux
de soins ville-hôpital dédiés à la SEP) et de l’existence d’une base de
données unique, EDMUS(5) [European Database for Multiple Sclerosis,
www.edmus.org], intégrée à la pratique quotidienne, l’OFSEP regroupe
déjà plus de 36 000 malades. Les neurologues français sont ainsi prêts
àréussir le défi d’un premier Observatoire mutualisé des traitements
enneurologie, qui leur permettra, en connaissant mieux les risques
maisaussi l’efficacité des traitements de fond dans la “vraie vie”,
demieuxsoigner leurs patients.
5. Confavreux C, Compston
DA, Hommes OR et al.
EDMUS, a European database
for multiple sclerosis. J
Neurol Neurosurg Psychiatry
1992;55(8):671-6.
AVIS AUX LECTEURS
Les revues Edimark sont publiées en toute indépendance et sous l’unique et entière responsabilité du directeur de la publication et du rédacteur
en chef.
Le comité de rédaction est composé d’une dizaine de praticiens (chercheurs, hospi taliers, universitaires et libéraux), installés partout en France,
qui représentent, dans leur diversité (lieu et mode d’exercice, domaine de prédilection, âge, etc.), la pluralité de la discipline. L’équipe se réunit
2 ou 3fois par an pour débattre des sujets et des auteurs à publier.
La qualité des textes est garantie par la sollicitation systématique d’une relecture scientifique en double aveugle, l’implication d’un service de
rédaction/révision in situ et la validation des épreuves par les auteurs et les rédacteurs en chef.
Notre publication répond aux critères d’exigence de la presse :
· accréditation par la CPPAP (Commission paritaire des publications et agences de presse) réservée aux revues sur abonnements,
· adhésion au SPEPS (Syndicat de la presse et de l’édition des professions de santé),
· indexation dans la base de données INIST-CNRS,
· déclaration publique de liens d’intérêts demandée à nos auteurs,
· identification claire et transparente des espaces publicitaires et des publi-rédactionnels en marge des articles scientifiques.
1
/
2
100%