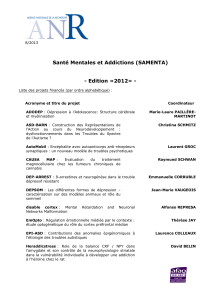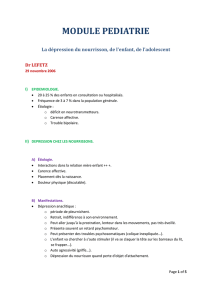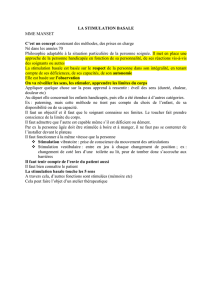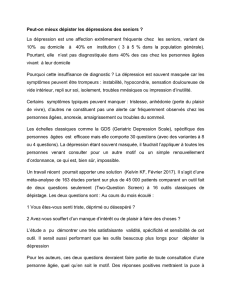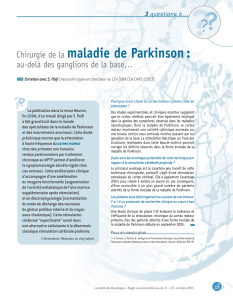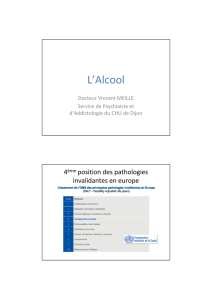L’ Stimulation subthalamique, maladie de Parkinson et suicide M

Mise au point
Mise au point
295
La Lettre du Neurologue - Vol. X - n° 9 - novembre 2006
Stimulation subthalamique, maladie de Parkinson et suicide
Subthalamic stimulation, Parkinson’s disease and suicide
#C. Ardouin*, H. Sibera-Rossignol*
* Unité des troubles du mouvement, INSERM U318, département de neurologie, CHU de Grenoble.
RÉSUMÉ
Le taux de suicide après stimulation subthalamique est supérieur
à celui observé dans la population générale des parkinsoniens.
La première année postopératoire semble être une période
de vulnérabilité. On peut distinguer deux types de facteurs
de risque :
– Une dépression préopératoire, avec dévalorisation, pessi-
misme, idées suicidaires, et/ou des motivations irréalistes, sources
de déception postopératoire. Il est alors prudent de traiter la
dépression et de modérer les espoirs avant la prise de décision
chirurgicale.
– L’apparition postopératoire d’une apathie qui peut favoriser
une dépression réactionnelle. Dans ce cas, les agonistes dopa-
minergiques ont prouvé leur e cacité.
Mots-clés : Stimulation subthalamique - Suicide - Traitement
dopaminergique - Apathie.
SUMMARY
After subthalamic stimulation, suicide rate is higher than in the
general parkinsonian population. The rst postoperative year seems
to be a phase of vulnerability. There are two types of risk factors:
– A preoperative depression with guilt, pessimism, suicidal thoughts
and/or unrealistic expectations, sources of postoperative disap-
pointment. It is then advisable to rst treat the depression and to
moderate expectations before the surgical decision-making.
– The presence of a postoperative apathy which can cause a reac-
tional depression. In this case dopaminergic agonist treatment is
e ective.
Keywords: Subthalamic stimulation - Suicide - Dopaminergic
medication - Apathy.
POINTS FORTS
Taux de suicide postopératoire : 0,5 % > population parkin-
sonienne générale.
Terrain : patients jeunes, début de maladie précoce.
Signes d’alerte préopératoires : pessimisme, dévalorisation,
idées suicidaires ; motivations irréalistes. Reporter la chirurgie,
traiter la dépression et discuter les motivations.
Signes d’alerte postopératoires : apathie. Traitement par
agonistes dopaminergiques.
Surveillance rapprochée durant la première année post-
opératoire.
L’effi cacité du traitement par stimulation cérébrale pro-
fonde (SCP) du noyau subthalamique (NST) sur les
symptômes moteurs de la maladie de Parkinson (MP)
n’est plus à démontrer. Son innocuité sur les fonctions cognitives
non plus. En revanche, son retentissement sur l’humeur et le
comportement n’est pas encore très clair. Divers troubles du
comportement ont été rapportés, en particulier une augmen-
tation du risque de suicide qui pousse certains auteurs à une
réelle mise en garde contre ce risque non négligeable.
Qu’en est-il ? Comment l’expliquer ? Comment le gérer ?
LES CHIFFRES : FRÉQUENCE DES SUICIDES
ET DES TENTATIVES DE SUICIDE
Le tableau I détaille les pourcentages relevés par les études
publiées portant sur un grand nombre de patients.
Tableau I.
Auteurs Nombre total
de patients
Pourcentage
de suicides
Pourcentage
de tentatives
de suicide
Burkhard et al.
(2004), Suisse (1)
140 (MP + dystonie +
tremblement essentiel)
6/140 = 4,3 %
4 MP = 2,8 %
Funkiewiez et al.
(2004),France (2) 77 1 = 1,3 % 4 = 5,2 %
Albanese et al.
(2005), Italie (3) 72 0 % 0 %
Voon et al. (2006),
[étude multicentrique] (4) 5 255 22 = 0,42 % 46 = 0,88 %
Selon les auteurs, le taux de suicide après SCP du NST varie
de 0 % à 2,8 %. Les résultats de l’étude multicentrique de Voon
et al. (4), qui regroupe les cas de suicides sur 53 centres dans
le monde, sont probablement les plus réalistes. La majorité de
ces actes suicidaires semblent avoir lieu au cours de la première
année postopératoire et sont eff ectivement plus fréquents que
dans la population générale.
Le pourcentage de suicide dans la population générale est
extrêmement variable selon les pays : il est en France de 0,016 %,
plus réduit en Italie (0, 005 %) et plus élevé dans les pays de
l’Est.
Et dans la population générale de parkinsoniens ? Une étude
épidémiologique danoise (5) n’a pas montré un taux de suicide
plus élevé dans cette population de patients que dans la popu-
lation générale (soit 0,03 %), et une deuxième étude, menée

Mise au point
Mise au point
296
La Lettre du Neurologue - Vol. X - n° 9 - novembre 2006
aux États-Unis, conclut que le suicide dans la MP est 10 fois
moins fréquent que dans la population générale (6). Toute
comparaison est cependant biaisée, car les patients bons
candidats pour la SCP ne sont pas le refl et de l’ensemble de
la population parkinsonienne. Ce sont des patients jeunes qui
ont une maladie invalidante, sensible à la L-dopa, compliquée
par des fl uctuations motrices et des dyskinésies, qui n’ont pas
ou peu de troubles cognitifs, pas de dépression sévère et pas
de troubles du comportement. Cela représente les critères
d’inclusion idéaux, mais un parkinsonien sans troubles de
l’humeur et du comportement existe-il ?
LA SYMPTOMATOLOGIE NEUROPSYCHIATRIQUE
DES PATIENTS PARKINSONIENS
Elle est extrêmement riche, car elle recouvre deux versants a
priori opposés.
Le versant hyperdopaminergique
, qui regroupe un ensemble
de symptômes secondaires au traitement dopaminergique, dont
les psychoses et tous les changements comportementaux com-
pris sous le terme de “syndrome de dysrégulation dopaminer-
gique” [SDD] (7) : l’hypomanie, l’hyperactivité, l’hypersexualité,
le jeu pathologique, l’achat compulsif, la créativité, l’addiction
dopaminergique et les modifi cations du comportement alimen-
taire. Cet état, qui est ressenti par les patients comme un état
merveilleux, de grande forme et de grand bonheur, peut aussi
devenir catastrophique et ruiner (au sens propre et fi guré) le
patient et sa famille.
Le versant hypodopaminergique
, qui appartient à la MP
elle-même et qui se caractérise par une apathie, une humeur
dépressive avec parfois des idées suicidaires et une anxiété pou-
vant conduire à des crises de panique.
La dépression
est le trouble le plus largement étudié et a été
décrit comme le plus fréquent. Mais, selon les auteurs, le pour-
centage peut varier de 20 % à 90 %. Pourquoi une telle variation ?
En fait, la dépression parkinsonienne est extrêmement diffi cile
à évaluer, car de nombreux facteurs entretiennent la confusion.
La condition (off ou on) du sujet au moment où l’évaluation est
faite peut déjà, chez des patients fl uctuants, être responsable de
grandes variations. De plus, certains symptômes appartenant
à la défi nition de la dépression existent dans la MP sans avoir
la même signifi cation, par exemple : les pleurs de tristesse ou
de désespoir versus le trouble du contrôle émotionnel de la
MP, ou bien les troubles du sommeil avec rumination versus le
sommeil pathologique de la MP, voire l’insomnie avec hyperac-
tivité nocturne de certains parkinsoniens. L’apathie, souvent
exprimée par les patients sous le terme de “grande fatigue”,
avec baisse de l’intérêt, émoussement des émotions de désir
et de plaisir, peut exister de façon tout à fait indépendante de
la dépression.
Dans la population de patients répondant aux critères de sélec-
tion pour la SCP du NST, les deux versants peuvent évidemment
coexister, les symptômes non moteurs hypodopaminergiques
en phase off et hyperdopaminergiques en phase on.
INTERPRÉTATION PHYSIOPATHOLOGIQUE
DES TROUBLES NEUROPSYCHIATRIQUES
La dégénérescence des voies dopaminergiques expliquerait en
majeure partie la symptomatologie hypodopaminergique. Une
dénervation dopaminergique du système limbique serait à la
base de la dépression, de l’apathie et de l’anxiété parkinsonienne.
Inversement, un excès de stimulation dopaminergique serait
responsable du SDD.
Des arguments forts appuient cette hypothèse :
Une étude, par PET, du système dopaminergique et nora-
drénergique de deux groupes de parkinsoniens se diff érenciant
uniquement par l’existence ou non d’une dépression a montré
chez le groupe dépressif une perte spécifi que de l’innervation
dopaminergique et noradrénergique du système limbique com-
parativement au groupe non dépressif (8).
La L-dopa a des eff ets psychotropes stimulants (9) et joue
un rôle fondamental dans la motivation (10).
De plus, la dénervation dopaminergique limbique entraînerait
une hypersensibilité des récepteurs dopaminergiques (7). Cette
hypersensibilité serait probablement à la base d’une plus grande
susceptibilité au SDD. Ce qui signifi e que plus l’atteinte limbique
est sévère, plus l’amplitude des fl uctuations non motrices est
importante et plus les risques de troubles thymiques et compor-
tementaux sont sérieux.
ÉVOLUTION DES TROUBLES NEUROPSYCHIATRIQUES
APRÈS CHIRURGIE
La stimulation du NST permet une réduction du traitement
dopaminergique de l’ordre de 50 % chez des patients qui prenaient
des dosages importants depuis de nombreuses années. Cela
entraîne un grand bouleversement dans la vie d’un parkinsonien.
La première année postopératoire est une période d’instabilité :
la plupart des cas rapportés de troubles comportementaux, y
compris des actes suicidaires, ont lieu durant cette période.
La majorité des études comparatives (avant/après chirurgie) sur
de larges groupes de patients constate une amélioration de la
dépression. L’étude de Funkiewiez et al. (2) montre, d’une part,
une amélioration des scores de dépression pour l’ensemble des
patients, sauf pour ceux qui avaient avant la chirurgie un état
dépressif sévère et qui restent dépressifs en postopératoire,
et, d’autre part, une augmentation de l’apathie, le pourcentage
de patients apathiques passant de 8,7 avant la chirurgie à 17,4
un an après et à 24,6 trois ans après. L’analyse individuelle des
diff érents symptômes de la dépression montre que seuls les
symptômes somatiques sont signifi cativement améliorés. Les
patients dorment mieux, ont plus d’appétit, ne perdent plus de
poids et sont moins préoccupés par la maladie, mais les aspects
spécifi ques de la dépression (la tristesse, le pessimisme, la culpa-
bilité, etc.) demeurent inchangés (11). Houeto et al. (12) ont
étudié l’évolution d’un groupe de patients et concluent que ceux
ayant des antécédents de troubles psychiatriques sont à risque,
avec une forte probabilité de décompensation postopératoire.

Mise au point
Mise au point
297
La Lettre du Neurologue - Vol. X - n° 9 - novembre 2006
L’évolution des symptômes du SDD est peu documentée, car ces
patients étaient jusqu’alors exclus. Cependant, quelques études
récentes montrent une amélioration postopératoire très nette
de ces symptômes comportementaux, liée probablement à la
réduction du traitement dopaminergique (13).
Globalement, l’évolution la plus classique sur cette première
année se déroule de la façon suivante.
Le traitement par SCP associé à la baisse des médicaments
dopaminergiques supprime les fl uctuations motrices et thy-
miques. La stimulation présente, en aigu, un eff et psychotrope
sur l’humeur, de même type que la L-dopa (9) ; dans la période
postopératoire immédiate et quelquefois pendant plusieurs
mois, l’eff et nouveau de la stimulation, auquel s’ajoute l’eff et
à long terme des médicaments dopaminergiques, donne une
humeur plutôt hypomaniaque.
Au fi l du temps, l’eff et euphorisant de la stimulation chro-
nique, qui n’a pas le caractère pulsatile du traitement dopa-
minergique, diminue parallèlement à l’épuisement de l’eff et à
long terme des traitements préopératoires, et l’on observe chez
certains patients, malgré un bon bénéfi ce moteur, des plaintes
de type “grande fatigue, manque d’énergie, pas d’envies”. Ils
regrettent parfois les bouff ées de bien-être apportées par la
L-dopa : “Avec la stimulation, je revis ; avec la L-dopa en plus, je
suis heureuse”, disait une patiente. Cet état, qui peut ressembler
à une phase de sevrage, est à prendre très au sérieux dans le
suivi des patients, car une apathie accompagnée d’un sentiment
de mal-être peut s’installer.
Le degré de tolérance des patients et de l’entourage face à
l’apparition d’une apathie est déterminant et demande une sur-
veillance. C’est souvent l’entourage qui supporte le plus mal
l’apathie. L’association d’une motricité retrouvée et d’un manque
de motivation est bien sûr diffi cilement compréhensible et
acceptable. Chez certains patients, on voit se développer une
dépression, réactionnelle à l’apathie, avec possibilité d’idées
suicidaires : “Je ne fais plus rien… ma vie est plate… qu’est-ce
que je fous là !”, et un risque de passage à l’acte. Dans ce cas, un
traitement s’impose. Les antidépresseurs se sont rarement avérés
concluants. L’expérience montre que la reprise d’un traitement
dopaminergique, et de préférence d’un agoniste dopaminergique,
est la solution la plus effi cace.
Les tentatives de suicide (TS) qui peuvent avoir lieu dans ce
contexte ne sont en général pas sévères.
STIMULATION SUBTHALAMIQUE ET SUICIDE :
L’EXPÉRIENCE GRENOBLOISE
Depuis 1993, 250 patients sont traités par SCP du NST, avec
un suivi postopératoire d’au moins un an. Douze patients ont
fait une TS. Un seul a réussi son suicide (0,40 %) et est mort
par pendaison 5 mois après la chirurgie. Ce patient, fortement
demandeur, avait une maladie très sévère avec dystonies doulou-
reuses et était dépressif, mais n’avait plus d’idées suicidaires au
moment de l’opération. L’imminence de la chirurgie lui apportait
un espoir, transitoire, car ses motivations profondes n’étaient
pas réalistes. Pour les 11 autres patients, les gestes suicidaires
étaient dans certains cas sérieux, comme la pendaison (un cas,
5
e
année postopératoire) ou les tentatives d’électrocution (un
cas, 3e année postopératoire). D’autres cas sont moins sérieux,
comme l’ingestion de médicaments antiparkinsoniens, de benzo-
diazépine ou de paracétamol, et d’autres paraissent carrément
bénins (dans 2 cas, le geste est rapporté par le patient, mais
passé complètement inaperçu par l’entourage, et dans 2 autres
cas il a été eff ectué au sein du service au cours d’une hospita-
lisation régulière de contrôle). Par ailleurs, parmi les patients
inscrits sur la liste d’attente pour la chirurgie, un patient est
décédé par suicide.
Ce groupe de 12 patients stimulés ayant fait une TS a été comparé
à un groupe contrôle composé de 24 patients parkinsoniens
également traités par SCP du NST, appariés selon la date de leur
chirurgie et n’ayant pas fait de TS. L’analyse comparative montre
que les patients du groupe TS sont plus jeunes au moment de
la chirurgie, que leur maladie a commencé plus précocement
(ce qui est retrouvé dans l’étude multicentrique de Voon et al.)
et que leur score global de dépression est plus élevé, que ce soit
à l’évaluation préopératoire ou postopératoire. L’analyse des
caractéristiques de la dépression met en évidence dans le groupe
TS un score plus élevé du facteur dépressif pur (pessimisme,
idées suicidaires, dévalorisation, etc.) à l’évaluation préopéra-
toire et un score plus élevé du facteur apathie (perte d’intérêt,
perte de plaisir, indécision, etc.) à l’évaluation postopératoire
la plus proche de la TS.
PATIENTS À RISQUE ET CONDUITE À TENIR
On peut dégager quatre catégories de patients à risque
(tableau II).
Tableau II.
Patients à risque Conduite à tenir
Période préopératoire
Dépression avec pessimisme, dévalorisation,
idées suicidaires (même si elles ne sont pas
actuelles).
Traiter la dépression et reporter
la décision opératoire.
Motivations irréalistes ou inadaptées par
rapport à la chirurgie, par exemple :
guérir, éviter un divorce, se libérer
de la dépendance parentale, etc.
Expliquer ce que l’on peut attendre de la
chirurgie et surtout qu’elle ne guérit ni
la maladie ni les problèmes familiaux.
Di érer la décision opératoire.
Période postopératoire
Fluctuations non motrices importantes
(en préopératoire) avec dépression sévère
et idées suicidaires en o .
Surveillance accrue car risque de
dépression et de TS consécutive à la
baisse du traitement dopaminergique.
Apathie avec idées noires. Expliquer et traiter par agoniste
dopaminergique, même avant
l’apparition d’idées noires si les plaintes
sont marquées.

Mise au point
Mise au point
298
La Lettre du Neurologue - Vol. X - n° 9 - novembre 2006
Les deux premières catégories de patients à risque peuvent donc
être évitées avant inclusion, et il est probable que ces cas de TS
ne soient pas réellement liés au traitement par stimulation, mais
à la personnalité du patient et à son incapacité à accepter ou à
gérer sa maladie. Les deux autres facteurs de risque semblent
être plus directement liés au changement de traitement consé-
cutif à la chirurgie qu’à la stimulation elle-même. Il est vrai
que la stimulation peut entraîner des réactions dépressives
instantanées (14), mais les plots de stimulation qui ont cet eff et
dépresseur ne sont pas utilisés en chronique. De plus, ces eff ets
aigus provoqués en phase postopératoire immédiate par une
stimulation à voltage élevé ne sont pas toujours reproduits à
distance de la chirurgie. En revanche, la stimulation s’associe
forcément à une réduction des traitements dopaminergiques
et, chez certains patients, la stimulation ne compense pas l’eff et
thymique de la L-dopa, ce qui se traduit par l’émergence d’un
état thymique hypodopaminergique jusqu’alors couvert par le
traitement médicamenteux.
Il est donc très important d’informer les patients (et si possible
leur conjoint) de cette éventualité, de leur décrire les symptômes
(fatigue, baisse d’énergie et d’envie, etc.), de leur expliquer la cause
de ce phénomène, de les rassurer, car les traitements sont effi caces,
et de les suivre régulièrement, même “en urgence” si nécessaire.
Le suivi des patients stimulés est très prenant durant la première
année, mais probablement pas plus que pour tout parkinsonien
jeune sous traitement dopaminergique. Aucune étude n’a évalué
le risque de suicide chez ce même type de patients sous traitement
dopaminergique. Le taux de “suicidalité” serait également plus
élevé que dans la population parkinsonienne globale, car l’état
hyperdopaminergique avec SDD comporte aussi des facteurs
de risque de suicide tels que la prise de conscience du joueur
pathologique ruiné et honni, ou celle du patient hypersexuel face
à des comportements que sa morale réprouve. O
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Burkhard PR, Vingerhoets FT, Berney A et al. Suicide after successful deep
brain stimulation for movement disorders. Neurology 2004;63:2170-2.
2. Funkiewiez A, Ardouin C, Caputo E et al. Long term eff ects of bilateral sub-
thalamic stimulation on cognitive function, mood, and behaviour in Parkinson’s
disease. J Neurosurg Psychiatry 2004;75:834-9.
3. Albanese A, Piacetini S, Romito L et al. Suicide after successful deep brain
stimulation for movement disorders. Neurology 2005;65:499-500.
4. Voon V, Krack P, Lang A et al. Frequency and risk factors for suicidal outcomes
following subthalamic deep brain stimulation for Parkinson’s disease: a multi-
center retrospective study. Neurology 2006;66(Suppl. 2). Abstract 195.
5. Stenager EN, Wermuth L, Stenager E et al. Suicide in patients with Parkin-
son’s disease. An epidemiological study. Acta psychiatr Scand 1994;90:70-2.
6. Myslobodsky M, Lalonde FM, Hicks L. Are patients with Parkinson’s disease
suicidal? J Geriatr Psychiatry Neurol 2001;14:120-4.
7. Evans AH, Lees AJ. Dopamine dysregulation syndrome in Parkinson’s disease.
Curr Opin Neurol 2004;17:393-8.
8. Rémy P, Miroslava D, Lees A et al. Depression in Parkinson’s disease: loss
of dopamine and noradrenaline innervation in limbic system. Brain 2005;128:
1314-22.
9. Funkiewiez A, Ardouin C, Krack P et al. Acute psychotropic eff ects of bilate-
ral subthalamic nucleus stimulation and levodopa in Parkinson’s disease. Mov
Disord 2003;18:524-30.
10. Schultz W. Predictive reward signal of dopamine neurons. J Neurophysiol
1998;80:1-27.
11. Lhommée E, Savorgnan G, Pollak P et al. No change in mood but increase in
apathy in Parkinson’s disease patients treated by subthalamic nucleus stimula-
tion. Parkinsonism and relat. Disord 2006;12(Suppl.1):S11.
12. Houeto JL, Mesnage V, Mallet L et al. Behavioural disorders, Parkinson’s
disease and subthalamic stimulation. J Neurosurg Psychiatry 2002;72:701-7.
13. Witjas T, Baunez C, Henry JM et al. Addiction in Parkinson’s disease: impact
of subthalamic nucleus deep brain stimulation. Mov Disord 2005;20:1052-5.
14. Bejjani BP, Damier P, Arnulf I et al. Transient acute depression induced by
high frequency deep brain stimulation. N Engl J Med 1999;13:1476-80.
1
/
4
100%