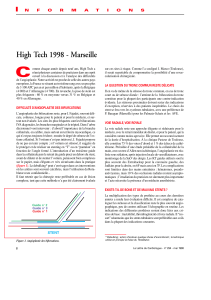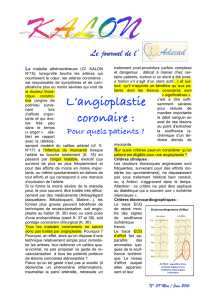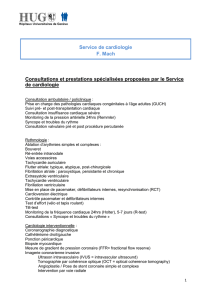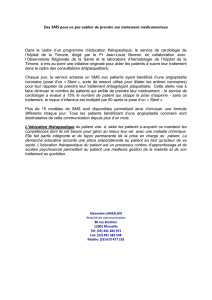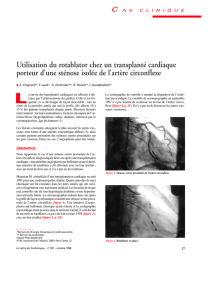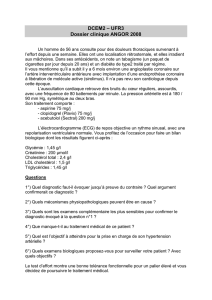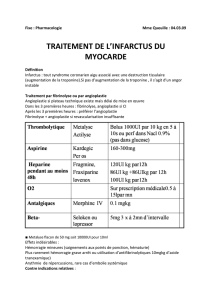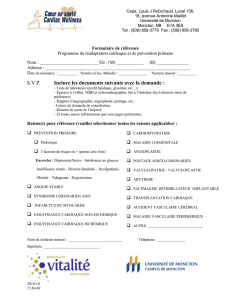n e u r o l o g i e Avancées thérapeutiques

343
neurologie
Avancées thérapeutiques
L’angioplastie des artères
cérébrales a bénéficié ces
cinq dernières années de
deux avancées impor-
tantes : la diversification
des endoprothèses vascu-
laires (stent) et l’utilisa-
tion raisonnée des anti-
agrégants plaquettaires.
Le stent est un treillis
métallique en forme de
cylindre de diamètre et de
longueur variables. Il est
déployé dans la lumière artérielle en
regard de la plaque d’athérome sur laquelle
il exerce une force d’expansion radiale.
Dans l’angioplastie cérébrale, le but prin-
cipal d’un stent est de prévenir ou de cor-
riger une éventuelle dissection artérielle
qui peut survenir lors de la dilatation de la
sténose.
Les associations d’antiagrégants plaquet-
taires préviennent le risque de thrombose
au site d’angioplastie, qu’un stent ait été
implanté ou non.
Nous entendons par artère à destinée céré-
brale, toutes les artères pouvant participer
à la vascularisation du cerveau depuis
l’origine des troncs supra-aortiques jus-
qu’aux branches de division intracrâ-
niennes. Toutes ces artères sont mainte-
nant accessibles à l’angioplastie (1).
Toutefois, les indications de ce traitement
sont très différentes selon l’étage considéré :
intracrânien, cervical et thoraco-sous-cla-
vier. Pour les sténoses intracrâniennes,
l’angioplastie est la seule méthode de
revascularisation. Ses indications sont
actuellement restreintes car l’histoire
naturelle de ces lésions et les risques du
traitement sont mal connus. Pour les sté-
noses de l’étage thoracique et sous-cla-
vier, l’angioplastie nous semble moins
traumatique que la chirurgie et elle est
proposée en première intention. Le pro-
blème est très différent pour les sténoses
de la bifurcation carotidienne car, dans
cette localisation, l’endartériectomie a
montré son efficacité par deux grandes
études prospectives : NASCET (2) et
ECST (3). L’angioplastie n’ayant pas été
évaluée de la même façon, elle est, dans
notre centre, réservée aux patients dits à
“haut risque chirurgical”.
Quel que soit le siège de la sténose, la réa-
lisation d’une angioplastie cérébrale sup-
pose une connaissance minimale de l’ana-
tomie et des syndromes vasculaires
cérébraux. La constatation sur une aorto-
graphie d’une sténose d’un tronc artériel
proximal ne suffit pas à affirmer sa res-
ponsabilité dans la survenue d’un accident
ischémique transitoire (AIT) qui peut être
en relation avec une sténose intracrânienne
dont le diagnostic nécessite la réalisation
d’une artériographie cérébrale sélective et
son interprétation correcte. Une angio-
plastie carotidienne peut se compliquer
d’une migration embolique cérébrale qui,
en fonction de l’importance fonctionnelle
de l’artère occluse, peut nécessiter la réa-
lisation d’une fibrinolyse
intra-artérielle. Le dia-
gnostic angiographi-que
et le traitement d’une telle
complication ne peuvent
être réalisés que par un
radiologue entraîné à ce
type d’intervention. Cette
“culture d’organe” dont la
nécessité est admise pour
le territoire coronaire
s’impose de la même
façon pour le territoire
cérébral.
Généralités techniques
Plusieurs points sont communs à toute
angioplastie cérébrale.
•Le bilan avant le geste comprend :
– un examen neurologique ;
– une consultation d’anesthésie avec réali-
sation d’un ECG ;
– un scanner ou une IRM cérébrale ;
– un doppler cervical et transcrânien ;
– avant angioplastie de la bifurcation caro-
tidienne, une échographie cardiaque afin
d’apprécier la fraction d’éjection systo-
lique.
• Protocole antithrombotique
Il est prescrit cinq jours avant l’angioplastie
une association Plavix®(1 cp/jour) + aspi-
rine (100 mg/jour).
En cours d’intervention, un bolus de
5000 unités d’héparine est injecté après
ponction fémorale. Au décours du geste,
l’association des antiagrégants est pour-
suivie pendant un mois puis le Plavix®est
interrompu mais l’aspirine poursuivie à
vie.
• L’intervention
Elle se déroule en salle d’angiographie
numérisée sous simple sédation. La voie
d’abord est le plus souvent fémorale. Si
Depuis l’invention par Grüntzig du cathéter à double
lumière, en 1978, l’angioplastie n’a pas cessé de se
développer dans les territoires coronaire, ilio-fémoral,
rénal et plus récemment cérébral. L’angioplastie consiste à
élargir la lumière artérielle en gonflant un ballon en
regard de la sténose, de façon à “repousser” la plaque
d’athérome vers l’extérieur de l’artère dont le diamètre
externe augmente.
* Service de neuroradiologie et d’angiogra-
phie thérapeutique, hôpital Lariboisière,
Paris.
Angioplastie des artères à destinée cérébrale
Emmanuel Houdart*

344
Act. Méd. Int. - Angiologie (16) n° 9/10, novembre/décembre 2000
angiologie et
Avancées thérapeutiques
cela n’a pas été réalisé lors du bilan initial,
l’intervention débute par une angiogra-
phie explorant les artères cérébrales non
seulement en région cervicale mais aussi
intracrânienne. Un cathéter à large lumière
(dit cathéter porteur) est ensuite placé
dans l’axe artériel dont dépend la sténose.
C’est au travers de ce cathéter que sont
introduits le ballon d’angioplastie et le
stent. Tous les systèmes introduits coaxia-
lement sont perfusés par du sérum physio-
logique sous pression, précaution essen-
tielle pour éviter la formation d’un
thrombus susceptible de migrer dans la
circulation cérébrale.
Après dilatation, il est effectué systémati-
quement une angiographie du segment
dilaté mais aussi du territoire vasculaire
d’aval afin de rechercher une éventuelle
complication embolique. Un examen neu-
rologique rapide est effectué en salle d’an-
giographie afin de s’assurer de l’absence
de modification clinique. Le patient est
surveillé systématiquement en unité de
soins intensifs pendant vingt-quatre heures.
L’introducteur fémoral est retiré quatre
heures après le geste si l’examen neurolo-
gique est inchangé. Toute modification de
l’état neurologique impose la réalisation
d’un scanner cérébral. Si le scanner est
inchangé, une artériographie de contrôle
s’impose à la recherche d’une complica-
tion thromboembolique justiciable d’un
traitement en urgence.
•Après angioplastie, le suivi comprend
outre un examen neurologique, un doppler
de contrôle de l’artère dilatée à un mois, six
mois, puis de façon annuelle. Dans tous les
cas, le traitement des facteurs de risque vas-
culaire est indispensable.
Angioplastie des sténoses
intracrâniennes
Les sténoses athéromateuses des artères
intracrâniennes sont plus rares que celles
des artères cervicales, notamment dans la
population caucasienne. Leur fréquence
est également sous-estimée car elles ne
peuvent pas être diagnostiquées par le
doppler cervical qui est souvent la seule
exploration réalisée dans le bilan d’un
AIT. L’histoire naturelle de ces sténoses
est également mal connue. Le traitement
habituel de ces patients est médical : anti-
Figure 1. Angioplastie d’une sténose du siphon carotidien. Patient de 60 ans aux nom-
breux facteurs de risque vasculaire ayant présenté plusieurs épisodes d’hémiparésie
gauche.
A : L’IRM cérébrale retrouve une séquelle d’infarctus hémisphérique droit dans le terri-
toire jonctionnel entre les artères cérébrales moyenne et antérieure.
B : L’artériographie carotidienne droite retrouve une sténose serrée du siphon carotidien
(flèche).
C : Le contrôle angiographique immédiatement après angioplastie montre un aspect de
dissection (flèche fine).
D : Le contrôle angiographique après implantation d’un stent, montre la correction de
la dissection et la restitution d’un calibre artériel normal.
AB
CD

345
neurologie
Avancées thérapeutiques
agrégants plaquettaires et/ou anticoagu-
lants oraux. L’endartériectomie est impos-
sible à cet étage et les anastomoses tem-
poro-sylviennes qui ont été effectuées
pour les sténoses de la terminaison caroti-
dienne et de l’artère cérébrale moyenne
ont montré leur inefficacité. L’angioplas-
tie est donc la seule méthode de revascu-
larisation des sténoses de cette localisa-
tion. Elle est devenue possible récemment
avec la miniaturisation des cathéters à bal-
lonnet (4, 5, 6). Toutefois, en raison de la
taille de ces artères, de leur tortuosité, de
la présence éventuelle d’artères perfo-
rantes à proximité de la sténose, le risque
de complications est supérieur à celui de
l’angioplastie des artères cervicales ou
thoraciques. De ce fait, les indications que
nous avons retenues sont très restrictives
et se limitent aux sténoses responsables de
manifestations ischémiques d’origine
hémodynamique après échec du traite-
ment antithrombotique. La sténose doit
être serrée (> 70 %) et doit siéger sur une
artère intracrânienne de relativement gros
calibre : segment terminal de l’artère ver-
tébrale, tronc basilaire, siphon carotidien,
segment M1 de l’artère cérébrale moyen-
ne. L’implantation d’un stent n’est pas
systématique dans ce territoire et n’est
pour l’instant réalisée qu’aux cas de dis-
section artérielle ou de resténose immé-
diate ou différée (figure 1).
Angioplastie des troncs supra-
aortiques et de la région
sous-clavière
Les sténoses des troncs supra-aortiques et
de la région sous-clavière peuvent être trai-
tées par angioplastie ou par chirurgie. La
chirurgie fait surtout appel aux techniques
de pontage extra-anatomique ou de réim-
plantation artérielle. Ces techniques suppo-
sent un abord chirurgical plus complexe que
celui de l’endartériectomie carotidienne et
n’ont pas été évaluées de façon indépen-
dante. Pour l’ensemble de ces raisons,
lorsque le traitement de la plaque est indi-
qué, nous proposons le traitement endovas-
culaire de première intention.
Sténoses de l’artère vertébrale
La particularité anatomique de la circula-
tion postérieure est que les deux artères
Figure 2. Angioplastie d’une sténose ostiale de l’artère vertébrale gauche.
Patient de 45 ans ayant présenté plusieurs accidents ischémiques thalamiques. Le dop-
pler cervical retrouve une thrombose de l’artère vertébrale droite.
A : L’artériographie sous-clavière gauche montre une sténose très serrée de l’origine de
l’artère vertébrale gauche (flèche).
B : Résultat angiographique après angioplastie et implantation d’un stent.
Figure 3. Angioplastie d’une sténose du TABC. Patiente de 60 ans ayant présenté des
épisodes récidivants de vertiges rotatoires. Les mesures de pression artérielle aux bras
ont montré une baisse de la pression systolique de 50 mmHg au bras droit.
A : L’aortographie retrouve une sténose serrée de l’origine du TABC (flèche).
B : Résultat après angioplastie-stenting de la sténose.
AB
AB

346
Act. Méd. Int. - Angiologie (16) n° 9/10, novembre/décembre 2000
angiologie et
Avancées thérapeutiques
vertébrales participent à la vascularisation
de la fosse postérieure en se rejoignant
pour former le tronc basilaire. Une sténose
d’une artère vertébrale ne donnera lieu à
une symptomatologie ischémique hémo-
dynamique que si la vertébrale controlaté-
rale est hypoplasique, très sténosée ou
thrombosée. L’angioplastie nous semble
moins invasive que la réimplantation ver-
tébrale qui nécessite un temps de clampage
artériel bien supérieur à celui de l’infla-
tion du ballon (figure 2).
Sténoses de l’artère sous-clavière pré-
vertébrale
Les sténoses de l’artère sous-clavière peu-
vent se manifester par des douleurs isché-
miques du membre supérieur. Dans le seg-
ment prévertébral, elles peuvent également
retentir sur la circulation cérébrale en inver-
sant le flux dans l’artère vertébrale homola-
térale réalisant le classique vol sous-clavier.
Celui-ci peut être parfaitement toléré ou
donner lieu à des manifestations neurolo-
giques transitoires à type de syndrome ver-
tigineux ou, de façon plus caractéristique,
de “drop-attack”. Ces manifestations cli-
niques justifient pour nous le traitement de
la sténose par angioplastie.
Sténoses de l’artère carotide primitive
et du TABC
Elles peuvent être isolées ou associées à
une sténose de la bifurcation carotidienne
réalisant une sténose en tandem. Leur dia-
gnostic est fait par une aortographie de la
crosse de l’aorte qui devrait constituer le
premier temps de toute exploration angio-
graphique d’une athérosclérose cérébrale.
Elles justifient un traitement lorsqu’elles
sont serrées et symptomatiques (figure 3).
Angioplastie de l’artère
carotide interne
Introduction
Nous avons dit que l’endartériectomie avait
démontré son efficacité dans le traitement
des sténoses serrées de la bifurcation caroti-
dienne. Pourquoi développer une technique
concurrente ? D’abord parce que la morbi-
mortalité de ce geste n’est pas nulle (5,8 %
dans l’étude NASCET) et qu’il est possible
d’espérer la diminuer par une technique
moins invasive. Ensuite, parce que les
patients considérés à haut risque chirurgical
ont été exclus des études NASCET et ESCT.
Une méta-analyse récente (7) a montré que
la morbi-mortalité de l’angioplastie était
voisine de celle de l’endartériectomie alors
que la plupart des études incluait des
patients à haut risque chirurgical (8, 9). Il
reste cependant à valider ces résultats par
des études prospectives qui vont débuter très
prochainement. Actuellement, il nous
semble que l’angioplastie ne peut être pro-
posée qu’aux patients à qui les avantages
techniques de l’angioplastie permettent
d’espérer une moindre morbidité que l’en-
dartériectomie.
L’angioplastie a sur la chirurgie les avan-
tages suivants :
– Ne nécessitant pas de dissection tissulaire,
elle évite les complications locales : lésions
des nerfs crâniens, problèmes d’hémostase
et de cicatrisation. Ces complications sont
d’autant plus à craindre que les tissus cuta-
nés et sous-cutanés sont remaniés, ce qui est
le cas après radiothérapie ou après une pré-
cédente intervention cervicale.
– Elle n’est pas limitée par le siège de la
sténose sur l’axe carotidien ni par l’exis-
tence de lésions en tandem qui seront trai-
tées dans le même temps.
– Elle n’interrompt le flux carotidien que
pendant une vingtaine de secondes (temps
d’inflation du ballon) ce qui prévient la
survenue d’un accident hémodynamique
chez les patients dont le polygone de
Willis n’est pas fonctionnel soit par agé-
nésie congénitale, soit du fait d’une occlu-
sion carotidienne controlatérale.
Indications
Nous ne réalisons d’angioplastie de la
carotide interne que pour des sténoses ser-
rées (> 70 %) chez des patients présentant
un ou plusieurs des critères suivants :
État local à risque
a. Sténoses radiques.
b. Resténoses postopératoires ou antécé-
dent de chirurgie cervicale homolatérale.
c. Patients trachéotomisés en raison du
risque d’infection du foyer opératoire.
d. Paralysie laryngée controlatérale car
l’éventualité d’une paralysie laryngée
bilatérale après chirurgie serait catastro-
phique sur le plan fonctionnel.
Localisations sténotiques à risque
a. Sténoses hautes situées sur la carotide
interne : en arrière de la branche montante
du maxillaire (car leur abord nécessite une
luxation mandibulaire) ou à la base du
crâne (inaccessible à la chirurgie).
b. Sténoses en tandem : association avec
une sténose de la carotide primitive (dont
l’accès chirurgical est plus complexe et
nécessite parfois une manubriotomie) ou
association avec une sténose du siphon
accessible seulement à l’angioplastie.
État vasculaire cérébral à risque
Sténoses associées à une occlusion de la
CI controlatérale ou à une agénésie du
polygone de Willis.
Technique
La voie d’abord est fémorale. La mise en
place d’un cathéter porteur de large calibre
(8 French) dans la carotide primitive d’un
patient âgé aux artères tortueuses est
d’ailleurs souvent difficile et constitue la
principale cause d’échec de la technique.
L’angioplastie de la bifurcation carotidienne
ne se conçoit qu’avec implantation d’une
endoprothèse, le plus souvent autoexpan-
sible (CarotidWallstent®, Schneider-Boston
Scientific). Celle-ci est constituée d’une
prothèse à mémoire de forme comprimée
dans une gaine externe protectrice. La
prothèse se déploie après retrait de la
gaine et retrouve son diamètre natif.
L’intérêt de ce type de prothèse est double.
D’une part, la gaine protectrice permet
l’implantation du stent avant dilatation de

347
neurologie
Avancées thérapeutiques
la sténose ce qui évite tout risque de dis-
section carotidienne lors de l’inflation du
ballon. Un stent serti sur ballon pourrait
se désolidariser du cathéter et migrer si
cette manœuvre était tentée. D’autre part,
en retrouvant son calibre nominal, le stent
s’adapte aux calibres différents de la caro-
tide interne et de la carotide primitive ce
qui est indispensable dans le traitement
des sténoses de la bifurcation carotidienne.
Un stent serti sur ballon ne pourrait pas
s’adapter à cette disparité de calibre arté-
riel. Après mise en place du cathéter por-
teur, la sténose est d’abord franchie à l’aide
d’un guide. Le patient reçoit alors 1 mg
d’atropine IV afin d’inhiber l’effet vagal
qui survient lors de la dilatation du glo-
mus carotidien. S’il s’agit d’une sténose
très serrée (> 90 %), une première dilata-
tion est réalisée à l’aide d’un ballon d’an-
gioplastie de 3 mm. Le stent est ensuite
déployé sur toute la hauteur de la sténose.
Un ballon d’angioplastie dilatant à 6 mm
est introduit dans la lumière du stent et
gonflé jusqu’à obtenir l’expansion com-
plète de la prothèse (figure 4).
Cas particulier : les sténoses carotidiennes
bilatérales.
La règle de traiter les sténoses bilatérales
en deux temps s’applique au traitement
chirurgical comme au traitement endovas-
culaire. Son but est de prévenir la surve-
nue simultanée de lésions bihémisphé-
riques, catastrophiques sur le plan
neuropsychologique.
Protection cérébrale
Il s’agit d’une variante de la technique
d’angioplastie précédemment décrite et
qui vise à protéger les artères cérébrales
des embols cholestéroliques qui pour-
raient se détacher de la plaque d’athérome.
Théron a été le premier à imaginer un sys-
tème permettant l’équivalent du clampage
carotidien distal lors d’une endartériecto-
mie (10). Le principe est de gonfler un
ballonnet dans la carotide interne en aval
de la sténose avant de réaliser le traite-
ment de la plaque puis d’aspirer les débris
éventuels avant de dégonfler le ballonnet.
Ce système est maintenant commercialisé
sous la forme d’un microguide porteur du
ballonnet de protection (Percusurge®).
L’inconvénient de ce système est de ral-
longer de plusieurs minutes l’interruption
du flux carotidien. D’autres systèmes sont
en développement, incluant notamment
des filtres qui retiendraient les débris de
plaque sans interrompre le flux artériel.
Conclusion
L’angioplastie des artères cérébrales est
maintenant possible depuis leur origine
jusqu’à leurs branches de division intra-
crânienne. Néanmoins, cette technique
reste en cours d’évaluation dans certains
centres spécialisés. Les indications et la
technique varient en fonction du siège de
la sténose. Une connaissance clinique et
anatomique des territoires vasculaires
cérébraux et de leur fonctionnalité nous
semble indispensable pour réaliser ces
gestes en sécurité.
Références bibliographiques
1. Kellogg JX, Nesbit GM et al. The role of
angioplasty in the treatment of cerebrovascu-
lar disease. Neurosurgery 1998 ; 43 : 549-56.
2. North american symptomatic carotid endar-
terectomy trial collaborators. Beneficial effect
of carotid endarterectomy in symptomatic
patients with high grade carotid stenosis.
N Engl J Med 1991 ; 325 : 445-53.
3. European carotid surgery trialists’ collabo-
rative group, MRC european carotid surgery
trial. Interim results for symptomatic patients
with severe or with mild carotid stenosis.
Lancet 1991 ; 337 : 1235-43.
4. Higashida R, Tsai FY et al. Transluminal
angioplasty for atherosclerotic disease of the
vertebral and basilar arteries. J Neurosurg
1993 ; 78 : 192-8.
5. Houdart E, Ricolfi F et al. Percutaneous
transluminal angioplasty of atherosclerotic
basilar artery stenosis. Neuroradiology 1995 ;
38 : 383-5.
Figure 4. Angioplastie d’une sténose de la bifurcation carotidienne. Patient de 60 ans
aux antécédents de radiothérapie cervicale pour néoplasie ORL ayant présenté plusieurs
épisodes d’hémiparésie droite. Le doppler cervical a montré une thrombose de l’artère
carotide droite et une sténose serrée de l’artère carotide interne gauche.
A : Artériographie carotidienne gauche montrant une sténose très serrée de l’artère caro-
tide interne (pointe de flèche) associée à une image d’excavation (flèche creuse) et à une
plaque sténosante de la bifucation carotidienne (flèche).
B : Résultat après angioplastie et implantation d’un stent autoexpansible
A
B
 6
6
1
/
6
100%