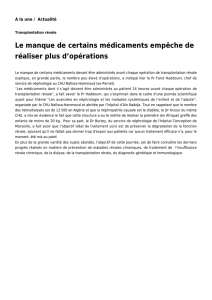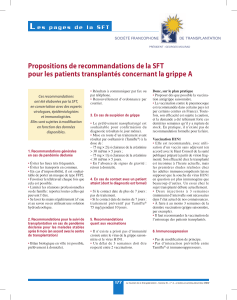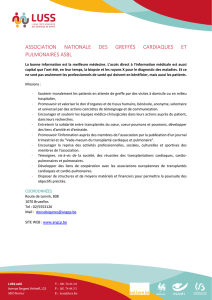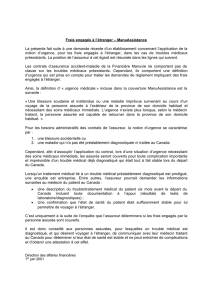Lire l'article complet

Le Courrier de la Tr a n s p l a n t a t i o n - Volume IV - n
o
3 - juillet-août-sept. 2004
169
MIEUX CONNAÎTRE LE MONDE DE L’ASSURANCE
DE PERSONNES
La pre m i è re fo rme d’assurance a commencé au Moyen Âge par
le “prêt à la grosse aventure”. L’assurance s’est développée par
la suite parallèlement à la croissance économique des nations
et au besoin de sécurité grandissant que nous ressentons tous,
plus ou moins consciemment.
L’assurance de personnes est un contrat par lequel un assureur
garantit à l’assuré (proposant), moyennant une prime, le paie-
ment d’une somme convenue en cas de réalisation d’un évé-
nement déterminé (sinistre). En Fra n c e,l ’ a s s u rance de pers o n n e
la plus commune couvre le décès, l ’ i n c apa cité de travail ou l’in-
va l i d i t é ; elle est fréquemment adossée à un prêt bancaire. Dans
ce cas, la banque est bénéficiaire et récupère la somme d’ar-
gent prêtée en cas de sinistre.
Pour qu’un contrat d’assurance soit fi n a n c i è rement équilibré
entre assureur et assurés, c’est-à-dire que l’assureur perçoive
une prime suffisante pour payer les sinistres potentiels, il doit
obéir à plusieurs principes intangibles :
Le risque à assurer doit être aléat o i re : il n’est pas possibl e
d ’ a s s u rer un risque certain ou quasi certain. Par exe m p l e,u n
a s s u r eur off rant une assurance décès à des personnes at t e i n t e s
d’une affection incurable au stade terminal de leur maladie sera i t
rapidement dans l’impossibilité d’honorer ses engage m e n t s .
Le risque à assurer doit être mutualisé entre tous les assu-
rés. En d’autres termes, le risque doit être réparti entre tous les
assurés ; certains paieront des primes sans avoir de sinistre, ils
paieront pour le sinistre des autres.
La prime à payer par l’assuré doit être fonction du ri s q u e
réellement encouru par l’assure u r. L’ a s s u r eur doit donc défi n i r,
au sein de la mu t u a l i s ati on du ri s q u e,des sous-populations d’as-
surés qui présentent un risque de sinistre anormalement élev é ;
on parle alors de risques aggravés. Par exe m p l e, la populat i o n
d’assurés ayant bénéficié d’une tra n s p l a n t ati on rénale, p o p u l a -
tion qui a statistiquement un risque de décès plus élevé que la
m o ye n n e ,p a i e r a une prime d’assurance majorée en conséquence.
L’assureur doit tenir compte d’un phénomène classique
en assurance, l’antisélection : une personne se sentant mena-
cée par un risque déterminé aura tendance à s’assurer pour ce
risque précis. Ainsi, l’antisélection peut fausser les calculs de
prime qu’avait faits l’assureur pour obtenir l’équilibre finan-
cier du contrat d’assurance.
Ces grands principes étant rap p e l é s , on comprend donc que l’as-
s u reur doit, à chaque demande d’assura n c e,é v aluer le plus objec-
t ivement possible le risque encouru. Pour cela, il doit obtenir des
i n fo rm ations médicales concernant les pro p o s a n t s , par l’inter-
m é d i a i re de questionnaires médicaux, de rap p o rts médicaux ou
d ’ a u t res pièces médicales ap p ro p riées. Toutes ces données sont
a n a lysées par les équipes médicales des assure u rs , et un avis tech-
nique est donné. Il peut s’agir d’une assurance sans surp ri m e,
d’une assurance avec surp ri m e, d’un re f u s , o u , é v e n t u e l l e m e n t ,
d’un ajournement pour obtenir des renseignements médicaux
s u p p l é m e n t a i res utiles à l’analyse du dossier. L’équipe médicale
de l’assureur étudie le risque “sur dossier”. Elle doit donner un
avis définitif sur des pièces médicales plus ou moins complètes
et ex h a u s t i ves. Lorsqu’elle accepte un ri s q u e, elle s’engage sur
p l u s i e u rs années, sans retour possible en arri è re. Elle a donc le
d e voir d’être objective et prudente dans son analy s e.
Le dernier point de vo c a bu l a i re qu’il est utile de connaître ava n t
de s’intéresser à la population de transplantés rénaux est celui
de “ r é a s s u rance”. L’ a s s u reur part age le risque en s’assurant à
son tour auprès de réassure u r s. L’ a s s u r eur connaît bien les
risques potentiels de son port e feu ille d’assurés. Le réassure u r,
agissant auprès de plusieurs assure u rs en France et à l’étra n ge r,
a une vision et une ex p é r ience plus globales du ri s q u e. Il peut
plus facilement anticiper les évo l u t i o n s , et agit donc souve n t
comme conseiller technique des assure u rs dans ce domaine.
LA POPULATION DES TRANSPLANTÉS RÉNAUX :
QUEL RISQUE POUR L’ASSUREUR ?
Pour répondre à cette question, il est nécessaire de “ d é c o r t i-
q u e r ” tous les risques potentiels émaillant la vie d’un assuré
transplanté rénal et, en particulier,il faut répondre aux ques-
tions suivantes :
Quelle est la cause de l’insuffisance rénale terminale qui a
conduit à la transplantation ?
Le risque peut être fonction de la maladie rénale sous-jacente.
Il peut s’agir d’une maladie de système pouvant toucher plu-
s i e u r s orga n e s , d’une gloméru l o n é p h rite ch ron ique isolée,
d’une néphropathie d’un patient diabétique avec une atteinte
polyvasculaire ou d’une néphrectomie post-traumatique sur un
rein unique chez une personne en excellente santé par ailleurs.
On comprend que le risque vital est bien diff é rent selon ces cas.
La maladie sous-jacente fait-elle courir un risque de réci -
dive au rein transplanté ?
Dans ce cas, il existe un risque augmenté de retour en dialyse.
Une récidive survient aussi plus fréquemment si une nouvelle
transplantation est tentée.
Un retour en dialyse ou une nouvelle transplantation rénale
sont-ils imminents ?
Un rein transplanté a une durée de vie limitée. À côté du risque
de décès avec un rein fonctionnel, un assuré transplanté n’est
donc pas à l’abri d’un retour en dialyse ou de la nécessité d’une
Dé b a t
D. Lannes*
* Médecin-conseil Scor Vie, 1, avenue du Général-de-Gaulle, 92074 Paris-La
Défense Cedex.
As s u ra n c e et pat i e n ts tra n s p l a n tés rénaux

Le Courrier de la Tr a n s p l a n t a t i o n - Volume IV - n
o
3 - juillet-août-sept. 2004
170
Dé b a t
nouvelle transplantation. Il est reconnu qu’une transplantation
rénale est un acte médico-chirurgical dont la mortalité globale
immédiate ou dans les quelques mois suivants est de l’ordre de
1%. Il n’est donc pas possible d’accepter une demande d’as-
surance d’une personne “à la veille” d’une nouvelle transplan-
tation, car le phénomène d’antisélection pourrait intervenir de
façon import a n t e. La demande d’assurance pourra donc être
étudiée après la transplantation, lorsqu’un délai de six mois a
été atteint. En revanche, nous acceptons les patients dialysés,
en liste d’attente de transplantation, car nous connaissons les
délais de plusieurs années de ces listes, et nous considéro n s
qu’un proposant en liste d’attente est en quelque sorte “sélec-
tionné” par les néphrologues comme étant médicalement apte
à supporter une intervention chirurgicale lourde.
Quel est l’état cardiovasculaire du proposant transplanté ?
La mortalité des patients transplantés est avant tout d’origine
c a rd i ova s c u l a i re, en particulier par infa rctus du myo c a rd e. Il
est donc primordial pour l’assureur d’avoir une évaluation pré-
cise de l’état cardiovasculaire du proposant en obtenant le der-
nier bilan card i ova s c u l a i r e réalisé, qui comporte notamment
un ECG, une épre u ve d’effo rt , une éch ographie cardiaque et
éventuellement une coronarographie. Par ailleurs, nous savons
que plus la période d’insuffisance rénale a été longue,plus la
période de dialyse précédant la transplantation a été longue et
plus l’état cardiovasculaire du proposant risque d’être altéré.
Ces para m è t res vont donc compter dans notre éva l u a tion du
risque.
Y a-t-il eu des progrès médicaux ou ch i ru rgicaux récents
et majeurs pouvant influencer signifi c at iveme nt le pro n o s t i c
global des patients transplantés ?
Les médecins-conseils travaillant dans un département médi-
cal de risques aggravés doivent suivre attentivement l’évolu-
tion et les progrès du monde médical et réévaluer régulière m e n t
leur approche du risque pour telle ou telle affection. Ils doivent
anticiper, avec prudence, l’effet attendu des progrès médico-
chirurgicaux sur la survenue de sinistres à venir.
Dans le domaine de la transplantation rénale,les néphrologues
nous ont ainsi ap p ris qu’il y ava i t , ces dern i è res années, u n e
m e i l l e u r e prise en compte des spécificités des donneurs , u n
développement du don d’organe par des donneurs vivants, une
m e i l l e u re efficacité et une meilleure tolérance des médicaments
a n t i rejets et, e n f i n , une meilleure prise en ch a rge anti-infe c-
tieuse, par exemple dans les infections à cytomégalovirus. Ces
éléments ont signifi c at ivement amélioré le pronostic global des
patients transplantés et ainsi conduit certains assureurs à élar-
gir les conditions d’accep t ation d’assurance des pro p o s a n t s
transplantés rénaux.
L’ASSURANCE DES PATIENTS TRANSPLANTÉS RÉNAUX :
QUELLE APPROCHE PRATIQUE ?
Ces lignes directrices tracées, revenons au travail quotidien du
médecin-conseil d’un département médical des risques aggra-
vés. Après avoir examiné le dossier médical de souscri p t i o n
d’un proposant transplanté rénal, il doit donner un avis tech-
nique. Pour cela, il utilise les statistiques de mortalité parais-
sant dans des études scientifiques incontestables. Dans un
contexte français, les statistiques publiées par l’Établissement
français des greffes sont particulièrement utiles. Bien sûr, l’as-
sureur et le réassureur utilisent également leurs propres statis-
t i q u e s , reposant sur les dossiers d’assurance de pro p o s a n t s
transplantés rénaux déjà assurés. Enfin, il est indispensable de
moduler l’évaluation théorique et scientifique du risque pour
une pat h o l ogie donnée, en étudiant les dossiers “ s i n i s t r e s ” .
L’étude des dossiers “ s i n i s t re s ” c o n s t i t u e,en quelque sort e,p o u r
le médecin-conseil “l’heure de vérité” ; elle est souvent riche
d’enseignements et peut permettre, dans certains cas, de rééva-
luer la position de l’assureur.
Pour donner un avis tech n i q u e, le médecin-conseil va donc inté-
grer la théori e, les réponses aux questions que nous nous
sommes posées plus haut et sa propre expérience. Il va ainsi
“baliser” le risque entre deux bornes, définies par l’élaboration
de “portraits robots du risque majeur et minime” :
Le port rait robot du proposant transplanté présentant un
risque majeur pour l’assureur
Il s’agit, par exemple, d’un proposant ayant une insuffisance
rénale consécutive au diabète,à une amylose ou à une maladie
de système touchant plusieurs organes, qui a déjà traversé une
longue période d’insuffisance rénale chronique ou de dialyse
précédant la transplantation. Il peut aussi s’agir d’un receveur
de gre f fe multiple ou d’un patient ayant déjà été gre f f é , p r é -
sentant une dysfonction avancée de son greffon rénal, ou qui
présente un mauvais état cardiovasculaire, etc.
Le port rait robot du proposant transplanté présentant un
risque minime pour l’assureur
Il s’agit d’un proposant jeune, n’ayant eu dans sa vie qu’une
c o u rte période d’insuffisance rénale ch ronique et de dialy s e,
avec une bonne fonction du greffon rénal et un état cardiolo-
gique impeccable.
Entre ces extrêmes, le médecin conseil aura à sa disposition un
large éventail de tarification du risque qu’il adaptera en fonc-
tion de son analyse précise de chaque dossier. Son avis tech-
nique dev rait actuellement perm e t t re à l’assureur d’accep t e r,
certes avec des primes d’assurance majorées, la majorité des
proposants transplantés rénaux, à des tarifs correspondant au
plus près des statistiques de mortalité de cette population de
patients.
Si le médecin-conseil veut faire mieux que la “boule de cris-
tal”, l’évaluation objective et précise du risque est difficile. Les
néphrologues qui pensent que ce travail est aisé peuvent réflé-
chir au dossier médical d’assurance d’une personne ayant une
maladie de Berger, avec hématurie,créatininémie à 36 mg/l et
hy p e rtension art é rielle traitée et… aucune autre info rm a t i o n
pertinente. Quel serait leur avis technique pour une demande
d ’ a s s u rance sur vingt ans ? A j o u rn e m e n t ? Refus ? Ta ri fi c a-
tion… à quel taux ?
1
/
2
100%