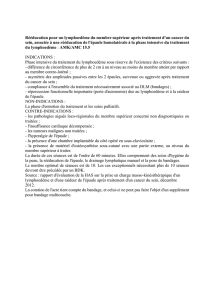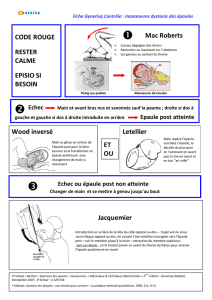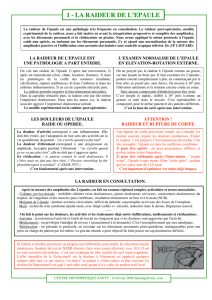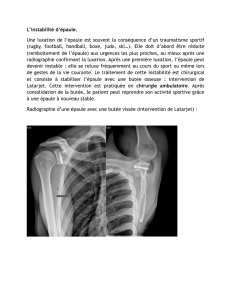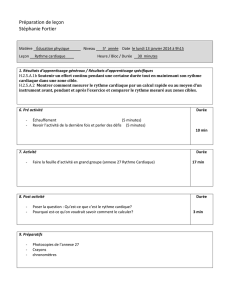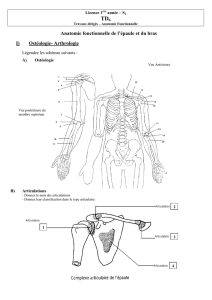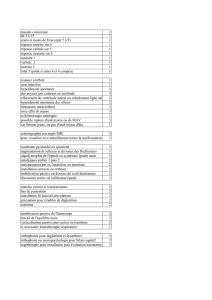Nouveaux concepts de prise en charge kinésithérapique.

“L
es traumatismes directs ou indirects de l’épaule sont très
fréquemment suivis d’une inflammation des tissus qui
entourent l’articulation scapulo-humérale. […] La péri-
arthrite de l’épaule doit être traitée avec soin à son début si l’on
veut éviter les raideurs qui en sont la conséquence.” Cette citation
de S. Duplay est tirée du mémoire qu’il a présenté en 1872 (1). Il
poursuivait ainsi : “La gymnastique du membre, l’électricité, les
douches, le massage, constituent le meilleur traitement […] jusqu’à
ce que l’épaule ait recouvré l’intégrité de ses mouvements.”
* Médecin rééducateur, Lyon.
■
Patient couché à plat, nous mesurons les amplitudes pas-
sives en élévation et en rotation externe RE1 ; puis, patient
assis en bord de table, nous mesurons les amplitudes actives
en rotation interne, élévation et rotation externes RE2.
■
La raideur de l’épaule intervient tout autant que la rup-
ture de la coiffe des rotateurs dans le dysfonctionnement de
l’épaule.
■
Une raideur postopératoire inhabituelle renvoie souvent
à une raideur préopératoire négligée.
■
La rééducation de l’épaule peut reposer sur une autoréé-
ducation simple, de quelques minutes quelques fois par jour.
■
S’étirer au zénith est fondamental en postopératoire.
Mots-clés : Épaule - Raideur - Autorééducation - Bloc du
nerf sus-scapulaire.
Keywords:
Shoulder - Stiffness - Self-rehabilitation -
Suprascapular nerve block.
Points forts
La raideur articulaire, à l’épaule, prend un masque plus subtil
qu’au genou. Autant il est facile d’associer une boiterie doulou-
reuse à un flexum de 10 degrés constaté sur un genou, autant il est
difficile d’associer une impotence douloureuse de l’épaule à une
raideur, devant un patient debout qui se présente bras au ciel. Or,
nous avons souvent observé qu’une élévation active, apparemment
complète au zénith, peut masquer une raideur de l’épaule ; un exa-
men clinique précis est nécessaire pour quantifier la raideur de
l’épaule.
RAIDEUR DE L’ÉPAULE : EXAMEN CLINIQUE
Pour mesurer les amplitudes, nous utilisons une méthode simple,
fiable, reproductible et comparative, préconisée par Neer (2). Patient
couché à plat, nous mesurons les amplitudes passives en élévation
et en rotation externe RE1. Puis, patient assis en bord de table, nous
mesurons les amplitudes actives en rotation interne, élévation et
rotation externe RE2. Pour l’élévation et la rotation externe pas-
sives, la mesure est faite coude au corps, sans aucune composante
d’abduction, qui même modérée augmente la mesure de 10 à
30 degrés. Pour l’élévation active, la main de l’examinateur, posée
dans le dos du patient, suffit à éliminer toute compensation latérale
ou postérieure : une élévation active contrôlée est de 10 à 30 degrés
moins élevée qu’une élévation buste libre. Cette mesure chiffrée
stricte permet d’établir le morphotype articulaire du patient du côté
sain ; du côté atteint, elle objective la raideur de l’épaule, qui est
chiffrée.
RAIDEUR DE L’ÉPAULE :
ÉLÉMENTS D’ANATOMO-PHYSIO-PATHOLOGIE
La raideur associe à des degrés divers bursite et capsulite. La
bursite et ses trois stades ont été présentés, en 1983, par Neer (3).
Dès le stade 2, la fibrose sous-acromiale peut limiter l’élévation
du fait de la perturbation du glissement sous-acromial ; pour Neer,
à ce stade, l’assouplissement de l’épaule fait partie des objectifs
du traitement médical. La capsulite rétractile “moderne” a été décrite
in vivo, dès 1945, par Neviaser (4) ; la rétraction capsulaire limite
Nouveaux concepts
de prise en charge kinésithérapique.
À propos de la raideur de l’épaule
Shoulder rehabilitation:
what about stiffness?
●J.P. Liotard*
La Lettre du Rhumatologue - n° 316 - novembre 2005
45
NOUVEAUX CONCEPTS KINÉSITHÉRAPIQUES

toutes les amplitudes, donnant le classique schéma capsulaire
90/0/main-fesse. Enfin, Neer (5) a insisté sur la limitation spéci-
fique de la rotation externe, du fait de la rétraction particulière du
ligament coraco-huméral.
La raideur postopératoire est un modèle expérimental inversé de
la raideur en train de se mettre en place dans une épaule. L’analyse
biomécanique de la raideur peut se faire à partir de trois stades :
les 90 degrés du schéma capsulaire, les 120 degrés de la raideur
sévère, les 150 degrés de la raideur résiduelle. À 90 degrés, la rai-
deur correspond à la rétraction du récessus capsulaire inférieur.
À 120 degrés, elle correspond à la rétraction du ligament coraco-
huméral. À 150 degrés, elle correspond au défaut de glissement
sous-acromial.
La raideur admet un traitement médical local pouvant agir sur la
bursite et la capsulite : c’est le bloc du nerf sus-scapulaire. Le nerf
sus-scapulaire innerve sur le plan sensitif l’espace sous-acromial
et la capsule gléno-humérale. Présenté dans la littérature depuis
1951 (6),le bloc du nerf sus-scapulaire a vu son efficacité sur les
douleurs de l’épaule gelée démontrée par Wassef, en 1992 (7).
Personnellement, depuis 1988, j’injecte sous contrôle scopique,
par voie transacromio-claviculaire, un dérivé cortisoné (2 ml), un
produit de contraste (3 ml) et les 10 ml de lidocaïne du test de Neer :
c’est un test de Neer à visée thérapeutique.
EXPÉRIENCE DE LA RAIDEUR
PRÉ- ET POSTOPÉRATOIRE
La raideur de l’épaule intervient tout autant que la rupture de la coiffe
des rotateurs dans le dysfonctionnement de l’épaule. En 2001 (8),
nous avons montré qu’en prenant en compte la raideur de l’épaule,
on peut obtenir des résultats satisfaisants, sans réparer la coiffe. Sur
49 patients porteurs d’une rupture de coiffe et s’étant enraidis (éléva-
tion antérieure moyenne à 116 degrés), tous étaient assouplis en quatre
mois et 76 % n’avaient pas été opérés avec un résultat fonctionnel
jugé satisfaisant après plus de deux ans de recul. La conclusion est
qu’il faut assouplir une épaule raide avant de rediscuter de la néces-
sité de la chirurgie, qui n’est le plus souvent pas nécessaire.
Une raideur postopératoire inhabituelle renvoie souvent à une
raideur préopératoire négligée. Négliger une raideur de l’épaule
est malheureusement habituel lorsqu’il existe une rupture de coiffe
confirmée par l’imagerie ; l’évidence de la rupture l’emporte sur
l’évidence de la raideur de l’épaule et conduit souvent à enchaîner
trop vite la consultation et l’intervention. La conclusion de notre
expérience est simple à définir : il faut s’acharner à expliquer au
patient l’inconvénient qu’il y a à être opéré avec une raideur de
l’épaule. Il convient également de le persuader de se plier aux
contraintes de l’assouplissement de son épaule raide, et de ne pas
forcément être opéré à terme.
RÉÉDUCATION :
RÉCUPÉRER L’ÉLÉVATION FONCTIONNELLE
Pour la rééducation, nous avons repris une règle de Neer (9) :
autorééducation simple, quelques minutes quelques fois par jour.
De 1985 à 1995, nous avions gardé une certaine complexité dans
la façon de faire (10). Depuis 1995, nous avons mis en place la
récupération de l’élévation, coudes fléchis au départ, mains entre-
croisées allant au-dessus de la tête puis au zénith, coudes tendus à
l’arrivée. Comme Hughes et Neer (11),nous pensons que ce que
le patient peut faire ne doit pas être fait par le kinésithérapeute et
pour nous, la manipulation kinésithérapique à visée mobilisatrice
est proscrite.
Le travail en élévation fonctionnelle est important. Gagey (12) a
montré en effet que la flexion et l’abduction ne permettent pas une
élévation complète à cause, respectivement, de la mise en tension
des ligaments coraco-huméral et gléno-huméral inférieur. L’éléva-
tion la plus complète et la plus facile est obtenue dans le plan de
l’omoplate, car les ligaments gléno-huméral inférieur et coraco-
huméral, en tension réciproque équilibrée, se déplient complète-
ment. En même temps, le massif trochitérien, évitant l’écueil acro-
mial (en abduction) et l’écueil coracoïdien (en flexion), s’engage
sans conflit sous le ligament acromio-coracoïdien. C’est ce qui se
passe lors de l’étirement mains entrecroisées au-dessus de la tête,
puis au zénith.
S’ÉTIRER AU ZÉNITH EST FONDAMENTAL
EN POSTOPÉRATOIRE
S’étirer au zénith optimise le remodelage collagénique : la cicatri-
sation concerne l’appareil capsulo-ligamentaire et la bourse sous-
acromiale, qui cicatrisent de part et d’autre du tendon. L’étirement
mains jointes en élévation, au gré du patient, crée des contraintes
progressives en traction, qui respectent la réinsertion transosseuse,
redonnent sa longueur à l’appareil capsulo-ligamentaire, et son rôle
de glissement à la bourse sous-acromiale. En postopératoire, la pro-
gression en élévation correspond, en même temps, à la remise en
route en étirement progressif de tous les muscles de la ceinture
scapulaire.
S’étirer au zénith est une modalité optimale de réveil et de travail
musculaire :s’étirer met en jeu 108 muscles pour les membres supé-
rieurs (13). Les étirements personnels, mains jointes, réveillent les
muscles ; les activités de la vie quotidienne, reprises progressive-
ment, les renforcent. Nous prévenons le patient que ses muscles vont
se réveiller plus vite et plus fort que ne vont cicatriser ses tendons,
car le métabolisme des cellules musculaires est beaucoup plus actif
que le métabolisme des fibres de collagène. Nous interdisons donc
tout exercice kinésithérapique complémentaire à visée musculaire
(travail actif et travail contre résistance), et nous invitons le patient
à être très prudent dans la reprise de ses activités.
PEUT-ON APPLIQUER CETTE RÉÉDUCATION
À L’ÉPAULE PRÉOPÉRATOIRE ?
Il est facile, en consultation, de proposer à un futur opéré de s’éti-
rer mains jointes au zénith ; il suffit de quelques secondes pour
le lui montrer et pour voir s’il est capable de le faire. Si cela paraît
difficile, voire impossible, comment imaginer que les désordres
articulaires qui l’empêchent de s’étirer ne vont pas se retrouver
aggravés en postopératoire, avec un patient qui ne pourra ni ne devra
plus forcer pour s’étirer et vaincre la raideur ?
NOUVEAUX CONCEPTS KINÉSITHÉRAPIQUES
La Lettre du Rhumatologue - n° 316 - novembre 2005
46

NOUVEAUX CONCEPTS KINÉSITHÉRAPIQUES
Si l’épaule est rebelle à cet autoassouplissement, un bloc sensitif
du nerf sus-scapulaire facilite les étirements mains jointes dans
le quart d’heure qui suit, grâce à l’action rapide de la lidocaïne.
L’assouplissement se complète dans les 10 jours qui suivent, grâce
à l’action plus tardive de la cortisone. La souplesse doit ensuite
être maintenue par les étirements, en se donnant au moins un mois
après l’infiltration pour en juger.
La raideur préopératoire négligée est en partie responsable de la
mauvaise réputation de la rééducation de l’épaule opérée : doulou-
reuse, difficile, longue et décevante. L’habitude prise de faire s’assou-
plir nos propres patients me permet de constater que, chaque fois
qu’un chirurgien déroge à cette règle et me confie le suivi de son
patient, je constate que la rééducation est douloureuse, difficile,
longue et décevante.
■
Bibliographie
1. Duplay S. De la péri-arthrite scapulo-humérale et des raideurs de l’épaule qui
en sont la conséquence. Archives générales de médecine ;1872:513-42.
2. Neer CS 2nd. In : Shoulder Reconstruction. Philadelphie : WB Saunders
Company;1990;7-14.
3. Neer CS 2nd. Impingement lesions. Clin Orthop Relat Res 1983;173:70-7.
4. Neviaser JS. Adhesive capsulitis in the shoulder: a study of the pathological
findings in periarthritis of the shoulder. J Bone Joint Surg 1945;27:211-22.
5. Neer CS 2nd. The anatomy and potential effects of contracture of the coraco-
humeral ligament. Clin Orthp Relat Res 1992;280:182-5.
6. Granirer LW. A simple technique for suprascapular nerve block. NY State J
Med 1951;51:1048-54.
7. Wassef MR. Suprascapular nerve block. A new approach for the management
of frozen shoulder. Anaesthesia 1992;47:120-4.
8. Liotard JP. Rupture de coiffe et raideur de l’épaule. Symposium sur la raideur
de l’épaule. 2001;La Baule, France. Proceedings.
9. Neer CS 2nd. In :Shoulder Reconstruction. Philadelphie :WB Saunders Company ;
1990;488-91.
10. Liotard JP, Expert JM, Mercanton G, Padey A. Rééducation de l’épaule. Édi-
tions techniques. Encyclopédie Médico-Chirurgicale. Paris. Kinésithérapie-
Rééducation fonctionnelle 1995;26-210:23-30.
11. Hughes M, Neer CS 2nd. Glenohumeral joint replacement and postoperative
rehabilitation. Physical therapy 1975;55:850-8.
12. Gagey O, Bonfait H, Gillot C, Mazas F. Anatomie fonctionnelle et mécanique
de l’élévation du bras. Rev Chir Orthop 1988;74:209-17.
13. Bonnel F. Épaule et couples musculaires de stabilisation rotatoire dans les
trois plans de l’espace. In : Bonnel F, Blotman F, Mansat M (eds). L’épaule.
Paris : Springer-Verlag;1993:35-6.
Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules
❏Collectivité .................................................................................
à l’attention de ..............................................................................
❏Particulier ou étudiant
M., Mme, Mlle ................................................................................
Prénom ..........................................................................................
Pratique : ❏hospitalière ❏libérale ❏autre..........................
Adresse e-mail ...............................................................................
Adresse postale .............................................................................
......................................................................................................
Code postal ........................Ville ……………………………………
Pays................................................................................................
Tél..................................................................................................
Merci de joindre votre dernière étiquette-adresse en cas de réabonnement,
changement d’adresse ou demande de renseignements.
ÉTRANGER (AUTRE QU’EUROPE)
FRANCE/DOM-TOM/EUROPE ❐140
€collectivités
❐116
€particuliers
❐80
ێtudiants*
*joindre la photocopie de la carte
❐120
€collectivités
❐96
€particuliers
❐60
ێtudiants*
*joindre la photocopie de la carte
LR 316
OUI, JE M’ABONNE AU MENSUEL La Lettre du Rhumatologue
Total à régler .......... €
À remplir par le souscripteur
À remplir par le souscripteur
À découper ou à photocopier
✂
ABONNEMENT : 1 an
+
ETPOUR 10 €DE PLUS !
10
€
, accès illimité aux 24 revues de notre groupe de presse disponibles sur notre
site vivactis-media.com (adresse e-mail gratuite)
+
R
RELIURE
ELIURE
❐10
€
avec un abonnement ou un réabonnement
MODE DE PAIEMENT
❐
carte Visa, Eurocard Mastercard
N°
Signature : Date d’expiration
❐
chèque
(à établir à l'ordre de La Lettre du Rhumatologue)
❐
virement bancaire à réception de facture
(réservé aux collectivités)
EDIMARK SAS - 2, rue Sainte-Marie - 92418 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 46 67 62 00 - Fax : 01 46 67 63 09 - E-mail : [email protected]
❐
1
/
3
100%