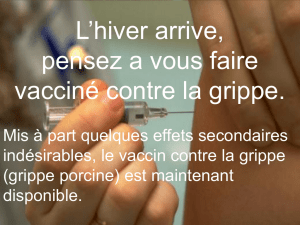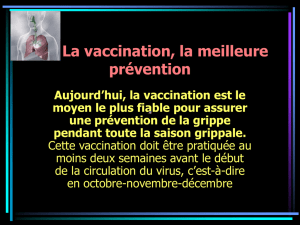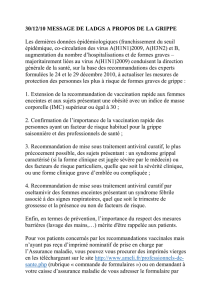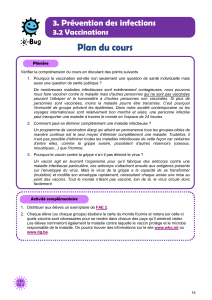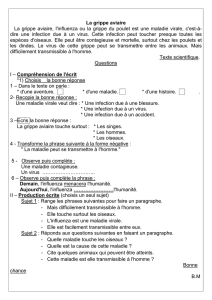L
a grippe nous quitte. Mais l’at-
tention est maintenant tour-
née vers l’Asie, où l’épidémie
de grippe aviaire A(H5N1) qui sévit a
déjà causé le décès d’au moins
10 per
sonnes. Depuis le foyer de cas
humains de grippe aviaire à Hong
Kong en 1997, plusieurs alertes ont
été déclenchées, notamment à Hong
Kong en janvier 2003, aux Pays-Bas
en avril 2003 et, maintenant, dans
toute l’Asie. Jusqu’ici, l’existence de
cas humains confirmés n’a jamais été
suivie de transmission interhumaine.
La vigilance s’impose car, pendant les
épidémies de grippe humaine, la cir-
culation concomitante de virus grip-
paux humains et aviaires augmente le
risque d’échanges de matériel géné-
tique entre eux.
L’importance du vaccin
Cette année, le virus grippal domi-
nant A (H3N2) a atteint surtout les
enfants et les jeunes adultes (50 %
des cas de moins de 20 ans). Cet
hiver, le virus identifié majoritaire-
ment est le virus Fujian A H3N2, donc
un peu différent du virus Panama A
H1N2 qui entre dans la composition
du vaccin. Par ailleurs, d’autres virus
circulant plus sporadiquement ont
été détectés (Panama A H3N2, H1N1,
virus B). Les spécialistes estiment
qu’il faut poursuivre les efforts pour la
promotion de la vaccination contre la
grippe, qui reste insuffisante chez les
personnes âgées, mais aussi chez les
professionnels de santé.
L’utilité de la prévention par la vacci-
nation annuelle a été démontrée.
Une épidémie de grippe est survenue
dans un établissement pour per-
sonnes âgées dans le sud de la
France : à défaut de la protection
contre le virus en cause, la souche
A Sydney H3 N2 (un variant non
inclus dans le vaccin 97/98),
69 patients sur 100 ont contracté la
grippe (7 sont décédés) en deux
semaines, et les soignants n’ont pas
été épargnés (20 %). Ce qui a rendu
encore plus difficile la gestion de
l’événement.
Les jeunes aussi
Alors que la grippe était habituellement
considérée comme une maladie affec-
tant essentiellement l’adulte, on admet
maintenant que l’enfant aussi est mas-
sivement touché. Comme le montrent
les données japonaises, le Japon a vu
s’effondrer l’incidence des décès
d’adultes liés à la grippe à la suite de
vaccination des enfants de 1962 à
1994, puis un retour à la situation anté-
rieure après l’arrêt de cette politique
vaccinale. Les trois grandes études réa-
lisées aux États-Unis et au Japon signa-
lent que le risque d’hospitalisation des
enfants, lié à la grippe, est d’autant plus
élevé que l’enfant est petit, et que les
nourrissons de moins d’un an (et éga-
lement les enfants porteurs d’une
pathologie sous-jacente, notamment
les asthmatiques) ont un risque d’hos-
pitalisation aussi élevé que les adultes
à risque. Les principales causes en sont
la pathologie respiratoire, dominée par
la pneumonie et les convulsions
fébriles prolongées (le risque est accru
en cas de grippe par rapport à d’autres
infections respiratoires). D’après une
étude menée en 2002 par l’équipe du
Pr D. Floret (Lyon) portant sur les
enfants admis aux urgences pédia-
triques, 49 % étaient positifs pour la
grippe et 28 % ont consulté pour des
symptômes non respiratoires (fièvre
isolée dans 22 % des cas, symptômes
Des virus grippaux A (H3N2) continuent d’être régulièrement détectés
à partir de cas sporadiques ou de petits foyers locaux. Mais le virus
s’éloigne maintenant vers l’est de l’Europe. Les indicateurs d’activité
médicale et sanitaire, relevés par les vigies des GROG*, sont revenus à
leur niveau de base dans toutes les régions. Quant à la grippe aviaire...
Grippe
L’épidémie se termine en France...
Inquiétudes en Asie
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 52 • janvier-février 2004
digestifs fébriles : 15 %, convulsions
fébriles : 5 %). Si la grippe est, en
général, bénigne chez l’enfant, elle
peut être responsable de maladies
graves telles que la pneumopathie
grippale qui peut conduire au syn-
drome de détresse respiratoire aiguë
(en particulier chez l’immunodéprimé
et dans le cadre des grippes nosoco-
miales), la myocardite ou les complica-
tions neurologiques. On a aussi
observé une augmentation d’incidence
des infections invasives à méningo-
coque dans les suites des épidémies
de grippe. Le Pr D. Floret souligne l’in-
térêt de l’utilisation des tests de dia-
gnostic rapide de la grippe au niveau
des urgences pédiatriques. Par contre,
la place des inhibiteurs de neuromini-
dase est encore mal connue chez l’en-
fant. Mais la vaccination se heurte à
des limites en raison du mode d’admi-
nistration injectable, et du fait qu’elle
n’est pas recommandée avant 6 mois.
Comorbidités
La morbi-mortalité élevée de la grippe
est largement attribuée aux complica-
tions respiratoires basses, liées à des
interactions entre les infections virales
et bactériennes. Le plus souvent, l’in-
fection virale précède et potentialise
l’infection bactérienne. À ce propos, au
cours des épidémies de grippe de
1918, 1957 et 1968, on a rapporté
une augmentation importante de l’inci-
dence des pneumonies bactériennes.
Citons aussi deux études dont il ressort
que l’étiologie virale a été identifiée
chez plus de 20 % des enfants ayant
une pneumonie bactérienne et chez
41 % de ceux souffrant d’otite aiguë
moyenne. Les mécanismes permettant
à une infection virale de favoriser une
infection bactérienne sont multiples :
altération de l’épithélium respiratoire
(modification du battement des cils),
augmentation de l’adhérence et de la
colonisation bactérienne, interférence
avec les défenses antibactériennes du
système immunitaire. À l’inverse, cer-
taines protéases bactériennes sont
Infos ...
Plus de
220 000 doses de
vaccin antigrippal
ont été livrées, en
Asie, en 10 jours,
par les entreprises
du médicament pour
lutter contre la
menace d’épidémie,
à l’appel de l’OMS.
La crainte est la
combinaison des
deux virus qui
pourrait créer un
hybride nouveau,
à contagion
interhumaine.
Actualité Santé
10
Actualités 23/02/04 15:38 Page 10

capables d’activer l’hémagglutinine de
la grippe. À noter que le virus grippal
est suspecté de créer les lésions pul-
monaires permettant la fixation des
souches de Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (productrices
de la toxine
PVL-Leucocidine de Panton
Valentine
), lesquelles sont associées
non seulement à la survenue d’infec-
tions cutanées bénignes ou sévères,
mais aussi à la nouvelle entité clinique
appelée pneumonie nécrosante sta-
phylococcique.
Sur le plan clinique, la bronchite aiguë
demeure la complication respiratoire la
plus fréquente de la grippe (3 % à 8 %
et jusqu’à 15,5 % chez les patients à
risque). L’association entre grippe et
pneumonie bactérienne est suggérée
par le parallélisme dans leur délai de
survenue. La pneumonie virale primaire
(principalement due au virus influ-
enza A)
survient de J2 à J3 et la pneu-
monie bactérienne secondaire (fré-
quence allant de 1 % à 2,5 %) à partir
de J5-J7, avec récidive fébrile, toux pro-
ductive et dyspnée. Les bactéries res-
ponsables sont S. pneumoniae, H.
influenzae, S. aureus, mais aussi
d’autres bactéries telles que K. pneu-
moniae, E. coli et P. aeruginosa chez le
sujet hospitalisé ou en institution. En ce
qui concerne l’antibiothérapie, il est
désormais reconnu qu’elle ne doit pas
être utilisée en cas de grippe simple de
l’enfant ou de l’adulte sans facteur de
risque. Or, il ressort d’une étude que
42,5 % des patients ont reçu des anti-
biotiques alors qu’une complication
n’est survenue que chez 9,5 %. Quant
à la place des inhibiteurs de neuramini-
dase, « il a été démontré que l’oselta-
mivir réduit les complications bacté-
riennes de la grippe (9 % vs 15 %) et
le recours aux antibiotiques (6 % vs
11 %) pour l’ensemble de la popula-
tion », rapporte le Dr Ch. Chidiac (Lyon).
La grippe aviaire
Le risque d’une infection bactérienne
existe donc en cas d’infection virale.
Si un virus grippal aviaire incorpore
dans son génome certaines caracté-
ristiques du virus humain, il peut
acquérir une capacité de transmission
interhumaine et, ainsi, se doter d’une
aptitude pandémique. Par ailleurs, le
porc peut aussi servir de lieu
d’échanges entre virus aviaires et
humains. La cohabitation de volailles,
de porcs et d’humains dans les régions
très agricoles offre ainsi des possibilités
d’émergence d’un nouveau virus
humain à potentiel pandémique.
Le 12 janvier, l’OMS avait confirmé
que la mort de deux enfants et d’une
adulte au Vietnam avait bien été pro-
voquée par le virus H5N1 de la grippe
aviaire, qui avait déjà tué 6 personnes
sur les 18 contaminées en 1997 à
Hong Kong. Le porte-parole du bureau
régional de l’OMS à Manille, Peter
Cordingley, a relevé que le taux de
mortalité de la grippe aviaire « était
bien plus élevé que celui du virus du
SRAS ». Pour rappel, l’épidémie de
SRAS du printemps 2003 avait fait
774 morts et contaminé plus de
8 000 personnes dans 27 pays (la
Chine a confirmé son premier malade
du SRAS en six mois). D’autres cas
suspects de grippe aviaire attendent le
résultat d’analyses. D’autres analyses
devront établir si le virus aviaire est
aussi responsable de la mort de neuf
autres enfants au Vietnam depuis la
mi-octobre. Deux bébés et un adulte
sont toujours hospitalisés, soit un total
de quinze personnes potentiellement
contaminées. « Nous avons besoin de
plusieurs jours pour établir un tableau
clinique très fiable. Mais il est vrai qu’il
y a des probabilités importantes pour
que toutes les personnes contami-
nées aient été victimes du virus du
poulet », a estimé Pascale Brudon,
directrice de l’OMS à Hanoï.
La Corée du Sud a renforcé ses
mesures de quarantaine et abattu
près de 90 000 volailles pour enrayer
un nouveau foyer de grippe aviaire,
signalé le 12 janvier après neuf jours
de trêve, à près de 400 km au sud-
est de Séoul. L’épidémie paraissait
avoir été contrôlée. Tous les poulets
de la zone de réapparition du virus
ont été tués, et les transports de
volailles interdits. Des mesures de
quarantaine ont également été ren-
forcées dans d’autres régions car le
virus peut survivre de 2 semaines à
35 jours selon l’environnement, esti-
ment les autorités sud-coréennes.
Pour la première fois depuis 1925, la
fièvre aviaire a aussi frappé le Japon,
tuant depuis fin décembre plus de
8 000 poulets d’une ferme d’élevage
du Sud-Ouest. Mais à ce jour, le foyer
ne cesse de s’étendre. Le Laos, le
Cambodge, la Thaïlande... mais aussi
la Chine avouent être atteints par ce
virus qui sème l’inquiétude chez les
virologues du monde entier. Dix décès
ont été recensés. Des millions de
volailles (poulets, canards) sont abat-
tus. L’OMS rappelle des conseils de
prudence quant à l’approche de ces
animaux (plus le porc) sur les mar-
chés d’Asie. Pour l’instant, le virus ne
se transmet pas d’homme à homme.
Du poulet à l’homme
C’est cependant au Vietnam, pays où
la transmission du virus à l’homme a
été prouvée en premier, que la situa-
tion est la plus préoccupante. Le gou-
vernement a ordonné la destruction
de tous les poulets contaminés.
Selon l’organisation des Nations
unies pour l’alimentation et l’agricul-
ture (FAO), entre 1 et 2 millions de
poulets ont été infectés, en majorité
dans des zones rurales, où les
moyens de communication sont limi-
tés. « Il faut absolument éviter la
transmission d’humain à humain. La
situation est sérieuse et inquiétante.
Mais je ne dirais pas qu’elle est hors
de contrôle », a expliqué Anton
Rychener, responsable de la FAO à
Hanoï. Les autorités de Hanoï doivent
incessamment préciser à la FAO et à
l’OMS leurs besoins en matière de
médicaments et d’équipements de
protection, destinés en particulier au
personnel médical et aux personnes
en charge de l’abattage des poulets.
Dans le cadre du plan pandémique de
l’OMS, la préparation d’un candidat
vaccin contre le virus H5N1 a été ini-
tiée. Elle est délicate car elle repose sur
une culture virale sur œufs embryon-
nés ; la grippe du poulet tue ces
embryons et empêche la culture. Il fau-
dra, par conséquent, modifier le virus
afin de préparer un virus H5N1, proto-
type en vue de la production du vaccin.
Ludmila Couturier
VIIIeJournée nationale des GROG à l’Institut
Pasteur et informations GROG et OMS sur la
grippe aviaire.
* GROG : groupes régionaux d’observation
de la grippe.
Professions Santé Infirmier Infirmière N° 52 • janvier-février 2004
Actualité Santé 11
© GEIG
Actualités 23/02/04 15:38 Page 11
1
/
2
100%