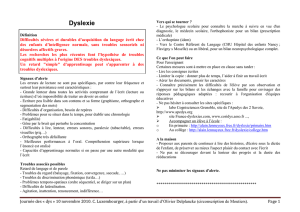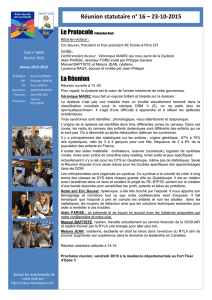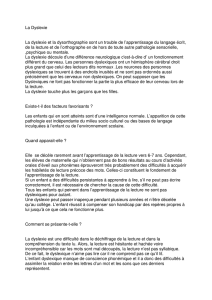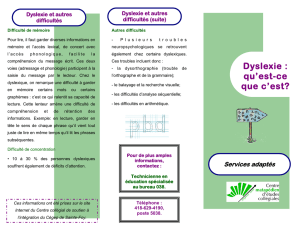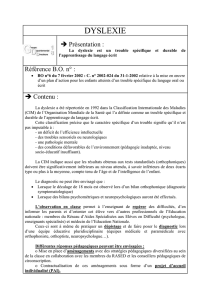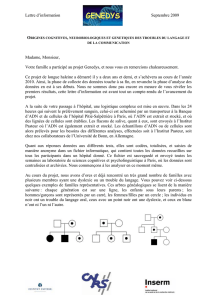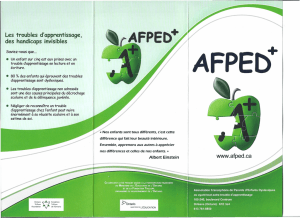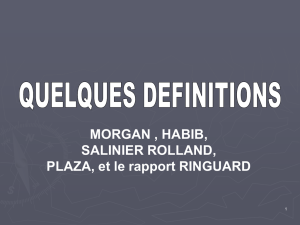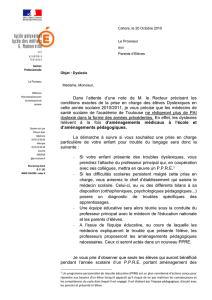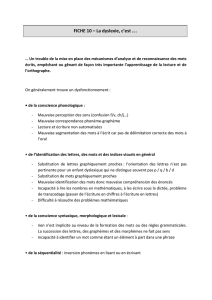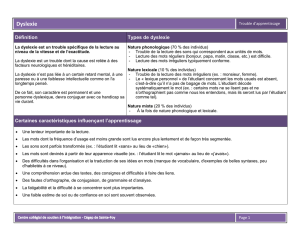Dyslexie : Base neuronale et anomalies cérébrales

© Cerveau & Psycho - N° 12 75
La dyslexie dans les neurones
Les cerveaux de personnes dyslexiques présentent
des amas de neurones dénotant un développement anormal.
Les zones cérébrales de la lecture s’organisent mal
à cause de ce défaut, peut-être d’origine génétique.
Franck R
AMUS
1. Une ectopie dans le cortex d’un dyslexique. Il s’agit d’un amas de cellules
gliales (en bleu) et de neurones (en orange), qui, au cours du développement
embryonnaire, n’ont pas migré correctement : ils ont dépassé la couche
corticale où ils auraient dû s’arrêter. En désorganisant les connexions au sein
du cortex, ces structures seraient responsables de l’activation trop faible de
certaines zones cérébrales nécessaires à la lecture.
Delphine Bailly
L
E POINT SUR
:
LA DYSLEXIE
Neurone
Cellule gliale
Ramus new 25/10/05 11:20 Page 75

En France, un enfant sur quatre est atteint
de ce qu’il est convenu d’appeler des
problèmes de lecture : difficultés de déchif-
frage, lecture hachée, erreurs fréquentes,
inversion de certaines syllabes, etc. Pour
autant, s’agit-il toujours de dyslexie ? La dyslexie
désigne les retards de lecture qui ne sont imputables,
ni à un retard d’éducation, ni à une déficience intel-
lectuelle, ni à des problèmes d’attention, ni à une
mauvaise insertion dans le système scolaire. En
d’autres termes, le dyslexique serait un enfant ayant
été éduqué dans de bonnes conditions, scolarisé
normalement, qui ne souffre d’aucun retard mental,
d’aucun trouble de l’attention, mais qui présente
néanmoins un retard de lecture par rapport à ses
camarades. De tels enfants représentent environ cinq
pour cent de leur classe d’âge, un chiffre qui se
retrouve dans l’ensemble de la population.
Si la cause n’est ni éducative, ni sociologique,
ni intellectuelle, quelle est-elle ? Les scientifiques
s’orientent de plus en plus vers une hypothèse
qualifiée de neurodéveloppementale : un problème
dans le développement de certaines aires du
cerveau, peut-être même une petite « différence »
génétique, qui instaurerait progressivement ce
retard dans la faculté de lire.
En 1979, un neurologue américain de l’Uni-
versité de Harvard, Albert Galaburda, fait une
découverte en examinant au microscope des
cerveaux de patients dyslexiques décédés. Il observe
de petites taches dans le cortex cérébral des
patients : ce sont des agrégats de cellules gliales,
cellules de soutien, qui ont en outre une fonction
nourricière. Il observe que ces cellules sont géné-
ralement regroupées avec une cinquantaine ou
une centaine de neurones accolés.
Une anomalie neuronale
D’après lui, ces neurones se seraient égarés: lorsque
le fœtus s’est développé, au lieu de rejoindre l’em-
placement qui leur était assigné par le programme
génétique de la migration neuronale, ils ont traversé
la couche du cortex où ils auraient dû s’arrêter, et
ont fini par s’amasser dans la couche la plus externe
du cortex. Cette hypothèse a été confirmée par de
nombreux travaux sur des rats et des souris présen-
tant des agrégats similaires, ce qui laisse supposer
une malformation neuronale chez les dyslexiques.
Pourquoi ces petits agrégats entraînent-ils des
troubles de la lecture ? Parce qu’ils désorganisent
la structure de la substance grise spécifiquement
dans certaines zones du cerveau dont l’enfant a
besoin pour apprendre à lire (le cerveau est consti-
tué de substance grise et de substance blanche ;
la première regroupe les corps cellulaires des
neurones, la seconde leurs prolongements recou-
verts de la myéline, qui est blanche).
Depuis une dizaine d’années, de nombreuses
équipes de recherche, dont celle d’Eraldo Paulesu à
l’Université de Milan, ont observé l’activité cérébrale
de patients dyslexiques dans un scanner. Chez ces
personnes, on constate une trop faible activité dans
trois zones de l’hémisphère gauche : l’aire occipito-
temporale, le gyrus frontal inférieur et l’aire pariéto-
temporale. Ces zones font partie du « réseau de la
lecture », vaste système cérébral œuvrant quand on
déchiffre un texte. Dans l’aire pariéto-temporale, le
gyrus temporal supérieur est le siège des représen-
tations phonologiques. C’est grâce à lui qu’un enfant
peut mentalement décomposer le mot salon en
syllabes sa et lon. Cette capacité est essentielle pour
apprendre à lire : en voyant le mot
S
.
A
.
L
.
O
.
N
., l’en-
fant va lire la première lettre et prononcer intérieu-
rement le son (ou phonème) qu’elle produit, puis lire
le
A
, prononcer de nouveau intérieurement ; ensuite,
il réalise la fusion auditive des deux sons. Cela donne
la syllabe sa. À force de voir de façon répétée un
S
suivi d’un
A
dans plusieurs mots et de relier ce motif
visuel à sa représentation phonologique du son sa,
l’enfant apprend à lire l’unité graphologique
SA
. C’est
pourquoi cette zone cérébrale des représentations
phonologiques est si importante : dans la plupart des
cas, les enfants dyslexiques ont un problème de
conscience phonologique, et cette activation céré-
brale trop faible en est le pendant organique.
L’activité du gyrus frontal inférieur gauche est
altérée chez les dyslexiques. Cette zone comporte
l’aire de Broca, qui intervient lorsqu’on articule
les mots ou qu’on les maintient en mémoire à court
terme. Enfin, le gyrus fusiforme, dans l’aire occi-
pito-temporale gauche, stocke les représentations
orthographiques : il s’active lorsque l’enfant perçoit
les mots écrits.
Les pièces du puzzle s’assemblent. Les ectopies,
ces petits agrégats de glie observés par A. Galaburda
il y a 20 ans, réduiraient l’activation de certaines
zones cérébrales : l’aire pariéto-temporale et le gyrus
frontal inférieur gauches. En effet, elles sont répar-
ties autour de la scissure de Sylvius gauche, qui
76 © Cerveau & Psycho - N° 12
2. Chez certains dyslexiques, trois zones cérébrales présentent une activité
réduite : le gyrus frontal inférieur gauche, l’aire pariéto-temporale et l’aire occipito-
temporale. Ces aires constituent un réseau cérébral de la lecture. On observe
également de petits agrégats de neurones dans la couche superficielle du cortex (les
ectopies) et, chez certains patients, une mutation sur le chromosome 15.
Gyrus frontal inférieur
Scissure de Sylvius
Aire occipito-
temporale
Aire pariéto-temporale
Ectopie
Gène
DYX
1
C
1
muté
Chromosome 15
Cerveau & Psycho
Ramus new 24/10/05 16:08 Page 76

traverse ces zones. L’hypothèse la plus plausible est
que les ectopies entraînent un sous-développement
de la substance grise avoisinante ; on a d’ailleurs
observé des réductions du volume de la substance
grise dans ces zones. L’imagerie de diffusion a égale-
ment révélé que les zones réparties autour de la scis-
sure de Sylvius sont moins connectées au reste du
cerveau… Ainsi, des perturbations locales de la migra-
tion neuronale se traduiraient, d’une part, par des
ectopies dans la couche superficielle du cortex,
d’autre part, par une plus faible densité de substance
grise, et enfin par une plus faible connectivité de la
substance blanche. Quant aux conséquences cogni-
tives de chacun de ces symptômes, elles restent
spéculatives. En tout état de cause, si ce scénario est
avéré, il reste une question : quelle est la cause de
l’anomalie de la migration neuronale ? Nous allons
le voir, l’hypothèse génétique est intéressante.
Une maladie génétique ?
À partir de la seconde moitié des années 1980,
plusieurs équipes de recherche ont étudié la compo-
sante génétique de la dyslexie. Par exemple, le
psychologue John DeFries, de l’Université du Colo-
rado, a étudié des jumeaux et a constaté que, lors-
qu’un vrai jumeau (ayant exactement le même
patrimoine génétique que son frère) est dyslexique,
l’autre a 70 pour cent de risques de l’être aussi.
Dans le cas de faux jumeaux, dont les patrimoines
génétiques sont aussi semblables que ceux de deux
frères ou sœurs, la probabilité n’est que de 45 pour
cent. Voilà une preuve convaincante du fait que
les gènes jouent un rôle dans la genèse de la
dyslexie, peut-être en participant à l’apparition des
ectopies. Des études précises ont conclu que la part
génétique de la dyslexie se monte à 60 pour cent
environ, les 40 pour cent restant étant dus à des
facteurs environnementaux.
Depuis trois ans, une quinzaine d’équipes de
recherche ont identifié six régions chromoso-
miques qui semblent participer au développement
de la dyslexie ; en 2003, le généticien finlandais
Mikko Taipale et ses collègues de l’Université
d’Helsinki ont identifié un gène, au sein de l’une
de ces régions, dont le rôle semble important, au
moins au sein de deux familles finlandaises présen-
tant des cas de dyslexie. Il s’agit du gène
DYX
1
C
1,
sur le chromosome 15. Ce gène remplit apparem-
ment une fonction déterminante dans la migra-
tion des neurones vers les différentes couches du
cortex chez le fœtus en développement.
En effet, en transférant à des souris de labo-
ratoire la version de ce gène présente chez les
familles finlandaises de dyslexiques, A. Galaburda
et ses collègues ont constaté que la migration
neuronale ne se fait pas correctement dans le cortex
de ces souris, et qu’on y observe même parfois des
ectopies. Pour autant, malgré le rôle important
accordé au gène
DYX
1
C
1, ses mutations ne s’ob-
servent que chez une partie des dyslexiques :
d’autres gènes interviennent probablement dans
d’autres cas, et il faut s’attendre à ce qu’une
mosaïque de gènes de la dyslexie concoure à pertur-
ber la migration des neurones chez les dyslexiques.
Peu à peu, la liste s’allonge : récemment, trois
nouveaux gènes ont été découverts, lesquels parti-
cipent aussi à la migration neuronale.
Pour cette raison, il est peu probable qu’on en
arrive un jour à une stratégie de dépistage géné-
tique de la dyslexie, et encore moins à de la théra-
pie génique. Le bénéfice que l’on peut attendre des
recherches dans le domaine de la génétique et des
neurosciences est, paradoxalement, d’ordre éduca-
tif. Le jour où la notion d’une maladie neurodéve-
loppementale d’origine partiellement génétique sera
acquise, on peut espérer un changement d’attitude
dans le corps enseignant, le premier confronté à la
dyslexie. Les premiers signes avant-coureurs pour-
raient être dépistés dès l’école maternelle.
Troubles neurologiques
et efforts pédagogiques
Or, pour l’instant, beaucoup d’enseignants répu-
gnent à parler de dyslexie lorsqu’un élève a des
difficultés de lecture. Certains gestes simples seraient
pourtant d’un grand secours pour sa rééducation :
lorsqu’on dépiste un enfant qui a des difficultés de
lecture, on pourrait l’envoyer chez un médecin ou
un psychologue scolaire, afin que le problème soit
le cas échéant identifié et traité (il faudrait pour
cela que ces professionnels soient eux-mêmes bien
informés sur la dyslexie). La première situation qui
devrait alerter l’enseignant est celle des retards de
langage oral, qui, souvent, annoncent des diffi-
cultés à venir pour le langage écrit.
En l’absence de symptômes évidents à l’oral, il
faut rester attentif à ce qui se passe en grande section
de maternelle ; dans tous les cas, les parents aussi
peuvent tester la conscience phonologique de leurs
enfants par des jeux de rimes : l’enfant qui ne saurait
pas distinguer l’intrus parmi les trois mots garçon,
ballon et sandale, risque de présenter un déficit de
conscience phonologique. Pour qu’un tel change-
ment d’attitude soit possible, il faut que la dyslexie
soit peu à peu considérée comme un trouble médi-
cal à part entière. Pour cette raison, la recherche
de ses causes cérébrales et éventuellement géné-
tiques doit être considérée comme un objectif profi-
table à tous, et non stigmatisée comme étant une
« entreprise de médicalisation d’un problème péda-
gogique ». Connaître une pathologie est le premier
pas vers sa prise en charge. ◆
© Cerveau & Psycho - N° 12 77
E
n 1999, le neurologue Albert Galaburda réalise des ectopies chirurgi-
cales chez des rats de laboratoire : il pratique des micro-incisions de la
première couche du cortex, de sorte que des neurones migrent vers des
zones où ils ne devraient pas s’engager, et des agrégats caractéristiques appa-
raissent. Il constate que, dans le cerveau des rats, une zone nommée corps
genouillé médial gauche du thalamus comporte un nombre anormalement
faible de magnocellules. Or, ces cellules servent habituellement à percevoir
les sons de courte durée, par exemple à distinguer un d d’un t. Dans les sons
da et ta, la différence auditive ne se manifeste que pendant 50 millisecondes :
les magnocellules du thalamus perçoivent cette différence. Certains y voient
la cause primaire des défauts de lecture des dyslexiques. Mais d’autres données
obtenues chez l’animal suggèrent le contraire : les ectopies entraîneraient en
premier lieu une baisse d’activité des zones corticales de la lecture ; les défauts
dans le thalamus ne seraient qu’un effet secondaire de ces perturbations.
Des rats dyslexiques
Franck R
AMUS
est
chargé de recherches au
CNRS
, Laboratoire de
sciences cognitives et
psycholinguistique
EHESS
/
ENS
/
CNRS
à Paris, et
associé à l'Institut des
neurosciences cognitives
de Londres (Institute of
Cognitive Neuroscience,
University College, London).
Bibliographie
Observatoire national de
la lecture, Les troubles de
l'apprentissage de la
lecture,
MENESR
, 2005.
Téléchargeable sur:
http://www.inrp.fr/onl/re
ssources/publi/troublesle
cture_tot.htm
C. B
ILLARD
et M. T
OUZIN
,
Kit de formation aux
troubles spécifiques
des apprentissages,
Signes Éditions, 2004.
L. S
PRENGER
-C
HAROLLES
et P. C
OLÉ
, Lecture et
dyslexie, Dunod, 2003.
M. H
ABIB
, Dyslexie :
le cerveau singulier,
Solal, 1997.
Ramus new 24/10/05 16:08 Page 77
1
/
3
100%