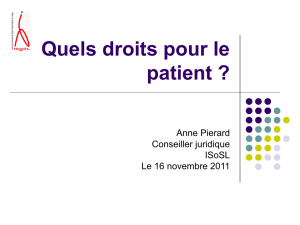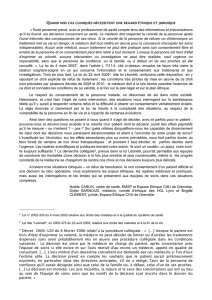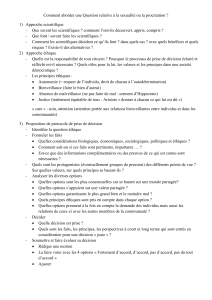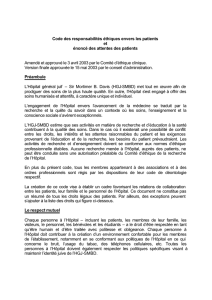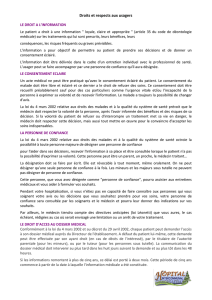Points de vue des patients et des psychiatres relatifs aux aspects éthiques

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (21), n° 5, mai 2004
Points de vue des patients
et des psychiatres relatifs
aux aspects éthiques
des risques de réémergence
de symptômes lors
de la participation
à des recherches
psychopharmacologiques
Nouveau Mexique (États-Unis)
Les protocoles pharmacologiques qui
impliquent des périodes sans médica-
ment et qui incluent, notamment, la
phase de wash-out au début des essais
cliniques, font l’objet d’une controverse
animée. En effet, on ne peut manquer de
s’interroger sur l’acceptabilité éthique
de recherches de ce type losqu’elles
incluent des patients psychotiques sévè-
rement atteints. La période de wash-out
est, certes, intéressante d’un point de
vue scientifique puisque, grâce à elle, on
peut isoler temporellement et physiolo-
giquement l’expérimentation, ce qui per-
met de clarifier les effets de la molécule
étudiée. Toutefois, les chercheurs ont le
devoir d’aider et de ne pas nuire aux par-
ticipants des essais cliniques. Par
ailleurs, on peut aussi s’interroger sur la
capacité des patients psychotiques à
identifier de manière prospective les
risques associés à une période de wash-
out. Enfin, la gravité de la réémergence
des symptômes ne sera peut-être pas per-
çue de la même manière par les partici-
pants à un protocole clinique et par les
expérimentateurs. Le Dr Weiss Roberts
et ses collaborateurs présentent une
étude empirique sur les enjeux éthiques
d’une période de wash-out chez des
patients schizophrènes (Weiss Roberts L,
Warner T, Nguyen K. et al.
Schizophrenia patients and psychiatrists
perspectives on ethical aspects of symp-
toms re-emergence during psychophar-
macological research participation.
Psychopharmacology 2003;171:58-67).
Cinquante-neuf patients schizophrènes
(dont 48 % de patients hospitalisés) et
soixante-dix psychiatres ont été invités à
répondre à un questionnaire en dix
points présentant un scénario fictif au
cours duquel un patient participant à une
telle étude était confronté à la réémer-
gence de symptômes sévères au cours de
la période de wash-out. Le taux de
réponse a été de 75 % chez les patients
et de 83 % chez les psychiatres. Les
patients fournissaient leur point de vue
personnel, de même que les médecins.
En outre, il était demandé aux psy-
chiatres de prédire quelles seraient, à
leur avis, les réponses des patients. Les
résultats montrent que tant les patients
que les psychiatres considéraient le pro-
tocole proposé comme modérément
nocif. Les deux groupes exprimaient
toutefois un enthousiasme modéré à la
perspective de participer à un tel essai,
étant donné les perspectives possibles.
En même temps, ils estimaient la déci-
sion relativement facile à prendre. Les
prédictions des psychiatres sur le com-
portement des patients sous-estimaient
le niveau de préjudice et surestimaient la
difficulté de prise de décision. Les
patients, pour leur part, reconnaissaient
que les propositions financières et la
demande de leur médecin ou de leur
famille seraient des facteurs susceptibles
de les faire accepter leur participation, et
les prédictions des psychiatres relatives
à cet aspect de la question étaient
exactes. La majorité des deux groupes
(63 % des patients et 52 % des psy-
chiatres) indiquaient que le médicament
devrait être administré malgré l’objec-
tion des participants. Les psychiatres se
sont trompés dans leurs prédictions sur
ce sujet, pensant que peu de patients
accepteraient l’administration involon-
taire de médicament. Les deux groupes
avançaient des motifs similaires pour
justifier la participation mais utilisaient
des stratégies différentes pour gérer la
situation. Dans cette étude, de nombreux
patients se sont révélés capables de
répondre raisonnablement, ce qui
démontre la préservation de capacités
décisionnelles chez des patients schizo-
phrènes concernant les éléments constitu-
tifs importants de protocoles pharmacolo-
giques. Les auteurs invitent les investiga-
teurs à faire des efforts pour présenter de
manière compréhensible les dimensions
cliniques et de recherche que comportent
leurs études. C’est en effet par ce type
d’actions que nous démontrerons que
nous n’oublions pas la confiance que les
patients nous font l’honneur de placer en
nous et les attentes qu’ils peuvent avoir à
notre égard.
Mots-clés : Recherche psychopharmaco-
logique – Schizophrénie – Wash-out –
Éthique.
105
Revue de presse
Revue de presse
N
ous vivons une époque de décou-
vertes scientifiques importantes,
qui s’accompagnent de la prise de
conscience accrue du fardeau que consti-
tue la maladie mentale. Les recherches
visant à mettre au point des traitements
psychopharmacologiques destinés aux
diverses affections psychiatriques parais-
sent prometteuses. Cet optimisme ne doit
toutefois pas occulter l’importance des
considérations éthiques dans la recherche
psychopharmacologique. La revue inter-
nationale Psychopharmacology a récem-
ment publié un numéro spécial consacré
à ces questions, qui reflète toute la com-
plexité et la diversité des recherches dans
ce domaine. Nous avons choisi d’en
rendre compte dans nos colonnes.
■
Enjeux éthiques des recherches en
psychopharmacologie
E. Bacon, A.M. Arnold,
Clinique psychiatrique, Strasbourg.

Compréhension du consentement
éclairé par les patients psychotiques
d’âge moyen et élevé
San Diego (États-Unis)
La compréhension des informations per-
tinentes relatives à un essai clinique
n’est que l’un des éléments qui doivent
être présents pour que l’on puisse parler
de capacité à prendre la décision de par-
ticiper, mais c’est toutefois un élément
fondamental pour que le consentement
ait du sens. L’optimisation des capacités
des patients psychiatriques à fournir un
consentement éclairé véritable est une
préoccupation majeure des chercheurs
en psychiatrie. Les auteurs de cette étude
ont tenté de savoir quels items d’un pro-
tocole ayant fait l’objet d’un consente-
ment pouvaient poser des problèmes
spécifiques. Ils ont cherché à identifier
les problèmes en comparant les patients
à des sujets sains, et à évaluer si la
meilleure compréhension était associée
à une meilleure performance sur cer-
taines questions (Dunn L, Jeste D.
Problem areas in the understanding of
informed consent for research: study of
middle-aged and older patients with psy-
chotic disorders. Psychopharmacology
2003;171:81-5). Cent deux patients
atteints de schizophrénie ou de trouble
apparenté (âge moyen : 51 ans) et vingt
sujets contrôle (âge moyen : 54 ans) ont
participé à l’étude. Les auteurs ont mis au
point un questionnaire en vingt items des-
tiné à évaluer la compréhension du
consentement éclairé pour un protocole de
recherche à faible risque. La procédure
d’établissement du consentement était
soit classique (papier et crayon), soit
plus sophistiquée, sur ordinateur, avec
des diapositives présentant des informa-
tions complémentaires. Les résultats
montrent que les patients avaient plus de
difficultés que les témoins pour
répondre aux questions ouvertes, notam-
ment celles évaluant la compréhension
de la procédure expérimentale, de la
durée, et des bénéfices et risques poten-
tiels. Chez les patients, la procédure de
consentement “améliorée” s’accompa-
gnait d’une meilleure performance ulté-
rieure dans les réponses aux questions
sur les risques potentiels et sur la durée
nécessaire à l’étude. Le perfectionne-
ment de l’intervention explicative a donc
eu un effet bénéfique sur la compréhen-
sion. Des travaux de ce type sont sus-
ceptibles d’aider à construire des pra-
tiques de protection et de sécurité amé-
liorées pour les recherches futures.
Mots-clés : Recherche psychopharmaco-
logique – Consentement éclairé –
Compréhension.
Considérations éthiques
dans les recherches psychopharmaco-
logiques impliquant des enfants et
des adolescents
Bethesda (États-Unis)
La prescription et l’usage en pédiatrie
de médications antipsychotiques ont
augmenté de manière saisissante au
cours de la dernière décennie. Plus
récemment, la recherche en psycho-
pharmacologie pédiatrique a aussi
connu un essor. L’éthique de la
recherche en psychopharmacologie
pédiatrique relève de l’éthique de la
recherche biomédicale en général, et de
la recherche pédiatrique en particulier.
Le Dr Vitiello a examiné les enjeux spé-
cifiques de ce type de recherche dans la
littérature scientifique et juridique
(Vitiello B. Ethical considerations in
psychopharmacological research invol-
ving children and adolescents.
Psychopharmacology 2003;171:86-91).
Il a centré son analyse sur trois ques-
tions essentielles, souvent implicites : le
traitement psychopharmacologique des
enfants est-il éthique ? La recherche
psychopharmacologique impliquant des
enfants est-elle éthique ? Les protocoles
de recherche pédiatriques de divers
types sont-ils éthiques ? Il ressort de son
analyse que l’efficacité et l’innocuité
des agents psychotropes chez les
enfants ne peuvent être inférées directe-
ment des données observées chez les
adultes, et que la participation des
enfants aux protocoles de recherche est
nécessaire. En plus des règles régissant
toute recherche portant sur des per-
sonnes humaines, celles impliquant des
enfants doivent suivre des règles parti-
culières. En ce qui concerne les
recherches avec bénéfice individuel
direct, il est crucial de s’assurer que le
rapport bénéfice/risque est véritable-
ment favorable à l’enfant inclus dans un
protocole. Pour les autres types de
recherche, le concept de risque minimal
et d’augmentation minimale du risque
minimal doit s’appliquer. Toutefois,
l’interprétation et l’application de ces
principes semblent varier selon les
études et selon les comités d’éthique. À
ce jour, il existe peu d’études qui se
soient intéressées aux motivations des
enfants et de leurs parents à participer à
une recherche, à la qualité des procé-
dures d’information et de recueil de
consentement, à l’éventualité de consé-
quences persistantes de l’exposition à
un traitement ou à un placebo, ou enco-
re à la validation des concepts de risque
minimal et d’augmentation minimale du
risque. L’auteur décrit les règles
éthiques et de fonctionnement spéci-
fique mises en place aux États-Unis.
Ces recommandations mettent l’accent
sur des subtilités concernant la compré-
hension du risque et sur l’évaluation du
rapport bénéfice/risque pour un enfant
enrôlé dans une étude. Mais il est clair
que beaucoup de choses restent encore à
faire dans ce domaine, et l’auteur sou-
haite la mise en œuvre de travaux empi-
riques sur les spécificités éthiques de ce
type de recherche.
Mots-clés : Recherche psychopharmaco-
logique – Éthique – Pédopsychiatrie.
106
Revue de presse
Revue de presse

Act. Méd. Int. - Psychiatrie (21), n° 5, mai 2004
Enjeux éthiques de la recherche
en psychiatrie génétique
Bethesda (États-Unis)
L’étiologie de la plupart des troubles
psychiatriques est complexe, mêlant les
contributions et les interactions de nom-
breux gènes à des facteurs environne-
mentaux très mal connus. Ces interac-
tions sont susceptibles d’agir pendant le
développement, la maturation et le
vieillissement. Les recherches dans ce
domaine sont particulièrement actives et
posent des questions éthiques spéci-
fiques, notamment lorsque se trouve
impliquée la participation de membres
de la famille des patients psychotiques.
L’anticipation des applications poten-
tielles des résultats des recherches en
psychiatrie génétique doit amener les
chercheurs de ce domaine à se demander
s’il faut ou non fournir les informations
de type génétique aux participants, et si
oui, quand et comment il faudrait
qu’elles soient délivrées (Bowles
Biesecker B, Landrum Peay H. Ethical
issues in psychiatric genetics research:
points to consider. Psychopharmacology
2003;171:27-35). Les données géné-
tiques spécifiques peuvent, en effet,
avoir un impact sur les familles, les
communautés et la société, impact qui
diffère sensiblement de celui des infor-
mations concernant la plupart des autres
domaines médicaux. Les auteurs pas-
sent en revue un certain nombre de ces
spécificités. Lorsque des informations
de type génétique sont délivrées à des
participants d’une même famille, se
posent des questions d’équité et de jus-
tice, celle, notamment, de savoir s’il
faut, ou non, offrir les mêmes informa-
tions aux membres de la famille qui
n’ont pas précédemment donné leur
consentement pour participer à la
recherche. Certains des proches peuvent
ne pas savoir qu’une recherche a été
entreprise avec des membres de leur
famille, ou ils peuvent ne pas vouloir
être informés des spécificités et/ou des
risques de telles études. La plupart des
chercheurs encouragent les participants
à informer leurs proches, mais il peut
arriver aussi que les participants eux-
mêmes n’aient pas informé leur famille.
Les conclusions des auteurs sont que
l’éducation génétique et le conseil sont
essentiels pour aider les participants à
comprendre la nature incertaine des
informations concernant la susceptibili-
té génétique, ainsi que les implications
de ces informations pour eux-mêmes, et
pour leurs proches. Des procédures spé-
cifiques de recueil de consentement
devraient mettre l’accent sur la sensibi-
lité de ce type d’informations, sur les
possibilités de mauvaise compréhension
des bénéfices, et sur la nécessité d’un
réel volontariat de la part de tous les
participants. En outre, la stricte confi-
dentialité devrait être préservée, du fait
de la stigmatisation associée à la fois
aux questions génétiques et aux mala-
dies psychiatriques. Les auteurs mettent
l’accent sur le fait que, dans ce domaine
en particulier, il est crucial d’anticiper
et de prévenir les conflits éthiques plu-
tôt que d’entreprendre d’y répondre
ultérieurement.
Mots-clés : Recherche en psychiatrie
génétique – Éthique – Susceptibilité
génétique – Famille.
Capacité décisionnelle et consente-
ment éclairé chez les patient schizo-
phrènes âgés
San Diego (États-Unis)
On s’attend à une multiplication par
quatre de 1970 à 2030 de la proportion
de personnes âgées présentant des
troubles psychiatriques. Jusqu’à pré-
sent, les patients âgés étaient plutôt
sous-représentés dans les protocoles de
recherche. Par exemple, seulement 6 %
des études sur la schizophrénie publiées
à ce jour dans les grands journaux inter-
nationaux de psychiatrie sont consacrés
aux patients âgés. Les choses sont ame-
nées à changer, et les enjeux bioé-
thiques de la neuropsychopharmacolo-
gie gériatrique sont nombreux. La capa-
cité décisionnelle des patients âgés
constitue un aspect crucial de la ques-
tion. Les modifications cognitives,
ainsi que la complexité accrue des trai-
tements médicamenteux, font qu’il est
particulièrement difficile pour certains
patients de comprendre pleinement,
d’apprécier, et/ou d’être capables
d’avoir un raisonnement cohérent sur
les risques et les bénéfices de la partici-
pation à un essai clinique. Les auteurs
de cet article présentent un modèle de
collaboration multidisciplinaire incluant
des scientifiques, des psychiatres, des
spécialistes de la famille et de la méde-
cine préventive, un professeur de droit,
un neuropsychologue, un expert en
bioéthique, un administrateur de service
gérontologique, des statisticiens et,
enfin et surtout, des membres de la com-
munauté (Jeste D, Dunn L, Palmer B et
al. A collaborative model for research on
decisional capacity and informed
consent in older patients with schizo-
phrenia: bioethics unit of a geriatric psy-
chiatry intervention research center.
Psychopharmacology 2003;171:68-74).
Les études préliminaires menées dans
ce centre suggèrent que les psycho-
tiques âgés varient considérablement eu
égard à leurs capacités décisionnelles,
mais que nombre d’entre eux semblent
parfaitement capables de donner leur
consentement aux projets de recherche.
En outre, le niveau de compréhension
des patients peut être significativement
amélioré par la répétition et la clarifica-
tion des éléments clés du formulaire de
consentement. La capacité de décision
pour un protocole donné peut donc être
améliorée chez des patients psycho-
tiques, même âgés.
Mots-clés : Bioéthique – Vieillissement –
Schizophrénie – Consentement éclairé.
107
Revue de presse
Revue de presse
1
/
3
100%