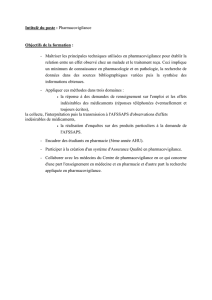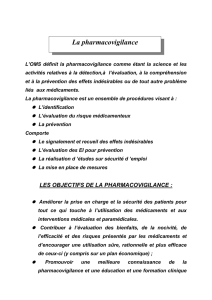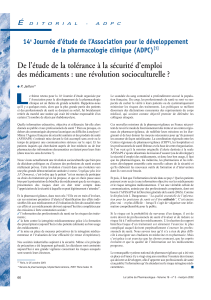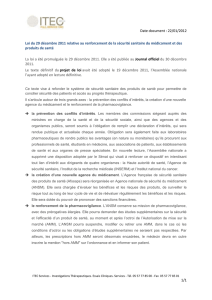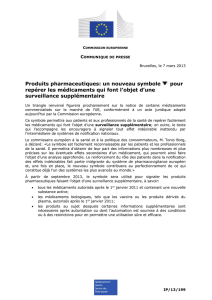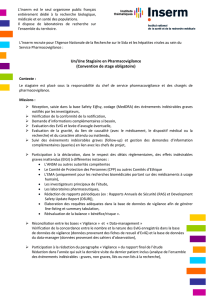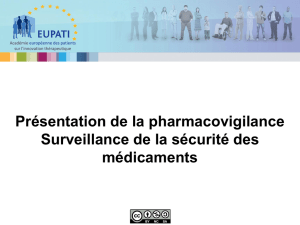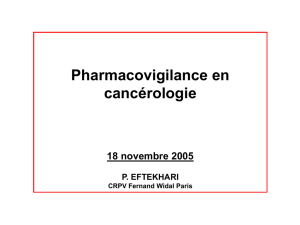Lire l'article complet

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008
Dossier médicaments anticancéreux
Dossier médicaments anticancéreux
87
RÉSUMÉ 왘
L’objectif de cet article est d’interpréter la notion de phar-
macovigilance appliquée à la pratique médicale oncolo-
gique. Les di érences entre pharmacovigilance et iatrogénie
médicamenteuse ne sont pas toujours bien comprises
par les professionnels de santé. Du fait du pro l de risque
particulier des médicaments qu’ils utilisent, les oncologues
ont une bonne habitude de la lutte contre la iatrogénie
médicamenteuse, mais ils envisagent rarement l’activité de
pharmacovigilance dans sa dimension de santé publique
d’amélioration de l’offre de soins. Pourtant, l’évolution
des thérapeutiques en cancérologie permet d’envisager
un intérêt croissant pour la pharmacovigilance. L’analyse
du rapport béné ce-risque des nouvelles molécules de
la thérapeutique cancérologique dans le cadre des essais
cliniques se rapproche de celle des médicaments classiques.
La gestion individuelle du risque médicamenteux tend
à se compléter d’une gestion populationnelle du risque.
La dimension de santé publique de la pharmacovigilance
s’exprimera en fonction du gain d’e cacité des nouveaux
protocoles.
En oncologie, l’o re thérapeutique n’est pas complètement
satisfaite par le système d’autorisation de mise sur le marché
(AMM). La mise en place d’un encadrement des prescriptions
hors AMM (autorisation temporaire d’utilisation [ATU] et
protocole temporaire de traitement [PTT]) doit s’accompa-
gner d’une surveillance du pro l de risque des médicaments
sous la forme d’une pharmacovigilance intensive tout au
long de ces expériences cliniques hors AMM.
Un certain nombre d’exemples dans la littérature démon-
trent l’intérêt d’une surveillance à long terme des patients
traités par anticancéreux anciens ou plus récemment
commercialisés. La pharmacovigilance doit se doter d’outils
nouveaux de surveillance des patients anticancéreux pour
découvrir et évaluer les signaux de toxicité des nouvelles
thérapeutiques ciblées.
Mots-clés : Cancérologie – Pharmacovigilance – E ets
iatrogènes – Autorisation temporaire d’utilisation (ATU) –
Protocole temporaire de traitement (PTT).
SUMMARY 왘
The aim of this paper is to explain the concept of pharmacovigi-
lance in oncology. The di erences between pharmacovigilance
and iatrogenic disorders induced by drugs are not always
clearly understood by health professionals. Due to the speci c
risk of cancer drugs, the oncologists have the capability to
detect and correct, when possible, the iatrogenic pathology of
drugs, but seldom consider the activity of pharmacovigilance
in its aims of public health in order to improve quality of care.
However, the evolution of therapeutics in cancer makes possible
to consider nowdays an evolution and an improvement of
interest for pharmacovigilance. As a matter of fact, the analysis
of the bene t-risk ratio of the new molecules used in cancer
within the framework of the clinical trials looks like that of
drugs used in other pathologies. The individual management
of the risk of the drugs tends to being supplemented by a risk
management in the population. Public health approach of
pharmacovigilance will be improved according to the impro-
vement of e ectiveness of the new protocols.
In oncology, the therapeutic o er is not completely satis ed by
the system of marketing authorization (AMM). The monitoring
of medical prescriptions in therapeutic elds not approved
by the regulatory authorities (Temporary Authorization of
Use [ATU] and Temporary Protocol of Treatment [PTT]) must
be accompanied by a monitoring of the pro le of risk of the
drugs in the form of an intensive pharmacovigilance. Finally,
examples in the literature show the interest of a long-term
monitoring of patients treated by anti-cancer drugs recently
marketed or not. New tools should be applied by the pharma-
covigilance system, in order to monitor patients treated by
anti-cancer drugs to discover and evaluate signals of toxicity
of these new targeted therapeutics.
Keywords: Oncology – Pharmacovigilance – Adverse
e ects – Temporary Authorization of Use (ATU) – Temporary
Protocol of Treatment (PTT).
Pharmacovigilance en oncologie
Pharmacovigilance in oncology
●● Christian Riche*, Dominique Carlhant*
* Centre régional de pharmacovigilance de Brest, Hôpital de la Cavale-Blanche, Brest.
DÉFINITION DE LA PHARMACOVIGILANCE
La pharmacovigilance est une activité réglementée, encadrée par
un certain nombre de textes en France (1-3, 5) et en Europe. En
revanche, le terme “pharmacovigilance” est perçu diff éremment

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008
Dossier médicaments anticancéreux
Dossier médicaments anticancéreux
88
par les divers acteurs de santé (le public, les juges) et recouvre des
champs d’application extrêmement diff érents. On peut classer les
défi nitions successives de la pharmacovigilance selon l’évolution
historique du concept, mais aussi selon le développement, au
sein du monde médical, des notions de sécurité, de risque, de
prévention et de précaution.
Historiquement, la pharmacovigilance est apparue avec l’af-
faire du thalidomide dans les années 1950, utilisé alors pour ses
propriétés sédatives, et qui fut retiré du marché mondial suite
à l’apparition de malformations chez des enfants nés de mères
ayant pris du thalidomide (6). Ces malformations n’avaient pas
été évoquées lors du développement du médicament. La mise en
évidence et l’existence du lien de causalité avec la prise du médi-
cament ont eu lieu seulement après la commercialisation.
À partir de ce dramatique accident s’est développée l’idée
que les connaissances sur la sécurité du médicament lors de
sa mise sur le marché étaient incomplètes et qu’il était donc
nécessaire d’assurer une surveillance postcommercialisation.
Le but de cette surveillance était de détecter et de comprendre
la survenue d’événements indésirables. Si un lien de causalité
se dégageait ou était sérieusement suspecté entre la prise d’un
médicament et l’apparition d’événements indésirables, l’objectif
était de prendre toute mesure de santé publique destinée à éviter
ces situations.
Cela a conduit à la première défi nition de la pharmacovigilance,
et par là-même, à la défi nition de son champ d’application. La
pharmacovigilance est une activité de phase 4 ; elle fonctionne
au départ essentiellement sur des méthodes de notifi cation,
aboutissant à une accumulation de preuves. La prise de décision
est très diff érente de celle concernant le bénéfi ce d’un produit.
En eff et, pour le bénéfi ce, on réalise des essais thérapeutiques
avec une méthodologie qui s’appuie sur une analyse statistique
de résultats ; en pharmacovigilance, la prise de décision est plus
empirique : elle relève de l’avis d’experts qui, au vu et à l’analyse
de cas, émettent un avis sur une relation potentielle entre la
survenue de cas et la prise du médicament. À partir de cette
analyse, ils conseillent aux autorités de santé les mesures de
précaution à prendre vis-à-vis de l’utilisation du produit.
Cette situation a été particulièrement vraie avant l’introduc-
tion des études de pharmacoépidémiologie, mais de nombreux
exemples montrent qu’il reste diffi cile de décider au vu de la
simple notifi cation.
Dans les débuts de la pharmacovigilance, le champ cancéro-
logique a été vraisemblablement peu investigué du fait de la
gravité du pronostic. Les conséquences de l’évolution naturelle
de la maladie conduit à une acceptation importante du risque,
même si le bénéfi ce est modeste.
On constate d’ailleurs de façon générale que l’intérêt pour la
pharmacovigilance augmente avec l’effi cacité des thérapeuti-
ques et avec la multiplicité des choix thérapeutiques pour le
prescripteur. Ce phénomène s’est particulièrement vérifi é lors
de l’apparition des bi- puis des trithérapies dans le domaine
du sida.
Si, jusqu’à une période récente, la pharmacovigilance avait peu
d’impact en cancérologie, en revanche, les cancérologues étaient
constamment sensibilisés à la toxicité des médicaments qu’ils
utilisaient. À la diff érence des autres thérapeutes et des autres
pathologies, la toxicité était pour les cancérologues une notion
connue et habituelle. L’existence de cette toxicité, indissociable
de l’utilisation du produit, a contribué à développer la notion
de iatrogénie, qui s’est progressivement diff érenciée de la phar-
macovigilance.
La iatrogénie conduit à une gestion individuelle des risques
pour un patient, dans le cadre d’une vision globale des risques
encourus. La pharmacovigilance a, quant à elle, des objectifs de
santé publique. L’une de ses priorités est le médicament, et elle
mesure spécifi quement le risque d’un produit pharmaceutique
et/ou d’une sous-population de patients ciblés.
Pour compléter la défi nition de la pharmacovigilance, il est
nécessaire également d’évoquer la notion du rapport bénéfi ce-
risque et son évolution tout au long de la vie du médicament. Une
étape importante a été franchie en ce sens lors de la survenue des
crises sanitaires qui ont concerné le médicament et qui ont suivi
les grandes crises du sang contaminé et du variant de la maladie
de Creutzfeldt-Jacob. Toutes ces crises ont eu des conséquences,
aussi bien en termes d’organisation du système de santé avec
la création des agences, que dans le domaine de la gestion des
risques avec la défi nition du principe de précaution. Lors des
problèmes liés au retrait de la cérivastatine, l’importance de la
phase de précommercialisation est apparue, avec la nécessité
d’organiser un processus permanent d’évaluation entre les phases
de précommercialisation et de postcommercialisation. En ce
qui concerne l’Europe, cela s’est traduit par un renforcement
de l’analyse du dossier de précommercialisation débouchant
sur des plans de gestion des risques ; en postcommercialisa-
tion, cela a conduit à un accroissement et une intensifi cation
de l’analyse des rapports périodiques de sécurité et à la mise
en place des mesures prévues dans les plans de gestion des
risques, avec en particulier le développement des études de
pharmacoépidémiologie.
Enfi n, rappelons que la défi nition de la pharmacovigilance peut
aussi être appréhendée suivant les acteurs (selon qu’ils sont
médecins ou non). Nous ne développerons pas ce point de vue,
car il n’existe pas de consensus entre les médias, les patients et
le juge sur ce que l’on nomme “pharmacovigilance” et sur ce qui
en est attendu. L’utilisation par la justice lors des procès d’avis
concernant des observations de pharmacovigilance montre bien
qu’il existe une diff érence importante d’interprétation selon les
acteurs. Pour ne donner que quelques exemples, le signifi ant
des mots “imputation” ou “causalité” n’a pas la même portée
selon l’acteur qui emploie ces termes.
Dans la suite de cet article, la pharmacovigilance est abordée sous
l’angle de la vie du médicament et, dans le cas de la cancérologie,
trois aspects particuliers sont mis en exergue : la pharmacovi-
gilance dans les essais cliniques, la pharmacovigilance dans les
autorisations temporaires d’utilisation (ATU) et les protocoles
temporaires de traitement (PTT), et la pharmacovigilance dans
la phase postcommercialisation, tout en suivant la pharmaco-
vigilance en phase aiguë et en envisageant son développement
à long terme.

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008
Dossier médicaments anticancéreux
Dossier médicaments anticancéreux
89
PHARMACOVIGILANCE
DANS LES ESSAIS CLINIQUES
L’évaluation du rapport bénéfi ce-risque dans les essais cliniques
des médicaments cancérologiques est, sur le plan réglementaire,
identique à celle des autres médicaments (1, 3) à la diff érence
des médicaments dérivés du sang (2). Cela dit, l’évaluation du
profi l de risque des molécules anticancéreuses a subi un change-
ment radical, avec l’apparition des molécules non cytotoxiques.
Avec les anticancéreux classiques, les phases de développement
avaient pour objectif de défi nir un profi l de risque composé
d’événements indésirables quasi systématiques, le plus souvent
en relation avec un mécanisme d’action du cytotoxique. Cet
aspect systématique de la toxicité entraînait une banalisation
de l’eff et indésirable ; on parlait d’ailleurs de “profi l iatrogène” ,
donnant à ce vocable une notion d’irrémédiable. Gérer la toxi-
cité des médicaments anticancéreux était et reste encore le
quotidien des thérapeutes en cancérologie. Ces intolérances aux
traitements entraînaient dans les essais comme dans la pratique
courante, l’arrêt de la thérapeutique, la réduction de la dose,
voire le décès du patient, au pire des cas. Cet aspect iatrogène
des médicaments cytotoxiques se traduit dans les marqueurs
d’activité par le temps à progression ou la réponse partielle ou
complète de survie sans rechute ou de survie globale. La iatro-
génie, indissociable des activités thérapeutiques, est le facteur
limitant de l’utilisation du produit. L’arrêt de traitement et la
réduction de dose pour toxicité, et par voie de conséquence, la
perte d’effi cacité du traitement, sont deux paramètres diff érents
analysés lors de l’évaluation de l’AMM.
Cependant, l’analyse du spectre iatrogène constitue davantage
une information et, fi nalement, l’analyse des courbes de survie
emporte la décision, sachant que, chaque fois que l’on doit réduire
ou arrêter le traitement, la chance d’effi cacité se réduit. Cela se
traduit dans la courbe de survie étudiée, où se confondent les
échecs par ineffi cacité ou par résistance au produit (malgré une
utilisation pleine et entière de celui-ci) et les échecs en partie
liés à une utilisation à dose réduite ou à un arrêt d’utilisation
consécutif à la toxicité.
L’apparition des drogues non cytotoxiques a partiellement boule-
versé ce paysage : la toxicité est devenue plus événementielle,
plus “patient-dépendante”, c’est-à-dire moins systématique et
donc plus remarquable. Ce contraste est atténué par l’effi cacité
encore relative de ces médicaments qui, même s’ils ont donné
des résultats intéressants dans un certain nombre d’indications,
n’ont qu’exceptionnellement bouleversé le devenir des patients.
Certes, il existe des produits remarquables en hématologie, dans
le cancer du sein, mais le bévacizumab, le cétuximab, l’alem-
tuzumab, le rituximab et le trastuzumab restent des thérapeu-
tiques complémentaires à des prises en charge encore basées
sur des chimiothérapies conventionnelles. Même si le spectre
de sécurité de ces nouvelles entités a tendance à les rapprocher
des molécules utilisées dans d’autres pathologies, le caractère
non systématique de cette toxicité encourage les cancérolo-
gues à défi nir des populations à risque. On peut penser que
ces thérapeutiques conduiront la cancérologie à une réfl exion
identique à celle observée pour les autres médicaments dans
leur phase de développement. Il faudra non seulement faire
un inventaire de la toxicité, mais aussi rechercher les facteurs
de prédisposition qui font qu’une population est plus parti-
culièrement sensible. De même, il faudra défi nir quelles atti-
tudes de détection ou de prévention avoir vis-à-vis de certains
types d’événements indésirables. L’évaluation du risque lors de
l’établissement du rapport bénéfi ce-risque faite au moment de
l’AMM devrait ainsi se rapprocher progressivement de celle
qui se fait pour les autres médicaments, avec l’élaboration de
plans de gestion des risques qui ne prennent tous leurs sens que
lorsqu’une thérapeutique est curative ou permet du moins une
survie suffi samment importante.
PHARMACOVIGILANCE DANS LES ATU ET LES PTT
Les PTT peuvent être considérés sur le plan théorique comme
des ATU (4). La diff érence entre ATU et PTT réside dans le
fait que ceux-ci sont mis en place pour des médicaments ayant
déjà une AMM.
L’ATU, en eff et, concerne par défi nition des médicaments qui
n’ont pas encore d’AMM et qui sont mis à disposition des pres-
cripteurs dans deux cadres, soit celui de l’ATU nominative qui
s’adresse à des patients spécifi quement défi nis au cas par cas,
soit celui de l’ATU dite “de cohorte”, qui s’adresse, moyennant
un protocole de prescription et de suivi, à une population
particulière. Dans les ATU de cohorte, l’état d’avancement des
études cliniques laisse à penser que cette population peut tirer
un bénéfi ce de la thérapeutique concernée.
Les PTT relèvent du même principe que les ATU de cohorte.
Ils ont été mis en place à la suite du décret sur le contrat bon
usage (CBU). La reconnaissance de ces pratiques de prescription
hors AMM a au départ une fi nalité essentiellement fi nancière,
afi n de permettre la prise en charge du coût de ces traitements
par les organismes de remboursement. Mais leur élaboration a
aussi été l’occasion de défi nir, pour un médicament ayant une
AMM, un certain nombre d’utilisations, en précisant les données
scientifi ques sur lesquelles s’appuyer de façon rationnelle pour
justifi er une prescription dans cette utilisation qui ne fait pas
l’objet d’une AMM.
En cancérologie, ces PTT sont défi nis et proposés par l’Institut
du cancer (INCa), examinés par l’Afssaps et par la Haute Autorité
de santé (HAS). L’Afssaps qui, du fait de sa mission, a accès à des
bases de données et à des sources documentaires confi dentielles,
se prononce sur la validité des arguments avancés et examine
tout particulièrement le niveau de sécurité à partir des données
de pharmacovigilance observées dans les indications reconnues
de l’AMM et dans les publications qui soutiennent l’utilisation
hors AMM. La gestion de la pharmacovigilance concernant les
médicaments en ATU ou en PTT est, en revanche, diff érente.
Les ATU sont soutenues et demandées par un laboratoire, alors
que les PTT sont à l’initiative des prescripteurs qui, faisant réfé-
rence à des données scientifi ques, souhaitent pouvoir utiliser
un produit au-delà de son AMM.

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008
Dossier médicaments anticancéreux
Dossier médicaments anticancéreux
90
En outre, les médicaments concernés par les PTT sont ceux
d’une liste dite “des médicaments hors GHS” qui comporte
environ 100 médicaments et qui est constituée de plus de 50 %
de médicaments à visée cancérologique. Comme les PTT, l’ATU
est fréquemment utilisée en cancérologie. Elle comporte un suivi
de pharmacovigilance codifi é et organisé par le laboratoire, et
le recueil des événements indésirables est très proche de ce qui
se fait dans les essais thérapeutiques.
Cependant, le suivi dans le domaine de la sécurité des PTT reste
encore à défi nir. Le PTT peut toutefois intéresser le laboratoire,
qui peut y voir un nouveau champ de développement ayant
comme objectif fi nal le dépôt d’une AMM. Dans ce cas, on
comprend aisément que, sollicité par les autorités réglementaires
pour assurer le suivi de sécurité du PTT, le laboratoire aura tout
intérêt à colliger les observations de façon à préciser le profi l
de risque du produit. Ce travail eff ectué dans le cadre du PTT,
viendra compléter les données qui soutiendront l’AMM. En eff et,
lors de l’examen du dossier AMM, l’analyse porte principalement
sur les essais thérapeutiques, mais des analyses complémentaires
sont réalisées sur les données des ATU ou sur les données de
prescription hors AMM, comme c’est le cas dans les PTT. Le
problème sera très diff érent si le laboratoire n’a pas d’intérêt
pour le PTT proposé dans le cadre des référentiels par les trois
institutions que sont l’INCa, l’Afssaps et l’HAS. Devant cette
situation, il semble évident qu’il faudra que se dégage, au sein des
autorités, une procédure permettant de recueillir et d’analyser
les événements indésirables observés lors de l’utilisation du
produit dans le cadre du PTT. En eff et, ces protocoles tempo-
raires doivent être périodiquement revus et il faudra bien sûr,
lors de ces révisions, procéder à un examen de sécurité à partir
des données collectées.
La mise en place des Observatoires des médicaments, des dispo-
sitifs et de l’innovation thérapeutique (OMEDIT), dans le cadre
du décret CBU, devrait contribuer à ce travail, en association
avec les centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV), mais
tout cela reste encore à préciser. Il s’agit là d’un objectif qu’il
faudra remplir à court terme, car un certain nombre de PTT en
cancérologie ont déjà été publiés, ou sont sur le point de l’être
dans les domaines du digestif, du poumon, du sein, des cancers
de l’enfant, etc. Il y a là un point particulièrement important
pour la survie du système.
PHARMACOVIGILANCE EN POSTCOMMERCIALISATION
La pharmacovigilance postcommercialisation est longtemps
restée relativement pauvre. Trois événements dans la littéra-
ture ont mis en évidence des problèmes de pharmacovigilance
susceptibles d’avoir entraîné une modifi cation de l’attitude de
la communauté cancérologique vis-à-vis de la détection des
eff ets indésirables.
Le premier concerne l’évolution d’enfants traités au Bicnu
®
pour des tumeurs cérébrales (7-9). Le pronostic à moyen et long
termes s’est trouvé particulièrement compromis par la survenue
de fi broses pulmonaires qui ont conduit soit au décès, soit à la
greff e cardio-pulmonaire. Les séries d’enfants sont petites dans
la littérature et la gravité des tumeurs traitées est telle que cela
est resté plus ou moins événementiel et n’a pas eu de grandes
conséquences dans la pensée collective.
Un autre exemple est celui des insuffi sances cardiaques observées
chez l’enfant à moyen et long termes, après des traitements par
anthracyclines dans le cadre de leucémies (10). Ces insuffi sances
cardiaques, qui ont parfois entraîné des tentatives de greff e
cardiaque, ont aussi constitué un événement fondamental qui
a participé à l’ébauche d’une réfl exion. Celle-ci s’est concrétisée
par la survenue de leucémies secondaires observées à la suite
des traitements de cancer du sein par mitoxantrone. Il s’agissait,
d’une part, de populations plus importantes, et d’autre part,
d’une pathologie très médiatisée. La survenue de ces incidents
a abouti à la prise de conscience qu’au-delà du profi l iatrogène
connu du produit, observé dans l’utilisation immédiate, il pouvait
exister des événements indésirables non connus, de survenue
plus ou moins tardive. Ces incidents peuvent compromettre de
façon gravissime la stabilisation de la maladie, voire, dans un
certain nombre de cas, le potentiel de guérison.
Le paysage s’est également compliqué avec l’apparition des
nouvelles thérapeutiques qui rendent la iatrogénie moins
systématique et permettent la défi nition d’événements plus
rares, graves, pouvant parfois mettre en jeu la vie du patient,
comme les insuffi sances cardiaques sous Herceptin
®
ou les
colites ischémiques sous Avastin
®
.
Ces modifi cations de l’arsenal thérapeutique et du pronostic
amènent donc à réfléchir différemment le suivi des événe-
ments indésirables lors des traitements anticancéreux. En ce
qui concerne l’ensemble des chimiothérapies, classiques et non
classiques, la notion d’événement indésirable immédiat reste
toujours présente, mais elle se complexifi e avec une toxicité à
moyen terme, voire à long terme, ce qui est un réel souci pour
les années à venir. Il est nécessaire d’y penser aujourd’hui pour
constituer les cohortes de malades, qui devront être suivis avec
des techniques adaptées à la pharmacovigilance. En eff et, on
comprend bien que la notifi cation spontanée, dans ce type d’ob-
servations, est relativement ineffi cace. C’est un sujet de réfl exion
important qui permettra d’éviter une incompréhension des
générations futures et de répondre à toutes les préoccupations
de sécurité de notre monde contemporain.
Le deuxième point important qui se dégage de ces évolutions
est la nécessité pour les cancérologues d’apprendre à gérer le
risque en fonction de la thérapeutique. Il est important de savoir
faire la diff érence entre un événement iatrogène courant et un
événement sentinelle, surtout quand le degré de gravité est
faible. Il peut s’agir d’un signal sur la possibilité de survenue
d’événement indésirable non systématique, pouvant rester très
acceptable chez certains patients, mais pouvant atteindre un
seuil de gravité important et n’apparaissant ou n’atteignant
cette gravité que dans une sous-population à risque. Cette
nouvelle attitude est compliquée, parce non habituelle, et la
réfl exion sur les traitements cancérologiques est fondée sur
celle des chimiothérapies cytotoxiques, s’accompagnant donc
d’une masse d’événements toxiques importants. Il faut, dans ce

La Lettre du Pharmacologue - vol. 22 - n° 3 - juillet-août-septembre 2008
Dossier médicaments anticancéreux
Dossier médicaments anticancéreux
91
cadre, être particulièrement attentif pour isoler dans le bruit
de fond les événements annonciateurs d’une toxicité spécifi que
particulière.
CONCLUSION
Après de nombreuses années durant lesquelles la pharmacovi-
gilance est restée un épiphénomène en cancérologie, le souci
de la prévention, de la détection précoce et de la correction des
événements indésirables graves, à court, moyen ou long termes,
est une nouvelle préoccupation et un véritable défi pour le futur.
La souplesse dans la prescription, introduite en particulier par
les ATU et les PTT, majore la nécessité d’organisation et de
réfl exion sur ce sujet.
La modifi cation de l’arsenal thérapeutique, avec l’apparition des
nouvelles thérapeutiques basées sur les anticorps, caractérisés
par l’originalité de leur développement (diffi culté de les étudier
dans des modèles expérimentaux non humains), est un défi
important pour les années à venir.
Le propre de l’événement indésirable est d’être négligé tant
qu’on est dans une phase où le pronostic vital est en jeu, mais
son importance croît avec l’amélioration du pronostic.
La tolérance médiatique pour les eff ets néfastes des thérapeutiques
est importante lorsque le problème de survie est au premier plan,
mais cette attitude a tendance à s’inverser lorsqu’on obtient une
certaine effi cacité thérapeutique avec un accroissement important
de l’espérance de vie, voire lorsqu’on atteint ce que l’on peut appeler
un statut de guérison. Il est très important pour la communauté
cancérologique de s’organiser pour gérer ce futur. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Décret n° 95-278 du 13 mars 1995 relatif à la pharmacovigilance.
2. Décret n° 95-566 du 6 mai 1995 relatif à la pharmacovigilance exercée sur les
médicaments dérivés du sang humain.
3. Décret n° 2004-99 du 29 janvier 2004 relatif à la pharmacovigilance.
4. Décret n° 94-568 du 8 juillet 1994 relatif aux autorisations temporaires d’uti-
lisation de certains médicaments à usage humain.
5. Arrêté du 28 avril 2005 relatif aux bonnes pratiques de pharmacovigilance.
6. Kohler G, Fisher AM, Dunn PM. alidomide and congenital abnormalities.
Lancet 1962;1:326.
7. Bouff et E, Khelfaoui F, Philip I et al. High-dose carmustine for high-grade gliomas
in children. Cancer Chemother Pharmacol 1997;39:376-9.
8. O’Driscoll BR, Kalra S, Gattamaneni HR et al. Late carmustine lung fi brosis.
Chest 1995;107:1355-7.
9. Chastagner P, Kalifa C, Doz F et al. French society of pediatric oncology (SFOP)
pilot study. Outcome of children treated with preradiation chemotherapy for a
high-grade glioma: results of a french society of pediatric oncology (SFOP) pilot
study. Pediatr Blood Cancer 2006;49:803-7.
10. Sorensen K, Levitt G, Bull C et al. Anthracycline dose in childhood acute
lymphoblastic leukemia: issues of early survival versus late cardiotoxicity. J Clin
Oncol 1997;15:61-8.
YZhXgY^ihYZ;dgbVi^dcBY^XVaZ 8dci^cjZ
:Y^bVg`HVcikdjhegdedhZYZhG:KJ:HYZ;DGB6I>DC
$JcXdb^iYZgYVXi^dchX^Zci^ÒfjZZijcXdb^iYZaZXijgZfj^egdedhZciYZhVgi^XaZhh^\cheVgaZhVjiZjgh\VgVcih
YZaÉ^cYZmVi^dc!ZiVXXdbeV\chYZaZjghXddgYdccZh
$9Zhg[gZcXZhW^Wa^d\gVe]^fjZhhnhibVi^fjZbZciVeeZaZhYVchaZiZmiZ
$AVcdi^dcYZÆXdcÓ^iYÉ^cigiÆXaV^gZbZci^cY^fjZVÒcYZ\VgVci^gaÉdW_ZXi^k^i!aVfjVa^iZiaÉ^cYeZcYVcXZhX^Zci^ÒfjZ
YZhVgi^XaZhejWa^h
$JcZejWa^X^ik^hjZaaZZi$djgYVXi^dccZaaZYjbY^XVbZciZiYjbVig^ZabY^XVaeVg[V^iZbZci^YZci^ÒZ!
hVch^ciZggdbegZaVXdci^cj^iYÉjcVgi^XaZ
$AZhVgi^XaZhYÉdgYgZhX^Zci^ÒfjZZiY^YVXi^fjZXdchi^ijZciaÉZhhZci^ZaYjXdciZcjgYVXi^dccZa
C#7#AZWVgbZYZhXgY^ihYZ;B8ejWa^eVgaZb^c^higZYZaVHVci
YXgZiYj&(_j^aaZi'%%+!eVgjVj?djgcVad[ÒX^ZaaZ.Vdi'%%+egdedhZfjVigZ
XVi\dg^ZhYÉVXi^dcYZ;B8ZiYÉkVajVi^dcYZhegVi^fjZhegd[Zhh^dccZaaZhYdciaVXVi\dg^Z'!XdbegZcVciaZh[dgbVi^dch^cY^k^YjZaaZhZi|Y^hiVcXZji^a^hVci
idjihjeedgibVig^ZadjaZXigdc^fjZ!cdiVbbZciaZhVWdccZbZcih|YZheg^dY^fjZhdjaÉVXfj^h^i^dcYÉdjkgV\ZhbY^XVjm#
<V\cZo)XgY^ih$Vc
ZcViiZciZYjYXgZiYÉVeea^XVi^dc
ZckdjhVWdccVciYhbV^ciZcVci
|jcZYZcdhejWa^XVi^dch
kd^gcdigZWjaaZi^cYÉVWdccZbZcieV\Z&'(
AV[VXijgZdjjcZViiZhiVi^dckVa^YZgdcikdigZ;B8
6WdccZo"kdjhZiWc[^X^Zo
1
/
5
100%