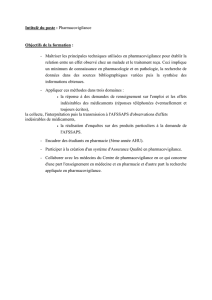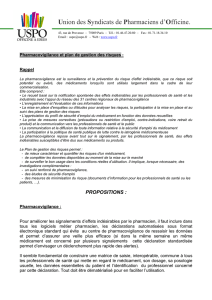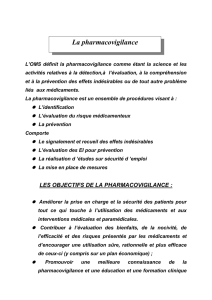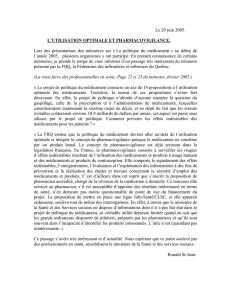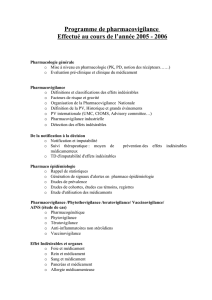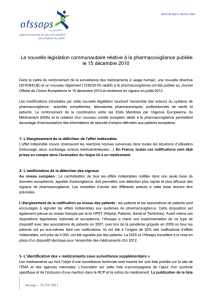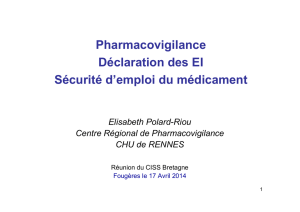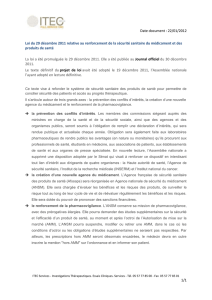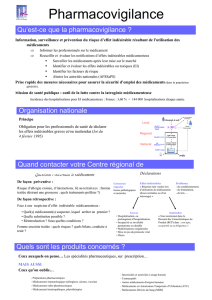L Organisation du recueil de l’information sur le terrain A

e recueil des informations nécessaires à la constitu-
tion d’un dossier de pharmacovigilance repose,
comme tout acte médical, sur les principes de base
d’une démarche diagnostique. Cependant, il existe une diffé-
rence fondamentale. En effet, la démarche diagnostique évo-
quée plus haut est le plus souvent sollicitée par un patient qui
invoque des troubles. En pharmacovigilance, l’information
arrive par le biais d’une tierce personne, en l’occurrence un
professionnel de santé, par notification spontanée.
L’article R 5144-19 du décret du 13 mars 1995 relatif à l’or-
ganisation de la pharmacovigilance précise bien que la décla-
ration “d’un effet grave ou inattendu susceptible d’être dû à un
médicament…” doit faire l’objet d’une déclaration immédiate
au Centre régional de pharmacovigilance (CRPV). Cette
La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 3 - mai/juin 2002
71
ADPC
Organisation du recueil de l’information sur le terrain
!Le point de vue d’un directeur de centre
"
M. Ollagnier*, C. Guy*, M.N. Beyens*, M. Ratrema*, G. Mounier*, L. Bergeron*
L
*Centre de pharmacovigilance et de renseignements sur le médicament de
Saint-Étienne, 42000 Saint-Étienne.

obligation est faite aux prescripteurs (médecins, chirurgiens-
dentistes ou sages-femmes) et aux pharmaciens, pour les médi-
caments qu’ils ont délivrés. Le même décret invite les membres
d’une profession de santé à faire de même. En dépit de cette
obligation ou recommandation, la sous-notification reste consi-
dérable, de 60 à 97 % selon les études. Or il faut bien avoir pré-
sent à l’esprit que sans cette information initiale, il n’y a pas
de pharmacovigilance, ce qui veut dire que le rapport béné-
fice/risque d’un médicament ne peut pas être évalué ni rééva-
lué. Les raisons de cette sous-notification sont nombreuses. Si
la démarche de pharmacovigilance a été initialement mal vécue
(peur du jugement), c’est maintenant exceptionnellement le
cas ; elle est, au contraire, perçue comme une aide au diagnos-
tic. Certains invoquent de fallacieux prétextes : pas le temps,
pas le papier qu’il faut, trop compliqué, cela ne sert à rien, effet
déjà connu, déclarer à qui, et où ? La rétention volontaire de
l’information, le plus souvent dans un but de publication, est
une source de sous-notification qu’il ne faut pas minorer. Il est
donc important d’améliorer la notification par tous les moyens
possibles :
#sensibiliser nos partenaires : médecins, pharmaciens, pro-
fessionnels de santé, et pourquoi pas les patients eux-mêmes,
puisqu’ils sont directement concernés par les effets indésirables
qu’ils subissent ;
#par une présence forte sur le terrain dans le cadre de l’aide
au diagnostic, mais aussi par un passage systématique et/ou une
participation active aux réunions de service, afin d’être au plus
près des événements ;
#assurer la formation initiale et continue des médecins, phar-
maciens et autres professionnels de santé ;
#faciliter le recueil par mise à disposition de téléphone, fax,
e-mail, et pourquoi pas par des formulaires T (préaffranchis).
Le signalement de l’effet indésirable obtenu, il reste à l’ar-
gumenter pour en évaluer la réalité, apprécier le niveau de
gravité, et lui donner une suite. Cette démarche devra s’atta-
cher à reconstituer la totalité du dossier médical à partir d’élé-
ments parfois épars. Cela sera d’autant plus complexe et long
que l’histoire médicale du patient sera elle-même compliquée.
Il sera nécessaire d’interroger avec tact et déontologie le
médecin généraliste, le ou les service(s) hospitalier(s) (sans
négliger le dossier infirmier, souvent riche d’informations).
Les interlocuteurs sont parfois nombreux, leur coopération
pas toujours à la hauteur des espérances. On peut comparer
cette phase, selon sa sensibilité personnelle, à un grand jeu de
piste, à une enquête policière, ou plus précisément à l’ins-
truction d’un dossier judiciaire qui devra, après avoir éliminé
les autres étiologies, affirmer le diagnostic d’accident médi-
camenteux.
La recherche de l’agent causal est le plus souvent assez simple
si l’on dispose des ordonnances ou des feuilles de traitement.
En leur absence, il faut alors se tourner vers le patient. Il est
toutefois indispensable d’être circonspect, afin d’éviter
quelques pièges liés au fait que la délivrance ne correspond pas
exactement à la prescription. La substitution d’un générique à
une forme princeps peut introduire un biais. À l’hôpital, la pres-
cription sera honorée selon la molécule qui aura été retenue par
l’appel d’offres pharmaceutique. Il ne faudra pas faire une
confiance absolue à la feuille de traitement, mais vérifier auprès
du pharmacien. Dans d’autres cas, le médicament suspect n’est
pas connu, car prescrit dans le cadre d’une autorisation tem-
poraire d’utilisation (ATU) ou, pire, d’un essai clinique. Enfin,
il ne faut jamais oublier ou minorer le risque d’automédication
par des médicaments OTC, des alicaments ou des produits dis-
ponibles sur le net par simple demande.
La dernière étape concerne la confrontation de cette informa-
tion avec les banques de données existantes, afin d’en apprécier
le degré de connaissance. En première intention, nous consul-
tons le résumé des caractéristiques du produit (RCP). Sachant
que la version proposée dans le dictionnaire Vidal®contient des
erreurs et que la version originale est très difficile à obtenir de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(AFSSAPS), nous sommes obligés d’avoir recours à d’autres
sources. En deuxième instance, nous utilisons la Banque natio-
nale de pharmacovigilance, à laquelle nous avons accès en exclu-
sivité avec l’AFSSAPS. La recherche s’élargit ensuite à l’in-
dustriel, aux ouvrages spécialisés et à la littérature internationale.
Le problème se complique lorsque le produit en cause est un
générique, un médicament en ATU ou en essai clinique, un
médicament OTC ou un alicament.
Une fois cette information collectée, organisée et validée, la syn-
thèse est adressée au(x) notificateur(s) avec, le cas échéant, un
complément bibliographique et une conduite à tenir. Elle peut
aussi faire l’objet d’une publication. En cas de conséquences pré-
visibles en termes de santé publique, cette information est trans-
mise à l’AFSSAPS et aux instances européennes (European
Medical Evaluation Agency [EMEA]) et internationales (OMS).
CONCLUSION
Ainsi, on peut constater que le recueil de l’information et son
organisation sont des étapes déterminantes de l’activité de phar-
macovigilance, de la qualité du service rendu et de la fiabilité
de l’évaluation du bénéfice-risque des médicaments dans une
optique de santé publique. !
72
La Lettre du Pharmacologue - Volume 16 - n° 3 - mai/juin 2002
ADPC
1
/
2
100%