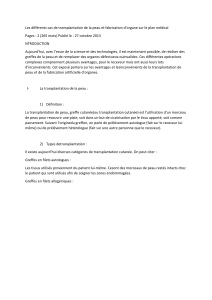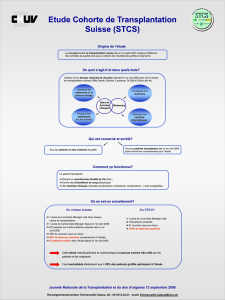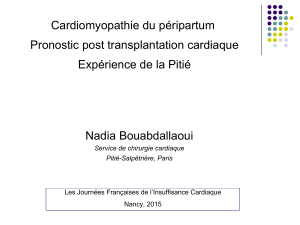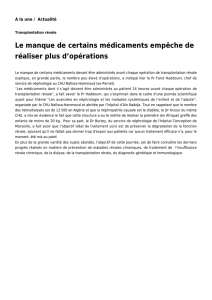Lire l'article complet

Le Courrier de la Transplantation - Volume III - no3 - juillet-août-sept. 2003
131
DOSSIER
thématique
ans de nombreux pays, la néphro-
pathie diabétique est devenue
une des causes principales de survenue
d’une insuffisance rénale chronique (1).
Dans la population concernée, un grand
nombre de travaux montrent que la
transplantation rénale et la transplanta-
tion rénopancréatique permettent une
meilleure survie des patients (2). Aussi,
en particulier chez des patients jeunes,
cette alternative thérapeutique est deve-
nue le traitement de choix, permettant à
la fois de suppléer à la fonction endocrine
du pancréas et d’obtenir, peut-être, un
meilleur contrôle des complications
secondaires au diabète. L’utilisation de
nouveaux traitements immunosuppres-
seurs et le drainage entéral des sécrétions
exocrines ont permis une amélioration
des résultats obtenus après double trans-
plantation rénopancréatique. Une revue
récente a montré que la survie actuarielle
à deux ans après la transplantation est de
97,7 % pour les patients, de 93,3 % pour
le greffon rénal et de 90,0 % pour le gref-
fon pancréatique (3). Du fait de ces suc-
cès, un nombre croissant de patients
jeunes vont bénéficier de ce traitement,
et la problématique du désir de grossesse
va devenir de plus en plus fréquente.
Nous n’envisagerons pas ici les gros-
sesses survenues après transplantation
pancréatique isolée ou en cas de greffes
d’îlots, à notre connaissance non encore
rapportées. Pour cette revue, nous avons
utilisé largement les données du National
Transplantation Pregnancy Registry
(NTPR) (4) et celles de l’International
Pancreas Transplant Registry (IPTR) col-
ligé par B. Barrou (5).
CARACTÉRISTIQUES DES PATIENTES
ET DE LA TRANSPLANTATION
La première question est celle des carac-
téristiques des patientes et de la trans-
plantation avant la grossesse. Dans l’ex-
périence de l’IPTR (5), l’âge moyen au
moment de la survenue du diabète, chez
les patientes ayant eu une grossesse, était
de 9 ± 4,5 ans et la durée moyenne du dia-
bète avant la transplantation était de
21,6 ± 7,5 ans. Toutes les receveuses,
âgées en moyenne de 29,7 ± 4,9 ans,
avaient bénéficié d’une double trans-
plantation provenant d’un même donneur.
Parmi ces 19 patientes, tous les pancréas,
sauf un, étaient placés en position pel-
vienne. Le drainage des sécrétions pan-
créatiques était, dans 9 cas, un drainage
vésical (l’un d’entre eux ayant nécessité
D
Grossesse
et
transplantation
Coordinateur : E. Thervet,
service de néphrologie
et de transplantation rénale,
hôpital Saint-Louis,
75010 Paris.
◗Introduction - E. Thervet (page 125)
◗Grossesse et transplantation rénale - C. Legendre, L. Bererhi (page 127)
●Grossesse après transplantation pancréatique -
E. Thervet
◗Grossesse après transplantation pulmonaire - P. Chevalier (page 135)
◗Grossesse et transplantation cardiaque - R. Dorent, I. Gandjbakhch (page 139)
◗Grossesse et traitements immunosuppresseurs - E. Thervet (page 144)
* Service de néphrologie et de transplantation
rénale, hôpital Saint-Louis, 75010 Paris.
Grossesse après transplantation pancréa-
●
E. Thervet*

une dé-dérivation entérale), dans 6 cas,
un drainage entéral d’emblée et, dans
2 cas, les sécrétions avaient été contrô-
lées par injection dans le Wirsung. Il
s’agissait dans 11 cas de la transplanta-
tion d’un pancréas total et dans 6 cas d’un
pancréas segmentaire. Toutes les gros-
sesses rapportées avaient été réalisées
chez des patients ayant une bonne fonc-
tion pancréatique et rénale (créatinine
117 ± 35 µmol/l), à l’exception d’un cas
pour lequel la créatinine était égale à
380 µmol/l.
Le délai moyen entre la transplantation
et la grossesse est variable, mais en géné-
ral supérieur à deux ans. Si le délai idéal
ne peut être précisé, la prudence impose
une période de deux ans, comme cela a
pu être proposé pour les receveuses de
transplantation rénale isolée. Il faut
cependant remarquer que les grossesses
survenues tôt (jusqu’à 6 mois après la
transplantation dans le registre de l’IPTR)
n’ont pas donné lieu à des complications
particulières.
Il ne semble pas non plus que le type de
transplantation pancréatique, totale ou
segmentaire, entraîne un devenir différent
durant la grossesse, malgré une masse
d’îlots inférieure en cas de transplanta-
tion segmentaire. De même, la situation
pelvienne de deux organes transplantés
au lieu d’un seul ne semble pas avoir été
un élément péjoratif lors de la délivrance.
Pourtant, une césarienne a été pratiquée
dans 100 % des cas pour l’IPTR et dans
53 % des cas dans le NTPR (cf. infra). De
plus, aucun épisode de pancréatite n’a été
observé durant la grossesse, malgré
l’augmentation de la pression pelvienne
secondaire au développement utérin.
CARACTÉRISTIQUES DE LA GROSSESSE
Le rapport 2001 du NTPR a rapporté les
caractéristiques de 45 grossesses chez
31 receveuses de transplantation réno-
pancréatique (tableau I) (4). On peut
remarquer qu’il existe une incidence plus
importante d’hypertension artérielle dans
cette population par rapport aux gros-
sesses survenant au cours de la trans-
plantation d’un autre organe. La question
principale est, bien sûr, la survenue de
troubles de la glycorégulation durant la
grossesse ou au décours de celle-ci.
Actuellement, il n’existe pas de cas, dans
le NTPR, de survenue de diabète gesta-
tionnel à proprement parler.
Dans un cas, une patiente a dû recom-
mencer une insulinothérapie pendant la
grossesse en raison de l’augmentation des
doses de stéroïdes. La conception, chez
cette patiente, est survenue 2,4 ans après
la transplantation, et la grossesse s’est
compliquée d’une hypertension artérielle
et d’une prééclampsie. Environ un mois
avant la délivrance, la créatinine sérique
s’est progressivement détériorée en l’ab-
sence de rejet, nécessitant l’arrêt de la
ciclosporine. Les stéroïdes ont été aug-
mentés à cette occasion. Après la nais-
sance par césarienne d’un enfant bien
portant pesant 2 778 g, la ciclosporine a
été redébutée et la fonction du greffon
rénal et pancréatique s’est améliorée ulté-
rieurement.
De façon notable, l’immunosuppression
a été modifiée durant la grossesse chez
6 receveuses sur 19 avec, en particulier,
une augmentation de la ciclosporine chez
4 patientes (de 10 à 100 % de la dose) et
une diminution des doses chez une
patiente (5).
Sur le plan chirurgical, parmi les com-
plications pouvant survenir sur le greffon
rénal durant la grossesse, McGrory et al.
(6) ont rapporté la nécessité de réaliser
deux néphrostomies sur 23 grossesses.
Ces néphrostomies ont pu être retirées
sans difficulté après la délivrance.
Enfin, sur le plan obstétrical, une césarienne
a été réalisée dans tous les cas rapportés par
B. Barrou, avec une hystérotomie trans-
versale chez 7 patientes et longitudinale
chez 6 autres (5). Aucune lésion des gref-
fons n’a été rapportée. Cela dit, l’accou-
chement s’est fait dans 47 % des cas par les
voies naturelles dans le NTPR, et les avan-
tages et les inconvénients de chacune des
techniques restent à évaluer.
DEVENIR DES PATIENTES
ET DES GREFFONS
Au dernier suivi dans le NTPR, 21 rece-
veuses avaient encore une fonction rénale
et pancréatique satisfaisante (4). Parmi
les autres, 4 avaient encore une fonction
pancréatique satisfaisante, mais avaient
dû reprendre l’épuration extrarénale par
dialyse, 2 avaient une fonction pancréa-
tique satisfaisante, mais une dégradation
de la fonction rénale, une avait dû
reprendre une insulinothérapie avec une
fonction rénale satisfaisante et une avait
une dégradation de la fonction pancréa-
tique et rénale sans recours à l’insuline ni
à la dialyse. Deux patientes étaient décé-
dées, dont une en raison d’une encépha-
lite après retransplantation rénopancréa-
tique ; l’autre avait une perte de la
fonction rénale et pancréatique et est
décédée d’une pneumonie 2 ans après la
dernière grossesse, survenue à la suite
Le Courrier de la Transplantation - Volume III - no3 - juillet-août-sept. 2003
132
DOSSIER
thématique
Tableau I. Devenir des grossesses chez
31 receveuses de transplantation rénopan-
créatique (4).
■Facteurs maternels
– Intervalle transplantation-conception 3,6 ans
– Hypertension durant la grossesse 76 %
– Diabète durant la grossesse 0 %
– Infection durant la grossesse 55 %
– Épisode de rejet durant la grossesse 8 %
– Prééclampsie 31 %
– Perte du greffon dans les deux ans 16 %
■ Devenir (n) 45
– Avortement thérapeutique 7 %
– Avortement spontané 11 %
– Grossesse ectopique 2 %
– Naissance vivante 80 %
■ Naissance vivante (n) 36
– Âge gestationnel moyen 35 sem.
– Prématurité (< 36 sem.) 75 %
– Poids moyen de naissance 2 167 g
– Poids de naissance < 2 500 g 57 %
– Naissance par césarienne 53 %
– Complications néonatales 53 %
– Morts néonatales (< 30 j) 1
■ Traitement immunosuppresseur (n, %)
– CsA, AZA, stéroïdes 19 (44)
– CsA, stéroïdes 6 (14)
– CsAME, AZA, stéroïde 10 (23)
– CsAME, stéroïde 2 (5)
– Tacrolimus, AZA, stéroïde 3 (7)
– Tacrolimus, AZA 2 (5)
– Tacrolimus, stéroïde 1 (2)

d’une double amputation. Cinq patients
avaient une perte du greffon dans les
2 ans suivant la grossesse.
Dans l’étude de Barrou, qui portait sur
19 patientes, un greffon pancréatique et
un greffon rénal ont été perdus chez deux
receveuses différentes (5). Un greffon
pancréatique avait dû être retiré 2,5 mois
après la délivrance en raison de la surve-
nue d’un rejet aigu. Le greffon rénal perdu
était celui de la patiente dont la fonction
était de 380 µmol/l. Ce greffon a été perdu
3 mois après la délivrance avec un gref-
fon pancréatique fonctionnel.
Le risque de rejet des organes transplan-
tés (rénaux ou pancréatiques) ne semble
donc pas être supérieur à celui observé
après une grossesse chez les patientes
receveuses d’une transplantation rénale
isolée.
Une étude a recherché les facteurs de
risque de perte des greffons après la gros-
sesse en comparant les patientes avec un
devenir favorable (n = 21) et celles ayant
perdu leur greffon (n = 6) (7). Aucun fac-
teur avant la grossesse n’était prédictif du
devenir, même si la fonction rénale était
légèrement, mais non significativement,
inférieure dans le groupe avec une perte
du greffon (tableau II). La fonction
rénale et un épisode de rejet durant la
grossesse étaient des facteurs prédictifs
de la perte du greffon. Parmi ces épisodes
de rejet, deux ont été diagnostiqués au
cours de la grossesse et un sur une biop-
sie réalisée au moment de la césarienne.
Cela permet d’insister encore sur l’im-
portance d’un suivi régulier et attentif, en
particulier de la fonction du greffon rénal
au cours de la grossesse. Aucun conseil
sur la fonction rénale avant grossesse ne
peut être donné, si ce n’est qu’elle doit
être la meilleure possible (!) et probable-
ment inférieure à 1,5 mg/dl, comme cela
avait été proposé par Davison en cas de
transplantation rénale isolée (8).
Une question spécifique pourrait être
celle des conséquences d’une grossesse
sur les complications diabétiques. À notre
connaissance, seul un cas d’aggravation
d’une rétinopathie a été rapporté par Bar-
rou et al. (5). Il faut malgré tout remar-
quer que, parmi les trois décès rapportés
dans les deux registres, deux avaient une
origine cardiovasculaire (infarctus du
myocarde dans un cas et pneumonie com-
pliquant une double amputation dans
l’autre). Cela ne peut être mis directement
en relation avec la grossesse, mais per-
met d’insister encore une fois sur l’im-
portance du suivi cardiovasculaire de ces
patientes à risque élevé (9).
DEVENIR DES ENFANTS
En ce qui concerne le devenir des enfants,
deux malformations congénitales ont été
rapportées dans l’IPTR (une cataracte
bilatérale et un arc aortique double). Un
enfant a notamment développé un diabète
de type 1 à l’âge de 3 ans (5). Dans le
NTPR, il n’était pas rapporté de malfor-
mations structurales particulières, même si
2 enfants avaient nécessité une transfusion
après la naissance pour anémie et un autre
avait présenté une communication inter-
auriculaire, résolutive en un an (6).
Cette question est difficile dans tous les cas
d’organes transplantés ; elle est particuliè-
rement complexe en cas de diabète,
puisque l’incidence des malformations
congénitales est déjà plus élevée chez les
patientes diabétiques non transplantées (2
à 8 fois plus fréquentes) que dans la popu-
lation générale (10). Comme si cette surin-
cidence pourrait être expliquée par un mau-
vais contrôle glycémique (11), qui n’existe
plus après transplantation rénopancréa-
tique, cela rend encore plus difficile l’ana-
lyse des données après cette double greffe.
La question du risque de survenue d’un
diabète chez les enfants des patientes
transplantées du rein et du pancréas est
également difficile à préciser. De plus,
elle comporte une dimension éthique que
nous n’envisagerons pas ici. À notre
connaissance, il n’existe qu’un seul cas,
mentionné dans le rapport de l’IPTR, de
survenue d’un diabète de type 1 chez un
enfant de 3 ans né d’une mère ayant béné-
ficié d’une double transplantation (5).
Compte tenu des connaissances actuelles
sur l’origine génétique du diabète de type
1 et sur son risque de transmission, il est
probable que cette incidence augmente
avec la durée de suivi des enfants de
patientes ayant bénéficié d’une double
transplantation. De plus, le risque de dia-
bète chez les enfants de patientes diabé-
tiques est plus important lorsque le dia-
bète est survenu tôt chez la mère (12).
Compte tenu des spécificités démogra-
phiques de la population des patients
transplantés rénopancréatiques, il est pro-
bable que l’incidence des diabètes de
novo observés chez les enfants sera plus
élevée.
Le Courrier de la Transplantation - Volume III - no3 - juillet-août-sept. 2003
133
DOSSIER
thématique
Tableau II. Comparaison des données selon qu’il y a ou non perte du greffon après trans-
plantation rénopancréatique (7).
Perte du greffon Pas de perte du greffon p
Intervalle greffe-conception (ans) 2,8 ± 2,4 (0,3-8,4) 3,5 ± 2 (1,2-11,3) NS
Avant la grossesse
Créatinine (mg/dl) 1,55 ± 0,38 (1,2-2,3) 1,37 ± 0,34 (0,85-2,6) NS
Hypertension (n, %) 5 (63) 16 (57) NS
Rejet (n, %) 4 (50) 23 (82) NS
Pendant la grossesse
Créatinine (mg/dl) 2,23 ± 0,86 (1,25-3,5) 1,49 ± 0,64 (0,85-3,9) 0,013
Hypertension (n, %) 8 (100) 20 (74) NS
Rejet (n, %) 3 (38) 0 (0) 0,008
Prééclampsie (n, %) 4 (57) 7 (44) NS
Infections (n, %) 6 (75) 13 (50) NS
Diabète gestationnel (n, %) 0 0 NS
Césarienne (n, %) 6 (86) 10 (46) NS
Après la grossesse
Créatinine (mg/dl) 2,51 ± 1,5 (1,3-6,0) 1,5 ± 0,67 (0,85-3,7) 0,013
Hypertension (n, %) 6 (75) 20 (74) NS
Rejet (n, %) 3 (38) 0 0,008

CONCLUSION
Grâce à l’amélioration des techniques
chirurgicales et des traitements immu-
nosuppresseurs, la double transplanta-
tion rénopancréatique est devenue le trai-
tement de choix des jeunes patientes
diabétiques présentant une insuffisance
rénale chronique parvenue à son stade
terminal. Cela a pour conséquence un
nombre croissant de transplantations
dans cette population et donc une plus
grande fréquence du désir de grossesse.
Il semble raisonnable de demander au
moins les mêmes contraintes et le même
suivi que chez les patientes receveuses
d’un greffon rénal isolé. Un délai de deux
ans après la greffe et une créatinine opti-
male (inférieure à 1,5 mg/dl) sont des
facteurs de sécurité pour ces grossesses.
Un suivi extrêmement strict portant sur
le contrôle tensionnel, glycémique et car-
diovasculaire par des équipes spéciali-
sées est également nécessaire. À ces
conditions, le devenir après la grossesse
de la mère, de l’enfant et des greffons
peut être aussi bon qu’en cas de trans-
plantation rénale isolée chez des femmes
diabétiques (13). Une information de
l’obstétricien et une bonne collaboration
avec l’équipe chirurgicale de transplan-
tation sont aussi garantes d’un accou-
chement à moindre risque. Enfin, pour
l’enfant, si le risque de malformations ne
semble pas supérieur à celui observé
chez les enfants de femmes diabétiques
et/ou transplantées d’un autre organe, le
problème du risque de survenue à dis-
tance d’un diabète de type 1 reste tou-
jours d’actualité, comme chez la mère
diabétique non transplantée. ■
RÉFÉRENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
1. US Renal Data System. Excerpts from the USRDS
2000 annual data reports : Atlas of end-stage renal
disease in the United States. Am J Kid Dis 2000 ; 36
(S2) : S37-S54.
2. Ojo AO, Meier-Kriesche HU, Hanson JA et al.
The impact of simultaneous pancreas-kidney
transplantation on long-term patient survival.
Transplantation 2001 ; 71 : 82-90.
3. Stratta RJ. Review of immunosuppressive usage in
pancreas transplantation. Clin Transplant 1999 ;
13 : 1-12.
4. Armenti VT, Wilson GA, Radomski JS et al. Report
from the National Transplantation Pregnancy
Registry (NTPR) : outcomes of pregnancy after
transplantation. In : Cecka JM, Terasaki PI (eds).
Clinical Transplants 2001. Los Angeles : UCLA
Typing Laboratory, 2002 ; 97-105.
5. Barrou BM, Gruessner AC, Sutherland DER et al.
Pregnancy after pancreas transplantation in the
cyclosporine era. Transplantation 1998 ; 65 : 524-7.
6. McGrory CH, Groshek MA, Sollinger HW, Moritz
MJ, Armenti VT. Pregnancy outcomes in female pan-
creas-kidney recipients. Transplant Proc 1999 ; 31 :
652-3.
7. Wilson GA, Coscia LA, McGrory CH et al.
National Transplantation Pregnancy Registry : post-
pregnancy graft loss among female pancreas-kidney
recipients. Transplant Proc 2001 ; 33 : 1667-9.
8. Davison JM. Dialysis, transplantation, and pre-
gnancy. Am J Kid Dis 1991 ; 17 : 127-32.
9. Boucek P, Saudek F, Pokorna E et al. Kidney
transplantation in type 2 diabetic patients : a com-
parison with matched non-diabetic subjects. Nephrol
Dial Transplant 2002 ; 17 : 1678-83.
10. Mills JL, Baker L, Goldman AS. Malformations
in infants of diabetic mothers occur before the seventh
gestational week. Diabetes 1997 ; 28 : 292-3.
11. Miller E, Hare JW, Cloherty JP et al. Elevated
maternal hemoglobin A1c in early pregnancy and
major congenital anomalies in infants of diabetic
mother. N Engl J Med 1981 ; 304 : 1331-4.
12. Bleich D, Polak M, Eisenbarth GS, Jackson RA.
Decreased risk of type I diabetes in offspring of
mothers who acquire diabetes during adrenarchy.
Diabetes 1993 ; 42 : 1433-9.
13. Armenti VT, McGrory CH, Cater J, Radomski
JS, Jarrell BE, Moritz MJ. The National
Transplantation Pregnancy Registry : comparison
between pregnancy outcomes in diabetic cyclospo-
rine-treated female kidney recipients and CyA-trea-
ted female pancreas-kidney recipients. Transplant
Proc 1997 ; 29 : 669-70.
Le Courrier de la Transplantation - Volume III - no3 - juillet-août-sept. 2003
134
DOSSIER
thématique
1
/
4
100%