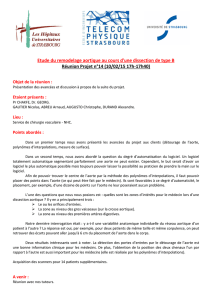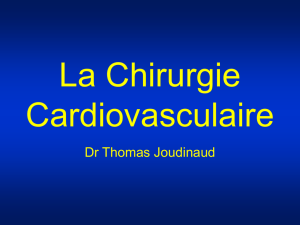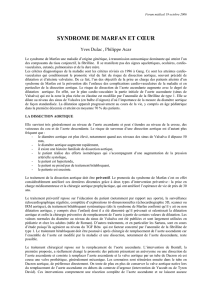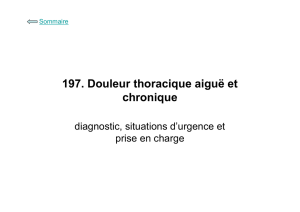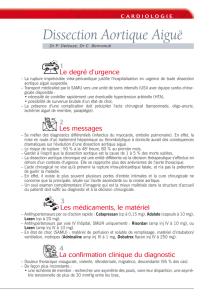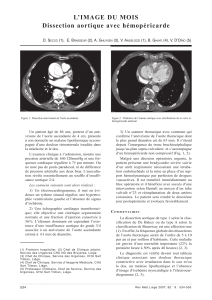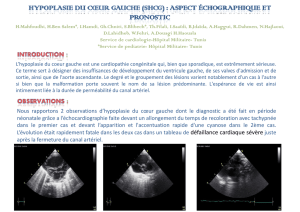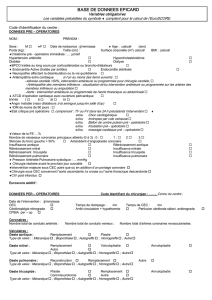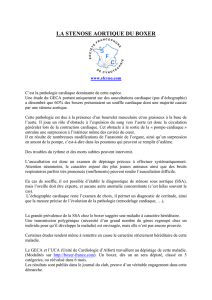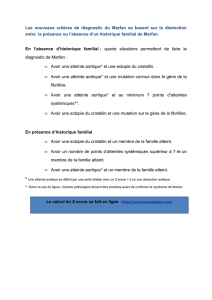Quand faut-il opérer une maladie de Marfan ? É

L’ATTEINTE AORTIQUE
La partie initiale de l’aorte ascendante (sinus de Valsalva) est la
partie le plus souvent anormale : c’est la zone la plus riche en
fibres d’élastine, et donc celle qui est le plus modifiée par l’ano-
malie de la fibrilline de type 1 ; de plus, elle subit à chaque sys-
tole ventriculaire une distension aiguë qui se corrige pendant la
diastole. Elle est initialement limitée à la partie initiale de l’aorte
au niveau des sinus de Valsalva et réalise un aspect en “bulbe d’oi-
gnon”. On peut méconnaître la dilatation si on ne fait pas parti-
culièrement attention à la mesurer à ce niveau, notamment au
cours d’un examen par IRM ou scanner spiralé, et ce d’autant que
le diamètre aortique retrouvé chez la plupart des patients n’est
qu’un peu au-dessus des limites supérieures des valeurs normales,
notamment chez l’enfant. D’autres patients présentent une dila-
tation plus étendue de l’aorte ascendante, non limitée aux sinus
de Valsalva : dans cette situation, le risque de dissection aortique
semble alors plus important.
La Lettre du Cardiologue - n° 339 - novembre 2000
3
ÉDITORIAL
Quand faut-il opérer une maladie de Marfan ?
●G. Jondeau*
*Consultation Marfan et service de cardiologie, hôpital Ambroise-Paré,
Boulogne.
■
La maladie de Marfan est une maladie géné-
tique, témoin dans la grande majorité des cas
d’une mutation du gène de la fibrilline de type 1
(situé sur le chromosome 15). La fibrilline de
type 1 est une molécule ubiquitaire qui se trouve
associée de façon étroite avec les fibres d’élas-
tine, dans la paroi vasculaire et les tissus valvu-
laires. L’anomalie de la fibrilline de type 1 pro-
voque une dysfonction des fibres d’élastine, ce
qui se traduit par une diminution de la résistance
des tissus de soutien.
■
La transmission de la maladie se fait selon le
mode autosomique dominant. Sa fréquence,
difficile à apprécier du fait de la méconnaissance
probable de nombreux cas, a été estimée à
3-5/10 000, sans prédominance de race ou sexe.
Sa pénétrance est très élevée, c’est-à-dire que le
porteur de l’anomalie génétique présente
presque toujours le syndrome après un certain
âge, si bien que l’un des parents d’un enfant
atteint est atteint, sauf s’il s’agit d’une nouvelle
mutation, ce qui serait le cas dans un tiers à un
quart des cas, et peut-être plus si le patient pré-
sente une forme sévère.
■Sur le plan cardiovasculaire, la maladie de
Marfan se traduit par une faiblesse de la
paroi aortique qui se dilate progressivement au
cours de la vie et risque de disséquer : avant que
la chirurgie de remplacement de la racine de
l’aorte soit réalisée (avant l’intervention de Ben-
tall), les patients mouraient à 80 % des consé-
quences de la dilatation aortique (dissection ou
fuite aortique avec insuffisance cardiaque), et la
moitié des patients étaient décédés avant l’âge
de 40 ans (1). Depuis que la prise en charge
médicale et chirurgicale a été optimisée, l’espé-
rance de vie des patients a augmenté de plus de
trente ans (2).
❏Un volet fondamental est donc la chirur-
gie de remplacement de la racine de l’aorte,
qu’il va falloir proposer à temps pour éviter que
les complications ne surviennent, mais pas trop
tôt, afin d’éviter au patient de prendre un risque
inutile (certains patients présentant un syndrome
de Marfan ne sont jamais opérés, et s’en trou-
vent très bien). On tend actuellement à proposer
une intervention plus précocement, avec l’idée
de préserver les valves natives et d’éviter ainsi
le traitement anticoagulant au long cours et les
complications des valves mécaniques.
❏Une autre complication cardiovasculaire
classique de la maladie est le prolapsus valvu-
laire mitral, qui peut également relever d’une
intervention chirurgicale.
Mots-clés : Syndrome de Marfan - Aorte -
Dissection - Traitement.
Introduction
A. Giacometti

La Lettre du Cardiologue - n° 339 - novembre 2000
4
Bien que l’atteinte prédomine au niveau de l’aorte initiale, l’ano-
malie structurelle, responsable d’une diminution de la distensibi-
lité de la paroi artérielle, se retrouve sur l’ensemble du vaisseau
(3) ; les aortes thoraciques descendante et abdominale sont égale-
ment susceptibles de se dilater et de se disséquer. En fait, la dis-
section de l’aorte descendante est très généralement une extension
d’une dissection de l’aorte ascendante. Mais le remplacement de
l’aorte initiale ne protège pas complètement les patients présentant
un syndrome de Marfan d’une dissection de l’aorte descendante.
Les risques de l’atteinte aortique
Insuffisance aortique. L’insuffisance aortique résulte de la
désaxation des valvules aortiques semi-lunaires par la déforma-
tion de la racine de l’aorte, zone sur laquelle s’appuient les
attaches des valvules. L’insuffisance aortique croît donc généra-
lement avec la dilatation.
Dissection de l’aorte. La dissection aortique survient très géné-
ralement au niveau de l’aorte ascendante ; elle peut s’étendre au
niveau de la crosse et des vaisseaux du cou et au niveau de l’aorte
descendante. Quand elle siège sur l’aorte ascendante, une inter-
vention en urgence se justifie du fait du risque de rupture. Quand
elle siège au niveau de l’aorte descendante, l’intervention n’est
réalisée que lorsque le diamètre aortique augmente (souvent au
dessus de 50-60 mm) ou qu’une ischémie y contraint.
FACTEURS FAVORISANT LA DISSECTION AORTIQUE
La dissection de l’aorte ascendante a d’autant plus de risques de
survenir que :
1. Le diamètre aortique est plus élevé ; on considère que le
risque est faible (bien que non nul) lorsque le diamètre aortique
au niveau des sinus de Valsalva reste en dessous de 50 à 55 mm
(figure 1).
2. Le diamètre aortique augmente, en valeur absolue chez
l’adulte ou plus que ne le voudrait la croissance chez l’enfant : la
dilatation rapide d’une aorte jusque-là stable doit faire considérer
l’intervention avant que la dissection ne survienne (5) (figure 2).
ÉDITORIAL
Figure 1. Répartition des patients suivant qu’ils présentaient une dis-
section de l’aorte ou non dans la série rétrospective mondiale portant sur
675 cas, et qui incluait également les patients Marfan. Le pourcentage de
patients présentant une dissection reste faible tant que l’aorte reste infé-
rieure à 60 mm (4).
Figure 2. Chez les enfants qui présentent une complication aortique, la
complication a été précédée d’une dilatation plus rapide de l’aorte (El
Habbal M, Information cardiologique 1991 ; 15 : 59-62).
Figure 3. La dilatation aortique est ralentie par le traitement bêta-
bloquant :
70 patients présentant un syndrome de Marfan ont été répartis
en deux groupes. Le groupe contrôle ne prenait pas de bêtabloquant, alors
que le groupe traitement recevait du propranolol à une dose suffisante
pour limiter la fréquence cardiaque à moins de 110 à l’effort. L’aortic
ratio, sur l’axe des X, correspond au rapport diamètre aortique mesuré sur
diamètre aortique théorique, et l’axe des Y représente les mois de suivi
(6).

La Lettre du Cardiologue - n° 339 - novembre 2000
5
3. Il existe une histoire familiale de dissection de l’aorte : bien
qu’une grande variabilité phénotypique soit observée à l’intérieur
d’une même famille, il semble que le risque de dissection pré-
coce soit plus important si un autre membre de la famille a pré-
senté une dissection aortique jeune ou alors que les sinus de Val-
salva n’étaient que peu dilatés.
4. Le patient réalise des efforts isométriques qui s’accompa-
gnent d’une augmentation importante de la pression artérielle sys-
tolique, et augmentent ainsi la contrainte appliquée à l’aorte ini-
tiale. Il faut donc déconseiller les sports qui impliquent ce type
d’effort, tels le basket ball, le tennis, le handball, le volley-ball...
et, bien sûr, la musculation, que ces patients pourraient être dési-
reux de pratiquer du fait de la diminution de la masse musculaire
qui accompagne parfois le syndrome.
5. Le patient est hypertendu.
6. Le patient ne prend pas de traitement bêtabloquant (figure 3).
7. La patiente est enceinte.
TRAITEMENT CHIRURGICAL : REMPLACEMENT DE L’AORTE
ASCENDANTE
Le traitement chirurgical repose sur le remplacement de l’aorte
ascendante. L’ensemble de la paroi est fragile ; l’ensemble de
l’aorte ascendante doit être remplacé, et il ne doit pas persister
de collerette de tissu aortique natif au-dessus des valves : le tube
sus-coronaire est à bannir. On peut ou non y associer un rempla-
cement valvulaire.
Les différentes interventions aortiques
L’intervention de Bentall
L’intervention de Bentall a réellement transformé le pronostic des
patients présentant un anévrysme ou une dissection de l’aorte
ascendante. Elle consiste à remplacer l’aorte ascendante et la
valve aortique par un tube de Dacron®,dans lequel a été cousue
une valve prothétique généralement mécanique. Les artères coro-
naires sont réimplantées ensuite dans le tube en Dacron®aortique,
de préférence directement. Le chirurgien peut ou non refermer la
paroi aortique native autour du tube en Dacron®pour favoriser
l’hémostase (figure 4).
ÉDITORIAL
Figure 4. Intervention de Bentall, avec la technique du bouton (pour
les ostia coronaires).
A. l’anévrysme de l’aorte ascendante est ouvert ;
B. on découpe un bouton autour de l’abouchement des artères coronaires ;
C. implantation du tube valvulé
;
D. aspect final après réimplantation des artères coronaires.
Cette intervention a largement fait ses preuves
et sa durabilité est bien établie, mais elle comporte,
outre les risques opératoires, les risques au long cours
d’une prothèse valvulaire mécanique et du traitement anticoagulant.

La Lettre du Cardiologue - n° 339 - novembre 2000
6
La préservation de la valve aortique
On peut tenter de conserver la valve aortique native lors du rem-
placement de l’aorte ascendante (intervention de Yacoub ou de
David). Ces interventions comprennent une résection complète
de l’aorte ascendante, et ne laissent aucune collerette aortique au-
dessus des valves. Le risque, difficile à évaluer actuellement, est
que s’installe plus ou moins rapidement une fuite aortique val-
vulaire. Cependant, cette intervention n’est pas toujours possible,
car les valves aortiques peuvent également s’altérer du fait des
conséquences mécaniques d’une fuite aortique chronique.
La tendance actuelle est de proposer une intervention de rem-
placement du culot aortique précocement, lorsque les valves aor-
tiques n’ont pas souffert d’une régurgitation chronique. En consé-
quence, la préservation de la valve aortique est de plus en plus
souvent possible et proposée. Mais les données sur les résultats
à long terme après chirurgie conservant la valve aortique sont
encore peu nombreuses.
L’indication opératoire
L’indication opératoire est portée sur un faisceau d’argu-
ments :
✔
Le diamètre aortique maximal, généralement au niveau des
sinus de Valsalva : lorsque le diamètre est supérieur à 60 mm,
l’indication est formelle. Elle est également portée lorsqu’il est
supérieur à 55 mm (4). Mais on peut proposer une intervention
lorsque le diamètre aortique est de 50 mm, avec l’idée de limi-
ter le risque de dissection, mais surtout de permettre une chi-
rurgie de remplacement de l’aorte ascendante qui préserve les
valves aortiques natives et évite ainsi au patient (ou à la patiente,
notamment en cas de désir de grossesse) les problèmes liés aux
valves mécaniques et au traitement anticoagulant. L’interven-
tion est également proposée plus facilement lorsqu’il existe une
histoire de dissection aortique dans la famille, d’autant plus que
la dissection est survenue à un jeune âge ou sur une aorte peu
dilatée.
✔
L’augmentation du diamètre aortique, ce qui ne saurait trop
faire souligner l’importance d’une surveillance régulière,
annuelle, et semestrielle lorsque l’on s’approche des diamètres
où la chirurgie est recommandée.
✔
Il faut apporter le plus grand soin à la réalisation de l’examen
(généralement échocardiographique), standardiser les méthodes
de mesure (figure 5), et comparer les résultats obtenus aux valeurs
normales compte tenu de l’âge, du poids, du sexe et de la taille.
Des valeurs normales du diamètre au niveau du sinus de Valsalva
ont été publiées par Roman (7), et sont largement utilisées pour
les adultes.
La surveillance après l’intervention
Après remplacement de l’aorte ascendante, les patients justifient
toujours d’une surveillance régulière : comme il est souligné plus
haut, c’est l’ensemble de l’aorte qui est fragile chez les patients
présentant un syndrome de Marfan. En conséquence :
1. Le traitement bêtabloquant doit être poursuivi après l’in-
tervention. Ce traitement est encore plus impératif lorsqu’une
dissection de l’aorte a touché l’aorte descendante, qui n’a très
généralement pas été remplacée, au moins d’emblée.
2. L’aorte doit être surveillée par un examen permettant de la
visualiser dans son intégralité, tel que le scanner spiralé ou la
RMN, à réaliser dans des centres ayant l’expérience de la mesure
des paramètres aortiques. On peut proposer une surveillance bi-
annuelle en l’absence de dissection ou de dilatation importante,
surveillance à renforcer en cas de complication.
L’INTERVENTION SUR LA VALVE MITRALE
L’intervention sur la valve mitrale n’est nécessaire que chez une
minorité des patients présentant un syndrome de Marfan et un
prolapsus valvulaire. Cela étant, les indications sont les mêmes
que dans la population non Marfan, avec deux particularités :
1. Il est presque toujours possible de faire une plastie valvulaire,
dont les bons résultats sont maintenus dans le temps.
2. Il est parfois délicat de décider ce qu’il faut faire sur l’aorte un
peu dilatée d’un patient chez lequel on réalise une plastie mitrale
ou, inversement, chez un patient qui va avoir une intervention de
remplacement de l’aorte ascendante et qui présente un prolapsus
avec une fuite qui semble augmenter.
CONCLUSION
La chirurgie de l’aorte est le principal facteur ayant permis d’al-
longer l’espérance de vie des patients présentant un syndrome de
Marfan. Il faut savoir la proposer à temps, ce qui peut permettre
de préserver la valve native, mais il faut également savoir ne pas
opérer un patient qui peut attendre dans de bonnes conditions de
sécurité. Les indications opératoires sur les aortes descendantes
sont souvent délicates, et la chirurgie du prolapsus mitral repose
en règle sur la plastie, dont les résultats se maintiennent dans le
temps. Il est important de poursuivre la surveillance et le traite-
ment après l’intervention, car il persiste une paroi aortique fra-
gile dans les segments aortiques non remplacés. ■
ÉDITORIAL
Figure 5. Mesure du diamètre aortique pour la surveillance de la racine
de l’aorte chez les patients présentant un syndrome de Marfan. .../...
Références bibliographiques, p. 8

La Lettre du Cardiologue - n° 339 - novembre 2000
8
ÉDITORIAL
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Murdoch J, Walker B, Halpern B, Kuzma J, McKusick V. Life expectancy and
causes of death in the Marfan syndrome. N Engl J Med 1972 ; 286 : 804-8.
2. Silverman D, Burton K, Gray J et al. Life expectancy in the Marfan syndrome.
Am J Cardiol 1995 ; 75 : 157-60.
3. Jondeau G, Boutouyrie P, Lacolley P et al. Central pulse pressure is a major
determinant of ascending aorta dilation in Marfan syndrome. Circulation 1999 ;
99 (20) : 2677-81.
4. Gott V, Greene P, Alejo D et al. Replacement of the aortic root in patients with
Marfan’s syndrome. N Engl J Med 1999 ; 340 : 1307-13.
5. El Habbal M, Somerville J. Size of the normal aortic root in normal subjects
and in those with left ventricular outflow obstruction. Am J Cardiol 1989 ;
63 (5) : 322-6.
6. Shores J, Berger K, Murphy E, Pyeritz R. Progression of aortic dilatation and
benefit of long-term ß-adrenergic blockade in Marfan’s syndrome. N Engl J Med
1994 ; 330 : 1335-41.
7. Roman MJ, Devereux RB, Kramer-Fox R, O’Loughlin J. Two-dimensional
echocardiographic aortic root dimensions in normal children and adults.
Am J Cardiol 1989 ; 64 (8) : 507-12.
.../...
GRAND PRIX ÉDITORIAL DU SNPM
Notre groupe de presse SR.Teleperformance Média
Santé a participé au premier Grand Prix Éditorial
organisé par le Syndicat National de la Presse Médicale
(SNPM), le 5 octobre dernier.
La Lettre du Cardiologue a été distinguée à deux reprises :
✔
L’article “Traitement endovasculaire des anévrysmes de
l’aorte : construction sur mesure des endoprothèses”,
de F. Koskas, a été sélectionné pour le Prix du meilleur article
de formation : revues de médecine spécialisée.
✔
Le numéro consacré au compte rendu de l’American Heart
Association (éditorial du Pr A. Vacheron) a été sélectionné
pour le Prix du meilleur compte rendu journalistique de
réunion scientifique.
Un grand bravo aux auteurs pour cette distinction.
Rendez-vous dans deux ans pour de nouveaux prix !
1
/
5
100%