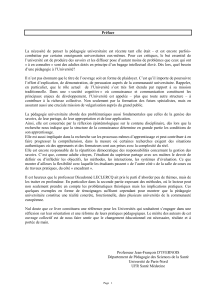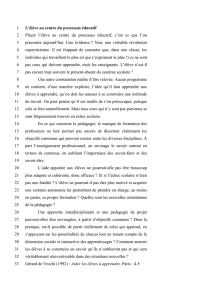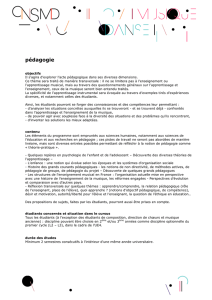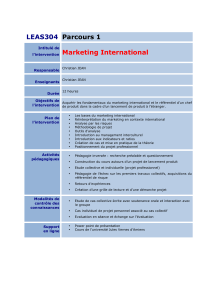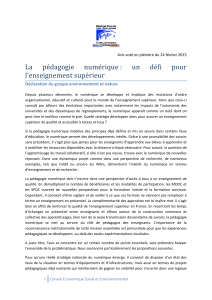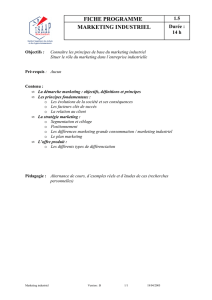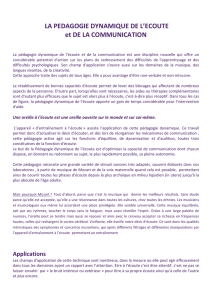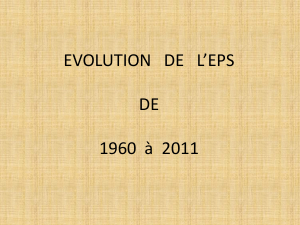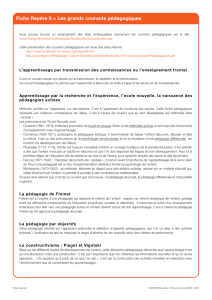reportage presse ecole

Le Couloir de l’info
Le Couloir de l’info
Édition du jeudi 25 février 2016
Pédagogie- Plan d’IENA
St Joseph de Boondael : Ce que les
enfants nous enseignent
La pédagogie alternative a
trouvé sa place au sein du
vaste paysage des
établissements scolaires
bruxellois. Se démarquant du
schéma traditionnel de
l’enseignement, cette « autre »
pédagogie a séduit l’école St
Joseph de Boondael, située à
Ixelles.
Au-delà du portail coloré de
l’école, on peut entendre le son
diffus des enfants qui jouent
dans la cour de récréation. Deux
panneaux se dressent de
chaque côté de la route, juste
devant l’établissement et sont
ornés de dessins enfantins, des
monstres, des Hommes et des
formes intraduisibles. Il est 8h30
et les parents se pressent pour
déposer leurs petits dans leurs
Horizons respectifs. Les
Horizons, à St Joseph de
Boondael, ce sont les différents
cycles en fonction de l’âge des
enfants. Dans la salle d’accueil
des 1res maternelles,
l’effervescence est palpable. Ce
matin on fête deux anniversaires
et les enfants sont surexcités. St
Joseph de Boondael est une
école à enseignement
fondamental ordinaire fondée
dans les années 1930.
Jusqu’aux années 1980, l’école
faisait partie du réseau
d’enseignement libre catholique
de quartier. Pour le directeur de
l’école, Marc Decastiau, les
racines chrétiennes de l’école
sont une fierté : « L’école a été
fondée par une congrégation de
sœurs avec une vocation sociale
très importante. Pour elles,
l’enseignement doit être à la fois
un ascenseur social et aussi un
lieu de mixité sociale ».
À partir des années 1980, le
directeur de l’époque commence
à organiser des concertations
entre les professeurs pour
repenser progressivement la
pédagogie au sein de
l’établissement. Selon Marc
Decastiau : « Sans l’impulsion
du directeur de l’époque, nous
n’aurions pas pu lancer une
initiative pédagogique
concrète ». Différentes directions
se succèdent alors jusqu’à
l’arrivée de Bernard Lacroix et
de son projet pédagogique créé
par le philosophe et pédagogue
allemand, Peter Petersen.
Le plan d’IENA
Une fois les parents partit, le
calme est partiellement revenu
dans l’espace des 1res
maternelles. Christophe,
l’instituteur en charge réunit les
enfants en cercle et se met à
leur raconter une histoire. Ce
moment de partage et de
discussion porte le nom de
« cercle » concept découlant de
la pédagogie du plan d’IENA de
Peter Petersen. Il s’agit de
rassembler les enfants pour
qu’ils s’expriment et s’écoutent
dans un souci de prise de
conscience communautaire.
Dans l’espace ou les enfants
sont rassemblés, des petites
affiches rappelant les règles de
vie sont affichées, sous forme de
dessin ou de texte, ce sont
parfois les enfants eux même
qui les réalisent. « On essaye de
leur faire prendre conscience
très tôt qu’ils évoluent ici dans
une communauté et qu’il y a des
règles. On veut qu’ils
apprennent à s’autoréguler. Je
suis un instituteur en charge,
mais en réalité, je suis plutôt un
éducateur », explique
Christophe. La pédagogie de
Peter Petersen est
pédocentrique, c’est-à-dire
qu’elle place l’enfant au centre
de son éducation, il est acteur
tout autant que les enseignants
et le reste du personnel de
l’école. Le pilier principal de
l’organisation scolaire devient
alors la communauté de vie,
comme l’explique Marc
Decastiau : « Ce qui fait la
spécificité de Petersen, c’est
d’abord le groupe. L’école est
constituée d’une communauté,
pas d’une société. Chacun a une
place qui n’est pas hiérarchisée,
une liberté existe dans le cadre
d’une loi établie par le groupe ».
Une organisation spécifique
Dans le bâtiment principal de
l’école, les différents Horizons
partagent des espaces semi-
ouverts ou les enfants peuvent
se déplacer avec une grande
liberté. Pas de murs entre les
différents groupes d’enfants,
seulement un couloir pour
passer d’une classe à une autre.
Les salles sont grandes, les
tables ne sont pas placées face
au tableau mais dispersées en
rectangle pour faciliter la
communication des enfants.
« On a dû abattre les murs »,
précise Marc Decastiau. Cela
donne une impression
intéressante de respiration, la
collaboration et l’autonomie sont
au centre de l’enseignement de
l’école, jusque dans son
architecture. Dans une des
salles, les 3emes primaires
débutent un exercice de
mathématique. Ici, pas de
professeur donnant un cours
théorique sur le tableau, les
enfants doivent effectuer un
atelier après une explication
assez brève de l’exercice. Par
groupes de deux, les enfants

Le Couloir de l’info
Le Couloir de l’info
Édition du jeudi 25 février 2016
vont résoudre des calculs en
utilisant des perles ou des
allumettes et inscrire les
résultats sur une feuille de route.
Dans la classe du niveau au-
dessus, les enfants réalisent un
travail individuel dans un profond
silence, le travail nécessite aussi
des temps calmes. Julie
Delepine, institutrice, explique :
« Il y a un équilibre entre des
travaux de groupe ou les enfants
peuvent interagir et
communiquer, et des travaux
individuels, des TIP où ils
doivent s’exercer d’eux même ».
À la fin de leur cycle primaire,
avant d’entrer dans le
secondaire, les enfants sont
évalués sur le chef d’œuvre, un
travail de fin d’études. « L’enfant
doit préparer un dossier écrit sur
un sujet, il doit aussi effectuer
une présentation orale devant
ses camarades », précise Marc
Decastiau. Un peu avant le
temps de midi, les enfants
participent à des ateliers jeux.
Divisées en trois groupes, des
activités ludiques leurs sont
proposé mais toujours dans un
souci d’apprentissage. Dans une
partie de la salle, un groupe joue
au pendu alors que de l’autre
côté, un autre fait des rébus ou
des charades. Quand sonne
l’heure de midi, les enfants
quittent les classes pour se
rendre au réfectoire.
Valeurs et limites
Ce qui fait la spécificité de
l’école St Joseph de Boondael,
c’est qu’elle n’est pas, au départ,
une école à pédagogie active.
La subtilité ici, c’est la
convergence entre les valeurs
religieuses et le projet
pédagogique de l’établissement.
« Peter Petersen évoluait dans
un milieu protestant, il n’y avait
pas pour lui de problème à mêler
l’enseignement avec la religion.
S’il décide de l’inclure, c’est que,
pour lui, l’intériorité,
l’émerveillement et l’éthique de
l’enfant doivent faire partie
intégrante de l’école », explique
Marc Decastiau. La religion a
donc sa place en tant qu’elle sert
d’appui à l’éducation des enfants
et à la pédagogie du plan
d’IENA. En aucun cas, l’aspect
religieux devient prépondérant,
la majorité des enfants ne sont
d’ailleurs pas de confession
catholique, l’école tient à garder
une mixité sociale et religieuse.
L’enseignement est gratuit,
comme dans n’importe quelle
école publique, les services
extra-scolaires, eux, sont
payants. Les repas ou les sorties
culturelles demandent donc un
investissement de la part des
familles. Les participations
demandées restent tout de
même correctes, pour une
semaine en classe verte par
exemple, il sera demandé entre
150 et 180 euros aux familles.
« Certaines écoles peuvent
cibler un public en proposant
des prix élevés, ce n’est pas le
cas à St Joseph de Boondael.
Ici, on essaye de trouver un
équilibre entre les familles
aisées et celles plus précaires »,
déclare Marc Decastiau. Le
problème que peut rencontrer un
enfant en suivant cette
pédagogie alternative se mesure
quand il entre à l’école
secondaire qui pratique un
enseignement traditionnel. Il
peut arriver qu’il parvienne
difficilement à s’adapter à ce
qu’on lui demande et ses
résultats peuvent baisser. Il
transparaît néanmoins que les
enfants parviennent en général à
poursuivre leur scolarité
normalement.
Le pacte d’excellence
Le 26 janvier 2015, la ministre
de l’éducation Joëlle Milquet à
lancé un projet sur la pédagogie
à l’école : le pacte d’excellence.
L’objectif est de repenser les
méthodes d’enseignement, de
soutenir les acteurs de la
pédagogie alternative pour palier
aux redoublements et au
manque de qualité de
l’enseignement. Pour Marc
Decastiau, c’est un projet
louable, mais qui arrive un peu
tard : « Le pacte d’excellence,
dans ses principes me convient.
Ce qui me dérange, c’est que
d’un côté il y a débat sociétal et
de l’autre il y a la marque d’une
ministre centralisatrice et
autoritaire. Je pense que ce sont
les petites structures locales qui
font changer les choses. » Vers
15h15, l’école se vide
doucement, les parents viennent
chercher leurs enfants. Quand
on parcourt le couloir qui longe
les classes vides, on peut
observer des dessins, des
réflexions sur les murs. Sur une
affiche, un élève a écrit un peu
naïvement : « Un pays sent
guerre, ça nexiste pas ? » Alors
on descend l’escalier pour
rejoindre le hall d’entrée, on
pousse la porte et soudain on
entend plus les rires des
enfants. On se souvient des
mots d’Antoine de St Exupéry :
« C’est fatiguant pour les enfants
de devoir toujours tout expliquer
aux adultes ».
Robin Poncelet

Le Couloir de l’info
Le Couloir de l’info
Édition du jeudi 25 février 2016
1
/
3
100%