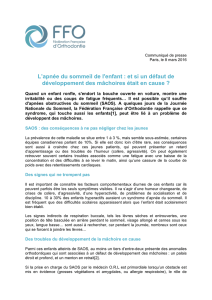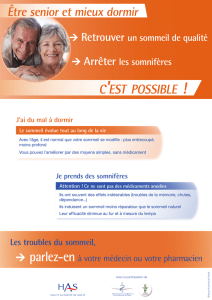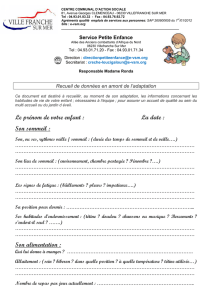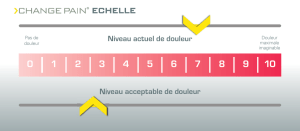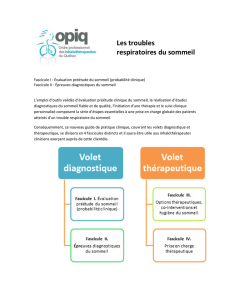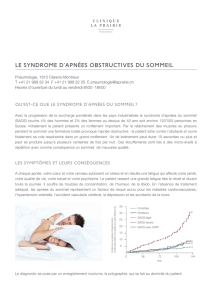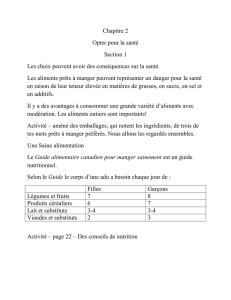Syndrome d’apnées obstructives du sommeil orientée vers la responsabilisation de l’automobiliste

La Lettre du Pneumologue - Vol. XI - n° 1 - janvier-février 2008
Chronique du droit
17
Chronique du droit
À
la suite de l’article publié par Michel Billiard dans
La Lettre du Pneumologue1 (département de neuro-
logie, hôpital Gu-de-Chauliac, Montpellier), il est
apparu clairement que l’attitude à adopter en ce qui concerne
le syndrôme d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) n’est
pas facile en termes de recommandations à prodiguer à un
malade donné, en particulier dans le domaine de la conduite
automobile.
Une réunion de travail a eu lieu sous la direction du rédacteur
en chef de La Lettre du Pneumologue, Philippe Godard, assisté
dans l’argumentation par Michel Billiard et Yves Dauvilliers.
L’objectif était d’expliquer la problématique à mesdames
Michèle Anahory et Marie-Ève Banq, avocates (Landwell), et
de tenter de dégager des conseils pratiques.
Nous rapportons ci-dessous leur synthèse. En effet, la question
de la reprise de la conduite ou, au contraire, de la prolongation
de l’incompatibilité est réglée de façon tout à fait insatisfai-
sante par “le test électro-encéphalographique de maintien de
l’éveil” dans l’arrêté du 21 décembre 2005.
La Société de pneumologie de langues française (SPLF)
travaille actuellement à la rédaction de recommandations
pour la pratique : ce thème sera abordé et des propositions
concrètes seront faites.
Le gouvernement a manifesté son intérêt pour le sommeil des
Français, en publiant, en janvier 2007, un Programme d’ac-
tions sur le sommeil2 qui a pour but de “faire du sommeil un
sujet de santé publique à part entière”.
Il souhaite à ce titre faciliter le dépistage, le diagnostic et le
traitement des troubles du sommeil à travers un parcours de
soins cohérent organisé autour des compétences des méde-
cins généralistes et spécialisés.
C’est dans ce contexte que s’inscrit la réflexion menée par des
médecins spécialistes et des juristes concernant les incidences
des troubles du sommeil – au rang desquels figure le syndrome
d’apnées obstructives du sommeil – sur le risque d’accident.
Syndrome d’apnées obstructives du sommeil
chez l’automobiliste : les carences d’une réglementation
orientée vers la responsabilisation de l’automobiliste
IP M. Anahory, M.E. Banq
Il faut en effet favoriser le dialogue entre pouvoirs publics et
professionnels de santé spécialisés dans le sommeil quant à la
réglementation actuelle du permis de conduire.
La place du médecin dans la délivrance ou le maintien du
permis de conduire est fondamentale, mais les moyens dont il
dispose en matière de prévention des risques dans le cadre de
la sécurité routière sont particulièrement limités.
TOUR D’HORIZON DE LA RÉGLEMENTATION
DU PERMIS DE CONDUIRE
Les dispositions applicables en France résultent de la trans-
position de dispositions communautaires. Le SAOS y est
envisagé en tant qu’affection incompatible avec le permis de
conduire.
La réglementation européenne
Le texte de référence en matière de réglementation du permis
de conduire est la directive européenne n° 91/439/CEE
du 29 juillet 1991 modifiée par la directive n° 2000/56/CE
du 14 septembre 2000.
Elle pose le principe suivant :
“En règle générale, le permis de conduire ne doit être ni
délivré, ni renouvelé à tout candidat atteint d’une affection […]
susceptible de constituer ou d’entraîner une incapacité fonc-
tionnelle de nature à compromettre la sécurité routière lors
de la conduite d’un véhicule à moteur, sauf si la demande est
appuyée par un avis médical autorisé et sous réserve, si besoin
est, d’un contrôle médical régulier.”
Cette directive comporte une annexe qui liste une série d’af-
fections non compatibles avec le permis de conduire.
Il n’y a aucune mention de somnolence, de SAOS, ou de narco-
lepsie dans cette directive européenne.
En revanche, certains pays membres de l’Union européenne
ont pris des mesures spécifiques concernant ces pathologies.
Tel est le cas de la France, de l’Espagne, de la Belgique, du
Luxembourg, des Pays-Bas et de la Finlande.
La réglementation française
Un arrêté du 7 mai 1997 a introduit les dispositions commu-
nautaires dans le droit français. Il visait notamment le SAOS
1. M. Billiard. Aspects thérapeutiques du syndrome d’apnées-hypopnées obstructives
du sommeil (SAHOS) de l’adulte. La Lettre du Pneumologue 2006;6:225-9.
2. Programme d’actions sur le sommeil, Xavier Bertrand, ancien ministre de la Santé
et des Solidarités, discours et dossier de presse, janvier 2007.
LPN-1-2008.indd 17 19/02/08 10:06:46

La Lettre du Pneumologue - Vol. XI - n° 1 - janvier-février 2008
Chronique du droit
Chronique du droit
18
et indiquait qu’il était “en principe une contre-indication à la
conduite de tout véhicule”.
Ce texte a été abrogé et remplacé par un arrêté du 21 décembre
2005.
Désormais, ce sont les troubles du sommeil, au titre desquels
figure le SAOS, qui sont visés dans la liste fixant les affec-
tions médicales incompatibles avec l’obtention du permis de
conduire3, car ils peuvent “exposer un candidat ou conducteur,
à la délivrance ou au renouvellement d’un permis de conduire,
à une défaillance d’ordre neurologique ou psychiatrique de
nature à provoquer une altération subite des fonctions céré-
brales [et] constituent un danger pour la sécurité routière”.
Le texte ne vise plus des pathologies qui sont “en principe
une contre-indication à la conduite” mais des affections
“incompatibles avec le permis de conduire”.
Un arrêté du 8 février 1999 précise les conditions de délivrance
et de validité du permis de conduire.
Il pose le principe selon lequel, au moment de la demande de
permis de conduire, le candidat s’engage à déclarer “sur l’hon-
neur” qu’il n’est pas atteint d’une infirmité ou d’une pathologie
susceptible d’être incompatible avec l’obtention ou le maintien
du permis de conduire.
Il désigne ensuite les personnes pour lesquelles la réalisation
d’un examen médical est obligatoire.
Il s’agit essentiellement des conducteurs professionnels, des
personnes handicapées, des personnes souffrant de défi-
ciences physiques ou de celles qui ont fait l’objet de mesures
particulières et susceptibles d’encourir à ce titre une interdic-
tion de solliciter le permis de conduire.
L’arrêté ne fait pas de l’examen médical une condition géné-
rale préalable à l’obtention ou au renouvellement du permis
de conduire.
Par ailleurs, il reste silencieux sur l’hypothèse des personnes
qui développent une affection incompatible avec le permis de
conduire après obtention de ce dernier.
LE RÔLE DU MÉDECIN DANS LA DÉLIVRANCE
DU PERMIS DE CONDUIRE
Pour les personnes dont l’obtention ou le maintien du permis
de conduire est subordonné à un avis médical, les examens
sont réalisés par une commission constituée à cet effet.
Lorsqu’elle le juge utile, la commission peut faire appel à un
médecin spécialiste.
L’examen par la commission médicale primaire
départementale
Lorsqu’un examen médical doit être réalisé, ce sont les méde-
cins des commissions médicales primaires départementales
agréées par le préfet qui sont compétentes.
Avant chaque examen médical, le candidat au permis ou le
conducteur remplit une déclaration décrivant loyalement ses
antécédents médicaux, une éventuelle pathologie en cours et
les traitements pris régulièrement.
Les commissions médicales primaires, lorsqu’elles le jugent
utile, peuvent saisir une commission médicale d’appel composée
de médecins spécialistes.
Occasionnellement, dans les cas difficiles, un test pourra être
effectué par une école de conduite, sur proposition des méde-
cins siégeant en commission médicale départementale.
Une concertation pourra être diligentée, préalablement à la
formulation d’un avis, entre la commission médicale et les
personnes autorisées à enseigner la conduite automobile qui
auront pratiqué le test.
Cette concertation se fera dans le respect des lois et règle-
ments relatifs au secret professionnel et médical.
La décision finale est laissée, en toute hypothèse, à l’apprécia-
tion de la commission médicale.
En effet, les médecins de ces commissions émettent des avis
à l’intention du préfet, qui valide ou non la proposition relative aux
circonstances de délivrance ou de refus du permis de conduire.
Il est à noter que, depuis peu, les médecins généralistes
peuvent également, dans leur cabinet, valider l’aptitude à la
conduite, sous réserve d’avoir effectué un stage de sécurité et
d’avoir été agréés par le préfet.
L’examen médical par le médecin spécialiste
Lorsque le type d’affection le justifie, il est prévu que les méde-
cins des commissions puissent faire appel à des médecins
spécialistes.
En l’espèce, concernant les troubles du sommeil, l’arrêté
du 21 décembre 2005 précise que la reprise de la conduite
pourra avoir lieu un mois après l’évaluation de l’efficacité
thérapeutique, et ajoute que cette reprise sera proposée
à l’issue du bilan spécialisé.
À ce sujet, Michel Billiard insiste sur la nécessité que le bilan
clinique et paraclinique soit réalisé par un pneumologue, un
neurologue, un psychiatre ou autre spécialisé en médecine du
sommeil. Or, le nombre d’établissements ayant à sa disposi-
tion des médecins répondant à ces critères est encore limité
et la réalisation d’un bilan spécialisé dans le délai d’un mois
prévu par l’arrêté n’apparaît pas réaliste en raison notamment
des délais liés à la prise de rendez-vous avec le médecin spécia-
liste, et à la réalisation des examens ainsi qu’à leur analyse.
La procédure prévue n’est donc pas compatible avec le fonc-
tionnement réel des services spécialisés dans la prise en charge
diagnostique et le traitement des troubles du sommeil.
Plus en amont, cette réglementation interroge sur les consé-
quences de l’apparition de troubles du sommeil chez une
personne déjà titulaire du permis de conduire.
En effet, si certaines catégories de personnes comme les conduc-
teurs professionnels (poids lourds, transports en commun, etc.)
sont soumises à des contrôles médicaux réguliers pour le main-
tien de leur permis de conduire, ce n’est pas le cas de celles qui
détiennent un permis moto, voiture ou véhicule utilitaire.
3. Arrêté du 21 décembre 2005. Annexe classe IV “Pratiques addictives – Neurologie
– Psychiatrie”.
LPN-1-2008.indd 18 19/02/08 10:06:47

La Lettre du Pneumologue - Vol. XI - n° 1 - janvier-février 2008
Chronique du droit
19
Chronique du droit
En d’autres termes, à la lecture de la réglementation, si l’évo-
lution de la personne est telle que les critères d’aptitude au
permis sont remis en cause, la personne doit spontanément
cesser de conduire et se présenter à l’examen médical du
permis de conduire.
Encore faut-il que la personne en question prenne conscience
de son état de somnolence diurne excessive – ce qui peut
prendre des années, en particulier dans le cas du SAOS au
cours duquel l’installation de la symptomatologie est très
progressive – ou qu’un médecin suspecte le diagnostic devant
l’habitus d’un malade le consultant pour un autre motif.
Dans son application, cette solution est donc complexe, ce
d’autant que la difficulté majeure n’est pas tellement celle de
l’identification de l’affection causale, qui peut très bien se faire
même si la personne ne se plaint que d’un seul symptôme,
mais davantage celle de la compréhension par la personne de
son état de santé.
Dans ce contexte se pose donc la question de l’identification du
moment à partir duquel on peut considérer qu’une personne
est atteinte d’une affection justifiant l’examen médical prévu
pour l’obtention ou le renouvellement du permis de conduire.
Dans l’hypothèse où la personne s’entretient de ses troubles
avec son médecin traitant ou un médecin spécialiste, quel sera
donc le rôle de ce professionnel conscient du danger ?
LES MOYENS LIMITÉS DE LA PRÉVENTION
DES RISQUES PAR LES MÉDECINS
Si le caractère absolu du secret médical s’oppose à ce que le
médecin divulgue à des tiers des informations relatives à ses
patients, sa mission lui impose toutefois de s’assurer que ces
derniers sont informés des risques encourus et des moyens de
les prévenir.
L’impossibilité pour le médecin de révéler
des informations concernant le patient
Dans la mesure où la réglementation du permis de conduire est
silencieuse sur le rôle du médecin informé de l’affection d’un
patient incompatible avec le maintien du permis de conduire,
la question se pose de savoir dans quelle mesure il pourra ou
devra agir dans un but de prévention des risques.
En effet, est-il possible pour le médecin spécialiste assurant
la prise en charge d’un patient de signaler à la commission
primaire médicale ou à une autorité administrative le cas d’un
patient dont l’affection est susceptible d’être incompatible
avec la conduite ?
En premier lieu, il faut rappeler que l’article R. 4127-4 du
Code de la santé publique (article 4 du Code de déontologie
médicale) prévoit que le secret professionnel institué dans l’in-
térêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions
établies par la loi.
Sur ce fondement, sauf à démontrer qu’il existe une déroga-
tion légale au secret professionnel, la réglementation s’oppose
à toute transmission d’informations à des tiers. À défaut, le
médecin s’expose à une sanction disciplinaire, voire pénale
(article 226-13 du Code pénal).
Même sur le fondement de l’obligation de porter secours, qui
peut, en tant que telle, justifier la violation du secret profes-
sionnel (article 223-6 du Code pénal), le médecin ne pourrait
divulguer de telles informations à une autorité administrative
ou judiciaire.
En effet, pour pouvoir informer un tiers des risques liés à la
conduite par un patient souffrant de SAOS, il faudrait un péril
imminent et constant nécessitant une action immédiate, soudaine,
imprévue et imprévisible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De même, le médecin ne pourra, sur le fondement de l’article
434-1 du Code pénal, porter à la connaissance des autorités
administratives ou judiciaires des informations relatives à son
patient souffrant du SAOS.
Là encore, alors que cet article justifie une atteinte au secret
professionnel lorsqu’une personne a connaissance d’un crime
dont elle peut prévenir ou limiter les effets, en matière de
circulation routière, les infractions susceptibles de résulter
d’un accident de la route ne relèvent pas de la catégorie des
crimes mais de celle des délits.
La dérogation au secret professionnel n’est donc pas envisa-
geable dans ce cas non plus.
Toutefois, si le médecin ne peut divulguer des informations
relatives au patient il a, à son égard, une mission d’information
et de conseil fondamentale.
L’obligation pour le médecin d’informer son patient
des risques encourus
Conformément à l’article L. 1111-2 du Code de la santé
publique, l’information donnée au patient est très large. Elle
porte “sur les différentes investigations, traitements ou actions
de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence
éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves
normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les
autres solutions possibles et sur les conséquences prévisi-
bles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution
des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit
en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver”.
Le législateur ajoute au dernier alinéa de cet article que :
“En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établis-
sement de santé d’apporter la preuve que l’information a été
délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent
article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen”.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins précise que, dans
le cadre de ses activités, le médecin est tenu de dépister toute
maladie ou conduite addictive, d’informer et de conseiller son
patient et de signaler sur l’ordonnance tout médicament qui
pourrait avoir un effet nocif sur la conduite automobile.
En l’espèce, le médecin devra donc informer le patient des
risques entraînés par le SAOS, des effets des traitements
médicamenteux, des risques encourus lors de la conduite ou,
comme le rappelle l’Ordre des médecins, des contre-indica-
tions à la conduite.
LPN-1-2008.indd 19 19/02/08 10:06:47

La Lettre du Pneumologue - Vol. XI - n° 1 - janvier-février 2008
Chronique du droit
Chronique du droit
20
Le cas échéant, il devra apporter la preuve de cette informa-
tion. Cette preuve pourra résulter d’un écrit, moyen de preuve
par excellence.
La prescription du médecin, qui sera conservée au dossier
médical, peut constituer cette preuve.
Le Conseil national de l’Ordre des médecins attire d’ailleurs
l’attention des praticiens sur l’importance, pour ces derniers,
de conserver une copie de leurs consignes pour se réserver la
preuve de leurs prescriptions4.
Il met par ailleurs l’accent sur l’implication des médecins
dans les contre-indications médicales à la conduite, aux côtés
des commissions médicales spécialisées évoquées précé-
demment5.
L’information donnée au patient peut aussi avoir comme support
un document de présentation des effets d’une pathologie ou des
effets indésirables d’un médicament remis au patient.
Afin d’encadrer au mieux sa responsabilité, le médecin spécia-
liste peut donc décider d’élaborer ce type de document d’in-
formation visant à sensibiliser le patient sur les risques liés à la
conduite et sur sa responsabilité en la matière.
Le médecin peut le faire en collaboration avec l’ordre départe-
mental auquel il appartient ou avec les professionnels de l’éta-
blissement de santé au sein duquel il exerce son activité.
Les derniers rapports remis au gouvernement (rapport
du Dr Jean-Pierre Giordanela, juillet 2006, et rapport du
groupe de travail relatif aux contre-indications médicales à la
conduite automobile, juin 2003), comme les lignes directrices
du Programme d’actions sur le sommeil du 29 janvier 2007,
constituent une base de documentation utile à l’élaboration de
ce type de document.
Enfin, il apparaît extrêmement opportun que le médecin
concerné informe le patient de l’existence de la commission
médicale primaire départementale et de ses compétences en
matière de délivrance et de maintien du permis de conduire.
La difficulté réside en l’espèce dans les effets de cette infor-
mation.
Par conséquent, si le médecin ne peut déroger au secret
professionnel, dans le cadre de ses missions, il doit s’em-
ployer à :
– dépister les maladies qui pourraient avoir un effet nocif
sur la conduite ;
– informer le patient des risques et contre-indications liés
à la pathologie, notamment concernant la conduite ;
4. Bulletin de l’Ordre, janvier 2005.
5. Le Quotidien du Médecin, 17 janvier 2006.
– conseiller au patient, le cas échéant, de contacter la
commission médicale primaire départementale compé-
tente.
CONCLUSION
Hormis les personnes pour lesquelles un examen médical est
rendu obligatoire par leur profession, un handicap ou d’éven-
tuelles incompatibilités avec la conduite, la réglementation
française favorise la responsabilisation des conducteurs.
En d’autres termes, l’aptitude à la conduite ne fait pas l’objet
d’un contrôle médical systématique.
La difficulté réside donc dans le silence des textes sur les consé-
quences de l’apparition ou de l’aggravation de troubles du
sommeil chez une personne titulaire du permis de conduire.
Médecins et juristes doivent se concerter pour déterminer
ensemble les voies d’action qui permettront de rechercher une
manière efficace de concilier la sécurité routière et la liberté
individuelle qui reste fondamentale.
On sait que les assureurs refusent leur garantie s’il s’avère que
au moment de l’accident, l’assuré souffrait d’une pathologie
incompatible avec le maintien du permis de conduire.
Par ailleurs, le préfet peut également être amené à demander
un examen médical dans le cas où des informations en sa
possession lui permettent d’estimer que l’état physique du
titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien du
permis.
Néanmoins, ce ne sont pas des réponses suffisantes pour le
médecin informé d’un danger lié à la pathologie d’un patient.
À l’inverse, le signalement systématique en raison d’une prise
en charge médicale dans un service spécialisé dans les trou-
bles du sommeil ne peut être envisagé, notamment parce qu’il
nuirait à la relation de confiance existant entre le médecin et
son patient.
Le débat est ouvert. Il doit porter sur les moyens de garantir
que le patient souffrant d’affections incompatibles avec le
maintien du permis de conduire prendra les décisions néces-
saires à la prévention du danger lié à la conduite.
N’est-ce pas l’occasion de saisir de cette question le nouveau
Comité de suivi du Programme d’actions sur le sommeil récem-
ment créé dans le cadre du plan d’action de janvier 2007 ?
En tout état de cause, des travaux destinés à proposer une
révision des dispositions européennes sont en cours, ce qui
laisse penser que des adaptations de la législation interne
seront à prévoir.
Affaire à suivre… ■
LPN-1-2008.indd 20 19/02/08 10:06:48
1
/
4
100%