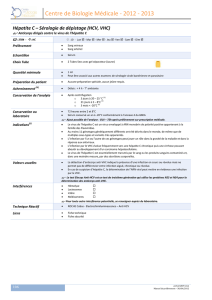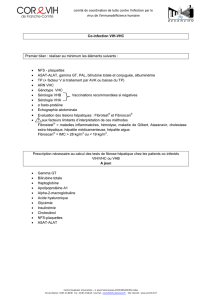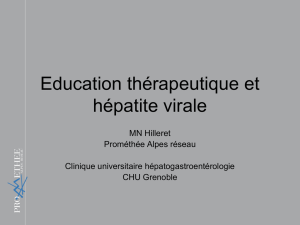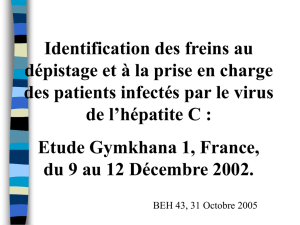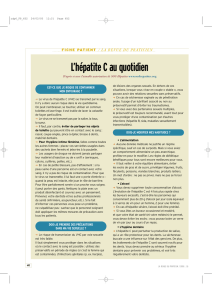Lire l'article complet

96
Le Courrier des addictions (7), n° 3, juillet-août-septembre 2005
La représentation de l’hépatite C qu’ont les
usagers de drogues est double : celle de la
maladie, celle de la contamination. Les
deux sont évolutives, tant chez les usagers
que chez les professionnels. Cette évolu-
tion est impossible à comprendre sans
retracer un historique de la rencontre entre
les virus et les drogues : en quatre temps.
1970-1984 : l’avatar
Le problème somatique viral des usagers
est, à cette époque, l’hépatite B (VHB). On
en parle comme de “la jaunisse, une grosse
fatigue”. On se dit qu’il faut alors faire
attention à l’échange de seringues (“Si ton
pote est jaune, t’échange pas”), le mode de
contamination est donc connu. La repré-
sentation de la maladie est celle d’un avatar
banal, normal, fréquent dans la vie d’un
usager : “Dans la vie d’un toxico, il y a
l’abcès, la prison, les plans qui foirent et la
jaunisse.” Bref une maladie qui n’est pas
vécue comme grave.
Ajoutons qu’à cette période, le VHC (virus
de l’hépatite C) n’est pas isolé : il fait par-
tie des hépatites “non A non B”. Notons
aussi, et surtout, que ce problème d’hépati-
te B va participer à la mise en place des
stratégies de réduction des risques et des
dommages (RDR, RDD) dans certains pays
anglo-saxons, et ce avant l’émergence du
VIH qui ouvre la deuxième période.
1984-1990 : le tremblement
de terre du VIH
Le problème somatique viral des usagers
devient le VIH (virus de l’immunodéficience
humaine). C’est le tremblement de terre
d’une maladie qui est alors sans traitement,
sauf pour les affections opportunistes. Un
tremblement de terre chez les profession-
nels et les usagers avec l’apparition pro-
gressive et tardive de la stratégie de réduc-
tion des dommages ainsi que les question-
nements sur la substitution (début des pra-
tiques de substitution sans les molécules
adaptées, sans tenir compte des bases théo-
riques de Dole et Nyswander...).
La contamination est connue : le sang et le
sexe sont en première ligne, même si
quelques fantasmes (la salive, le toucher,
les moustiques…) viennent obscurcir le
message. Parllèlement, l’accès aux seringues
est gêné par le retard législatif français (mai
1987), l’absence de matériel adéquat (le
Stéribox®est à inventer) et l’idée que les
usagers sont incapables de prévention
(l’avenir prouvera le contraire). Pour les
usagers en effet, comme avec le VHB, la
représentation de la contamination est clai-
re, la protection c’est “pas d’échange de
seringue” et le “safer sexe”.
1990-1996 : le VHC a un nom,
mais pas de traitement
Le VHC est dépistable fin 1989. À ce
moment là, le VHC n’apparaît pas comme
un problème majeur : il “bénéficie” des
représentations des virus précédents.
Par rapport au VIH, le VHC n’est pas vécu
comme une maladie grave (“j’ai rien, j’ai
chopé que l’hépatite C”), discours volon-
tiers renforcé par les professionnels.
Par rapport au VHB, le VHC est aussi une
hépatite (vécue comme banale, c’est
“l’avatar” déjà décrit ci-dessus) et en plus
une hépatite “légère”, sans symptômes (pas
de jaunisse : “j’ai même pas senti que je
l’avais eue”).
Enfin, c’est également à l’époque une
maladie peu intéressante, car sans traite-
ment, donc avec une proposition de dépis-
tage peu insistante, par ailleurs étouffée par
le poids des communications sur le VIH,
les progrès de sa thérapeutique et les nou-
veaux examens biologiques.
Quant à la contamination, la compréhension
en est complexe. Pour le VIH, la conduite de
risque est repérée, la modification des pra-
tiques provoque une baisse de la contamina-
tion. Mais cette modification des pratiques
ne provoque pas de baisse de la contamina-
tion par le VHC pour laquelle on ne repère
pas de pratiques dangereuses donc de com-
portements à modifier. La représentation de
la contamination par le VHC reste ainsi obs-
cure, très éloignée du modèle médical du
virus. Ingold parle d’une assimilation aux
miasmes, à la poussière, la saleté. Ce vécu
“d’avatar” de la vie d’un toxicomane est
doublement renforcé. D’une part par le fait
que, si on peut à présent dépister le VHC,
une positivité peut provenir d’une contami-
nation fort ancienne dans l’histoire du
patient. D’autre part parce que la positivité
ne distingue pas encore une guérison spon-
tanée d’un portage chronique.
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
Hépatite C : évolution des représentations
et aspects psychiatriques
L. Gibier *
La représentation de l’hépatite C est double : celle de la maladie
et celle de la contamination. Ces représentations sont évolutives
dans le temps, liées à l’histoire récente des virus qui ont touché
les usagers de drogues. Les modes de contamination ont
longtemps été difficiles à comprendre par ce public et toute
occasion est bonne pour l’expliquer.
La maladie, traitée ou non, comprend des complications
psychiatriques trop souvent réduites à la dépression, ne tenant pas
compte des autres, des interactions personnalité-maladie-
traitement, et surtout des processus adaptatifs qui se mettent en
place face à toute maladie chronique. Il est nécessaire
d’éclairer le sujet afin de limiter les contre-indications et de
favoriser les suivis.
*Psychiatre, praticien hospitalier, CHRU de
Tours.

97
Ce sera à l’époque (et encore maintenant !)
une priorité que de lever les incertitudes
entourant la contamination par le VHC,
tant chez les usagers que chez les acteurs de
terrain. Il faut attirer l’attention sur les
risques de contamination par tout le matériel
d’injection (pas seulement les seringues
mais aussi la cuillère, les cotons et, dans un
autre registre, l’eau, le citron) ainsi que les
pailles de sniffing, le tatouage, et les pos-
sibles recontaminations (risque encore
souvent ignoré).
De 1996 à nos jours : une
maladie grave avec traitement
efficace mais dur à vivre
L’évolution porte sur la représentation de la
maladie qui, avec l’apparition progressive
des premiers cas d’hépatites chroniques, de
cirrhoses, de cancers, devient soudaine-
ment très inquiétante, d’autant que ces pro-
blèmes touchent des usagers en train de se
stabiliser. Les nouvelles vont vite dans le
groupe identitaire (“Je suis tox, je suis
méthadonien, je suis ex.”) qui découvre la
chronicité et ces symptômes, les décès... Le
virage est important, le vécu de la maladie
change, les traitements sont questionnés.
Durant cette période, la maladie liée au
VHC est passée successivement du “statut”
de maladie passant inaperçue, sans consé-
quence, puis comme pouvant être grave tar-
divement, puis grave et sans traitement,
grave avec traitement inefficace, enfin
grave avec traitement efficace mais épui-
sant, dur à vivre (on entend “j’ai fait le
traitement” comme “j’ai fait Fleury
Mérogis !”)
Au cours de ces évolutions, apparaît un
vocabulaire qu’il faut également appréhen-
der, comprendre, à travers moult fantasmes
et peurs.
La PBH (ponction biopsie hépatique),
voilà du vocabulaire entre les mots et les
maux ! Intensément fantasmée, elle a une
représentation particulièrement théâtrali-
sée, allant de l’intrusion faramineuse dans
le corps à un geste totalement indolore ! Le
groupe est dans l’attente qu’un de ses
membres vive l’examen et le lui raconte.
L’ARN viral (la PCR) est un terme souvent
mal compris, surtout s’il existe une certaine
anxiété dans l’attente des résultats, d’autant
qu’il ne faut pas se calquer sur le VIH
(séropositivité, charge virale). Et que les
explications prêtent à confusion ! Qu’est ce
qu’un bilan positif ? Une sérologie négative ?
Une sérologie positive avec un ARN viral
négatif ? Sûrement pas une sérologie posi-
tive avec un ARN viral positif ? Un bilan
positif, c’est bien ou c’est mal ? Et la conta-
giosité, est-elle marquée par la sérologie
positive ou par l’ARN viral positif ? Et
pour la ou le conjoint(e), peut-on accepter :
“On couche ensemble, on peut bien sniffer
ensemble (non !) ?”
Les moments sensibles
de la maladie
Par rapport à l’énorme bibliographie sur le
VIH, il y a bien peu de travaux sur le VHC,
sauf de façon très récente, et plutôt sur les
complications psychiatriques du traite-
ment. Nous distinguerons les moments sen-
sibles et le vécu de la maladie proprement
dits.
Les moments sensibles décrits avec le VIH,
moments douloureux, déstabilisants psy-
chiquement, ne sont guère retrouvés dans le
cadre du VHC.
Ainsi la demande de test VIH et l’attente
du résultat provoquent une forte anxiété ;
cela n’est pas retrouvé pour le VHC.
Clairement, l’usager qui déboule en
consultation et dit : “J’ai fait une connerie,
je veux un test” pense bien plus au VIH
qu’au VHC. De plus, chez les anciens usa-
gers, pendant longtemps il y avait peu de
demande de test (ils pensaient l’avoir
même s’ils n’avaient pas eu de bilan).
De même, les réactions à l’annonce du
diagnostic VIH, maladie au pronostic
incertain et fortement stigmatisée, com-
prennent les classiques phases successives
décrites dans les maladies sévères par
Kubler-Ross : phase de choc, de déni, de
transition (avec culpabilité, colère, agressi-
vité, repli sur soi, refus d’aide), d’accepta-
tion, voire de préparation à la mort. Pour le
VHC, le choc émotionnel est rare. On
assiste cependant à un retour sur le passé.
Ainsi, pour le transfusé, il y a retour sur
l’incident, l’accident responsable avec un
sentiment d’injustice, un moment repéré
pendant lequel la vie bascule. Chez l’ex-
usager, le sentiment d’injustice existe éga-
lement, l’impression de “payer la note” au
moment où il est en train de s’en sortir.
Quant à l’usager actif, il présente peu de
réaction en cas d’annonce de diagnostic.
En revanche, d’autres éléments sont à sou-
ligner, d’autres moments sensibles existent
avec le VHC. La PBH en est un, nous
l’avons déjà évoquée.
Les bilans sont aussi des moments difficiles,
chez certains patients peu “piquables”, d’au-
tant que les prélèvements sont fréquents et
nécessaires aux suivis et ajustements théra-
peutiques. Il faut savoir s’entourer de spécia-
listes permettant de faciliter les choses (anes-
thésiste, etc.) sinon gare aux conduites d’évi-
tement et aux rendez- vous manqués.
L’entrée en traitement objective la maladie,
pour soi et pour l’entourage, ce qui était éga-
lement décrit avec la VIH (dans ce cas, l’ob-
jectivisation pouvant s’accompagner d’un
vécu de stigmatisation). Cela est d’autant plus
vrai que le patient présente peu de symptômes
de sa pathologie et qu’il va en avoir beaucoup
avec le traitement ! Il est, là aussi, capital de
préparer la venue de ces symptômes pour
mieux les accompagner et éviter les arrêts de
traitement. Il est classique de s’inquiéter de
relancer une perte de contrôle de l’injectable à
cause de l’interféron parentéral, mais le stylo
est fort différent de la seringue et on peut
réfléchir à l’intervention d’un infirmier.
Rappeler la notion de distorsion cognitive qui
ferait confondre les frissons du syndrome
pseudo grippal et ceux du manque est égale-
ment classique (ne pas toucher à la substitu-
tion ou accepter de la monter pour peu que le
patient prenne son traitement !)
La qualité de vie est ainsi un élément capi-
tal de cet accompagnement. C’est là où être
écouté et entendu conditionne le maintien
en traitement. “Devenir un foie”, c’est ne
pas être entendu ; se résumer à un bilan,
c’est ne pas être entendu (par exemple, le
bilan est bon, mais la fatigue persiste tou-
jours). Les résultats des bilans peuvent
aussi faire l’objet d’une véritable fétichisa-
tion des chiffres, mécanisme de défense
qu’il faut savoir ne pas entretenir si ce
mécanisme empêchait le patient de se
livrer, ne serait-ce qu’un minimum. Les
échelles de qualité de vie sont la preuve de
l’intérêt grandissant pour cet aspect du
couple “maladie-thérapeutique”. La qualité
de vie concerne aussi les répercussions sur
les relations avec le conjoint, la famille, les
collègues de travail. Proposer des entre-
tiens au patient avec son entourage, même
avant l’entrée en traitement est une straté-
gie qui participe également à la compliance.
Insistons sur la femme, traitée ou conjointe
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t

de patient traité, en particulier sur les
aspects de la sexualité, de la fécondation,
du désir d’enfant, impossible dans la durée
avec la ribavirine, à un moment où il est
quelquefois question de mettre en place ce
projet de couple.
Vivre avec l’hépatite C :
la difficile adaptation
Les symptômes les plus fréquents sont les
troubles de l’humeur, l’asthénie, les cépha-
lées, les troubles sexuels. Mais il n’y a pas
que ces symptômes, car l’organisation même
de la vie psychique est modifiée par la mala-
die : la santé permet de se décentrer de soi-
même et d’investir les objets extérieurs. La
perte de la santé concentre sur son corps et
ravive les angoisses de mort et de séparation.
On note ainsi une obnubilation par son
propre corps, une hypochondrie sentinelle,
une anesthésie affective protectrice. Le
risque est de désinvestir l’extérieur, la vie
affective, familiale, sociale, intellectuelle.
Existe également le sentiment de ne plus
être seul dans son corps : une vie à deux
avec un processus interne évolutif inconnu,
non maîtrisable qui prive de toute anticipa-
tion possible.
Il faut apprendre à vivre avec un corps
malade, un narcissisme mutilé (en particu-
lier la fatigue). Cela est d’autant plus
acceptable et métabolisable que ces troubles
sont en partie liés à un traitement qui a une
fin programmée (6 mois, 12 mois), avec une
guérison annoncée (mais…) !
Il s’agit donc de passer ce cap, d’aider à pas-
ser ce cap, car ces processus ne sont pas
pathologiques. C’est un processus d’adapta-
tion : retrouver un équilibre psychique avec
des réactions temporaires à respecter et à
accompagner, plus qu’à “psychotropiser”
dans l’instant (comme la différence entre tra-
vail de deuil à respecter et dépression à trai-
ter). La nécessité d’un soutien psychologique
est donc importante. Plus que purement psy-
chiatrique, un travail psychopédagogique
mené par des infirmiers formés spécifique-
ment, par un psychologue est nécessaire.
Les complications psychiatriques :
variées, difficiles à prévoir
La causalité n’en est pas univoque entre le
virus lui-même, le traitement (en particu-
lier l’interféron alpha), la personnalité sous
jacente du patient qui peut décompenser.
Même les conséquences somatiques du
virus et des traitements peuvent participer
aux troubles (par exemple, une anémie liée
à la ribavirine accentue la fatigue, ce qui
aggrave le sentiment d’inutilité, ce qui par-
ticipe à l’instauration d’une dépression.
Autre exemple : une hypothyroïdie auto-
immune). Et n’oublions pas que les traite-
ments prescrits, en particulier les psycho-
tropes, peuvent eux-mêmes avoir des
conséquences psychiatriques (un antidé-
presseur trop facilement prescrit sur un état
mixte peut faciliter l’émergence d’un accès
maniaque dans le cadre d’un trouble bipo-
laire !). Enfin rappelons que les substances
psychoactives utilisées par les usagers ont,
elles aussi, la capacité de favoriser certains
troubles psychiatriques.
Les complications psychiatriques en elles
mêmes sont variées. Ce n’est pas l’objectif
de cette article de les détailler, mais plutôt
de les mettre en perspective dans un
contexte plus large et de questionner la per-
tinence des contre-indications au traitement
touchant trop facilement les patients addic-
tifs. Ces troubles sont individuels, indépen-
dants des antécédents psychiatriques, et
donc difficiles à prévoir. On décrit donc
des troubles anxiodépressifs, “dose dépen-
dants”, volontiers atypiques quant à la
symptomatologie, quelquefois intégrés à
des états mixtes. Les accès maniaques sont
également présents dans la littérature sur le
sujet. Les troubles anxieux sont moins
connus des non-spécialistes de la question
et pourtant on décrit des recrudescences de
manifestations phobiques, de troubles
obsessionnels compulsifs, de crises d’an-
goisse ou d’anxiété généralisée. Il existerait
enfin des possibilités de délires, sans plus
de précision.
Il n’y a donc pas que la dépression. De
plus, ce diagnostic est-il fait sur les mêmes
critères par un généraliste, un hépatologue,
un psychiatre ? La maladie VHC et ses
conséquences thérapeutiques produisent-ils
des symptômes pouvant évoquer une
dépression ?
Pour le non-spécialiste, la triade diagnos-
tique est volontiers : asthénie, insomnie,
anxiété. Pour le psychiatre, les troubles du
caractère et les signes somatiques (asthé-
nie, insomnie, anorexie, amaigrissement,
algies) sont importants, car ils sont souvent
le point d’appel, mais il est indispensable
au diagnostic de retrouver les deux signes
cardinaux de la dépression : l’inhibition
psychomotrice (ralentissement physique et
cognitif) et la tristesse de l’humeur (avec
désintérêt, insatisfaction, etc.). Or la plu-
part des symptômes somatiques décrits ci-
dessus sont présents dans l’hépatite VHC,
traitée.
L’interféron induit également des symp-
tômes somatiques. De même les échelles
surchargées de ces items somatiques et
anxieux sont peu utiles à l’aide au diagnos-
tic. Ce sont peut-être les professionnels qui
suivent déjà le patient depuis des années
qui sont les plus aptes à dépister une inhi-
bition psychomotrice et une tristesse de
l’humeur. Autrement dit, sur la symptoma-
tologie somatique, il y a peut-être des dia-
gnostics de dépression par excès. Il y a
peut-être également excès par la confusion
de la dépression avec le processus adaptatif
à la chronicité de la maladie. Il y a peut-être
encore défaut de diagnostic lorsqu’on ne va
pas à la recherche des signes cardinaux de
la dépression. Cela questionne les prescrip-
tions rapides d’antidépresseurs et donne de
l’intérêt à des études récentes concernant le
recours à des neuroleptiques à faible poso-
logie.
Le problème des contre-
indications au traitement
Il y a excès de prudence à considérer que
“chez les patients ayant une maladie psy-
chiatrique, il semble raisonnable de ne pro-
poser un traitement anti-VHC qu’à titre
exceptionnel”, citation de la conférence de
consensus de février 2002. Les usagers y
sont décrits comme de bons candidats aux
traitements (sujets jeunes, contamination
récente, génotype 3, histologie favorable)
et impossibles à traiter (alcool, co-infec-
tions VIH-VHB, lien social, troubles psy-
chiatriques).
En fait, il n’y a pas contre-indications,
mais des indications à prendre plus de
précautions. Certes, il existe des cas où
l’usager présente un style de vie gênant la
gestion du quotidien et du réel : quel jour
de la semaine, la prise des repas avec le
traitement, l’heure des rendez-vous, des
prises de sang, l’anticipation pour organiser
un transport sanitaire par exemple (tous ces
éléments pouvant être améliorés par un
accompagnement confiant). Certes, il existe
98
Le Courrier des addictions (7), n° 3, juillet-août-septembre 2005
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t

des cas où l’usager présente des consomma-
tions impliquant justement cette gestion du
quotidien : benzodiazépines, alcool, canna-
bis en usage massif, perte de contrôle de
consommation de la cocaïne ou d’injec-
tions des médicaments de substitution
détournés (tous ces éléments pouvant être
améliorés par une recherche diagnostique
de troubles psychiatriques sous-jacents).
Mais dans les autres cas, la priorité est la
préparation et l’anticipation : où en est le
patient ? Quels sont ses besoins pour être
mieux suivi au sein du réseau de soins ?
(par exemple une rencontre avec une équi-
pe psy doit être organisée à froid, bien
avant une décompensation), de quelle dis-
ponibilité l’équipe dispose pour les accom-
pagnements (il doit même être possible de
programmer l’entrée en traitement avec le
patient et l’hépatologue selon cette disponi-
bilité) ? Dans ces conditions, les usagers
doivent bénéficier du traitement sans dis-
crimination : c’est une affaire de moyen,
pas de contre-indications. Mais le suivi ne
doit pas s’arrêter avec la fin de la bithéra-
pie, car il existe des décompensations psy-
chiatriques retardées, des dépressions post-
traitement !
Les dépressions post-traitement
Elles ne sont pas rares, et se voient dans
deux cas : les échecs thérapeutiques et les
dépressions paradoxales.
Le premier cas peut être simple, il s’agit
d’échec thérapeutique, soit que le traite-
ment ait été interrompu à cause d’effets
secondaires, soit que le patient soit non-
répondeur, soit encore qu’il soit biologi-
quement guéri, mais conserve des symp-
tômes invalidants (fatigue en particulier). Il
arrive aux professionnels, devant l’extraor-
dinaire avancée de la bithérapie, d’oublier
ou de minimiser ces risques d’échec.
Encore une fois, c’est la préparation et l’ac-
compagnement qui sont les plus utiles pour
aider à s’adapter à ce qui est vécu comme
une injustice, une perte de chance de vivre
mieux.
Il arrive également que le traitement ait
totalement réussi, mais qu’il soit vécu
comme un échec par le patient. En particu-
lier quand les troubles narcissiques sous-
jacents à la problématique addictive sont
importants. Le patient attribuait son
manque d’intérêt dans la vie au VHC ;
celui-ci disparaît, et le voilà au pied du
mur, confronté, par exemple, à ses propres
difficultés à sublimer par exemple (quand
on a eu un périmètre de marche de 10 m et
qu’on retrouve 100 m, que fait-on des 90 m
gagnés ?). Dans le même contexte, il nous
est arrivé de recevoir de la part de patients
des demandes insistantes de mise sous
bithérapie, alors qu’il n’y avait aucune indi-
cation virologique, pour supprimer des
symptômes qui n’avaient rien à voir avec le
VHC !
La dépression paradoxale, elle, succède
volontiers à un surinvestissement de la
période du traitement. Le sujet a souvent
des problèmes de dépendance à l’autre, au
groupe, à un processus addictif mal résolu.
On assiste ainsi à un glissement de dépen-
dance vers le soin somatique, une centra-
tion sur le traitement, le patient se stabilise
sans véritable réaménagement psychique…
et rechute dans l’addiction ou la dépression
rapidement à la fin de la bithérapie. Et alors ?
Il reste à améliorer la conduite addictive
d’un patient guéri du VHC et que l’on pré-
viendra d’une recontamination toujours
possible. Peut s’ajouter le sentiment
d’abandon et de vide succédant à un suivi
hyper-intensif...
Surtout des indications...
à plus d’accompagnement
et de partenariat
Les anciennes générations d’usagers ont
vécu une longue histoire avec les virus qui
a modelé et obscurci leurs représentations :
le mode de contamination par le VHC doit
sans cesse leur être rappelé et expliqué. La
maladie et les traitements ont énormément
évolué en peu de temps, offrant de grands
espoirs de guérison. Mais les usagers de
drogues bénéficient encore peu de ces pro-
grès. On considère souvent que leur cas
contre-indique les traitements auxquels ils
sont mal compliants. Pour notre part, nous
postulons qu’ils sont plutôt des indications
à plus de précautions, plus de préparation,
plus de disponibilité, plus d’anticipation,
plus de partenariat. Alors, malgré les com-
plications psychiatriques diverses, les
nécessaires processus d’adaptation à la
maladie, les troubles de la personnalité
sous-jacents à accompagner, de nombreux
patients pourront avoir accès aux traite-
ments. Et guérir.
Références bibliographiques
–Conférence de consensus, Paris, 27-28
février 2002, traitement de l’hépatite C.
Réseaux hépatites, mars 2002;22:13-20.
– Castera L et al. Manifestations psychia-
triques au cours du traitement de l’hépatite
chronique C. Gastroenterol Clin Biol
2005;29:123-33.
– Christophorov B. Hépatite C et addic-
tions. L’actualité en 2002. Le Courrier des
addictions 2002;2,4:47-8.
– Fontargues T. Aide à la prise en charge
des patients atteints d’une hépatite C chro-
nique par une éducation thérapeutique.
Actes du colloque THS 6, Addictions et
pathologies somatiques, Frison Roche
août 2004:151-3.
– Gibier L. Les traitements de substitution,
comment en améliorer la pédagogie? Le
Courrier des addictions 2004;2,6:76-9.
– Ingold FR, Boughar A, Harbonnier J et
al. L’eau, la seringue et les miasmes.
Analyse des représentations de l’hépatite
C chez les usagers de drogues.
Psychotropes 2001;6,3:81-94.
– Lang JP, Royer T, Landier S. Troubles
affectifs et hépatite C. THS mars 2004:
1073-7.
– Lang JP, Michel L, Halleguen O. Troubles
affectifs au cours de l’hépatite C. Ann
Med Interne 2002;153;7(suppl):2S22-
2S30.
– Melin P, Surget B, Schoeny M. Le toxi-
comane et les hépatites. Revue documen-
taire Toxibase 1999;3,3etrimestre.
– Melin P. “Vivre avec une hépatite virale”
enquête de SOS Hépatites, Réseaux
Hépatites mars 2004:14-6.
– Remy AJ, Daurès JP, Tanguy G et al.
Mesure de la qualité de vie chez les
malades ayant une hépatite chronique
virale C: validation d’un indicateur géné-
ral et d’un indicateur spécifique. Gastro-
enterol Clin Biol 1999;23:1296-309.
99
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
M
i
s
e
s
a
u
p
o
i
n
t
Imprimé en France - EDIPS - Paris - Dépôt légal 3etrimestre 2005 - © décembre 1998 - DaTeBe édition.
Les articles publiés dans Le Courrier des addictions le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
1
/
4
100%