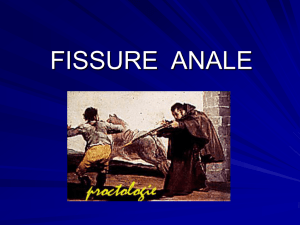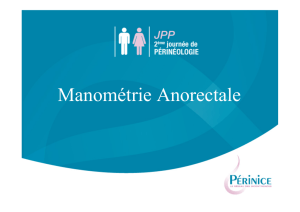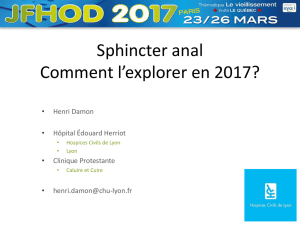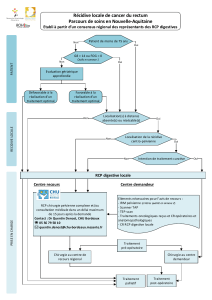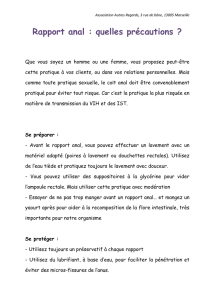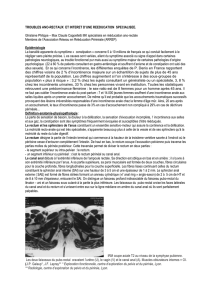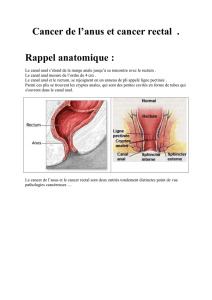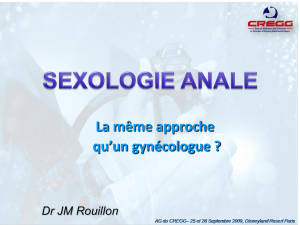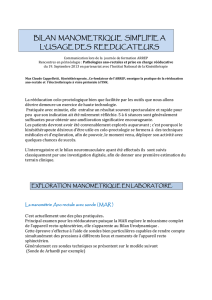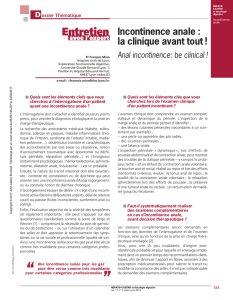Lire l'article complet

50
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 1, vol. I - mars 2001
a manométrie anorectale explore le fonc-
tionnement de l’appareil recto-sphincté-
rien. Mise au point initialement pour rechercher
l’absence de réflexe recto-anal inhibiteur chez
l’enfant témoignant d’une maladie de
Hirschsprung, elle permet également d’objecti-
ver et de quantifier les désordres survenant au
cours des incontinences et des constipations
distales.
F
ONCTION ANORECTALE
:
RAPPEL PHYSIOLOGIQUE
L’appareil anorectal est constitué d’un système
capacitif, le rectum, et d’un système résistif
représenté par les sphincters de l’anus. Les
sphincters de l’anus comportent un sphincter
anal externe, constitué de muscles striés, à
commande volontaire, et un sphincter anal
interne, constitué de muscles lisses à fonction-
nement automatique (figure 1). Le système
capacitif a la propriété de pouvoir stocker le
contenu intrarectal. La capacité de stockage du
rectum est due à sa distensibilité, la paroi se
laisse distendre par le contenu intrarectal, de
sorte que le besoin s’atténue ou disparaît très
vite après être survenu. Le système résistif s’ex-
plique par la pression exercée par les sphinc-
ters de l’anus sur le canal anal ; de ce fait, la
pression dans le canal anal est nettement supé-
rieure à la pression intrarectale, ce qui évite
l’écoulement du contenu intrarectal à travers le
canal.
Continence
L’essentiel de la continence est assuré par la
fonction de stockage colique. En dehors des
moments où le sujet ressent un besoin, le rec-
tum est normalement vide. La fonction de conti-
nence de l’appareil anorectal est donc une fonc-
tion provisoire, qui doit permettre à l’individu
de choisir le moment et le lieu pour satisfaire un
besoin provoqué par l’arrivée de matières ou de
gaz dans le rectum. Le réflexe d’échantillon-
nage joue un rôle essentiel. La paroi rectale est
distendue par l’arrivée de matières ou de gaz
perçue par le sujet grâce à la stimulation des
tensio-récepteurs de cette paroi. Simultané-
ment, la distension rectale va provoquer deux
réflexes. Le premier réflexe est le réflexe recto-
anal inhibiteur (RRAI) lié exclusivement aux
plexus nerveux intrinsèques contenus dans la
paroi rectale. Le RRAI se traduit par une relaxa-
tion du sphincter anal interne responsable
d’une diminution de pression au niveau du
canal anal, qui va donc s’ouvrir et permettre l’is-
sue du contenu intrarectal à la partie haute du
canal anal. C’est à ce niveau que le sujet va
pouvoir analyser le contenu (gaz ou matières)
de ce qui vient de provoquer le besoin “rectal”
et décider de la conduite appropriée (conti-
nence ou défécation). En même temps que le
réflexe recto-anal inhibiteur, survient un réflexe
recto-anal excitateur d’origine striée. Ce
réflexe, sous contrôle des structures supra-
médullaires, apparaît lors de l’apprentissage de
la propreté. Le réflexe recto-anal excitateur va
limiter la pénétration du contenu intrarectal à la
partie haute du canal anal, évitant la fuite de ce
contenu pendant le temps au cours duquel le
sujet analyse la situation avant de décider de la
conduite à tenir.
Ces phénomènes initiaux sont suivis d’une
adaptation du canal intrarectal à son contenu
permettant à la pression intrarectale de baisser
suffisamment pour que le besoin s’atténue ou
disparaisse. Si nécessaire, une contraction
volontaire du sphincter anal externe peut
prendre le relais du réflexe recto-anal excita-
teur.
Défécation
Pour obtenir une défécation ou l’évacuation
d’un gaz, il est nécessaire que la pression intra-
rectale soit supérieure à la pression exercée sur
le canal anal. Cette inversion des pressions est
facile à obtenir si l’on satisfait son besoin au
moment où il survient. Pour un volume de dis-
tension suffisant du rectum, le réflexe recto-
anal inhibiteur est alors maximum et perma-
nent, c’est-à-dire que la pression exercée sur le
La manométrie anorectale
■A.M. Leroi*
Exploration
* Groupe de recherche de l’appareil digestif,
environnement et nutrition (ADEN),
hôpital Charles-Nicolle, CHU Rouen,
76031 Rouen Cedex.
e-mail : [email protected]
L

51
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 1, vol. I - mars 2001
canal anal est à peu près nulle, tandis qu’il
existe une activité contractile rectale. Il suffit à
ce moment d’interrompre la contraction volon-
taire du sphincter strié et le contenu intrarectal
est évacué, éventuellement aidé par une pous-
sée abdominale. En dehors de ces conditions
physiologiquement favorables, la défécation
peut être obtenue en utilisant une poussée
abdominale très forte au cours d’une
manœuvre de Valsalva et en relâchant simulta-
nément la musculature striée du périnée pour
évacuer le contenu intrarectal.
L
A TECHNIQUE
Quel matériel utiliser ?
La manométrie anorectale est effectuée au
moyen de cathéters perfusés, de ballonnets
remplis d’eau ou de microcapteurs. Chacune
de ces méthodes, utilisée correctement,
donne des résultats significatifs et reproduc-
tibles, mais chacune présente certains incon-
vénients.
La méthode des cathéters perfusés à l’avan-
tage d’être simple, de permettre le recueil des
pressions anales au moyen de cathéters très
fins, évitant ainsi les artéfacts dus à la dilata-
tion du canal anal par une sonde volumineuse.
En revanche, la perfusion des cathéters perçue
par le patient peut provoquer des réponses
contractiles volontaires du sphincter anal
externe chez des patients qui redoutent de
salir la table d’examen. Les orifices percés laté-
ralement sur les cathéters peuvent être répar-
tis sur la circonférence de la sonde et étagés.
Ils permettent ainsi de mesurer de façon conti-
nue la pression anale en différents points. Ils
donnent simultanément des informations à dif-
férents niveaux dans le sens longitudinal et
selon différents axes dans le sens radial. La
compliance du système de mesure est un point
essentiel pour enregistrer correctement des
variations rapides de pression (1). Pour que la
compliance du système de mesure soit cor-
recte, la déformabilité des cathéters doit être
minime et la perfusion doit être assurée par un
perfuseur capillaire hydropneumatique. Il faut
rappeler qu’il existe une asymétrie radiale de la
pression intra-anale et que, de ce fait, la
mesure de la pression selon trois axes, comme
cela est préconisé en pratique, n’est pas un
reflet exact des pressions endo-anales. Les
sondes à ballonnets (figure 2, p. 51) évitent
a.
4
2
3
1
3
5
8
3
6
7
b.
Figure 1.
a: Coupe frontale du pelvis. 1. Ampoule rectale. 2. Canal anal. 3. Releveur de l’anus.
4. Sphincter externe. 5. Espace pelvi-rectal supérieur. 6. Fosse ischio-anale.
b:Coupe verticale du canal anal. 1. Sphincter interne. 2. Releveur de l’anus. 3. Sphincter
externe (faisceau profond, superficiel, sous-cutané). 4. Couche longitudinale complexe.
5. Ligament de Parks. 6. Septum intermusculaire. 7. Corrugator cuti anis. 8. Espace
intersphinctérien.
(figure réalisée par J.M. Muller).
5
1
3
6
4
2

52
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 1, vol. I - mars 2001
l’écueil de l’asymétrie radiale des pressions
endo-anales, puisque la pression mesurée
représente la somme de toutes les pressions
mesurées dans chaque orientation. Leur mise
en place est facile et reproductible (au
contraire des sondes à cathéters avec les-
quelles on ne sera pas certain que les orifices
latéraux explorent à chaque fois la même
orientation). Les ballonnets doivent être rem-
plis d’eau et il est impératif de chasser les
bulles d’air afin de ne pas entraîner un amor-
tissement du signal. Les sondes à ballonnets
sont d’un diamètre supérieur à celui des
sondes à cathéters perfusés et entraînent donc
une déformation plus importante du canal
anal. Pour cette raison, elles sont susceptibles
de provoquer une perturbation du fonctionne-
ment réflexogène du sphincter anal externe. La
taille minimale des ballonnets ne permet d’étu-
dier la pression anale qu’à deux niveaux, alors
que les cathéters perfusés autorisent des
mesures étagées tous les 0,5 cm. Enfin, les bal-
lonnets mesurant les pressions aux parties
haute et basse du canal anal sont fixes, situés
à 1,5 cm l’un de l’autre, et ne peuvent donc pas
s’adapter aux différentes longueurs du canal
anal. Les cathéters à microcapteurs offrent une
mesure de la pression radiale et ponctuelle. La
fragilité des microcapteurs et leur coût en res-
treint l’utilisation.
Au vu des avantages et des inconvénients de
chaque méthode, bien qu’une réunion d’ex-
perts ait conclu à la supériorité de la sonde à
ballonnets (8), il semble que la majorité des uti-
lisateurs préfèrent la sonde à cathéters perfu-
sés (13).
Quels paramètres étudier ?
La pression basale de fermeture anale
Elle est calculée dans les parties haute et basse
du canal anal. La mise en place de la sonde
déclenche parfois une contraction réflexe du
sphincter anal externe. Une fois la sonde mise
en place, il faut donc attendre pendant un
temps suffisant (20 à 30 minutes) durant lequel
la pression anale va progressivement diminuer,
puis se stabiliser (10 à 30 minutes) (figure 3).
La pression anale de repos est fréquemment
soumise à des fluctuations. Il peut s’agir
d’ondes lentes définies par leur amplitude et
leur fréquence (amplitude : 5 à 25 cm H2O ; fré-
quence : 6 à 20/mn), ou d’ondes ultra-lentes
beaucoup plus amples et de moindre fréquence
(amplitude: 30 à 100 cm H2O ; fréquence :
‹ 3/mn). Les ondes ultra-lentes sont souvent
associées, chez des sujets constipés, à une
hypertonie anale et constitue l’hypertonie
anale instable (figure 4). Il semblerait que ces
variations soient secondaires à des fluctuations
de l’activité du sphincter anal interne.
Les réflexes recto-sphinctériens
Ils sont étudiés à l’aide d’une sonde à 3 voies
qui permet la mesure de la pression dans le rec-
tum, dans la partie haute (sphincter anal
interne) et dans la partie basse du canal anal
(sphincter anal externe) et d’un ballonnet intra-
rectal que l’on distend brièvement avec de
faibles volumes d’air croissant progressivement
(10 à 50 ml). Chaque distension doit être espa-
cée d’au moins 2 minutes. Lors de chaque insuf-
flation, on étudie le RRAI à la partie haute du
canal anal (présence du réflexe, durée et ampli-
tude de la relaxation). Plus le volume de disten-
Exploration
Figure 2. Sonde de manométrie
anorectale de Arhan en place.
Orifice
du canal perfusé
B1
B2
B3
Ballonnet de la partie
basse du canal anal
(SE)
Ballonnet de la partie
haute du canal anal (SI)
Seringue (distension de B1)
Capteurs
Ballonnet intrarectal

53
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 1, vol. I - mars 2001
sion rectale est élevé, plus l’amplitude et la
durée de la relaxation du sphincter anal interne
sont importantes (figure 5). L’amplitude et la
durée de la contraction réflexe du sphincter anal
externe (réflexe recto-anal excitateur) sont éga-
lement corrélées au volume de distension rec-
tale (figure 5).
La contraction volontaire du sphincter anal
externe
L’amplitude et la durée de la contraction volon-
taire du sphincter anal externe sont étudiées en
demandant au sujet de serrer l’anus le plus fort
possible (figure 6, p. 54). L’amplitude de la
contraction volontaire doit être déterminée à
partir de la pression anale basale. Elle est maxi-
male en regard du sphincter anal externe, à la
partie basse du canal anal. La durée de la
contraction volontaire du sphincter anal
externe permet d’étudier la fatigabilité du
sphincter.
L’enregistrement de la pression anale durant
la manœuvre de Valsalva
Elle permet d’étudier le synchronisme abdo-
mino-pelvien. On demande au patient de pous-
ser comme pour déféquer. Normalement, lors
de la défécation, le sphincter anal et le muscle
releveur de l’anus se relâchent, phénomène qui
entraîne une diminution des pressions anales
et donc une ouverture du canal anal (figure 7,
p. 54). L’absence de relaxation anale ou une
EMG
périnéal
Prt
(zéro)
Prt
PHC
(zéro)
PHC
PBC
(zéro)
PBC 10 sec 50 cm H2O
Figure 3. Étude de la
pression anale de repos
enregistrée au moyen
d’une sonde de Arhan
chez un sujet volontaire
sain, au niveau de
l’ampoule rectale (Prt),
de la partie haute (PHC)
et de la partie basse
(PBC) du canal anal. La
voie du haut
correspond à
l’électromyogramme
périnéal intégré (EMG)
obtenu à partir
d’électrodes collées sur
la marge anale.
Figure 5. Étude des réflexes provoqués par la
distension de l’ampoule rectale. L’enregistrement des
pressions est fait au niveau du rectum (a), de la partie
haute (b) et de la partie basse (c) du canal anal. L’EMG
périnéal est un EMG intégré obtenu à partir
d’électrodes collées sur la marge anale. La distension
brève de l’ampoule rectale avec 30, 40, 50 ml d’air
provoque une contraction rectale (voie a), un
relâchement du sphincter anal interne (voie b) et une
contraction du sphincter anal externe (voie c).
L’amplitude et la durée de ces réponses sont
proportionnelles au volume de distension.
EMG périnéal
a
b
c10 sec
50 cm H2O
30 ml 40 ml 50 ml
Figure 4. Enregistrement de la pression de repos au niveau de la partie haute
du canal anal chez un patient se plaignant de difficultés d’exonération. La
pression est très élevée, atteignant 170 cm H2O, et présente des oscillations
importantes (ondes ultralentes). L’association d’une hypertonie et d’ondes
ultralentes définit une hypertonie instable.
Pression
cm H2O
10 sec
200
150

54
Correspondances en pelvi-périnéologie - n° 1, vol. I - mars 2001
Exploration
Figure 6. Étude de la contraction volontaire anale
par enregistrement des pressions au niveau de
l'ampoule rectale (Prt), de la partie haute (PHC) et
de la partie basse (PBC) du canal anal au moyen
d'une sonde de Arhan. L'électromyogramme (EMG)
périnéal est un EMG intégré obtenu à partir
d'électrodes collées sur la marge anale.
L'amplitude de la contraction volontaire
correspond au pic observé au début de la
contraction (Æ). La durée de la contraction
correspond au temps entre le début et la fin de la
contraction, marquée par le retour à la valeur de
pression de repos mesurée au niveau du canal
anal. On remarque que la pression dans l'ampoule
rectale augmente progressivement au cours de la
contraction, comme cela s’observe souvent du fait
de la fatigabilité du sphincter strié.
EMG
périnéal
Prt
(zéro)
Prt
PHC
(zéro)
PHC
PBC
(zéro)
PBC
50 cm H2O
10 sec
30 ml 40 ml 50 ml
Figure 7. Effort de poussée avec relaxation du
sphincter anal et diminution des pressions anales.
PV : effort de poussée volontaire.
PR : pression rectale.
PHC : partie haute du canal anal.
PBC : partie basse du canal anal.
EMG
périnéal
intégré
PR
PHC
PBC
zéro (PHC)
zéro (PBC)
50 cm H2O
10 sec
PV PV
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%