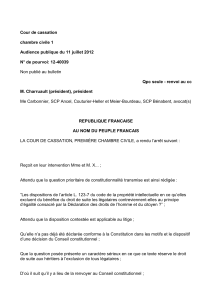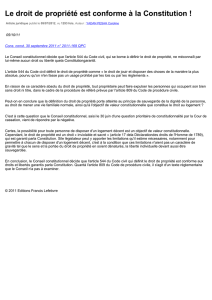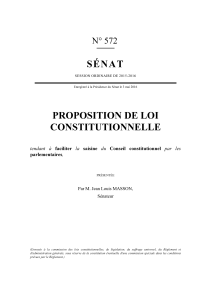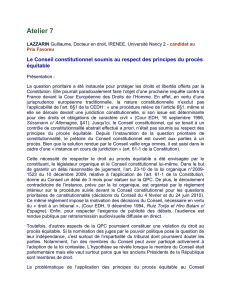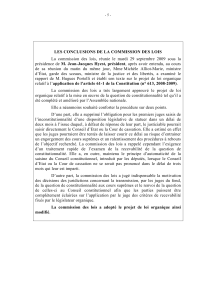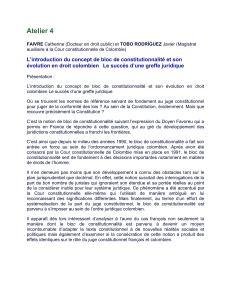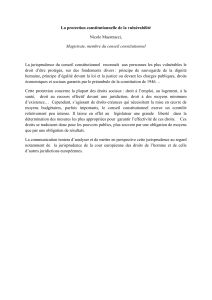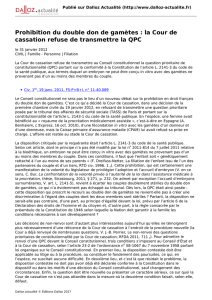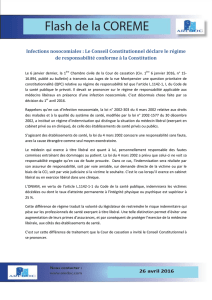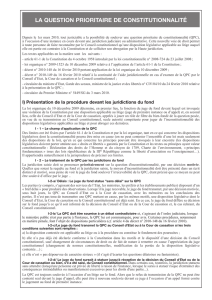Marrakech, 29-30 mars 2012 La question prioritaire de

1
Marrakech, 29-30 mars 2012
La question prioritaire de constitutionnalité,
un nouveau droit pour les justiciables
présentation par
Mme Jacqueline de Guillenchmidt
Membre du Conseil Constitutionnel de France

2
L’évolution française du contrôle de la conformité des lois à la Constitution apporte la preuve
que l’état démocratique d’un pays, si avancé soit-il, est toujours perfectible. C’est ainsi
qu’en 2008, a été votée en France une révision constitutionnelle dont l’un des objectifs était
de donner plus de droits aux citoyens. Parmi ces droits figurait en bonne place, le droit de
permettre aux parties à un procès de contester devant le Conseil Constitutionnel la loi
applicable à leur litige. Autrement dit, le droit de poser au Conseil Constitutionnel une «
question prioritaire de constitutionnalité » (QPC).
Entre la promulgation de la Constitution du 4 octobre 1958 et aujourd’hui le contrôle de
constitutionnalité de la loi s’est affirmé dans un premier temps, approfondi ensuite. Cette
Constitution de 1958 a instauré pour la première fois un tel contrôle et l’a confié à un
organisme indépendant, le Conseil Constitutionnel. Cette instauration relativement tardive a
été aussi timide : contrôle limité à la loi promulguée mais non encore entrée en vigueur,
saisine limitée au Président de la République, au premier ministre aux présidents de l’une et
l’autre des assemblées parlementaires.
Le rôle essentiel du Conseil, celui pour lequel il avait été principalement créé, se limitait à
veiller à ce que la loi n’aille pas au-delà du domaine que lui impartit l’article 34 de la
Constitution, qu’elle n’empiète pas sur le domaine de droit commun du règlement.
Dix ans après sa création, cependant, le Conseil Constitutionnel s’est émancipé de ce rôle
étriqué voulu par le constituant de 1958. Par une décision du 16 juillet 1971, il a décidé
d’inclure dans ses normes de référence le Préambule de la Constitution lequel renvoie à la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au Préambule de la Constitution
de 1946 qui énonce les droits économiques et sociaux. C’est donc à une très large panoplie
de droits que le Conseil constitutionnel confronte la loi qui lui est déférée.
A cela s’ajoute l’extension de sa saisine à 60 députés ou 60 sénateurs par la révision
constitutionnelle du 29 octobre 1974, ce qui mécaniquement a multiplié par plus de dix le
nombre annuel de lois qui lui sont déférées.
C’est dans le début des années quatre vingt dix qu’un élargissement plus significatif de
l’accès au contrôle de constitutionnalité a été sérieusement envisagé en France. Un projet
de loi constitutionnelle instituant un contrôle de constitutionnalité des lois par voie
d’exception, largement inspiré par Robert Badinter, alors président du Conseil
constitutionnel, avait été déposé sur le bureau de l’Assemblée Nationale au mois de mars
1990. Il permettait aux justiciables d’invoquer devant une juridiction l’inconstitutionnalité de la
loi applicable à leur litige. Ce projet très contesté par le Sénat, n’a pu faire l’objet d’un
accord entre les deux assemblées et après deux lectures devant chacune d’entre elles il a
été abandonné.
Quelques années plus tard, en 1993, un Comité consultatif pour la révision de la
Constitution, mis en place par le président de la République et présidé par le Doyen Georges
Vedel, ancien membre du Conseil constitutionnel, proposait à nouveau de permettre aux
justiciables de saisir le Conseil par la voie de l’exception. Un projet de loi déposé en ce sens
au Sénat le 11 mars 1993 n’a pas été repris après l’alternance politique qui a suivi.
Les deux projets, celui de 1990 et celui de 1993, avaient en commun d’instituer un filtre
obligatoire des questions de constitutionnalité, exercé par le Conseil d’État et la cour de
cassation : la révision du 23 juillet 2008 en est très directement inspirée.
Je vous propose tout d’abord de rappeler les principales caractéristiques de la procédure de
question prioritaire de constitutionnalité et de vous en présenter un premier bilan puis
d’examiner l’influence de cette réforme sur le fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

3
1- Caractéristiques de la QPC et premières statistiques
1-1 Caractéristiques
La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, suivant en cela les préconisations d’un
comité, présidé par l’ancien premier ministre Edouard Balladur et chargé de faire des
propositions en vue de la modernisation de nos institutions, consacre enfin le droit pour les
justiciables de contester, au cours d’un procès, la conformité de la loi à la Constitution.
Ce droit est néanmoins circonscrit aux « droits et libertés que la Constitution garantit » ; il
exclut par là même toute dispositions de la Constitution étrangère à ces droits ou libertés et
notamment toute question relative à la procédure selon laquelle la loi a été adoptée.
Toutefois, le Conseil a admis que la méconnaissance de l’article 34 de la Constitution qui
définit les matières réservées à la loi, pouvait fonder une QPC si sont affectés des droits ou
libertés : « la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être
invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est
affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; » (QPC 2010-5 du 18 juin 2010
Sté Kimberly Clarck).
Cette réforme a trois objectifs. Le premier, le plus important, nous l’avons déjà souligné,
était de donner de nouveaux droits aux justiciables. Le président de la commission des lois
de l’Assemblée nationale s’exprimait ainsi : « il s’agit d’abord de répondre à un besoin de
défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles. Il apparaît en effet, que la
possibilité de faire référence, pour tout justiciable, à cette norme juridique fondamentale
qu’est la Constitution doit être considérée comme une avancée de la protection juridique
dont tout citoyen profiterait, ce d’autant plus que le bloc de constitutionnalité s’enrichit
constamment grâce à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. ».
Le deuxième objectif qui découle du premier est de purger notre ordre juridique des
dispositions contraires à la Constitution qui pourraient subsister. Ces dispositions peuvent
avoir été adoptées avant 1958 c’est-à-dire avant l’institution du contrôle de la
constitutionnalité des lois ; quant aux lois votées depuis, elles n’ont pas toutes, loin s’en faut,
été déférées au Conseil constitutionnel.
Le troisième objectif était de rappeler la place de notre Constitution au sommet de l’ordre
juridique interne. C’est la signification du mot « prioritaire » : la question de constitutionnalité
doit être examinée en tout premier lieu et notamment avant la question de la conformité de la
loi aux conventions internationales.
Ainsi, un nouvel article 61-1 est introduit dans la Constitution et dispose que « lorsque à
l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil
constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de
Cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les
conditions d’application du présent article. »
Les conséquences de l’abrogation de la loi par le Conseil constitutionnel à la suite d’une
question prioritaire de constitutionnalité, sont fixées par un 2ème alinéa ajouté à l’article
62 de la Constitution qui permet au Conseil de déterminer « les conditions et limites dans
lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. ».
Cette disposition habilite le Conseil constitutionnel, comme c’est le cas pour de nombreuses
cours constitutionnelles et notamment la cour constitutionnelle allemande, à prendre en
compte les situations concrètes affectées par ses décisions et à résoudre les difficultés qui
pourraient naître de l’abrogation d’une loi en vigueur.
Une loi organique du 10 décembre 2009 est venue ensuite préciser les conditions
d’application de la réforme.

4
Le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité est simple. La question est
posée à la seule initiative d’une partie à un procès : le juge ne peut soulever d’office
l’inconstitutionnalité de la loi. Les juridictions devant lesquelles elle peut être posée sont
toutes celles relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, c’est à dire en fait
l’ensemble des juridictions de droit commun ou spécialisées. La QPC peut être posée en
première instance, en appel ou en cassation.
Devant le juge « a quo », trois conditions sont requises :
- la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure ou constituer le
fondement des poursuites
- elle ne doit pas avoir été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et
le dispositif d’une de ses décisions sauf changement de circonstances
- elle ne doit pas être dépourvue de caractère sérieux.
Lorsque ces trois conditions sont remplies, le juge sursoit à statuer, sauf si la personne est
privée de liberté, et transmet immédiatement, « sans délai » dit la loi, la question à la
juridiction suprême de son ordre, Conseil d’Etat ou Cour de Cassation, qui dispose de trois
mois pour rendre une décision de transmission ou de non transmission au Conseil
constitutionnel. Outre les deux premières conditions prévues devant le juge « a quo », la
juridiction suprême doit également vérifier que la question est nouvelle et qu’elle présente un
caractère sérieux, ce qui est plus exigeant que la formule « non dépourvu de caractère
sérieux ». Par question nouvelle il faut entendre que le Conseil Constitutionnel n’a pas
encore eu l’occasion d’interpréter la disposition constitutionnelle dont la violation est
alléguée. Si les cours suprêmes ne se sont pas prononcées dans ce délai de trois mois, la
QPC est transmise au Conseil Constitutionnel. Cela n’est encore jamais arrivé.
Le Conseil Constitutionnel a lui aussi un délai de trois mois pour se prononcer. N’étant pas
juge du fond du procès, il ne vérifie pas la condition de l’applicabilité au litige de la
disposition législative contestée, ni le caractère sérieux. Il se limite à vérifier qu’il ne s’est pas
déjà prononcé sur la constitutionnalité de la disposition législative en cause. Si c’est le cas, il
ne peut l’examiner à nouveau qu’en cas de changement de circonstance de droit ou de fait.
S’il déclare la disposition contestée non conforme à la Constitution, il l’abroge à compter de
la publication de sa décision et elle disparait de l’ordonnancement juridique.
Les délais devant les différentes juridictions ont été à ce jour tenu. Notons que le Conseil
Constitutionnel juge les QPC en deux mois en moyenne.
1-2 Premières statistiques
Pour les dix premiers mois de 2010, 64 QPC ont été jugées, et 110 en 2011. Le flux ne tarit
pas, puisqu’aujourd’hui, deux ans après la réforme, la 250ème QPC vient d’être enregistrée.
Comme il fallait s’y attendre, le droit pénal et la procédure pénale viennent en tête des
matières faisant l’objet de QPC : 36% de celles-ci. Viennent ensuite le droit fiscal et la
procédure fiscale pour 29%, le droit de propriété pour 16%. Ensuite, entre 10 et 14% des
affaires, sont concernés l’organisation judiciaire et la composition des juridictions, le droit du
travail et le droit social, le droit des collectivités territoriales, le droit commercial et le droit
des pensions.
Pour l’anecdote, la loi la plus ancienne ayant fait l’objet d’une QPC est celle du 14 juillet
1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de rétractation : son article 2 a été déclaré
non conforme à la Constitution, comme contraire au principe d’égalité entre héritiers venant
à la succession d’après la loi française (2011-159 DC du 5 août 2011). De même une

5
disposition d’origine de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a fait l’objet d’une
QPC et a elle aussi été déclarée contraire à la Constitution.
Il n’y a pas eu à ce stade de diminution des saisines à priori en application de l’article 61 de
la Constitution. Elles sont restées à leur étiage moyen et pour les dix derniers mois de
l’année 2010, quinze lois ordinaires ont été déférées au Conseil et 9 lois organiques.
Relevons que le nombre anormalement élevé de lois organiques est une conséquence de la
révision constitutionnelle de 2008 qui a renvoyé au législateur organique la mise en œuvre
de cette révision. En 2011, 14 lois ont été déférées au CC et six lois organiques et depuis le
début de l’année 2012, soit depuis deux mois et demi, cinq lois ont été déférées.
Tout au plus, peut-on observer que la loi votée le 12 mai 2011sur la garde à vue n’a pas été,
contre toute attente, déférée au Conseil dans le cadre du contrôle a priori mais qu’elle a fait
l’objet trois mois plus tard de plusieurs QPC.
On observe ainsi , un changement quantitatif dans le nombre des affaires à traiter qui se
double d’un changement plus substantiel qui affecte la nature même du Conseil et le
caractère de son contrôle.
2– Les conséquences de l’introduction de la QPC sur le fonctionnement du Conseil
Constitutionnel
La QPC a accentué la juridictionnalisation du Conseil, c’est le premier point que je vous
propose d’examiner. La QPC a atténué le caractère abstrait du contrôle constitutionnel,
même si ce caractère abstrait demeure sa caractéristique principale, c’est le deuxième point
que nous examinerons ensuite.
2-1 La juridictionnalisation du CC
A l’origine, le caractère de juridiction était très vivement dénié au Conseil Constitutionnel
comme ne correspondant pas à l’intention des « pères fondateurs » de la Veme République.
Dans une décision du 6 novembre 1962 sur la loi référendaire instituant l’élection du
président de la République au suffrage universel, le Conseil se qualifiait lui-même d’ «
organe régulateur de l’activité des pouvoirs publics ».
La nature du Conseil Constitutionnel a alimenté un certain temps des controverses
doctrinales et c’est seulement en matière de contentieux électoral que son caractère
juridictionnel ne lui était pas contesté.
Si l’on considère que l’existence d’un litige entre parties est le critère essentiel pour
caractériser une juridiction, on pouvait effectivement douter de sa nature juridictionnelle dans
le cadre du contrôle a priori de la loi.
Cependant pour de nombreux auteurs et notamment le professeur Marcel Waline, ancien
membre du Conseil Constitutionnel, une juridiction est un organe qui dit le droit au nom de
l’Etat par un acte ayant l’autorité de la chose jugée, l’existence d’un litige n’étant pas
indispensable. Et de fait lorsque le CC est saisi a priori de la conformité de la loi à la
Constitution, il ne s’agit pas d’un litige entre parties. Il n’y a pas pour les parlementaires
saisissants ou pour les autorités politiques habilitées à saisir le Conseil, d’adversaire
physiquement identifié. C’est une disposition législative qui est contestée et le doyen Vedel a
pu parler à cet égard de « recours pour excès de pouvoir législatif ».
Néanmoins, il est très vite apparu au Conseil Constitutionnel qu’il était nécessaire
d’aménager, dans le cadre du contrôle a priori, une procédure contradictoire, si succincte
soit-elle. C’est au secrétaire général du gouvernement (SGG) qu’est revenue la tâche
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%