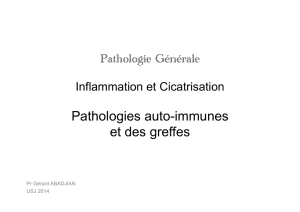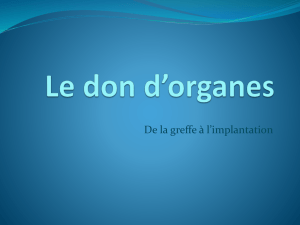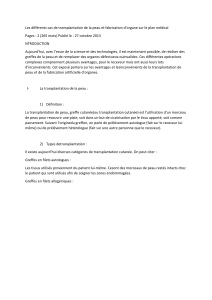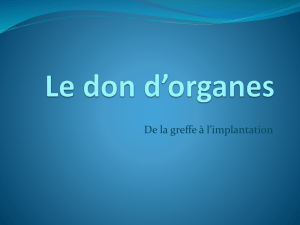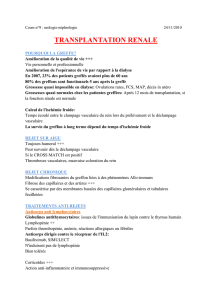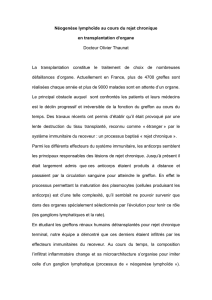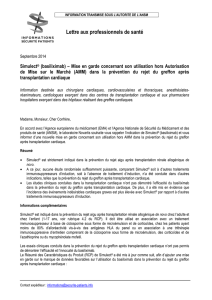Lire l'article complet

Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n
o
1 - janvier-février-mars 2005
53
Revue
de presse
Traitement d’un patient
diabétique par transplantation
de cellules souches autologues :
premier cas mondial
Histoire clinique
Après les premières expériences de
notre groupe, qui ont consisté à implan-
ter des cellules souches en situation
intracardiaque pour traiter des lésions
d’infarctus du myocarde (plus de
70 cas), nous avons décidé de commen-
cer un programme d’implantation de
cellules souches dans le pancréas, afin
de remplacer les cellules β2 pancréa-
tiques productrices d’insuline.
De nombreux travaux ont déjà démontré
que les cellules souches peuvent traiter
le diabète. Un patient de sexe masculin
de 42 ans, diabétique de type 2, a été
admis dans notre service de cardiologie
interventionnelle pour subir une implan-
tation in situ de cellules souches auto-
logues mononucléées (CD34+, CD38-)
dans le pancréas. Le patient a accepté le
traitement et a donné son consentement
éclairé. La glycémie à l’entrée était
égale à 3,5 g/dl ; le patient recevait de
l’insuline NPH et des sulfonylurées. La
moelle osseuse (500 cc) a été extraite de
la crête iliaque sous anesthésie locale.
La suspension des cellules souches a été
préparée pour obtenir un enrichissement
satisfaisant de cellules mononucléées
(13 x 10
7
). Les cellules étaient positives
pour le CD34, indiquant un potentiel
pluripotent et une capacité de différen-
ciation. La suspension enrichie en cel-
lules CD34 positives (22 x 10
6
) a été
réinjectée dans l’artère de la queue du
pancréas 3 heures après l’extraction de
moelle osseuse.
Angiographie
Une cathétérisation sélective de l’artère
splénique a été réalisée en utilisant la
technique de Judkins à partir d’une
ponction de l’artère fémorale avec un
cathéter d’angiographie Side Winder
6Fr. L’angiographie a montré les artères
pancréatiques postérieures ou caudales
et médianes ou corporéales ainsi que les
branches terminales de l’artère splé-
nique à l’intérieur de la rate (figures).
Procédure
Un cathéter avec guide métallique a été
placé dans l’artère splénique, et il a été
ensuite retiré. Sur ce guide métallique, un
cathéter Judkins RC6Fr a été inséré dans
la portion distale de l’artère splénique
avant l’origine de l’artère de la queue du
pancréas. Deux guides métalliques de
0,014 pouce (0,035 cm) ont été placés
dans les branches terminales de l’artère
splénique. Deux ballons de cathéters
d’angioplastie (4 mm x 20 mm et 3,5 mm
x20mm) ont été glissés par l’intermé-
diaire de chaque guide et placés au début
de la bifurcation de l’artère splénique
après le début de l’artère de la queue du
pancréas. Les deux ballons ont été gonflés
avec une pression basse pour occlure le
flux distal de l’artère splénique et dériver
le débit sanguin à l’intérieur de l’artère
pancréatique de la queue du pancréas. La
suspension enrichie en cellules CD34
positives (22 x 10
6
) a été réinjectée dans la
portion finale de l’artère splénique par
l’intermédiaire de ce cathéter, qui a été
maintenu en occlusion grâce aux ballons
durant la perfusion, afin de dériver ces cel-
lules à l’intérieur du pancréas. Après avoir
injecté la solution de cellules souches, il a
été injecté 50 ml de solution saline pour
améliorer le flux à l’intérieur du pancréas.
Les ballons ont été dégonflés et retirés.
Un nouveau contrôle angiographique a
été réalisé montrant l’absence d’occlu-
sion ou d’embolie des artères spléniques
terminales, ainsi qu’un bon flux à l’inté-
rieur des artères de la queue du pancréas.
Le cathéter a été retiré au bout de deux
heures, et le patient est sorti de l’hôpital
après 24 heures sans complication.
Évolution
Durant la première semaine après l’im-
plantation, la glycémie a diminué jus-
qu’à 2,5 g/dl. La glycosurie s’est égale-
ment améliorée. Après la deuxième
semaine, la glycémie est passée à
1,5 g/dl, avec une dose minime de sulfo-
nylurées. L’amylase n’a pas augmenté,
ce qui plaide en faveur de l’absence de
pancréatite.
Commentaires
La technique endovasculaire pour
implanter des cellules souches de façon
sélective dans la queue du pancréas afin
d’éviter les complications d’une
implantation massive de cellules
souches est une façon sûre et une procé-
dure facile non seulement d’implanter
des cellules souches adultes, mais éga-
lement de perfuser des traitements (fac-
teurs de croissance) à l’intérieur du pan-
créas et d’améliorer la régénération des
cellules β2 des patients diabétiques.
Traduction E. Thervet
Fernandez Vina R, Andrin O, Sosa N et al. First
world report of feasibility of implant autologous
stem cells with endovascular technique in a dia-
betes mellitus patient. Inédit.
E-mail : [email protected]

Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n
o
1 - janvier-février-mars 2005
Revue
de presse
Recurrence risk after
organ transplantation
in patients with a history
of Hodgkin’s disease
or non Hodgkin’s lymphoma
D
e plus en plus, des patients ayant eu
un lymphome sont considérés
comme guéris, mais nous sont présentés
ultérieurement comme candidats à une
transplantation en raison de la survenue
de la défaillance d’un organe, défaillance
secondaire aux thérapeutiques utilisées
dans le traitement de leur hémopathie.
L’exemple le plus fréquent est l’appari-
tion chez des sujets jeunes d’une
défaillance cardiaque par toxicité des
anthracyclines.
À partir du registre IPITTR (Israel Penn
International Transplant Tumor Registry)
sont recensés, aux États-Unis, entre
1968 et 2002, les cas de transplantation
de patients ayant eu antérieurement un
lymphome hodgkinien ou non hodgki-
nien.
Quatre-vingt-onze patients ont ainsi eu
une transplantation, dont 81 permettent
d’avoir des données exploitables, avec
une durée médiane de suivi post-trans-
plantation de 25,7 mois (0,4-131,1).
Quarante-quatre transplantations car-
diaques, 2 transplantations pulmonaires,
14 transplantations hépatiques et
31 transplantations rénales ont ainsi
été pratiquées dans cette population
particulière.
La survie globale de ces patients est de
96 %, 94 % et 78 % à 1, 3 et 5 ans post-
transplantation.
Sur les 81 patients, 8 ont eu une réci-
dive de leur lymphome, soit environ
10 % des patients, chiffre déjà signalé
dans des publications antérieures. Ce
chiffre de récidive de 10 % concerne
aussi bien les patients ayant eu un lym-
phome hodgkinien (3 récidives pour
34 patients) que ceux ayant eu un lym-
phome non hodgkinien (5 récidives sur
47 patients). Ces récidives sont appa-
rues après 4 transplantations car-
diaques, 3 transplantations rénales et
une transplantation hépatique. Bien
qu’il n’y ait pas de significativité sta-
tistique (peu de patients), un délai de
moins de 2 ans de rémission semble
être un facteur de risque de récidive, et
les auteurs conseillent de maintenir
une durée de 5 ans avant de proposer
une transplantation. Les patients qui
n’ont pas eu de récidive avaient une
période médiane de rémission avant
greffe plus longue (115 mois) que ceux
ayant récidivé (30,2 mois) (p = 0,24).
Ce délai de 5 ans n’est cependant en
rien une garantie contre la récidive, et,
notamment, un lymphome a récidivé
malgré 215,5 mois de rémission. La
plupart des récidives surviennent dans
les 2 ans qui suivent la transplantation
(durée médiane : 18,7 mois), avec un
extrême allant jusqu’à 82,2 mois. La
survie des patients dont l’hémopathie
récidive est faible, puisqu’un patient
sur 3 est décédé pour les lymphomes
hodgkiniens et un patient sur 5 pour les
lymphomes non hodgkiniens, avec une
durée médiane de survie après récidive
de 6,8 mois (0-22,1 mois). Il n’y a
pas d’informations concernant les
thérapeutiques employées pour traiter
ces récidives. Comme les auteurs le
déplorent eux-mêmes, il n’existe
pas de données anatomopathologiques
permettant de tirer des conclusions
pronostiques. Les types de traitement
immunosuppresseur et le type de
transplantation ne sont pas cités
comme facteurs de risque de récidive.
Il faut signaler que, malgré ces antécé-
dents, 32 % et 25 % des 91 patients
initiaux ont reçu respectivement un
traitement par OKT3 ou RATG pour
induction ou traitement de rejet aigu
(un seul patient ayant récidivé avait
reçu de l’OKT3).
En conclusion, la transplantation
est possible même en cas d’antécédent
de lymphome, mais à la condition
de prévenir les patients du risque de
récidive. La mortalité est importante,
mais les données recueillies sont
antérieures aux nouveaux protocoles
thérapeutiques dont nous disposons
actuellement.
P. Chevalier, Paris
Trofe J, Buell J,Woodle ES et al. Transplantation
2004;78,7:972-7.
Utilisation des cellules
dendritiques
pour contrôler
la réponse allogénique
indirecte et induire la tolérance
L
e rejet chronique est la première
cause de perte de greffon, et on ne
dispose à l’heure actuelle d’aucun trai-
tement satisfaisant.
Depuis les expériences de “parking
d’allogreffes rénales” publiées au
début des années 1980 par Lechler et al
(1), il est admis que la voie directe de
présentation des alloantigènes est la
principale responsable du rejet aigu,
tandis que le mode de présentation
indirecte de ces mêmes alloantigènes
conduit au rejet chronique. Plus récem-
ment, des travaux ont montré que
les cellules T capables de transférer
la tolérance au greffon à un receveur
naïf étaient spécifiques des allo-
antigènes présentés sur le mode indirect
(2).
Ces deux observations, qui soulignent
la nécessité de développer des proto-
coles visant à contrôler la présentation
indirecte des alloantigènes, permettent
de mieux apprécier l’intérêt du travail
publié il y a quelques mois par l’équipe
de Mirenda (3).
54

Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n
o
1 - janvier-février-mars 2005
55
Revue
de presse
L’originalité du travail repose sur l’utili-
sation de cellules dendritiques toléro-
gènes coexprimant les déterminants
allogéniques du donneur avec ceux du
receveur.
Le modèle utilisé était celui de la greffe
rénale entre deux souches histo-incom-
patibles de rat [AUG (RT-1A
u
) *LEW
(RT-1A
l
)]. Le protocole reposait sur
l’administration de cellules dendritiques
(CD) dérivant de la moelle osseuse
d’animaux F1 AUGxLEW. Le choix de
ces cellules était guidé par le fait
qu’elles coexpriment les déterminants
allogéniques des deux souches, et donc
présentent spontanément les peptides
dérivant du CMH du donneur (AUG)
dans un contexte restreint par les CMH
du receveur (LEW). Ces CD étaient cul-
tivées en présence de dexaméthasone,
afin de leur conférer un phénotype tolé-
rogène (cellules différenciées, mais
immatures), et injectées par voie intra-
péritonéale à un receveur LEW, 10 jours
avant une transplantation rénale ortho-
topique avec un greffon AUG. Les rece-
veurs étaient traités pendant les 10 pre-
miers jours par de la ciclosporine, afin
de contrôler la phase initiale de recon-
naissance directe, puis étaient laissés
sans traitement immunosuppresseur.
Les auteurs rapportent l’obtention d’une
survie indéfinie de greffons rénaux, à
condition toutefois d’administrer une
injection unique d’anti-CTLA4 24 heures
après l’injection des CD (9 jours avant la
greffe). Cette dernière avait pour objectif
d’empêcher l’uptake des CD injectées et
leur présentation immunogénique par les
CD du receveur. Le même protocole uti-
lisant les cellules dendritiques AUG ne
montrait aucun bénéfice.
Une série d’expériences in vitro a permis
aux auteurs de démontrer que ce proto-
cole induit une “tolérisation” de la voie
indirecte de présentation des alloanti-
gènes AUG. Cette tolérance repose sur
l’induction d’une population CD25+
régulatrice, activée par la présentation
indirecte des alloantigènes AUG par les
CD F1 tolérogènes. Non seulement les
cellules T régulatrices sont capables de
contrôler la reconnaissance indirecte des
alloantigènes AUG, mais elles ont aussi
une certaine efficacité sur la voie de
reconnaissance directe.
Pour conclure, il faut souligner le carac-
tère potentiellement intéressant chez
l’homme de ce protocole original dans
le cadre des greffes avec donneurs
vivants. O. Thaunat, Paris
1. Lechler RI et al. Restoration of immunogeni-
city to passenger cell-depleted kidney allografts by
the addition of donor strain dendritic cells. J Exp
Med 1982;115:31-41.
2.Yamada A et al. Recipient MHC class II expres-
sion is required to achieve long-term survival
of murine cardiac allografts after costimulatory
blockade. J Immunol 2001;167:5522-6.
3. Mirenda V et al. Modified dendritic cells co-
expressing self and allogeneic major histocompa-
tibility complex molecules: an efficient way to
induce indirect pathway regulation. J Am Soc
Nephrol 2004;15:987-97.
CXCR3, CCR5, IP10,
RANTES et I-TAC :
chimiokines et récepteurs
qui interviennent au cours
du rejet
L
es chimiokines sont une famille de
petites molécules exerçant un effet
chimioattracteur sur les leucocytes,
grâce à des récepteurs exprimés sur la
membrane leucocytaire. Dans les
modèles animaux, la neutralisation de
CXCR3 ou CCR5 ou l’invalidation des
gènes qui les codent inhibent profondé-
ment le rejet. Leur rôle chez l’homme
est moins bien établi. Les auteurs ont
analysé l’expression de CXCR3 et de
ses ligands IP10 (interferon gamma-
inducible protein), Mig (monokine-
induced γ-interferon) et I-TAC (interfe-
ron-inducible T cell-αchemoattractant)
et de CCR5 et de ses ligands, RANTES
(regulated on activation of normal T cell
expressed and secreted, CCL5), MIP-1β
(macrophage inflammatory protein 1α),
MIP-1β,ainsi que celle de MCP-1
(monocyte chemoattractant protein-1,
ligand de CCR2), sur des biopsies
rénales, réalisées entre J3 et J9. Treize
patients étudiés ont présenté un rejet, et
13 autres n’ont pas présenté de rejet au
moment de l’analyse. Aucun cas de rejet
vasculaire n’a été inclus dans cette
étude.
La présence de cellules exprimant forte-
ment CXCR3 et CCR5 a été constatée
dans la région tubulo-interstitielle des
patients avec rejet (CXCR3 : 140
±32/30 champs à fort grossissement,
CCR5 : 161 ± 33) par rapport aux
patients sans rejet (22 ± 5 et 36 ± 11,
respectivement, p = 0,002 et p = 0,007).
Il n’y avait pas de marquage dans les
glomérules. La majorité des cellules
CXCR3+ étaient CD3/CD4+, quelques-
unes étaient CD3/CD8+. Les cellules
CCR5+ étaient également CD3/CD4+.
Quelques-unes étaient CD68+. En PCR
temps réel, l’expression d’IP10
(5,2 fois ; p < 0,05) et d’I-TAC (7,2 fois ;
p<0,05) était augmentée en cas de
rejet. Mig était augmentée de façon non
significative (7,5 fois ; p = 0,07).
RANTES (5,7 fois ; p < 0,05) était aug-
mentée de façon significative. MIP-1α,
MIP-1βet MCP-1 n’étaient pas expri-
mées de façon significative, même en
cas de rejet. L’expression des récepteurs
CXCR3 (2,6 fois ; p = 0,06) et CCR5
(2,9 fois ; p < 0,015) était modérément
augmentée en cas de rejet, correspon-
dant probablement au recrutement de
cellules inflammatoires CXCR3 et
CCR5+ dans le greffon. L’expression
d’IP10 en hybridation in situ était forte
dans la région tubulo-interstitielle au
cours des rejets (et peu ou pas en l’ab-
sence de rejet). Cette expression était
liée à la présence de leucocytes infil-

Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n
o
1 - janvier-février-mars 2005
56
Revue
de presse
trants, mais des cellules tubulaires
proches de ces cellules inflammatoires
étaient également marquées, ainsi que
des cellules de la capsule de Bowman.
En ce qui concerne I-TAC, un signal
fort était détecté dans les cellules inter-
stitielles, dans l’ensemble du greffon en
cas de rejet. En revanche, les cellules
mononucléées de l’infiltrat inflamma-
toire n’étaient pas marquées, pas plus
que les cellules tubulaires ni celles de la
capsule de Bowman. La majorité des
cellules marquées étaient des cellules
endothéliales des capillaires péritubu-
laires. I-TAC n’était pas exprimé en
l’absence de rejet. Enfin, l’excrétion
urinaire d’IP-10 était augmentée en cas
de rejet (250 ± 82 ng/24 h versus 36
±16 en l’absence de rejet ; p < 0,002).
Il n’existait pas de différence d’excré-
tion urinaire en ce qui concerne Mig et
RANTES. I-TAC n’était pas détectable
dans les urines.
Il est couramment admis que les cel-
lules T de type TH-1, qui expriment
préférentiellement CXCR3 et CCR5,
jouent un rôle essentiel dans le rejet
d’allogreffe. Ces données sont renfor-
cées par les études expérimentales mon-
trant que l’invalidation de CXCR3 chez
le receveur ou d’IP-10 chez le donneur
réduit l’intensité du rejet d’allogreffe.
Ce travail montre que l’expression d’IP-
10, de RANTES et d’I-TAC est aug-
mentée chez les greffés rénaux présen-
tant un rejet aigu. De plus, il existe un
recrutement local de cellules CXCR3
positives et CCR5 positives au cours du
rejet d’allogreffe. L’augmentation d’ex-
pression d’IP-10 semble être liée à la
présence de leucocytes infiltrant le gref-
fon, mais IP-10 est également exprimée
au niveau des cellules tubulaires du
greffon. I-TAC semble être exprimée
essentiellement au niveau des cellules
tubulo-interstitielles, probablement des
cellules endothéliales des capillaires
péritubulaires. IP-10, exprimée préco-
cement au cours du rejet, pourrait attirer
des lymphocytes T et NK CXCR3-posi-
tifs au niveau du greffon. La production
locale d’interféron pourrait augmenter
l’expression locale des chimiokines et
renforcer l’attraction des lymphocytes
inflammatoires. L’augmentation d’ex-
pression d’IP-10 dans les urines confir-
me que les cellules tubulaires elles-
mêmes sont l’une des sources prédomi-
nantes de cette chimiokine. CXCR3 et
CCR5 sont des cibles potentielles pour
le développement de futurs immuno-
suppresseurs, au moins en transplanta-
tion rénale.
Y. Calmus, Paris
Panzer U et al. CXCR3 and CCR5 positive T-cell
recruitment in acute human renal allograft rejec-
tion. Transplantation 2004;78:1341-50.
Chimioembolisation
prégreffe
et chimiothérapie adjuvante
postgreffe sont-elles bénéfiques
en cas de greffe pour CHC ?
L
a cirrhose posthépatitique C est la
première indication de transplanta-
tion hépatique (TH) aux États-Unis, et la
seconde indication en France. Compte
tenu de l’épidémiologie de cette mala-
die, les TH pour maladie virale C
devraient augmenter jusque dans les
années 2015 à 2020. Le développement
d’un carcinome hépatocellulaire (CHC)
est fréquent sur les foies de cirrhose
posthépatitique C. En cas de CHC sur
cirrhose posthépatitique C, la TH peut
rester une bonne indication, mais au
prix d’une survie réduite et d’un risque
de récidive. L’équipe de Los Angeles a
revu ses résultats concernant la TH pour
CHC associé à la maladie virale C de
façon à en tirer les facteurs prédictifs de
survie et de récidive.
Entre 1990 et 1999, 463 patients adultes
ont bénéficié d’une TH pour cirrhose
posthépatitique C. Soixante-dix d’entre
eux (15,2 %) avaient un CHC concomi-
tant. Trois patients ont été exclus. Dans
cette série, 15 patients ont bénéficié
d’une chimioembolisation prégreffe, et
13 d’une chimiothérapie adjuvante
postopératoire. La chimiothérapie avait
été décidée devant la constatation d’un
stade tumoral plus important que prévu
ou d’un envahissement vasculaire sur la
pièce d’exérèse. Il est intéressant de
noter que le stade tumoral était très
sous-évalué lors de l’évaluation pré-
greffe : le CHC était inconnu chez
26 patients (il s’est avéré de stade
pTNMI chez 11 patients, II chez
9patients, III chez 2 patients et IVA
chez 4 patients). Chez 5 patients éva-
lués comme étant de stade I, le stade
s’est avéré II chez un patient, III chez
un patient et IVA chez un patient au
moment de la transplantation, et chez
31 patients évalués comme étant des
stades II, 10 se sont avérés être des
stades III et 7 des stades IVA.
La survie globale des 67 patients a été de
75 %, 71 % et 55 % respectivement à un,
3 et 5 ans, contre 84 %, 76 % et 74 %
chez les patients transplantés pour cir-
rhose posthépatique C sans CHC
(p = 0,001). La survie était meilleure
chez les patients de stade I que chez ceux
de stade II, III ou IV (p = 0,007,
p=0,019 et p = 0,034 respectivement),
mais il n’existait pas de différence signi-
ficative entre les stades II, III et IV.
Vingt-quatre des 67 patients (36 %) sont
décédés : 8 d’une récidive tumorale, 3
d’une récidive virale C et 13 d’une cause
non liée au virus C ou au CHC. Onze
patients (16,4 %) ont développé une réci-
dive tumorale, dans le greffon dans 5 cas
et dans le poumon dans 5 cas. La récidi-
ve a eu lieu au cours de la première
année postgreffe dans 81 % des cas, dans
les 3 ans dans 9 % des cas ; la médiane
de survenue de la récidive était de
10,5 mois. En analyse multivariée, la
survie des patients était meilleure en cas

Le Courrier de la Transplantation - Volume V - n
o
1 - janvier-février-mars 2005
57
Revue
de presse
de stade pTNMI, de chimioembolisation
prégreffe (risk ratio =0,231) ou de
chimiothérapie adjuvante (RR = 0,42).
En ce qui concerne la récidive tumorale,
un stade tumoral plus avancé (p = 0,017),
la présence d’un envahissement vasculai-
re (p = 0,0001) ou le fait d’avoir dia-
gnostiqué le CHC avant la greffe
(par rapport aux CHC “incidentaux” ;
p=0,039) étaient les variables significa-
tivement associées. Dans ce travail, la
taille de la tumeur (> 3 cm : p = 0,063),
la multilocalité (p = 0,069) et la faible
différenciation (p = 0,067) étaient de
signification marginale. Quatorze
patients ont survécu plus de 5 ans. Parmi
eux, 5 avaient un stade tumoral avancé
(III ou IVA) : 4 de ces 5 patients avaient
reçu une chimiothérapie adjuvante et
n’avaient pas d’envahissement veineux
au moment de l’exérèse.
Les taux de survie observés dans ce tra-
vail sont tout à fait comparables à ceux
de la littérature : environ 70 %, 60 % et
50 % à un, 3 et 5 ans dans la majorité
des grandes séries. L’incidence du stade
tumoral sur la survie a été retrouvée,
comme dans la plupart des travaux ; en
revanche, la taille de la tumeur, l’enva-
hissement vasculaire, la différenciation
et le nombre de tumeurs ne ressortaient
pas comme prédictifs de la survie de
façon indépendante au stade TNM. De
façon intéressante, la chimiothérapie
adjuvante et la chimioembolisation
étaient des éléments bénéfiques, indé-
pendamment associés au stade TNM.
L’équipe de Los Angeles est l’une des
premières à avoir préconisé la chimio-
thérapie adjuvante, traitement qui, à ce
jour, semble intéressant pour la majorité
des équipes, sans qu’il existe de travail
rétrospectif randomisé sur ce sujet. Le
taux de récidive dans cette étude (16 %)
était comparable à celui de la majorité
des travaux antérieurs. L’envahissement
vasculaire et la chimiothérapie étaient,
là encore, des éléments prédictifs
importants. Les messages importants de
ce travail sont les suivants : le staging
tumoral est souvent pris en défaut au
moment de la greffe ; la technique
d’imagerie, incluant l’IRM, et une répé-
tition du staging dans la période d’at-
tente sont essentielles. En cas d’élé-
ments prédictifs péjoratifs (stade TNM
plus important que prévu ou envahisse-
ment vasculaire) au moment de la TH,
une chimiothérapie adjuvante est proba-
blement utile, et mérite d’être évaluée
de façon prospective.
Y. Calmus, Paris
Shimoda M et al. Predictors of survival after liver
transplantation for hepatocellular carcinoma
associated with hepatitis C. Liver Transplant
2004;10:1478-86.
Le foie
est-il un organe
lymphoïde primaire ?
L
a réponse immunitaire antivirale C
peut prendre des aspects très diffé-
rents, allant d’une réponse intense et
multispécifique, permettant l’éradica-
tion virale (c’est le cas chez environ
15 % des sujets immunocompétents), à
une réponse apparemment inadaptée,
responsable d’une hépatite chronique
pouvant évoluer vers la cirrhose. La
réponse T cellulaire de type CD8+
semble jouer un rôle majeur dans l’éra-
dication du virus. Les lymphocytes T
CD8+ sont capables de détruire les
hépatocytes infectés par le virus de l’hé-
patite C (VHC) dans le contexte des
molécules du complexe majeur d’histo-
compatibilité (CMH) de type I. Après
translantation hépatique (TH), l’infection
du greffon par le VHC est constante.
Dans la majorité des cas, les lésions
hépatiques sont accélérées par rapport à
la situation observée chez les sujets
immunocompétents, mais un pourcentage
non négligeable de patients présentent
des lésions minimes. Le traitement anti-
viral peut permettre l’éradication du
virus, même chez les sujets transplantés.
Une des inconnues est le rôle de l’appa-
riement HLA entre donneur et receveur :
après TH, les lymphocytes du receveur
persistent, et sont capables d’induire
l’apoptose des hépatocytes du greffon, à
condition qu’il existe un appariement
des molécules HLA de classe 1. En cas
de mésappariement total, ces lympho-
cytes sont en principe incapables d’in-
duire des lésions au niveau du greffon.
Cependant, le rôle de l’appariement
HLA reste obscur : l’absence d’apparie-
ment ne semble pas être un facteur asso-
cié à une gravité réduite des lésions de
récidive virale C. Par ailleurs, les lym-
phocytes sont souvent transmis au
niveau du greffon lui-même, et l’expan-
sion de lymphocytes provenant du don-
neur pourrait également être capable
d’induire des lésions au niveau du gref-
fon lui-même. Le but des auteurs a été
de déterminer s’il existait des lympho-
cytes du donneur ou du receveur
capables d’induire des lésions hépa-
tiques au niveau du greffon après TH.
Les cinq patients étudiés dans ce travail
étaient infectés par un VHC de géno-
type 1. Deux d’entre eux ont été traités
après la greffe. Les cellules mononu-
cléées du sang périphérique ont été ana-
lysées. Dans les cinq cas, le donneur
était HLA-A2 positif et le receveur
HLA-A2 négatif. La technique des
tétramères a été étudiée pour évaluer la
présence de lymphocytes CD8, VHC-
spécifiques : des tétramères de molécule
HLA-A2, marquées par un fluorochro-
me et associées à des peptides immuno-
dominants du VHC, provenant des dif-
férentes régions (core, NS3, NS5),
étaient utilisées pour détecter des lym-
phocytes T CD8+ spécifiques du VHC.
Les auteurs ont ensuite généré des cel-
lules positives par clonage utilisant la
dilution limite. Ces cellules étaient
CD45 RO+, RA-, et exprimaient forte-
ment les marqueurs d’activation CD38
et CD69. Par ailleurs, elles ne portaient
 6
6
1
/
6
100%